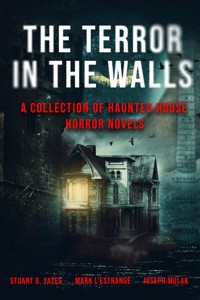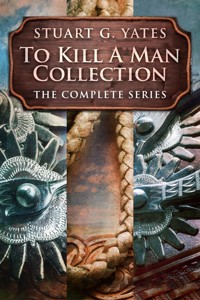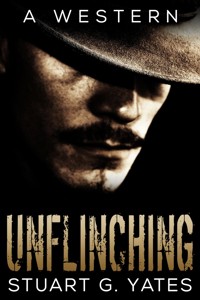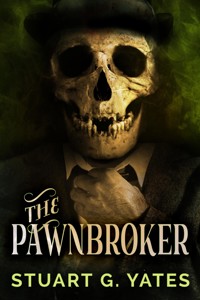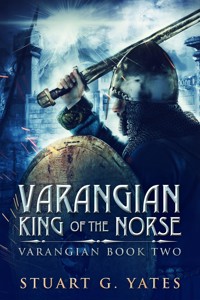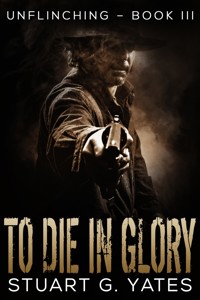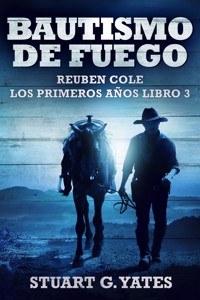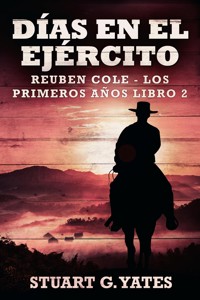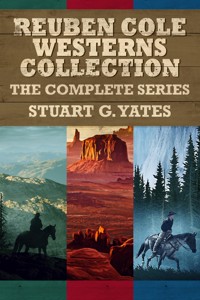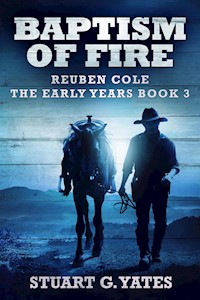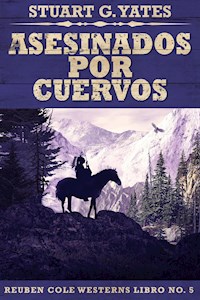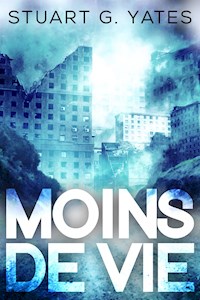
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter Circle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Que ferons-nous quand notre planète en aura assez ?
Le monde se meurt. Face à la pollution galopante, à la surpopulation et à l'élévation du niveau de la mer, l'élite dirigeante élabore un plan audacieux, mais terrible. Lorsque le cerveau de ce plan fait marche arrière et cache au monde entier ce plan ingénieux, sa vie est soudainement menacée par un facteur des plus inattendus.
L'inspecteur Bremen est fatigué. Il a tout vu et il en a assez de la vie, la sienne et celle du monde. La seule bonne chose est son fils, Petie. Peut-être, si le monde était sécurisé, Petie aurait-il un avenir. Mais lorsque Bremen est engagé pour enquêter sur un meurtre brutal, les choses commencent à s'effilocher rapidement. Lancé dans un monde fou et tordu de corruption, de mensonges et de meurtres, Bremen découvre plus que ce qui est bon pour lui.
Moins de Vie est un thriller qui se déroule dans un avenir pas si lointain.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
MOINS DE VIE
STUART G. YATES
TRADUCTION PARHANÈNE BAATOUT
© Stuart G. Yates, 2015
Conception de la mise en page © Next Chapter, 2021
Publié en 2021 par Next Chapter
Couverture illustrée par http://www.thecovercollection.com/
Ceci est une œuvre de fiction. Les noms, personnages, lieux et situations décrits dans ce livre sont purement imaginaires : toute ressemblance avec des personnages ou des événements existant ou ayant existé n’est que pure coïncidence.
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement, ou par tout système de stockage et de récupération d’informations, sans la permission de l’auteur.
TABLE DES MATIÈRES
Une chambre avec vue
Quelques années plus tôt
Une découverte malencontreuse
Le cambriolage
Funérailles
Des mots dans la nuit
De Petites Révélations
Scène de crime
Pensées dans la nuit
Des Pulsars dans la nuit
Emploi douteux
La vérité fait mal
Nouvelle coéquipière, nouveaux développements
Retour au manoir
Réunions du gouvernement
Un discours curieux
Interrogations et accusations
Dans la gueule du loup
Domaine de Fuscha
Serrer la vis
Révélations à minuit
Journée sans pitié
Moulins à café
Notes dans un livre
La quadrature du cercle
L'hôtel Excelsior
Vu mais pas entendu
Vol dans la nuit
Un pas dans l'abîme
Négociations et transactions
Une curieuse rencontre
Etat de confusion
Le brouillard se dissipe
Un entrepôt quelque part
Un meurtre... ou deux
Exécutions
Cinq ans plus tard
Le calme après la tempête
Cher lecteur
Pour David, qui fait aussi des cauchemars sur notre planète.
UNE CHAMBRE AVEC VUE
Wilson Frement se leva. Il frissonna lorsqu'il regarda par la fenêtre la rue en contrebas. Une journée fraîche et glaciale derrière le triple vitrage, nette et claire, les feuilles des arbres cernées de blanc. Ni la pluie pour perturber ce silence parfait. Ni les gens. Jamais personne, plus jamais.
Une chambre froide et clinique, aux murs blancs et aux souvenirs douloureux de ceux qui avaient souffert dans les limites de sa lumière crue.
Désinfectée. Propre et éclatante. Aucun bruit susceptible de déranger Wilson.
Sauf les cris dans sa tête.
Les cris des torturés et des mourants. Et leurs visages, tordus, agonisants, les mains tendues, implorant la pitié.
Aucun d’eux ne parvint.
De telles images défilaient derrière ses yeux pendant le sommeil et au moment du réveil. Des mannequins grotesques, luttant pour se libérer de bras forts les traînant à l'intérieur, les plaquant contre le mur, les mettant à nu. Là, ils se tortillaient jusqu'à ce que des hommes grossiers attachèrent des électrodes à leurs testicules et mettèrent le courant.
Mon Dieu, ces cris !
Souvent, il se surprit, comme s'il se réveillait d'un rêve, à se demander si tout cela n'était pas une erreur. Il n'y avait pas si longtemps, les gens allaient et venaient dans cette rue. Les chiens tiraient sur leur laisse, les enfants riaient. Ils n'étaient pas tous méchants, ces gens. Certains d'entre eux étaient bons, décents et attentionnés, profitant de leurs journées, de leurs espoirs et de leurs rêves illuminant leurs yeux, planifiant un avenir plein de promesses. La ville regorgeait de citoyens, de couples aimants, les bras entrelacés, les têtes serrées l'une contre l'autre, perdus dans un monde d'amour. De jeunes familles sautaient, souriaient. De temps en temps, une personne passait, le visage terni par la misère et la douleur, mais cela justifiait-il sa mort ? Même les criminels, leurs crimes étaient-ils si odieux ? De plus, comment distinguer le mal du bien, simplement en les surveillant. Impossible. Seules les actions révélaient le secret du cœur et les actions des citoyens ordinaires ne créaient pas les problèmes.
"Nous devons les massacrer", se souvint-il lui avoir dit le président chinois à l'autre bout de la table du conseil, tandis que les dignitaires d'une douzaine d'autres pays fixaient le regard en silence, aucun d'entre eux n'osant penser l'impensable.
Sauf Wilson Frement.
Il savait que les gens ordinaires n'étaient pas la cause. C'était du ressort du monde des affaires, du désir de toujours plus de richesses, quelles qu'en soient les conséquences. Les gisements de pétrole s'asséchaient, la fracturation hydraulique des roches provoquait des tremblements de terre, le niveau de carbone augmentait. Même si leur monde se mourrait autour d'eux, peu de citoyens se détournaient de la vie décente et saine. La plupart vécurent leur vie du mieux qu'ils purent, comme des rats en cage, mais honnêtement et dans le respect de la loi. Tout le monde n'était pas mauvais. Néanmoins, Wilson avait regardé droit dans les yeux du président chinois et avait hoché la tête. L'ordre de les tuer. De tous les tuer.
Lorsque la porte s'ouvrit, il se retira de sa rêverie et se retourna. Son fils franchit le seuil. Wilson fronça les sourcils.
"Je pensais t'avoir demandé de ne jamais venir ici à l'improviste."
Sebastian demeura immobile. Pendant un instant, la froideur de la pièce surpassa le grand froid ressenti de l'autre côté de la fenêtre. Les yeux du jeune homme oscillèrent d'un côté à l'autre, serrant les poings, incertain. Il fit semblant de partir.
"Qu'est-ce qu'il se passe ?" s'écria Wilson, furieux d'être dérangé. Il avait si peu de temps à présent, quelques moments de solitude de temps en temps et il les valorisait plus que tout autre chose.
"Ils te veulent."
Wilson ferma les yeux et ravala sa colère. Ils le voulaient tout le temps. Toujours un nouveau mandat à approuver, une directive à superviser. L'intérieur de la steppe, le Ghobi, la nature sauvage de l'Inde. Des tas de régions toujours pas expurgées. Il soupira, tourna une fois de plus son regard vers le monde derrière la vitre. Un moineau picorait sur la route, la peur disparue comme les véhicules ne passaient plus, menaçant d'éteindre la vie. Plus de circulation, plus de population ici, à l'ouest. Seuls quelques-uns, essentiels - pour ceux qui prenaient les décisions, ceux qui entretenaient le pool génétique.
Et les serviteurs occasionnels. De nombreux citoyens privilégiés préféraient un être humain à un clone cybernétique, sans émotion, sans éclat dans les yeux. D'autres, comme les mineurs de diamants, les travailleurs du secteur des biocarburants, les ingénieurs des éoliennes et des ondes. Leur mission consistait désormais à servir l'élite, à assurer la continuité des modes de vie de luxe.
Le moineau sauta sur le trottoir puis s'envola dans un arbre à proximité. Wilson s'efforça d'entendre son appel, mais n'y parvint pas. Rien ne pouvait traverser la vitre. Il soupira. "Je pense m'en aller."
"Oh." Sebastian s'approcha.
Par-dessus son épaule, Wilson dévisagea son fils. "Quelque part, très loin. Un endroit différent. Un endroit où je peux me vider l'esprit, être plus subjectif. Peut-être les Rocheuses. Il paraît que c'est beau là-bas. J'ai besoin de paix, de sagesse. Tu comprends ?"
"Je comprends les mots."
Wilson ferma les yeux. Mais, quel était le problème ? "Sébastian, à ton avis, pourquoi je t'ai demandé de ne jamais venir ici ?"
Prenant un moment pour examiner les murs nus, l'absence de meubles, le petit judas dans la porte, les prises électriques oubliées, tous désormais sans vie, Sebastian haussa les épaules. "Je ne sais pas."
"As-tu déjà pensé à la raison ?"
"Est-ce important ?"
"De comprendre le "pourquoi" ? Bien sûr. C'est le principe fondamental de la vie - poser des questions. Trouver les réponses."
"Je croyais que le principe fondamental était de servir ?"
"Servir ?" Wilson secoua la tête. " Mon Dieu. Servir qui ?"
"Soi-même. L'État. Contribuer, entretenir, améliorer."
"Tu parles comme un vulgaire manuel."
"Nous n'avons pas de manuels, papa. En fait, je ne pense pas avoir déjà vu un livre, et encore moins en avoir lu un."
"La lecture améliore l'esprit, elle te donne les outils pour débloquer des secrets et développer l'imagination."
"Ce genre de choses n'a aucun intérêt pour moi."
"Ça devrait. Tu dois te poser des questions, Sebastian. Et non seulement tout accepter facilement. S'intéresser, se poser les questions qui doivent être posées. Cette chambre est..." Il referma les yeux, mais sans exaspération cette fois. Des souvenirs. Trop nombreux ; ils traversèrent brutalement son cerveau. Il ouvrit les yeux et montra la fenêtre de la tête. "En bas, dans la rue. Rien d'interpellant pour toi ? Comment était le monde avant, que s'est-il passé en bas ?"
Sébastien fronça les sourcils, la question lui causant manifestement quelque embarras. "Que s’est-il passé avant ?"
Wilson pressa son index et son pouce dans les yeux. "Jésus ... Des choses comme des enfants, des gens qui vivent leur vie, qui vont d'un endroit à l'autre."
"Pourquoi aller d'un endroit à l'autre quand tout ce dont on a besoin est là ?"
Wilson lâcha délibérément sa main. Il resta bouche bée devant son fils. "Mais regarde, Sebastian, regarde l'oiseau dans l'arbre ! Tu le vois ?"
Le fils de Wilson s'approcha de la vitre en suivant le doigt pointé de son père et haussa les épaules. "Je vois l'arbre. Cet oiseau est-il une espèce exotique ?"
"C'est un moineau. Tu ne trouves rien de curieux ? Rien du tout ?"
Sebastian suivit à nouveau le regard de son père et aperçut le petit oiseau qui se posa sur le tarmac. Le moineau sautilla sur la route, suivi par deux autres. Un petit moment de convivialité.
"Je ne comprends pas. Les oiseaux ? Ils ne sont pas méchants, n'est-ce pas ? Pourquoi les oiseaux devraient-ils m'intéresser ? ”
"Parce qu'ils vivent."
"Moi aussi."
Wilson grimaça lorsqu'un poignard de douleur s'en prit à son cerveau et il se massa le front. "C'est comme ça que tu vois les choses ? Ce que tu fais, ce que je fais. Ce que nous faisons tous. Tu appelles ça une vie, ou une existence ? Les gens avaient une vie, avant. Ils étaient impatients de faire des choses, partir en vacances, en week-ends. Tu n'as jamais envie de quelque chose de ce genre, d'un désir d'appartenir au passé ?"
Un long soupir.
"Papa, je ne comprends pas où tout cela mène. Je ne comprends pas tes questions."
"Ce n'est pas grave. Je ne comprends pas non plus." Il baissa la main. "En fait, j'ai de plus en plus de mal à comprendre quoi que ce soit."
"Je ne t'ai jamais vu comme ça."
"Eh bien..." Wilson haussa les épaules. "Les choses changent. La vie. Tu sais, soudain tu te réveilles un matin et tu réalises que tu es vieux. Tu as une autre vision des choses, tu réévalues tes réalisations, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait." Il grimaça une deuxième fois, se malaxa la tempe avec les poings. "Si peu de temps, et pourtant tant à faire."
"Mais tu as déjà tellement fait pour nous tous. Nos vies, le monde, si propre, un paradis comme disent les gens. Tout ça, c’est grâce à toi, de ce que tu as accompli. Le salut. ”
« Vraiment ? » Wilson avait du mal à le croire. Il s'était installé devant les écrans interactifs, à la maison et dans les stades, les images de son visage souriant rayonnaient dans le ciel, les gens l'acclamaient. Le salut. Même lorsqu'ils s'étaient débarrassés des corps en décomposition du dernier immeuble, il n'avait éprouvé aucune joie, aucun sentiment de triomphe. Comment aurait-il pu, maintenant qu'il était le plus grand meurtrier de masse de l'histoire de l'humanité ? Les estimations variaient. Certaines parlaient de dix milliards, d'autres disaient plutôt vingt. Quelle que fût la vérité, ils furent presque tous morts et la terre entière poussa un immense soupir de soulagement. Mais pas Wilson Frement. Il secoua la tête, se détourna. "Je n'en suis pas si sûr."
Sebastian sourcilla. Il allait toucher le bras de son père mais il s'arrêta net. Il y avait rarement des signes d'émotion entre eux désormais. Peut-être n'y en avait-il jamais eu. "Ils veulent que tu les voies au Parlement."
Wilson ne rencontra pas le regard de son fils. "Je n'avais pas le droit de me prendre pour Dieu."
"Le monde se mourait. Quelqu'un devait prendre les décisions, sinon tout aurait disparu. Nous serions devenus comme des bêtes, papa. Tu sais que c'est la vérité."
"Mais tant de..."
Silence. Wilson avait le regard fixe dans l'espace et peu de temps après, Sebastian s'éloigna. Il s'arrêta à la porte et lui dit : "Je leur dis que tu viens?"
En regardant par la fenêtre, Wilson répondit d'une voix rauque: "Oui." Puis la porte se referma. Il appuya son front contre la vitre froide et regarda les moineaux sauter sur le tarmac vide. Une vie simple pour eux, mais une vie quand même. Une vie qui a un sens.
"Jésus", dit-il alors que la première larme coulait sur sa joue, "qu'ai-je fait..."
QUELQUES ANNÉES PLUS TÔT
DES BOMBES ET DES BOMBARDIERS
Il sortit de son rêve en sursaut, l’esprit empli de scènes de maisons en feu, de chaleur accablante, de la puanteur de cheveux et de chair brûlés. Assis droit comme un piquet, perplexe, désorienté, un cri se coinça dans la gorge et de quelque part une voix hurla : "Bremen, Bremen pour l'amour de Dieu, réveille-toi !"
Une main lui saisit l'épaule et le secoua. "Réveille-toi !"
Bremen se tourna vers le son de la voix, incapable de se concentrer, un voile de fumée et de poussière impénétrable l'empêchant de distinguer des formes ou des silhouettes.
Ce n'était que lorsque l'eau l'éclaboussa qu'il émergea soudainement de sa confusion. Toussant et bafouillant, il s'essuya le visage avec la paume de sa main. "Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?"
La silhouette se dessina à la périphérie de sa vision, émergeant lentement de l'obscurité. Le sergent de service. "Prends ton manteau, Bremen. On vient de nous appeler, un incendie à la caserne de Manchester."
Bremen balança ses jambes sur le côté du lit de camp et se pencha en avant, passant les doigts dans ses cheveux. "Quelle heure est-il ? J'ai l'impression d'avoir dormi cinq minutes."
"Il est trois heures et quart. Tu as dormi pendant plus de quatre heures."
En s'étirant, Bremen bâilla, claqua ses lèvres et se leva. Il attrapa le holster automatique en bandoulière posé sur le dossier d'une chaise et le passa sur l’épaule. Précipitamment, il enfila sa veste et enfonça ses pieds dans ses chaussures. Baillant à nouveau, il se traîna jusqu'à la porte, "Il me faut une boisson".
Le sergent de service fourra une tasse de café dans la main de Bremen. Il en prit une gorgée, fit une grimace, "Merde. Combien de sucres as-tu mis dedans ?"
"Deux."
"Jésus." Il en prit une autre gorgée et la rendit au sergent. "J'en prends quatre."
Il ouvrit la porte et scruta le couloir silencieux menant à la sortie principale. Il n'y avait personne aux alentours, juste la collection de bureaux jonchés de papiers et de cendriers trop pleins lui rappelant, s'il en avait besoin, que l'équipe de jour travaillait beaucoup plus dur qu'il ne lui semblait. Le sien était un petit bureau de contrôle, bien loin du centre ville, l'un des plus paisibles de cette partie du pays. Il frissonna.
"Tu as oublié ton masque."
Il se retourna vers le sergent qui suspendait le masque par la lanière entre le doigt et le pouce. Bremen sourit d'un air suffisant, il sortit sans le prendre.
"Je t'enverrai les détails sur ton ordinateur de bord."
Bremen ne dit rien. Il se sentait mal, ses genoux lui faisaient mal, le fond de sa gorge était déjà recouvert d'une substance métallique et désagréable. Il toussa, sortit une cigarette et l'alluma.
Il trouva sa voiture sur l'aire de chargement et il y monta face à la console. Les feux rouges s'allumèrent et presque aussitôt, les sonorités douces et mélodieuses de la voix féminine de l'ordinateur le saluèrent : "Bonjour, inspecteur Bremen. J'ai les détails de votre destination. Caserne de Manchester, quartier des affaires du port d’Eastside. L'heure d'arrivée prévue est de sept virgule trois minutes. Le trafic est léger à cette heure de la journée, je doute que vous deviez passer à…"
Bremen baissa le volume et se pencha en arrière sur son siège, fixant le plafond et expirant un nuage de fumée. Il était de service depuis trois nuits, et il lui en restait encore un à accomplir. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une autre nuit tranquille, et non d'un cas d'incendie criminel qui ne mènerait probablement à nulle part. Des questions à poser, des rapports à rédiger. Il reprit une bouffée de sa cigarette avant de l'écraser dans le cendrier du tableau de bord : "Allons-y, d'accord ?"
Traversant le ciel nocturne, il remarquait de temps en temps des troubles civils occasionnels, des fusillades, des agressions. Il vit des vélos de secours se précipiter sur des groupes de citoyens forçant l'entrée de commerces ou d'entrepôts encore en activité. Sur le tarmac, plusieurs corps gisaient, entourés de mares noires. Le sang coulait à flots, comme toujours.
Le feu flamboyait dans les immeubles. Bremen n'osait pas rabaisser les vitres de peur d'être contaminé mais il crut entendre le bourdonnement constant des cris, une symphonie de désespoir sans fin. À sa droite, sur le côté gris du fleuve, les lueurs de la rive éloignée ondulaient à la surface. Là-bas, la violence et la dépravation étaient la norme. Le mauvais coin de la ville, où la nuit servait de voyage dans la rue des abattoirs. Bremen ferma les yeux et souhaita que tout cela disparût.
Lorsque des camions de pompier passèrent bruyamment en faisant marche arrière, il rouvrit les yeux, secoua ses épaules et enfonça les poings dans ses yeux. La descente se fit lentement, il se pencha en avant et monta le volume de la console. "Nous sommes arrivés, Inspecteur. Avez-vous apprécié la balade ?"
Bremen grogna, sortit en rampant avant que la porte ne s'ouvrît complètement et se cogna la tête contre la jante. Il jura, tint sa tête d'une main et sortit ses cigarettes de l'autre. Le paquet était vide. Dégoûté, il le jeta et se fraya un chemin à travers la crasse et la puanteur jusqu'au vaste bâtiment de briques rouges qui se dressait devant lui.
Il s'arrêta et regarda vers le ciel. Une centaine de fenêtres noires le regardaient mais sans la moindre lueur. Le feu ? Où était ce putain de feu ?
Tout près, des lampes à arc éclairaient toute chose d'une lumière fade. Bremen frissonna.
Une brise glaciale remontait du fleuve. Il tira le col de son manteau autour de son cou et se dirigea vers les portes qui se trouvaient en haut d'un grand escalier. Là, étaient plantés deux hommes en uniforme et aux bérets noirs posés élégamment. Les énormes fusils automatiques menaçants qu'ils tenaient près de leur poitrine n'avaient, par contre, rien d'élégant.
Le premier garde ne le regarda pas à mesure que Bremen s'approchait, agitant sa carte d'identité devant le nez de l'homme. " Bremen. Brigade d'enquête locale. Où est le feu ?"
Prenant son temps, probablement délibérément, le garde se tourna et regarda Bremen. Il n'y avait aucune émotion sur son visage, ni dans sa voix éraillée lorsqu'il répondit : "Vous n'êtes pas autorisé à entrer."
Bremen cligna des yeux : "Hein ? Qu'avez-vous dit ?"
"Vous n'êtes pas autorisé à entrer."
"Je n'ai pas dit que je voulais entrer."
"Mais vous en aviez l'intention. Vous n'en avez pas le droit."
Bremen recula, lâcha son manteau et posa les mains sur ses hanches. "Qui a dit ça ?"
"Moi. Le bâtiment est en quarantaine."
"En quarantaine" ? Contre quoi ?"
"Contre toute menace possible."
Bremen toussa et remarqua pour la première fois qu'aucun des gardes ne portait de masque. "Mon Dieu, vous êtes des androïdes sanguinaires."
"Nous sommes des agents du gouvernement, Inspecteur Bremen. Cette zone est interdite au personnel des forces de l'ordre."
"Pourquoi ?"
"Je vous l'ai déjà dit."
"Je ne vous crois pas. J'ai été envoyé ici pour enquêter sur un incendie. Il a été signalé."
"Il n'y a pas de feu. C'était une fausse alerte. Bonne nuit, Inspecteur."
Bremen se rapprocha et plongea son regard profond dans les yeux sans vie du garde : "Alors comment se fait-il que vous soyez ici ?"
"Bonne nuit, inspecteur", dit le second garde, aussi impassible que le premier, mais en pointant le fusil automatique dans sa direction, Bremen comprit.
Il descendit les marches d'un pas lourd. Il jeta un oeil gauche puis à droite avant de voir un véhicule d'intervention d'urgence près duquel discutaient trois hommes assis autour en train de discuter. Ils portaient tous des masques résistants. Ils n'étaient donc pas des androïdes. Bremen était sûr d'obtenir au moins quelques informations de leur part. Alors qu'il s'approchait, les hommes cessèrent de parler et devinrent tendus, le considérant avec leurs yeux étroits.
"Lequel d'entre vous est le responsable ?"
"Moi", répondit un homme accroupi, chauve, considérablement plus âgé que les autres. Même dans l'obscurité et avec le masque, Bremen pouvait voir à quel point le visage de l'homme était cireux. Bremen montra sa carte d'identité. L'homme haussa les épaules. "Je m’attendais à ce que vous soyez l'un de ces détectives."
"Précisément. J'aimerais vous poser des questions." L'homme soupira, le son s'amplifiant derrière le masque. "On m'a dit qu'il y avait un feu. On a été prévenu au commissariat, donc quelqu'un a du penser qu'il y en avait un, mais d'après ce que je vois, c'était un canular."
"C'était une bombe."
Pendant un moment, Bremen ne réalisa pas le sens des mots de l'homme. Il s'arrêta, retenant son souffle, et fronça les sourcils : "Une bombe ? Vous voulez dire, des terroristes ?"
" Je ne saurais pas vous le dire."
"Mais, elle a explosé ?"
"En partie, oui. On nous a appelés quand la bombe a explosé et détruit tout l'étage. On a trouvé et désamorcé les deux autres. Si elles avaient explosé, tout ce putain de bâtiment se serait écroulé."
"Il faut que j'aille jeter un oeil. Est-ce que l'endroit est sécurisé ?"
"Quasiment, mais ces deux charmants garçons ne vous laisseront pas entrer, peu importe qui vous êtes. Vous vous êtes déplacé inutilement, inspecteur."
"On dirait bien." Bremen se retourna vers les deux hommes en haut des marches qui se tenaient aussi immobiles et droits que des statues. "Des agents du gouvernement ? Que diable fait le gouvernement ici ?"
"J'en sais rien, c'était peut-être des terroristes, qui sait. Je n'ai pas demandé et si vous avez un peu de bon sens, vous ne vous entêterez pas à trouver la réponse à cette question particulière, mon garçon. Vous feriez mieux de ne pas y fourrer votre nez."
Bremen fronça les sourcils encore une fois. "Mais pourquoi une bombe ? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ?"
"Aucune idée, et ces deux-là n'allaient pas nous laisser fouiner. Dès que nous avons fait notre travail, ils nous ont fait sortir de là."
"Vous n'avez pas demandé pourquoi ?"
Le chef lança à Bremen un regard de mépris total : "Êtes-vous débutant, ou juste idiot ? Personne ne demande rien aux agents du gouvernement. Nous avons juste fait ce qu'on nous a dit."
"Mais la première bombe, celle qui a explosé ? Où était-elle ?"
"Dans le bureau du troisième étage. Elle a fait sauter toutes les fenêtres et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ce dont nous devions affronter quand nous avons réussi à nous frayer un chemin à travers les décombres était une ruine de meubles, des débris de plafond, des trous dans les murs."
"Personne n'a été tué ?"
"Il n'y avait personne, pas à cette heure matinale. Écoutez," ajouta-il en jetant un coup d'œil autour de lui, s'assurant qu'il était bien hors de portée de voix. Il prit Bremen à part en le tirant par le coude, "vous feriez bien de ne plus poser de questions, non ? Je vais vous dire une chose, cette situation est bizarre. Ils étaient là avant nous, ces deux imbéciles. A mon avis, ils savent tout, donc ça veut dire qu'ils ont peut-être été prévenus ou..." Ses yeux soutenaient ceux de Bremen.
"Ou quoi ?"
"Ils ont posé la bombe."
À une dizaine de minutes de la gare, Bremen s'arrêta près d'un kiosque alimentaire ouvert toute la nuit. L'homme derrière le comptoir occupait presque tout l'espace. Il avait un fusil à répétition dans les mains, et portait un regard qui proclamait au monde entier que personne n'avait intérêt à s'en prendre à lui. Bremen évita tout contact visuel et scruta le menu accroché sur le côté du kiosque. "Il y a quoi, dans tes hamburgers ?"
"Des noix."
"Hein ? Bremen leva les yeux, en faisant la grimace. "Que des noix ?"
"Un peu de viande de rat. Ce n'est pas un restaurant cinq étoiles, mec. Alors, fais ton choix et dégage. »
Pour donner un sens à ses paroles, il brandit son gros fusil. Bremen secoua la tête, glissa sa carte de crédit dans le moniteur de paiement et dit : "Je vais en prendre un".
Soudain, un cri derrière eux les fit tous les deux sursauter. Bremen se retourna et vit une femme, vêtue d'une robe noire déchiquetée, pieds et jambes nus, surgir d'un immeuble et prendre les marches de l'entrée trois par trois. Quelques secondes plus tard, elle fut suivie par un grand type, totalement nu, brandissant une bouteille cassée. Du sang jaillissait de sa bouche. Il avait vraisemblablement reçu un coup.
"Viens ici, salope."
Bremen regardait la scène comme dans un film, adossé au kiosque, se demandant s'il devait intervenir ou non. Mais le problème de la caserne tournait toujours dans sa tête. C'était un film de série B, sans grand intérêt, bien qu'il eût cru reconnaître l'homme nu. Se forçant à se concentrer sur le visage de l'homme, et non sur le reste de son corp, il bailla devant la normalité de la scène. Même lorsqu'une voiture volante noire se posa au milieu de la rue et que trois types en uniforme en sortirent, dont deux équipés d'automatiques noirs et maléfiques, aboyant très fort et criblant le grand homme nu d'une demi-douzaine de balles. La poitrine et l'abdomen de l'homme explosèrent et il tomba contre les marches, mort. La femme, en sanglots, le visage dans les mains, se dirigea vers la voiture en titubant. Un des hommes en uniforme l'aida à monter à l'intérieur et en quelques secondes, le véhicule s'éleva dans le ciel encore sombre et disparut.
"Des proxénètes et des putains", marmonnait le propriétaire du kiosque en faisant glisser le hamburger vers Bremen.
"Joli quartier"
"C’est pas le pire."
Bremen se retourna et prit une bouchée du hamburger. Il mâcha la garniture filandreuse et haussa les épaules. "Il faudrait plus d'oignons."
"C'est un ersatz, mec. Il n'y a pas d'oignons par ici."
"Ersatz ? C'est quoi ça, de l'allemand ?"
L'homme mit le fusil de côté et prit un chiffon humide pour essuyer le comptoir. "Je suis Allemand. Tout comme ces hamburgers. Si tu n'aimes pas, tu peux aller voir ailleurs, comme je viens de te le dire."
"Non, non", Bremen regarda le hamburger avec satisfaction, se léchant les lèvres, "C'est bon. Quelqu'un va venir prendre le corps ?"
"Les chiens feront ça."
Bremen acquiesça. C'était vraiment un super quartier. "Dis-moi, tu sais quelque chose sur la caserne de Manchester ?"
L'homme cessa de nettoyer et jeta un regard sombre sur Bremen. "Seulement que c’est une caserne et que ce n'est pas à Manchester."
"Oui, mais tu as entendu parler de quelque chose qui s'y passe ?"
"Même si c'était le cas, je ne te le dirais pas."
Bremen haussa les épaules. "Et si je t'en scannais deux cents ?""Je te dirais d'aller te faire foutre."
"Cinq cents ?"
Les lèvres de l'homme s'allongèrent légèrement. Probablement un sourire. "Scanne-le, mon pote."
Ce que fit Bremen aussitôt avant de glisser le dernier morceau de hamburger dans la bouche.
"Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Mais pas des gens ordinaires. Des professionnels. Ils y sont transportés tous les matins par un bus qui les récupère tard dans la nuit. Ils passent par là tous les jours."
"Qu'est-ce qu'ils font ?"
"Je n'en ai aucune idée. Mais ça doit être important, car il y a des voitures blindées et d'autres machins lourds tout partout autour de cet endroit. Si quelqu'un s'approche, on lui dit de partir. S'il ne le fait pas", le mec met son index contre sa tête et utilise son pouce pour tirer avec le faux pistolet.
"Bang !"
Bremen cligna des yeux. "Quoi, tu veux dire qu'ils tirent sur les gens ?"
"J'ai déjà vu ça. Donc, comme tu peux l'imaginer, plus personne ne s'approche de cet endroit maintenant."
"Les gardes, ils tirent vraiment sur les gens ?"
L'homme inclina la tête : "Tu es sourd ou quoi ? J'ai dit, bang ! Bref", il reprit le nettoyage du comptoir, "c'est tout ce que je sais".
"Combien de travailleurs dans le bus ?"
Un haussement d'épaules, un moment de réflexion. "Trente ou quarante, peut-être plus. Ils viennent parfois en deux chargements, généralement la nuit. Donc, peut-être quatre-vingts. Et ils travaillent en équipe. L'endroit n'est jamais tranquille."
"Il l'est, maintenant.˝
"T'y es allé ?" Il secoua la tête, toujours en passant le tissu sur le comptoir afin de trouver une occupation. "Tu dois avoir des pulsions suicidaires."
Bremen s'essuya les doigts d'une serviette et regarda de l'autre côté de la route le mort qui gisait là, dans son sang et ses entrailles. "Tu dois aimer cet endroit."
"Tu l'as dit, mon pote. Un paradis sur terre."
Alors qu'il entrait dans son appartement en titubant, les yeux granuleux, la puanteur de la rue dans les narines, la nouvelle tomba à l'holovision. Il y avait eu un autre scandale terroriste. Un important fonctionnaire du gouvernement abattu devant la maison d'un ami, et un kiosque de rafraîchissement situé à proximité pulvérisé. Le propriétaire, un certain "Leonard Karpernov", mort sur place. Selon les services de sécurité, les deux incidents n'étaient liés.
Bremen s'affala sur sa chaise, bouche bée devant les scènes devant lui, incapable de bouger, alors que le vomissement remontait de ses tripes. Il eut des haut-le-cœur, plié en deux et resta assis pendant un long moment, fixant le désordre, sans savoir s'il devait remettre les pieds hors de son appartement.
UNE DÉCOUVERTE MALENCONTREUSE
Le lendemain matin, à l'heure de son service, il reçut un appel téléphonique de son supérieur. "Prends ta soirée, Bremen, c'est calme."
Bremen, qui était sorti de la douche, pressa une serviette contre ses cheveux humides, fronça les sourcils vers le commissaire, dont l'image scintillait gris-vert au centre de la pièce. "Qu'est-ce tu veux dire, chef ?"
"C'est calme. Tu n'es pas obligé de venir, alors prends un peu de temps pour toi. Sors manger, ou regarde un film. Profite de tes loisirs, mais ne viens pas. Pas ce soir. Je te verrai vendredi prochain." Il sourit, se pencha derrière son bureau et, un instant plus tard, se redressa, tenant le masque de Bremen par la lanière. "Et tu as oublié ça, espèce d'idiot. Ce serait peut-être mieux pour toi de rester à l'intérieur. Je vais t'envoyer des sushis."
"Je n'aime pas les sushis."
"Un burger au rat, alors."
Bremen se figea alors qu'il se séchait les cheveux, et ses yeux se fixèrent sur ceux de son chef. "Qu'as-tu dit ?"
"Bremen, j'ai lu ton rapport. Je l'ai supprimé. Tu n'étais pas près de ce kiosque, tu me comprends ?"
"Non, pas vraiment, chef."
L'homme gonfla ses joues, exaspéré : " Putain, tu es vraiment aussi bête que tout le monde le dit ". Il se pencha en avant, envahissant la pièce, le visage dur, intransigeant. "Je vais te le dire clairement, alors écoute bien. Tu t'es rendu à la caserne et tu as découvert que l'alerte était une erreur. Un appel anonyme. Tu es allé directement au poste, tu as signé et tu es rentré chez toi. Rien d'autre."
"Pas exactement. J'ai parlé au..."
"Je sais ce que tu as fait, Bremen. Et eux aussi." Il sourit, sans humour. "Tu comprends ce que je veux dire, Bremen ?"
"Je pense que oui."
"Bien. Maintenant, tu restes assis sur ton gros cul pendant les trois prochains jours et tu ne mentionnes plus jamais, jamais rien de tout ça à une autre âme qui vive, tu comprends ?"
Bremen hocha la tête et le visage du commissaire disparut, laissant Bremen fixer la porte à l'autre bout de la pièce. Il devrait sortir immédiatement, retourner au poste et parler au chef en personne. Mais quelque chose l'en empêchait.
Qui diable étaient "ils" ?
Quelques heures plus tard, Bremen passa un coup de fil au sergent de service, dont le visage s'assombrit lorsqu'il vit son interlocuteur sur l’écran. Il se pencha sur son bureau, se couvrant le visage d'une main grisâtre et noueuse. "Putain, qu’est-ce que tu veux, Bremen ?"
"Le registre des appels. Je veux savoir d'où venait l'appel concernant l'incendie."
"Pourquoi ?" Il retira sa main et parut fatigué, résigné à une autre nuit fastidieuse, pleine de viols, de combats et de meurtres. "Je croyais que le chef t'avait dit de lâcher prise ?"
"Non, il m'a dit de ne plus en parler. C'est ce que je fais, sergent. Je n'en parle plus, je pose une question. C'est tout."
"Tu es vraiment idiot, Bremen. Je ne peux pas t'aider."
"Parce qu'il est supprimé."
"Perspicace. En ce qui nous concerne, les incidents de la nuit dernière n'ont pas eu lieu. Rien de tout cela. Maintenant, laisse tomber, Bremen."
"J'ai vu un homme se faire tirer dessus et j'ai parlé avec le propriétaire du kiosque. Maintenant il est mort et je veux savoir pourquoi."
"Je ne te le dirai pas."
"C'était aux infos, disant que c'était une attaque terroriste, mais je sais que ce n'était pas le cas. J'ai tout vu."
"Non. Je vais te le répéter pour la dernière fois - tu n'as rien vu."
"Juste le numéro, sergent. Le numéro de la personne qui m'appelé."
"Je ne m'en souviens pas."
"Ou tu ne veux pas te souvenir ?"
Ses yeux devinrent froids. "Bremen, tu n'aurais pas une case en moins ? Tu es proche de la retraite. Dans trois ans. Pourquoi ne pas faire ce qu'ils te disent et oublier la nuit dernière, prendre ton courage à deux mains et rêver de vacances au soleil, hein ?
Qui sont "ils", sergent ? Je ne cesse d'entendre "Ils" ceci, "ils" cela. Eclaire-moi."
Le sergent regarda à gauche puis à droite, "Le Gouvernement. Ok ? Rien que ce mot devrait te mettre dans la tête que ce n'est pas une partie de plaisir, Bremen. Ce qui s'est passé hier soir ne te concerne plus."
"J'ai parlé aux démineurs."
"Tu as fait quoi ? Quand ?"
"Hier soir. Ils m'ont dit que ce n'était pas un incendie. C'était une bombe. On les avait appelés pour la désactiver, mais ils sont arrivés trop tard. L'explosion a détruit un des étages de l'immeuble. Ils en ont trouvé deux autres et ont réussi à les neutraliser."
"Mon Dieu, Bremen. Je ne veux pas entendre ça."
"Trop tard, je viens de te le dire. Maintenant, donne-moi ce putain de numéro d'appel."
Deux heures plus tard, il avait réussi à localiser l'origine de l'appel. Sur son canapé, sa troisième tasse de café à côté de lui, il avait le regard, incrédule.
L'appel provenait de la résidence privée de Wilson Frement. À ce moment, Bremen pensa qu'il valait mieux tout oublier, du moins pour l'instant.
Mais, comme toujours, il ne pouvait pas oublier.
Il attendit la nuit, puis se vêtit d'un polo noir et d'un jean gris foncé. Une veste en cuir brun sale compléta sa tenue et, alors qu'il considérait son reflet dans le miroir géant, il enfila un bonnet de laine et grogna de satisfaction.
La nuit. Il roula jusqu'aux alentours de la caserne de Manchester, stationnant le véhicule dans une rue latérale déserte. La nuit, silencieuse et sinistre, s'était abattue sur tout le quartier. D'immenses bâtiments se dressaient devant lui et, de chaque fenêtre et porte fermée, il s'attendait à ce que des agents gouvernementaux en noir émergèrent à tout moment et le forcèrent à partir. Il frissonna, referma son manteau et, se tenant près du mur de l'immeuble d'en face, il avança discrètement jusqu'à l'angle. Il jeta un rapide coup d'œil sur la route principale.
La caserne de Manchester demeurait silencieuse. Les agents du gouvernement étaient partis. Le journal télévisé n'avaient pas fait allusion à une bombe qui aurait explosé à cet endroit, une autre curieuse omission dans cette affaire de plus en plus déroutante. Après une dernière vérification des lieux, il se glissa sur la route.
Dans l'espace dégagé, il était conscient d'être exposé. Il se trouvait sur une place, dont le centre était dominé par une grande fontaine, ornée d'une statue de bronze massif représentant des combattants, commémorant un conflit oublié depuis longtemps. Tout autour se dressaient d'autres bâtiments indéfinissables, d'impressionnants sièges sociaux. Il se rendit compte, avec un soubresaut, que c'était le cœur battant de la ville, bien qu’éloigné du centre. Là, des hommes en costume gris s'éloignaient sans se faire remarquer, gagnant leur fortune, alors que tout autour, le monde suffoquait et mourait de faim.
Quelque chose bougea derrière lui. Il se mit à genoux et saisit son arme. Une série de poubelles s'entrechoquèrent. Il se figea, retenant son souffle, attendant.
Il poussa un long soupir lorsqu'un chat s'échappa des grands conteneurs en plastique, lui lança un regard révulsif avant de disparaître dans la pénombre. Bremen remarqua que la main qui tenait l'arme tremblait. Il en ria, s'efforçant de se calmer. Comment aurait-il réagi de toute façon ? Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait utilisé son arme de service, sauf pour les séances d'entraînement bimensuelles. ˝Trois tirs ciblés sur douze, Bremen", avait dit Cosgrave la dernière fois, en grimaçant, sérieux comme un cadavre. Ce n'est pas suffisant. Je vais devoir le dire au commissaire.
En rangeant l'automatique, il scruta les étages supérieurs et décida de tenter sa chance par derrière. Il s'élança donc vers le coin le plus éloigné et se faufila par l'arrière du bâtiment.
Il pensait qu'une alarme aller se déclencher mais quelque chose dans cet édifice presque désert lui donnait des raisons de douter de cette hypothèse. Aussi, lorsqu'il arriva à l'entrée arrière aux volets baissés, il n'hésita pas à se pencher, à empoigner le dessous et à le soulever.
Le concertina en aluminium grinça horriblement. Il s'arrêta, haletant, à l'affût de tout signe d'alerte des agents de sécurité accourant pour enquêter.
Rien ne se produisit. Pas d'alarme, pas de gardes, seulement le calme de la nuit.
Il prit une profonde inspiration et se contracta tous les muscles afin d'ouvrir complètement la porte d'entrée usée.
Il scruta l'obscurité et renifla l'air vicié. La puanteur de l'abandon et de la décadence prouvait que plus personne n'utilisait cet endroit, peut-être même qu'ils ne l'avaient pas honoré pendant des années.
Il sortit son vieux briquet Zippo de sa poche et effectua trois ou quatre tentatives avant qu'il ne s'allumât. Il le tendit, balançant la flamme de gauche à droite alors qu'il se dirigeait progressivement vers l'intérieur. La faible lumière parvint à pénétrer dans une partie de l'alentour, mais de manière très limitée. La pièce semblait remplie de cartons d'emballage, le sol jonché de feuilles de papier étouffées par la poussière qui se soulevait alors qu'il avançait à pas feutrés, ce qui l'obligeait à s'arrêter à chaque pas pour tousser.
Il n'avait plus besoin de preuves. L'endroit était désert.
Il rabattit le couvercle du briquet et attendit. Plongé dans l'obscurité, il prit un moment pour permettre à ses yeux de se retrouver. Il se retourna et se dirigea à tâtons vers la sortie, mais avant d'avoir fait deux pas, il l'entendit. Un clic métallique, venant du fond des entrailles du bâtiment.
Évidemment, il se maudit. Le sous-sol. Les démineurs ne lui avaient-ils pas dit qu'ils avaient désamorcé un appareil explosif dans les étages inférieurs, ou bien l'imaginait-il ? Alors qu'il se tenait immobile, la bouche ouverte, à l'écoute, le ronronnement des câbles métalliques lui dirent exactement ce qui se passait.
Un ascenseur. Il se déplaçait vers le haut. Et s'il fonctionnait, cela signifiait que quelqu'un avait dû l'activer.
LE CAMBRIOLAGE
Avery était vieux. Pas assez pour ne pas pouvoir marcher ou uriner quand il le voulait, mais assez vieux pour se souvenir de l'époque où le monde était plus verdoyant.
Il ne se passait pas grand chose à présent. La vie était devenue fastidieuse, une suite interminable de journées sans signification mais des journées qui fuyaient. Il se réveillait, se brossait les dents, prenait quelques repas et, en un clin d'oeil, l'heure du coucher était arrivée. Parfois, allongé dans son lit, le pavé tactile le dévisageant, les mots sur l'écran n'étant qu'un flou bleu, il essayait de se rappeler ce qu'il avait fait pendant la journée. Un petit déjeuner sur la terrasse du Gilbert, quelques mots de conversation oisive. Puis une promenade en front de mer, pour regarder les maçons empiler les pierres. Un exercice inutile s'il en était un. Un peu plus tard, le déjeuner. Un cocktail peut-être. Il aimait les cocktails. Ils lui transportaient à un endroit, loin de toutes ces conneries.
L'histoire. Personnelle. Lui et Mavis. Comment elle riait, lui tenait la main, touchait son visage et l'embrassait. Souvenirs. Puis, le dîner avec Clément qui servait la nourriture. Pas de mots, juste le cliquetis de cuillères en argent sur des plateaux en argent. De la bonne nourriture, bien préparée. Mais il ne se souvenait d'aucun détail. La routine quotidienne. Le flou.
La nuit où l'incident se produisit, Avery se mit à table et regarda Clément lui servir de la soupe dans un bol, à l'aide d'une louche. " Quel effet cela vous fait-il d'être un domestique ? "
Clément, peut-être plus âgé que les collines, s'arrêta, leva un sourcil. "Je vous demande pardon, Monsieur ?"
"Bon sang, je vous le demande."
"Mais je n'en comprends pas le sens, Monsieur."
"Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Dans cette maison, à me servir ?"
"Monsieur, c'est..." Clément semblait troublé, il se frotta le menton. "Je ne sais pas à juste titre, Monsieur. Je me souviens de votre père, Monsieur. Je me souviens qu'il m'avait fait passer un entretien pour le poste ici, mais il y a combien de temps, c'était..." Il secoua la tête. "Il y a longtemps, Monsieur. C'est tout ce que je sais."
"Vous vous souvenez de mon père ? Mon Dieu, c'est que vous êtes plus vieux que moi."
"Je crois bien, Monsieur."
Avery secoua la tête. " Zut. Ma mémoire se détériore, Clem. Je ne peux pas me rappeler ce que j'ai fait plus tôt dans la journée. Peut-être est-ce plus lié à la vacuité de tout ce qui nous entoure. J'ai besoin de ... d'une raison pour me lever le matin. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai besoin d'une raison pour avancer."
"Le business, Monsieur. Vous avez votre business, c'est une raison suffisante, non ?"
"C'est la responsabilité de mon fils, maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec tout ça."
"Vous avez encore beaucoup à offrir, Monsieur. Je ne pense pas que vous ayez plus de 80 ans."
"J'ai 87 ans, Clément. Quel âge avez-vous ?"
Clément recommença cette expression douloureuse. "Monsieur... Je ne sais pas."
"Une supposition, alors. Pour l'amour de Dieu, vous devez avoir une idée, une intuition."
"Bien plus d'une centaine, Monsieur. Peut-être... peut-être cent vingt."
Avery prit son verre et fit tournoyer le cognac. "Mais vous avez un objectif, non ? Une raison de continuer à avancer."
"Celle de vous servir, Monsieur. Oui."
Avery fixa son verre. "Mais que faites-vous pendant votre temps libre, le soir, Clem ? Comment remplissez-vous le vide ?"
"Pas grand-chose, Monsieur. Je mange, je regarde les vieux matchs de ballon sur l'holovision, en me souvienant du passé. Des choses comme ça."
"Est-ce que vous lisez, Clem ? Des livres, je veux dire ? Je lisais beaucoup. De la fiction, de l'histoire, un peu de tout. Maintenant, je n'arrive plus à garder les yeux ouverts plus de deux minutes avant de m'endormir. Le pavé tactile est un véritable fouillis, les mots sont flous et n'ont plus aucun sens. J'aimais lire autrefois".
Un lourd silence s'abattit sur eux.
Clément s'appuya sur l'autre jambe. Je ne me rappelle pas avoir déjà lu, Monsieur. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce que je veux est sur l'holovision."
"Mais avant l'holovision, Clem ? Vous n'avez pas lu à l'époque, dans le temps ?"
"Je ne me souviens pas des jours avant l'holovision, Monsieur. Ça a dû être terriblement ennuyeux."
"Oui, je suppose." Avery vida son verre, se lécha les babines, observa les résidus de l'eau-de-vie. "Alors, comment c'est d'être un serviteur ?"
"Comme tout le reste, je suppose, Monsieur. C'est un travail. Je me lève, je fais mon travail et je vais me coucher. Même chose, le jour suivant, et ainsi de suite."
"Et c'est tout ?"
"Y a-t-il autre chose, monsieur ?"
Avery observa son domestique. Une sorte de compréhension s'échangea entre eux. Un lien. Quelque chose. Maître et serviteur partageant un moment émouvant, l'acceptation de leurs rôles respectifs. "Je vous envie, Clem. Savoir ce que chaque jour nous réserve. J'y trouverais du réconfort, un sentiment de sécurité."
"Mais vous avez le choix, Monsieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un luxe qui dépasse de loin mon existence, Monsieur."
"L'existence". Oui. Mais, de plus en plus, je me retrouve à tout remettre en question. Les jours se confondent en un seul. Une seule, longue chaîne de vide. Je suis une force épuisée, Clem. Je n'ai plus rien à offrir à personne." Il but la dernière goutte de cognac et posa le verre sur le plateau d'argent. "Je m'excuse. Je deviens morose. Ne faites pas attention. Bonne nuit, Clem."
"Bonne nuit, Monsieur."
Avery alla se coucher. Ses vieux os craquèrent alors qu'il mettait son pyjama non sans difficulté. Le matelas s'affaissa sous son poids. Allongé, il fixa le plafond et se demanda si la vie de Clem était plus satisfaisante que la sienne. Plus il y réfléchissait, plus il commençait à accepter qu'en fait, la vie de Clem était infiniment meilleure que la sienne. Le manque de responsabilité, le poids des décisions, sans rien de tout cela, la vie devait être meilleure. Certainement plus simple.
Il essaya de dormir.
Mais il n'y arrivait pas.
Après des heures infructueuses, il descendit pour se servir un verre de lait.
Il traversa lentement la grande cuisine froide, ouvrit la porte et aperçut une ombre dans le hall. Il sut à ce moment précis que la vie était sur le point de prendre un tout nouveau tournant, inattendu.
Deux individus l'attachèrent à une chaise solide au centre de la pièce. L'un des deux intrus fourra une orange dans la bouche d'Avery, mais l'autre la lui retira aussitôt. "Comment est-il censé nous parler avec ça ?"
L'autre haussa les épaules, fit une grimace, ouvrit le frigo. Il sortit une brique de jus de fruit, arracha le dessus et en but le contenu en une seule gorgée. Il se lécha les babines et s'essuya la bouche du dos de la main. Il dit en soupirant: "Purée, je n'ai pas dégusté ça depuis plus d'un demi-siècle."
"C'est la manière dont vit la meilleure moitié, Sheldon."
Sheldon répondit par un regard furieux. "Pas de noms, espèce d'idiot."
L'autre gémit, posa sa main sur la bouche. Il regarda Avery. "Tu n'as pas entendu ça, n'est-ce pas, grand-père ?"
"Tu seras anéanti pour ça," répondit Avery
"Ta gueule", dit l’inconnu et il gifla Avery durement. Le coup était si puissant qu'il renversa la chaise et fit tomber Avery. Il se cogna la tête contre un placard. Son crâne s'ouvrit comme un oeuf cassé. Avery s'effondra et resta immobile, le sang coulant sur le sol, tacheté de petits morceaux de matière cérébrale. Ses yeux restèrent ouverts.
Il était mort.
"Espèce de putain de lunatique." Sheldon claqua la porte du frigo, prit l'autre homme par le col et le poussa à travers la pièce. Il donna un coup sur le bord de l'évier, jura fort, et sortit un petit automatique noir de l'intérieur de son manteau. "Tu me touches encore et je te tue, salaud."
Sheldon s'agenouilla et chercha le pouls du vieil homme. Il leva la tête. "Tu l'as tué."
"Et alors ? On peut toujours trouver le truc."
"Comment ?"
"Hein"
"Comment on va trouver le truc s'il est mort ? Il allait nous donner la combinaison du coffre, espèce d'idiot."
"Arrête de m'appeler comme ça, Sheldon. Attention à toi."