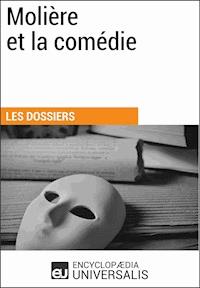
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Molière est parvenu, en trente ans de carrière, à faire du rire l'un des meilleurs instruments pour exercer sur le monde un regard critique. Grâce à des farces populaires (
Les Précieuses ridicules), des comédies riches en rebondissements et en péripéties (
Les Fourberies de Scapin), des comédies-ballets (
Le Bourgeois gentilhomme) ou des pièces plus graves (
Le Misanthrope, Tartuffe, Dom Juan), cet artisan de la scène, rompu aux techniques théâtrales (commedia dell'arte, théâtre de foire...), n’a eu de cesse de dénoncer avec humour, mais non sans dureté, les défauts des hommes – la jalousie, l'hypocrisie, l'avarice, la pédanterie, la vanité...
Ce
Dossier Universalis, composé d’articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis, vous invite à découvrir l'homme et son œuvre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002172
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce dossier, consacré à Molière et la comédie, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles de ce dossier à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Molière et la comédie
Molière est parvenu, en trente ans de carrière, à faire du rire l’un des meilleurs instruments pour exercer un regard critique sur le monde.
Grâce à des farces populaires (Les Précieuses ridicules, Le Médecin malgré lui), des comédies riches en rebondissements et en péripéties (L’Avare, Les Fourberies de Scapin), de nombreuses comédies-ballets (George Dandin, Le Bourgeois gentilhomme), cet artisan de la scène, rompu aux techniques théâtrales (commedia dell’arte, théâtre de foire...), n’aura de cesse de dénoncer, avec humour mais non sans dureté, les défauts des hommes – la jalousie, l’hypocrisie, l’avarice, la pédanterie, la vanité...
Le présent dossier vous invite à découvrir l’homme et son œuvre.
E.U.
MOLIÈRE (1622-1673)
Dans la longue tradition de la littérature comique, qui naît avec Aristophane et qui n’a cessé de se développer depuis la Grèce classique jusqu’au XXe siècle, le nom de Molière figure parmi les plus grands. Il n’est pas question de ramener tout l’art de la comédie à l’imitation de ses pièces et nul aujourd’hui n’aurait cette prétention. Mais elles gardent une valeur éminente. C’est dans le cadre de l’histoire du théâtre qu’il est le plus utile de les étudier. La vie même de l’écrivain et sa conception de l’art du comédien se relient étroitement à son œuvre et permettent d’en saisir la signification.
Philosophe du bon sens bourgeois, moraliste du juste milieu, autant de titres que Molière a acquis aux dépens de son renom d’homme de théâtre. L’homme du jeu corporel, de la posture, de la grimace, l’héritier des farceurs et le chef de troupe ont été longtemps négligés par la critique. C’est pourquoi l’homme de théâtre mérite une particulière attention.
Antoine ADAM
Alfred SIMON
1. La carrière d’un comédien
Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, naquit à Paris. Fils d’un tapissier ordinaire du roi, il fit ses études au collège de Clermont où les jésuites assuraient l’instruction des fils de la noblesse et de la riche bourgeoisie. Son père le destinait à lui succéder dans sa charge, mais le jeune homme se détourna de la carrière qui lui était préparée et forma avec quelques amis une troupe de comédiens.
Cette troupe se constitua par acte notarié le 13 juin 1643 et s’appela l’Illustre-Théâtre. Elle loua successivement deux salles. Dans les deux cas, l’échec fut complet. Elle fit faillite, et le jeune Poquelin fut emprisonné pour dettes. Libéré après quelques jours, il partit pour la province. La troupe où il entre est signalée en Gascogne, en Bretagne, en Languedoc et enfin dans la région du Rhône. En 1650, il fut choisi par ses compagnons pour être leur chef. Il avait pris le nom de Molière.
On est aujourd’hui suffisamment renseigné sur l’histoire de sa troupe pour savoir combien est fausse l’image qui en a été longtemps donnée. Les comédiens de Molière ne sont pas des gueux faméliques constamment sur les chemins. Ils font, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, des séjours de plusieurs mois, ils y louent une maison pour la durée de leur présence. Ils placent en rentes des sommes importantes.
Toutefois, leur rêve était naturellement de retourner à Paris. Le 24 octobre 1658, après douze années passées en province, ils jouèrent pour la première fois devant le jeune Louis XIV, et en obtinrent la jouissance de la magnifique salle du Petit-Bourbon.
En 1660, ils durent la quitter parce que l’administration royale en avait décidé la destruction. Louis XIV mit alors à leur disposition la salle du Palais-Royal, construite par Richelieu et demeurée sans emploi depuis sa mort. C’est là que Molière joua jusqu’à son dernier jour.
La situation prestigieuse qu’il sut acquérir ne doit pas faire ignorer les difficultés et les tristesses de sa vie. Directeur d’une troupe venue de province, il se heurta aux Comédiens du roi. Ceux-ci ne reculèrent devant aucun moyen pour le perdre et firent jouer des pièces où il se voyait insulté de la façon la plus ignoble. Il eut d’autres ennemis. Les plus acharnés furent les dévots. Un curé de Paris réclama contre lui, dans un libelle furieux, la peine du bûcher. Les médecins ne prenaient pas ses moqueries à la légère. Les marquis, à la cour, se déchaînaient contre lui. Il eut longtemps pour lui le patronage déclaré de Louis XIV. Mais, quand il mourut, il y avait un an que cet appui lui manquait, toute la faveur royale allait alors à Lully.
La vie de Molière, à son foyer, fut marquée également de grandes tristesses. Il avait épousé une jeune comédienne de sa troupe, Armande Béjart. Officiellement, elle était la sœur de son ancienne maîtresse Madeleine Béjart, mais, selon la plus grande probabilité, elle était la fille de l’illustre actrice ; les ennemis de Molière osèrent prétendre que ce dernier était son père, et portèrent cette infâme accusation jusqu’au roi. Et ce qui atteignit peut-être plus profondément Molière, c’est qu’Armande lui fut scandaleusement infidèle. Il en souffrit, puis il pardonna ; les deux époux reprirent la vie commune.
Épuisé peut-être par les ennuis, Molière tomba malade en 1665. Il ne guérit pas. Un de ses ennemis le décrit alors blême, les yeux creux, maigre comme un squelette. C’est ce qui explique trop bien sa mort, à l’âge de cinquante et un ans.
Lorsqu’il composait ses comédies, Molière avait dans l’esprit, de la façon la plus précise, le rôle qu’il y tiendrait. Les contemporains ont été d’accord pour voir en lui « la survivance de Scaramouche », c’est-à-dire du meilleur des comédiens italiens. Ils retrouvaient en lui « les démarches, la barbe et les grimaces » de son modèle. C’est dire qu’il ne visait nullement à une sage vraisemblance. Tous ceux qui l’on vu ont parlé de sa démarche un peu bouffonne, le nez au vent, les pieds « en parenthèse », de ses « grimaces », des tons « très aigus et très extraordinaires » qu’il affectait, du hoquet même dont il coupait plaisamment son texte.
De même, Molière était, comme metteur en scène, beaucoup moins soucieux de distinction que de mouvement et de vie. On aurait tort de penser qu’il ne s’intéressa que médiocrement à la comédie-ballet. Il fut au contraire le promoteur de ce genre alors nouveau : il y cherchait une heureuse combinaison des différentes formes de l’art du spectacle. À partir de 1666, les comédies-ballets furent de plus en plus nombreuses dans son œuvre. Des pièces comme Monsieur de Pourceaugnac ou Le Bourgeois gentilhomme étaient jouées sur un rythme endiablé. Le Sicilien ou l’Amour peintre, sur un registre tout différent, se développait dans une atmosphère de fantaisie poétique. Le prologue de L’Amour médecin célèbre l’union de la comédie, de la musique et de la danse.
2. La création littéraire
• Des débuts aux « Précieuses ridicules »
Quand Molière arriva à Paris, la troupe des Comédiens du roi et celle du Marais jouaient des comédies qui s’inspiraient, soit de la commedia sostenuta de l’Italie, soit de la comedia de capa y espada des Espagnols. Ces comédies étaient en cinq actes et en vers. On appelait ce genre de pièces « la grande comédie », ou encore « la grande et belle comédie ». C’étaient des intrigues ingénieuses et le plus souvent romanesques, des tableaux des passions « galamment touchés », « des brillants d’esprit ». On s’explique sans peine le succès qu’elles obtenaient dans la société galante qui donnait le ton.
Les deux premières pièces créées par Molière à Paris (il les avait déjà jouées en province), L’Étourdi et Le Dépit amoureux, appartiennent à ce type de comédie, et plus précisément à la tradition italienne. Les invraisemblances y abondent : c’était une loi du genre. Ce que Molière y met de personnel, c’est la verve, c’est le jaillissement des formules drôles. Le public parisien y trouva un très vif plaisir.
D’autre part, Molière prit l’habitude de donner en fin de séance, de « petits divertissements ». Deux seulement ont été conservés : La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant. Ils permettent de comprendre combien le comique, chez Molière, est fondamentalement populaire. Il convient en outre de se souvenir que, si la vieille farce avait à peu près disparu des scènes parisiennes depuis 1640, elle restait vivante à Lyon et dans les provinces du Sud-Est, où Molière venait de passer plusieurs années.
Si le succès de ces pièces fut grand, Les Précieuses ridicules, en décembre 1659, furent un triomphe, et c’est alors que la carrière de Molière commence véritablement. Si l’on veut comprendre ce premier de ses chefs-d’œuvre, il faut en étudier séparément la forme et la signification.
Les Précieuses ridicules sont, pour la forme, une farce. Ce genre de littérature théâtrale, à cette époque, a ses lois nettement fixées. La farce est une pièce en un acte. L’intrigue est très simple : un mauvais tour joué à un sot (ou à une sotte). Les personnages sont des types ; pour comprendre ce trait capital, il est bon de se rappeler les types comiques du cinéma, à l’époque de Max Linder et de Charles Chaplin. De pièce en pièce, on retrouve certains personnages, avec les mêmes noms, les mêmes silhouettes, les mêmes tics ; pour mieux marquer ce caractère « typique », ils portent souvent un masque qu’ils conservent de pièce en pièce, comme faisaient d’ailleurs Arlequin, Trivelin et leurs camarades. Tous ces traits se retrouvent dans la farce des Précieuses : pièce en un acte, mauvais tour joué à deux sottes ; personnages typiques : Gorgibus, le « vieux Gaulois » trop attaché à des idées surannées, Mascarille le marquis à la mode (faux d’ailleurs), Jodelet le valet de tant de comédies contemporaines. Et un témoignage du temps indique que Mascarille et Jodelet portaient le masque.
Toutefois, si Molière conçoit Les Précieuses comme une farce, il donne à sa pièce une signification qu’aucune farce n’avait encore possédée. Il y fait la satire d’une mode qui triomphe alors dans la belle société parisienne. Satire amusante à coup sûr, et il serait fort exagéré de prétendre qu’il s’indigne. Il outre le ridicule, il pousse jusqu’à la caricature et, quoi qu’on en ait dit, il fait parler à ses précieuses un langage qui n’était celui d’aucun salon de Paris. Mais cette caricature est vraie d’une vérité supérieure, de la même vérité que les grands caricaturistes italiens de l’époque savaient mettre dans les visages et les silhouettes de leurs personnages.
Et cette satire ne se dissimule pas : Le Grand Cyrus et Clélie sont nommés et la carte du Tendre est citée en toutes lettres. Comme si, de nos jours, un auteur avait le courage de mettre sur la scène les ridicules d’une « élite » mondaine éprise de métaphysique transcendante et de jargon philosophique. À partir des Précieuses, les Parisiens virent en Molière l’auteur qui, mieux qu’aucun autre, savait donner « d’agréables peintures du temps ». Ils dirent qu’il combattait dans ses pièces « les défauts de la vie civile ».
Au mois de mai 1660, Molière fit jouer une nouvelle farce, Sganarelle, ou le Cocu imaginaire. Il ne donnait pas à cette pièce la signification satirique qui avait fait le succès des Précieuses. Mais il y créait un type, que l’on retrouve dans les comédies qui suivirent, celui de Sganarelle. Il avait été jusqu’ici Mascarille, beau parleur et faussement élégant d’allures. Il est maintenant, et il sera souvent dans l’avenir, sous le nom de Sganarelle ou sous un autre, le pauvre homme, trompé par les femmes, moqué par tout le monde, et qui vit dans un rêve de noblesse et de grandeur à l’heure même où tout le monde le bafoue. Et, ce qui n’est pas moins digne d’attention, Molière donnait dans sa nouvelle pièce une part importante à la mimique. Les scènes les meilleures de Sganarelle sont des scènes mimées, et c’est par ses attitudes et ses gestes, au moins autant que par ses paroles, que le « pauvre homme » exprime ses colères et ses affolements.
• « L’École des femmes »
Un an plus tard, en juin 1661, Molière créait L’École des maris. Sur deux points, cette pièce apportait des nouveautés importantes. Si, par certains traits, elle s’en tenait aux traditions de la farce, elle était écrite en trois actes, ce qui contrevenait aux lois du genre. On devine sans peine l’origine de cette nouveauté : la commedia dell’arte des Italiens était en trois actes ; c’est à elle que pense Molière quand il écrit L’École des maris.
D’autre part, il introduit dans sa pièce un ordre de préoccupations qui n’apparaissait pas dans son œuvre antérieure. Non seulement le comique de L’École des maris n’est pas gratuit comme celui de Sganarelle, mais il n’est pas non plus une simple satire de modes ridicules comme celui des Précieuses. Molière laisse maintenant deviner sa pensée sur les problèmes moraux qui se posent à son siècle. Il est d’accord avec l’optimisme moderne. Il croit que la société n’est pas force d’oppression, mais moyen de culture, et que la meilleure des écoles, c’est « l’école du monde ». Pour la première fois, Molière laisse apparaître sa pensée intime, qui est son adhésion aux maximes de l’humanisme.
Après Les Précieuses et Le Cocu imaginaire, L’École des maris n’était encore qu’une étape. L’École des femmes, à la fin de 1662, marque un aboutissement. La pièce est en cinq actes. C’est donc une « grande comédie ». D’autre part, la signification morale n’est plus à l’arrière-plan : elle s’affirme, sans dogmatisme, mais avec une force éclatante.
À certains niveaux de sa pièce, Molière reste d’ailleurs fidèle aux traditions. Il va chercher son sujet dans la littérature des contes, et le souvenir de Boccace ou des Nuits plaisantes (Piacevoli Notti) de Straparole est visible. Il emprunte aussi des traits au théâtre italien et l’on a retrouvé dans un recueil de canevas napolitains un sujet qui ressemble de trop près à la pièce de Molière pour que cette rencontre soit fortuite. Mais, d’autre part, L’École des femmes étant une « grande comédie », la tradition exigeait qu’elle contînt des éléments romanesques. Molière ne se dérobe pas devant cette obligation. La fin de son École des femmes, qui n’est certes pas la partie la meilleure de la pièce, s’explique par cette loi du genre adopté.
Mais ce qui fait la haute portée de L’École des femmes, c’est que Molière y met sans ambiguïté une intention morale. Il y décrit une âme de jeune fille, opprimée par d’absurdes routines, qui s’en libère et que l’amour vient éclairer et former. Car le style de vie qu’Arnolphe a imposé à Agnès n’est pas une imagination gratuite et outrancière de l’écrivain. Les vieilles disciplines imposaient à la femme une absolue subordination au mari ; elles lui interdisaient toute culture de l’esprit, elles ne lui permettaient que la lecture des livres de dévotion, que la fréquentation des églises, que la conversation de ses parentes ou de quelques voisines. Depuis plus d’un siècle, la Renaissance avait proposé à la femme un autre idéal ; il avait été accepté par une élite, mais il était encore rejeté par le plus grand nombre. Molière ose prendre parti. Il ne le fait pas par des tirades pédantesques ; il préfère donner le spectacle d’une âme qui se libère, qui découvre la vérité et le bonheur.
Par cette signification donnée à sa pièce, Molière dépasse la gratuité habituelle des comédies contemporaines. Il trouve le moyen d’éclairer et d’émouvoir en donnant une œuvre qui pourtant reste franchement comique. Et son génie est là. En face de la pure et courageuse Agnès, dont l’esprit se dégage, d’acte en acte, des liens qu’une éducation insensée lui avait imposés, Molière place l’absurde Arnolphe, non point terrible, comme certains comédiens l’ont compris, mais fantoche inconsistant et qui fait rire. Il y met Chrysale, en qui des commentateurs ont eu l’étrange idée de voir le porte-parole de Molière, alors qu’il incarne la platitude d’un prétendu bon sens que l’écrivain livre à nos railleries.
Les contemporains virent immédiatement la nouveauté de L’École des femmes et beaucoup crièrent au scandale. Les Comédiens du roi jugèrent intolérable une comédie qui attirait le public parisien et faisait baisser leurs recettes. Mais ce furent surtout les dévots qui se déchaînèrent, et les défenseurs de la vieille morale : ils dénoncèrent en Molière un impie bon pour le bûcher ; ils affirmèrent que sa pièce « blessait nos mystères » ; ils relevèrent en particulier une scène qui leur paraissait une parodie des Dix Commandements. Molière se défendit avec vigueur. Pour répondre à ses ennemis, il fit jouer successivement La Critique de l’École des femmes (1er juin 1663) et L’Impromptu de Versailles (18 ou 19 oct. 1663).
• « Tartuffe » et « Dom Juan »
Plus encore que les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, le parti dévot semblait à Molière l’ennemi à combattre. Non pas simplement pour des motifs personnels. Mais puisqu’il concevait maintenant la comédie comme un tableau satirique de son temps, nul type moderne ne lui paraissait plus digne d’être porté à la scène que le dévot, nul danger pour la paix des esprits ne lui paraissait plus grave que la puissance secrète que ces hommes s’étaient arrogée.
Telle est, en effet, la vraie pensée de Molière lorsqu’au lendemain de la querelle de L’École des femmes il entreprend Tartuffe. Il ne songeait certainement pas, comme on l’a dit parfois, à combattre la religion nationale, ni les croyances chrétiennes. S’il était probablement détaché de tout credo positif, comme l’étaient d’ailleurs la plupart des humanistes, il respectait comme eux, dans la hiérarchie et dans les dogmes de l’Église, une forme, belle entre toutes, noble, indispensable à la paix publique, de cette religion universelle qui était la croyance profonde de l’humanisme.





























