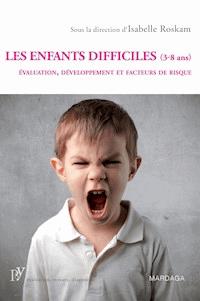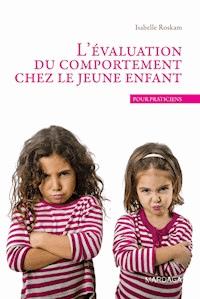Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Un ouvrage pratique pour apprendre à réagir face aux différents comportements de nos enfants.
Agitation, cris, pleurs, agressivité… les enfants ont mille et une façons d’exprimer leur mécontentement ! Et cela s’avère souvent déconcertant pour les adultes qui les entourent. Comment réagir face à ces comportements ? Est-ce l’éducation qui pose problème ? Et surtout, quand faut-il réellement s’en inquiéter ?
S’inspirant à la fois de sa pratique clinique et des dernières recherches scientifiques, Isabelle Roskam répond aux questions posées par les parents inquiets des comportements de leur enfant. Elle commence par aider chaque parent à analyser sa propre situation : mon enfant est-il réellement difficile ? Ses comportements sont-ils normaux ? Elle livre ensuite des clés permettant de comprendre le développement et les agissements de l’enfant, au sein de sa famille et en milieu scolaire. Finalement, elle permet à chaque parent d’appréhender sereinement le comportement de son enfant pour sortir de situations parfois difficiles.
« Il faut se souvenir de l’enfance pour devenir parent et se rappeler que, quoi que l’on fasse, nos enfants auront besoin de nous le reprocher à un moment ou un autre. » Zep, préfacier
Découvrez les réponses d'Isabelle Roskam aux questions que se pose chaque parent sur leurs enfants !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Isabelle Roskam est professeure de psychologie du développement à l’Université de Louvain (Belgique) et a exercé pendant dix ans en tant que clinicienne dans l’unité de neuropédiatrie de l’Hôpital Saint-Luc. Elle dirige aujourd’hui des recherches sur le développement de l’enfant et sur la parentalité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préface de Zep
Votre enfant est difficile ? Qu’est-ce que je devrais dire… ? Le mien se fait convoquer toutes les semaines chez le principal, c’est le virtuose du pétard dans la crotte de chien, la terreur des maîtresses, il est sur la blacklist de toutes les baby sitters.
Il s’appelle Titeuf.
Bon d’accord, Titeuf, c’est un personnage de bande dessinée. C’est pô pareil…
Mais je suis également papa de trois vrais enfants, pas en papier, ceux-là.
Les enfants ont un super pouvoir : ils entendent ce qu’on ne leur dit pas. Instinctivement, ils vont nous emmener dans nos zones de fragilité. Nous faire crier, nous qui ne sommes que patience, nous rendre fous, nous qui ne sommes que raison… nous mettre face à nos contradictions, nous renvoyer dans les cordes de notre propre enfance. Celle dont on ne garde souvent qu’un souvenir très partiel.
Sans qu’on le leur demande, ils vont nous éduquer à devenir des parents.
Depuis vingt ans, je vis une enfance prolongée à travers un personnage de papier, tout en essayant de devenir un bon père de famille. Et bien ce n’est pas si schizophrénique que ça. Il faut se souvenir de l’enfance pour devenir parent et se rappeler que, comme disait Freud (ou mon beau-frère, je ne sais plus) quoi que l’on fasse, nos enfants auront besoin de nous le reprocher à un moment ou un autre.
Et dites-vous que, quoi qu’il arrive, vos enfants grandissent et finiront par devenir parents eux-mêmes d’enfants qui leur feront voir du pays !
Vous voyez, il y a une justice.
Sauf pour le mien, Titeuf, qui a 10 ans depuis vingt ans et ça ne l’arrange pas !
Zep est auteur de bandes dessinées.
Il est, entre autres, le père du célèbre Titeuf (13 albums parus chez Glénat).
Introduction
Imaginez que vous êtes dans la salle d’attente de votre dentiste. Une mère et son enfant de 3 ans attendent leur tour. Le dentiste a un peu de retard et l’attente semble manifestement insupportable à l’enfant. Il bouge sans cesse, grimpe sur les chaises, les déplace bruyamment, se couche par terre en geignant, met du désordre dans les magazines mis à disposition, sautille autour de la table basse… Qui n’a jamais été confronté à pareille situation ? Dans les salles d’attente, mais aussi dans les grandes surfaces, au cinéma, au restaurant, dans les halls de gare, aux arrêts de bus, dans les plaines de jeux : on peut croiser ces enfants « perturbateurs » partout. Ils dérangent, ils perturbent le bon fonctionnement des choses, ils ne nous laissent pas en paix. Et c’est probablement la raison pour laquelle la thématique des « enfants difficiles » intéresse – et irrite ! – autant. En quinze ans d’activités professionnelles, j’ai eu maintes fois l’occasion de m’en rendre compte. Le comportement de ces enfants interpelle tout le monde : leurs parents bien entendu, les enseignants qui doivent les gérer dans leur classe au quotidien (en évitant de tomber dans le burn-out !), les professionnels consultés, qui peuvent proposer sinon des solutions, du moins une approche compréhensive de la problématique,… sans oublier les adultes qui ont autrefois eux-mêmes été considérés comme des gosses compliqués, voire des « sales gosses ». Mais au-delà de ces différents publics, il est évident que la société tout entière manifeste un intérêt – teinté d’agacement – pour ces enfants et les difficultés qu’ils posent, et ce jusqu’au responsable politique qui se demande s’il ne faudrait pas mettre en œuvre des mesures de prévention pour ces enfants qui sont peut-être sur la voie de la délinquance !
Chacun se targue d’avoir un avis à faire valoir sur la question. Ne raconterez-vous pas le soir à votre conjoint à quel point votre attente chez le dentiste fut pénible ? Et ne serez-vous pas tenté d’attribuer le comportement insupportable de cet enfant à l’inefficacité de ses parents ? Le responsable politique, lui, s’entourera de spécialistes pour faire émerger une voie à suivre… qui ira de préférence dans le sens de son électorat.
L’intérêt débordant pour le sujet fait bien mon affaire, je dois l’avouer… La thématique me passionne, j’y ai consacré l’essentiel de mes activités de recherche depuis 2004, et de mes activités cliniques durant dix ans. Peut-être cela me donne-t-il l’occasion de me sentir utile à la société ? (Une chance qui n’est pas forcément donnée à tous les chercheurs, il faut bien le reconnaître).
Méfions-nous des idées simplificatrices…
Je n’en suis pas venue à me préoccuper des enfants difficiles par hasard. Il se fait que j’ai commencé ma carrière de psychologue par une thèse de doctorat qui portait sur le développement de la personnalité chez les enfants et sur les idées que s’en faisaient les mères. Certaines pensaient par exemple que la personnalité de leur enfant était due à celle du père (« Il est très bavard, c’est tout son père. ») et attribuaient donc ses traits à une sorte de fatalité génétique ; d’autres pensaient que la personnalité de l’enfant était malléable et que son caractère dépendait essentiellement de la manière dont elle-même l’éduquait (« Il est assez bavard parce que je lui ai toujours raconté des histoires et que nous avons beaucoup parlé avec lui. »).
Cette thèse de doctorat m’a beaucoup appris, en particulier sur l’influence des « croyances parentales » sur le développement des enfants. En effet, si l’on revient aux deux exemples que je viens de mentionner, il est évident qu’ils ont des implications très différentes sur la relation que chacune de ces mères noue avec son enfant. Dans le premier cas, la mère qui se trouvera face à des traits problématiques comme un caractère colérique prendra sans doute peu d’initiatives éducatives puisqu’elle pense que les colères de son fils reposent sur des facteurs hérités. Dans le second cas, par contre, la mère, dans une situation similaire, aura tôt fait de proposer des réponses éducatives pour tenter d’infléchir la tendance colérique de son enfant.
Le recours aux croyances concernant le comportement des enfants n’est pas l’apanage des parents. On l’a dit déjà, n’importe quel quidam a un avis sur le sujet. Pourquoi ? Parce que notre cerveau humain est ainsi fait que nous cherchons à donner du sens et une explication aux expériences que nous vivons. Ces croyances – surtout pour les situations qui ne nous concernent pas directement – se forment de manière automatique et échappent le plus souvent à notre conscience. Ainsi, une personne sans enfant ou un parent dont l’enfant se développe sans embûche peut se permettre d’avoir sur le développement des enfants des croyances simples : « On a les enfants qu’on mérite ! » Son expérience de vie ne les a jamais démenties, il n’a donc pas besoin de les remettre en question… Il n’en va pas de même pour un parent confronté à un enfant rebelle. Ses expériences quotidiennes démentent l’idée simple selon laquelle il suffit d’avoir de bons principes éducatifs pour que l’enfant soit parfait. Il devient nécessaire de remettre cette idée en cause, de la nuancer, de la réélaborer, de la complexifier. Dès lors, les croyances simples des autres sont perçues comme injustes, voire blessantes.
C’est ainsi que nos croyances spontanées sont responsables de nombreuses stigmatisations dans la mesure où elles simplifient parfois dangereusement la réalité. Ce type de stigmatisation, les parents d’enfants difficiles le vivent régulièrement, que ce soit de la part du quidam croisé chez le dentiste, ou de la part des enseignants. Ils se sentent mis en cause, montrés du doigt comme s’ils portaient toute la responsabilité des débordements de leur enfant. Comme nous le verrons tout au long de cet ouvrage, les choses ne sont évidemment pas aussi simples.
Le cheminement d’une réflexion
Revenons-en à mon parcours. Parallèlement à l’élaboration de ma thèse de doctorat, j’ai travaillé comme psychologue clinicienne dans une équipe multidisciplinaire de neuropédiatrie au sein d’un hôpital universitaire. J’y ai procédé pendant dix ans à des examens d’enfants pour dépister des troubles du développement et des troubles du comportement. Très rapidement, mon intérêt scientifique pour les croyances des parents m’a amenée à proposer des consultations de guidance parentale. Elles avaient pour objectif d’accompagner les parents dont les enfants étaient traités dans le service de neuropédiatrie par des orthophonistes1, psychomotriciens ou d’autres psychologues. Il s’agissait de leur offrir une aide dans le cheminement difficile mais nécessaire qui s’impose à tous ceux dont un enfant est en échec scolaire, doit être réorienté en enseignement spécial, présente des comportements atypiques, se montre dépressif ou anxieux, ou est « simplement » intenable. Ces consultations rencontraient en général beaucoup de succès auprès des parents. Nous y travaillions les représentations que la mère et le père avaient de l’enfant et de son avenir proche ou lointain, les croyances liées à son développement, les raisons qui avaient conduit – selon eux – aux problèmes dont souffrait l’enfant, les enjeux de leurs relations familiales tant dans le couple qu’avec l’enfant et la fratrie. J’ai beaucoup apprécié ces consultations. Elles me donnaient l’occasion d’opérationnaliser mes travaux scientifiques et les nombreuses lectures qu’impose la réalisation d’une thèse de doctorat. À l’inverse, je revenais dans mon bureau à l’université avec de nouvelles questions théoriques et de nouveaux défis de recherche suscités par les rencontres avec les familles. Le va-et-vient entre la clinique et la recherche fut un enrichissement inénarrable.
Et tandis que je profitais de cette double appartenance, je suis aussi devenue mère. J’ai touché là une autre dimension, celle de l’empathie. Bien sûr, mes études de psychologie m’avaient déjà préparée à me montrer empathique envers les patients, mais l’expérience personnelle de la parentalité m’a permis de vivre de l’intérieur tout ce qu’elle suppose de bonheur et d’angoisse. J’ai moi aussi, car nul n’y échappe, développé des croyances plus ou moins justes concernant le développement de mes enfants, j’ai dû prendre des décisions éducatives et je me suis parfois trompée en voulant néanmoins faire de mon mieux. Il en est ainsi dans la plupart des familles, je pense. Hormis quelques parents foncièrement maltraitants ou pervers, tous les parents veulent le meilleur pour leur progéniture. Ils s’efforcent de faire des choix justes et facilitateurs pour que leur enfant s’épanouisse et progresse. Tous ces choix sont forcément discutables ; ils ne reposent pas sur une science exacte. Nous ne pouvons faire que de la guidance, conseiller et accompagner. Proposer des recettes toutes faites et donner des leçons ne relève pas de la psychologie mais de la morale.
Parmi mes expériences parentales, j’ai aussi goûté à la difficile conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. J’ai développé une empathie particulière vis-à-vis de ceux qui repartaient des consultations effectuées dans notre service avec des recommandations thérapeutiques impliquant deux, voire trois séances par semaine pour un seul enfant de la fratrie. J’ai parfaitement mesuré alors le défi que cela représente pour des familles dont les parents sont actifs sur le plan professionnel, les sacrifices que cela implique et la culpabilité qui rôde lorsqu’on fait le choix de ne pas suivre toutes les recommandations prescrites par les spécialistes !
Petit à petit, comme beaucoup de professionnels de la santé qui accumulent de l’expérience, mes consultations tant en évaluation diagnostique qu’en guidance parentale se sont spécialisées sur un public-cible particulier. Mes activités cliniques se sont massivement concentrées sur les enfants présentant des troubles du comportement. La raison de ce ciblage ne résulte pas d’une augmentation du nombre d’enfants difficiles dans l’absolu. Nous reviendrons plus loin sur la question de savoir si ces enfants sont plus nombreux que par le passé. Le ciblage progressif est plutôt lié au fait que les neuropédiatres prenaient petit à petit connaissance de ma pratique en guidance parentale et qu’ils trouvaient judicieux de m’adresser les enfants difficiles et leurs parents. Ces derniers avaient, dans la majorité des cas, besoin d’être écoutés dans leurs défis éducatifs quotidiens.
Naissance d’un projet de recherche
En réalité, la fréquence des consultations liées à des difficultés de comportement chez des enfants très jeunes, dès 2 ou 3 ans, a toujours été élevée dans notre service. Après avoir éliminé des causes de type neurologique comme l’épilepsie, les neuropédiatres avaient pour habitude d’orienter ces enfants vers des séances de psychomotricité. Ces séances étaient destinées à les aider à structurer leur comportement et à diminuer leur agitation. Ce type d’orientation reposait sur deux arguments. Le premier est qu’il n’est pas toujours souhaitable de s’alarmer quand l’enfant est en très bas âge. Dans beaucoup de cas, on peut en effet parier sur les effets bénéfiques de la maturation qui est évidemment loin d’être achevée. Nous reviendrons plus longuement sur cette question dans la suite de ce livre. Dans cette optique, avant l’entrée à l’école primaire, on ne cherche ni à effectuer une évaluation diagnostique spécifique, ni à mettre en œuvre des prises en charge thérapeutiques. Le second argument est qu’il n’existe pas à ce jour de traitement ou de rééducation spécifique des troubles du comportement pour le petit enfant. Dans ce contexte, la psychomotricité reste une intervention de première intention.
Au fil des années, nous avons dressé plusieurs constats importants.
Premièrement, de nombreux parents qui avaient déjà consulté précocement lorsque l’enfant avait 2-3 ans, revenaient quelques années plus tard parce que les difficultés de comportement persistaient. Ni la maturation spontanée, ni les séances de psychomotricité n’avaient véritablement résolu le problème. C’est dans cette perspective que la guidance parentale s’est imposée comme une intervention utile, en complément ou comme alternative à la psychomotricité. Les familles de ces enfants ne savent souvent plus quelles réponses éducatives proposer pour cadrer les comportements à problèmes et la guidance apporte un lieu d’échange propice. Elle permet de rencontrer cette demande : réfléchir ensemble aux sollicitations à adresser à l’enfant, à l’opportunité des punitions ou des récompenses, à la qualité de la relation parent-enfant.
Deuxièmement, les parents d’enfants difficiles consultaient notre service de neuropédiatrie mais également celui de psychiatrie infanto-juvénile du même hôpital. En se penchant de plus près sur les raisons pour lesquelles les uns choisissaient la neuropédiatrie et les autres la pédopsychiatrie, j’en suis revenue aux croyances parentales que j’évoquais plus haut. En effet, il semble que l’orientation vers l’un ou l’autre service reposait sur les raisons évoquées par les parents pour rendre compte des difficultés de comportement. Schématiquement, les parents consultant les neuropédiatres évoquaient spontanément des explications biologiques telles que l’immaturité, ou génétiques comme la transmission d’une hyperactivité par l’un des deux parents. Ce type d’explication était souvent accompagné d’une attente logique en termes de traitement médicamenteux. Les parents consultant les pédopsychiatres, pour leur part, mettaient davantage les comportements difficiles de l’enfant sur le compte d’un conflit interparental, d’un climat familial stressant ou d’un événement de vie traumatisant tel qu’un déménagement. Ce type d’explication était alors accompagné d’une attente logique en termes de thérapie familiale ou individuelle de l’enfant. Comme nous le verrons dans le chapitre 6 consacré aux causes des comportements difficiles, ces explications données spontanément par les parents doivent être confrontées au bilan diagnostique. Un travail préalable centré sur les représentations du trouble qu’elles génèrent est essentiel si on veut construire une alliance avec les parents et espérer rencontrer leurs attentes.
Troisièmement, il nous a rapidement semblé utile, avec quelques collègues, de faire des observations plus systématiques de ces enfants. Nous étions en effet dans l’impossibilité de répondre aux questions récurrentes des parents. Comment ces troubles évoluent-ils à mesure que l’enfant grandit ? Disparaissent-ils avec le temps ? D’où viennent ces troubles ? À partir de quels critères peut-on considérer qu’ils sont normaux ou au contraire pathologiques ? Comment répondre aux sollicitations de l’école, à la souffrance des frères et sœurs ? Comment gérer le stress que cela provoque dans la sphère du couple ? Comment peut-on soigner, pour autant que cela se soigne ?
Ces différentes questions seront tour à tour abordées dans le présent ouvrage.
Et si nous sommes aujourd’hui en mesure de les traiter, c’est que nous avons investi beaucoup d’énergie et de temps dans des activités scientifiques de recherche visant le développement de ces enfants. Comment avons-nous concrètement procédé ? Nous avons proposé à tous les parents qui venaient consulter avec des enfants « difficiles » de 3 à 5 ans de prendre part à une observation systématique pour une durée de trois ans. Sans grande difficulté tant la demande était forte, nous avons enrôlé plus de 120 familles issues de ces consultations en l’espace de dix mois. Nous les avons rencontrées deux fois par an pendant trois années consécutives. Cela nous a permis d’observer comment ces enfants grandissaient, ce qu’il advenait de leurs comportements difficiles, de leur expérience scolaire, et de leurs relations familiales. Parallèlement, nous avons également recruté, avec l’aide de plusieurs écoles, 300 enfants contre lesquels aucune plainte liée au comportement n’avait été formulée par les parents ou l’enseignant. Ces enfants dits « témoins » nous ont donné des éléments de comparaison notamment pour démêler le normal du pathologique. Tous ces enfants, les 420, ont été soumis à un même « protocole », ce qui est inévitable lorsqu’on souhaite utiliser des données à des fins de recherche. Malgré les contraintes incontournables liées à la standardisation de la recherche, les enfants et leurs parents ont bénéficié d’une évaluation diagnostique approfondie et d’un suivi qui répondait à leurs préoccupations.
Sur le plan scolaire, des visites annuelles ont été rendues à tous les enfants. Elles nous ont permis de les observer dans leur classe et dans la cour de récréation avec leurs copains, et en relation avec trois enseignants durant les trois années de recherche consécutives. Ce fut également l’occasion de partager des échanges de vues avec les enseignants à propos des défis d’éducation que posent ces enfants. Quatre doctorants ont consacré leur thèse à l’analyse précise de toutes les données ainsi collectées.
Le programme de recherche« H2M Children » dont l’acronyme doit se lire « Hard-to-manage children » a été initié en 2004 par des chercheurs et des cliniciens de l’université de Louvain (UCL). Il ambitionnait de comprendre le développement des comportements difficiles chez les jeunes enfants, ses causes et leur traitement.
La collaboration avec les cliniciens de neuropédiatrie et de psychiatrie infanto-juvénile fut également très étroite durant toutes ces années. Les chercheurs œuvrent pour mettre en évidence des relations entre des phénomènes qu’ils observent et les cliniciens ont un sens inégalé de l’interprétation. Les découvertes scientifiques n’ont aucun intérêt si la signification même de ces relations ne peut être établie. C’est en cela que le tandem chercheurs-cliniciens est performant ! Les uns observent de manière systématique et relient les phénomènes observés entre eux, les autres donnent du sens au contexte de l’observation et aux processus en jeu.
Le besoin de communiquer
Le tandem chercheurs-cliniciens a également porté ses fruits en favorisant la diversification des publications au sujet des enfants difficiles. Car un projet tel que celui que j’ai initié et piloté n’a de sens que s’il mène à de nouvelles connaissances en répondant notamment aux questions qui ont présidé à sa mise en œuvre. Ces réponses et connaissances doivent ensuite être communiquées. À qui ? Les publics sont multiples et les publications doivent s’y adapter.
Il y a d’abord les autres chercheurs universitaires. Nous sommes tous tenus de rendre compte de nos travaux dans des revues scientifiques internationales. C’est à partir de ces publications que la portée et la qualité de notre carrière est évaluée. Elles permettent aussi de nombreux et stimulants échanges entre chercheurs et équipes scientifiques partout dans le monde.
Mais si importantes soient-elles, ces publications sont peu accessibles, tant dans leur forme que dans leur fond, à beaucoup de professionnels comme les enseignants, les éducateurs et même les cliniciens. Pour deux raisons principales : elles sont majoritairement en anglais et elles sont obligatoirement focalisées sur des micro-hypothèses que nous lançons et que nous testons. Il faut donc en lire de grandes quantités pour faire le tour d’un problème aussi vaste que complexe. Et pour cela, il faut beaucoup de temps. Les enseignants, les éducateurs et les cliniciens en manquent ! Un deuxième type de publication s’adresse justement à ces professionnels, ceux qui accompagnent au quotidien les enfants difficiles et leur famille. Notre tandem chercheurs-cliniciens a permis la rédaction de plusieurs articles et d’ouvrages dont la forme et le fond se sont adaptés aux attentes de cette catégorie professionnelle, en leur donnant l’occasion de comprendre les mécanismes sous-jacents, de documenter leur pratique, et d’opérationnaliser les connaissances qui leur sont communiquées dans une activité diagnostique et d’intervention.
Enfin, un troisième type de public qu’il faut absolument toucher, c’est le « grand public » : les parents ou toute personne intéressée par le sujet. Il faut leur communiquer ce que nous savons… et tout ce que nous ne savons pas encore. Il le faut parce que, je l’ai dit, ils sont nombreux à s’y intéresser et à être concernés ! C’est la raison d’être du présent ouvrage…
1. Les orthophonistes sont appelés « logopèdes » en Belgique et « logopédistes » en Suisse.