1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
et d’adaptation réservés pour tous pays.
Mercredi 20 Mars 1968.
Ivan me serra contre lui pour essayer de me protéger.
« FLN VAINCRA ! US ASSASSINS ! »
Dans la bousculade, nous avions perdu les camarades. Des inconnus, le bas du visage caché sous un foulard scandaient les slogans. J'avais trop peur pour participer. Un fracas de verre brisé me fit me recroqueviller de terreur.
— Les vitrines de l’American Express ! Vite, il faut filer !
Ivan me broyait la main. Il fallait vite se dégager de la foule des manifestants et fuir. Impossible de descendre dans la station Opéra noire de monde. Nous avons couru droit devant nous dans l’espace dégagé du boulevard des Italiens jusqu’à Bonne Nouvelle.
— Je n’en peux plus ! Si j’avais su, je ne serais jamais venue à cette manif !
Dans le métro, à bout de souffle, je m’écroulai sur un strapontin.
— Tu crois que tout le monde a réussi à se sauver ?
— Je n’en sais rien. J'ai vu des CRS !
— Tu savais ce qui nous attendait, toi ?
— Pas vraiment. Mais j’aurais dû m’en douter. Trop bizarres tous ces rendez-vous différents ! En tout cas, pas question que tu rentres seule. Je vais à Soisy avec toi.
— Ton studio va s’ennuyer !
Nous avons ri. Mon frère, je l’adorais.
— Pourvu qu’ils n’en parlent pas à la télé. Maman serait trop inquiète !
Samedi 23 Mars 1968.
Depuis cinq mois je travaillais à la banque. Cinq mois que j’avais perdu mon père. Cinq mois que ma vie ne ressemblait plus à rien.
Maman était chez la voisine. Elle y avait passé l’après-midi. Moi, j’avais passé tout ce temps-là à pleurer. J’étais censée étudier mes maths et mon français. Mais je ne comprenais plus rien et je n’en pouvais plus. Pourtant mes notes étaient honorables. Ils étaient plutôt sympas les profs du CNED, mais je n’y arrivais pas. Jamais je n’obtiendrais mon bachot. C’était trop difficile.
La porte d’entrée grinça. Maman arrivait.
— Pauline, c’est moi ! Où es-tu ?
J’ai foncé dans la salle de bain pour voir la tête que j’avais et suis restée consternée devant mon nez rouge et mes yeux ravagés. Cette fois-ci, impossible de cacher à maman mon occupation de l’après-midi. De toute façon, je devais lui dire. Je suis allée la retrouver dans la cuisine.
— Que t’arrive-t-il ma chérie ? Tu as pleuré ?
— Mes cours sont trop difficiles. Je n’y arrive pas.
J’ai respiré un grand coup et ajouté :
— Voilà, j’ai décidé : j’abandonne.
— Tu as raison ma puce, tu pourras profiter de tes week-end. Je ne voulais pas te décourager, mais…
— Non !
Tournant le dos à maman, j’ai couru me réfugier dans ma chambre. Sa réaction me blessait. Elle savait pourtant à quel point j’y tenais à mon bachot. Comment pouvait-elle se réjouir que j’abandonne ? Mon père nous avait toujours poussés mon frère et moi dans nos études. Il rêvait pour nous de carrières d’enseignants. Mon objectif était d’être institutrice. Quand j’avais raté le concours d’entrée à l’École Normale, j’avais cru tout perdre. Mais papa m’avait consolée. Je suivrais les traces de mon frère. J’irais à la fac. Allons bon, les larmes débordaient. Mon mouchoir sale plaqué sur la bouche, j’essayais d’étouffer le bruit de mes pleurs. Comme j’aimerais être encore l’année dernière. Je profiterais d’avantage de mon père.
Mon regard se porta sur la table qui me servait de bureau. Mes cours, mes cahiers s’y étalaient. D’un geste rageur, j’ai tout envoyé valdinguer par terre et me suis jetée sur mon lit.
— Papa. Pourquoi m’as-tu abandonnée ?
Plus tard, pour me calmer, je me suis brossé les cheveux devant la glace de mon armoire. J’ai regardé de tout près mon visage se décomposer peu à peu et disparaître derrière une buée impalpable. Je me trouvais presque belle avec mes yeux marrons si tristes.
Dimanche 24 Mars 1968.
Une journée perdue. Les copains des Bleuets étaient allés à Paris et j’étais restée cloîtrée à la maison pour subir la visite de ma tante, de mon oncle et de mon petit cousin. Ils avaient apporté des gâteaux. Maman et sa sœur avaient passé l’après-midi à bavarder, racontant pour la millième fois les souvenirs de leur jeunesse.
— Tu te rappelles Tihou ?
— Et comment ! Papa avait failli le tuer quand il avait égorgé toutes les poules du poulailler.
— Maman et moi nous lui retenions les mains, et toi, tu étais partie chercher grand-père !
Tihou, c’était leur chien quand elles avaient 10 et 11 ans. De l’histoire ancienne. Elles racontaient toujours les mêmes choses. Avant, j’adorais les dimanches en famille à la maison. Je ne comprenais pas l’attitude d’Ivan qui préférait sortir avec ses copains. Encore moins celle de papa, qui, la plupart du temps partait se balader en mobylette, seul. Papa… Depuis sa mort, la vie ne m’intéressait plus.
— Tu viens te promener ? ai-je demandé à Gérard.
— Si tu veux, m’a-t-il répondu, surpris et enchanté.
Il faut dire que d’habitude, j’évitais de m’occuper de ce sale gosse. Une vraie tête à claques. Il avait 8 ans et était le dernier né de ma tante. Chouchouté à mort, il avait tous les droits et ne manquait jamais l’occasion d’empoisonner mes dimanches. Mais j’en avais assez d’être assise là à écouter nos mères. Et depuis la mort de mon père, j’en voulais un peu à ma tante.
Lundi 25 Mars 1968.
Était-ce cela la vie ? Comme chaque jour de travail, j’étais arrivée au bureau à huit heures et demie. Après avoir suspendu mon manteau dans mon vestiaire et enfilé ma blouse, j'avais signé la feuille de présence, serré la main de mes collègues et m’étais installée à mon bureau. Mes affaires sorties, j’avais pris la pile d’ouvertures de comptes distribuée par la chef pour tout codifier.
Je ruminais. Quand la banque m’avait embauchée, j’avais effectué un stage de trois mois à l’école de dactylographie. J’aimais bien. Les quarante mots à la minute atteints, l’examen en poche, j’avais été affectée à ce service. Mais je ne tapais jamais à la machine ! Une semaine par mois, je perforais des fiches, le reste du temps je codifiais des ouvertures de comptes et des rectificatifs d’adresses. Travail automatique. Quand, par chance, le client était d’une nationalité peu courante, je consultais des fiches. Pour les rectifs, s’il s’agissait de Paris, je devais vérifier les arrondissements dans un livre et parfois, je m’attardais sur les cartes. Bien sûr, c’était interdit. Tout était interdit.
La matinée se traînait. Vers dix heures, je m’octroyais une pause en mangeant quelques biscottes apportées de la maison. L’idéal aurait été de sortir boire un café à l’extérieur, mais c’était interdit. Quand enfin arrivait midi, nous avions une heure un quart pour déjeuner. Qui passait à toute allure. C’était le seul moment agréable de la journée. Dans le service, nous étions environ une trentaine de personnes réparties en groupes de huit. Six employés, un chef de groupe et un sous chef de groupe. Les chefs étaient des vieilles. Au moins quarante ans. La chef de section, une vieille fille, Mlle Ritz que nous avions surnommée Ritzou avait comme rôle principal de nous empêcher de vivre. Heureusement que la majorité des employés était jeune. La moyenne d’âge tournait autour de 16 ans. La différence entre mes collègues et moi, c’était qu’eux étaient entrés dans la banque par choix. Ils en avaient assez d’étudier. Le BEPC en poche, ils avaient choisi de travailler. Pas moi. J’avais 17 ans et avant, j’étais en terminale au lycée. J’allais passer mon bac et continuer mes études quand la mort de mon père avait tout changé.
La sonnerie de l’heure de déjeuner retentit. Comme au lycée, des sonneries rythmaient les heures de la journée.
— Tu viens Pauline ?
— Attends, je n’ai pas ma carte de réfectoire !
J’ai fouillé dans mon tiroir, l’ai trouvée et me suis levée d’un bond pour sortir à la suite de Françoise.
— Mesdemoiselles ! a crié la chef.
— Oui ?
— Essayez d’être à l’heure pour une fois. Sinon, je serais obligée d’en parler à monsieur Magnard.
C’était le chef de service, un vieux monsieur aux cheveux blancs auquel il valait mieux ne pas avoir affaire !
— Oui, oui.
Nous avons dévalé l’escalier, traversé la rue et sommes entrées dans l’immeuble du réfectoire. À la porte, un groupe de jeunes distribuait des tracts.
J’en ai pris un et l’ai parcouru rapidement. C’était un tract CGT qui parlait des revendications de salaires. Rien de passionnant. Moi, c’était la politique qui m’intéressait et surtout la guerre au Vietnam. J’ai tendu le tract à ma collègue.
— Ça parle de quoi ? m’a-t-elle demandé.
— Des salaires.
— Bof. Toujours les mêmes salades. Au fait, tu as vu ? Danièle, c’est la chouchoute de Ritzou. Oh, tu sais, il paraît qu’il va y avoir un nouveau ! J’espère que ce sera un mec et qu’il sera jeune et sympa.
J’ai disposé les assiettes, le verre, les couverts, mon pain sur la table et suis allée poser mon plateau sur les autres. Aujourd’hui, rien ne me tentait et j’avais pris du jambon avec de la salade et un fromage blanc.
— Tiens, je ne savais pas que tu faisais attention à ta ligne. Maigre comme tu es, tu n’en as pas besoin ! Tu ne connais pas ta chance. Moi, je n’arrête pas de grossir, mais je suis si gourmande !
Françoise je l’aimais bien, mais parfois elle me fatiguait. D’autres collègues du service nous ont rejointes. J’ai avalé mon dessert en vitesse et me suis levée.
— À tout à l’heure !
Chaque midi, au lieu d’aller boire un café avec les autres, je me réservais du temps pour moi toute seule. J’adorais flâner sur le boulevard des Italiens. De nombreuses librairies, des disquaires qui vendaient également des partitions de musique. J’entrai dans la plus grande librairie, examinai les livres, survolai les résumés avec dans ma tête la chanson d’Yves Montand : « J’aime flâner sur les grands boulevards. Y’a tant de choses, tant de choses à voir. » Bien sûr, je n’achetais rien. Les seuls livres que je m’autorisais à m’offrir, c’était des livres de poche. Un coup d’œil à ma montre : déjà 13h10. J'avais juste le temps de rejoindre mon bureau en courant.
Je signai de nouveau la feuille de présence et déjà l’après-midi s’éternisait. 18 heures, enfin. L’heure de sortie. Métro, train de banlieue et enfin la maison.
Ma journée à la banque s’écoulait de cette façon, monotone et terne. Comment envisager ma vie entière ainsi ? J’aurais voulu qu’il se passe quelque chose pour briser cette routine.
Vendredi 29 Mars 1968.
Ce soir, à la MJC, c’était soirée ciné-club et bien-sûr, Ivan était présent. Il ne loupait aucune séance. Aujourd’hui, au programme :Contes de la lune vague après la pluiede Misogushi.
Une fois rentrée du travail, j’avais retiré ma jupe et mon pull noir (j’étais toujours en deuil) pour enfiler un blue-jean. Ma tenue préférée. Cela aurait été sensass d’aller travailler habillée de cette façon. Mais dans une banque, c’était inimaginable. Le pantalon était à peine toléré, alors le blue-jean ! Jamais ce ne serait possible.
Le ciné-club se passait dans la salle de cinéma des Bleuets. C’était Marie-Claude, mon amie du lycée, qui l’année dernière m’avait amenée à la Maison des Jeunes. Depuis, j’y passais beaucoup de temps. L’ambiance était sympa et les activités nombreuses : outre le ciné-club déjà cité, équitation le dimanche matin dans la forêt de L’Isle Adam, jeux de société, musique, etc. Tous les adultes responsables de la MJC étaient politisés et nous discutions beaucoup. De tout. Nous refaisions le monde. Parfois les discussions étaient plus qu’animées. Au début, je ne comprenais pas tout et n’osais pas me mêler aux discussions. J’écoutais. Depuis, j’avais décrypté. Daniel était au P.C., Ivan, Paul et Claude au PSU. Les autres, moi itou, avaient adhéré au CVN. Le Comité Vietnam National. J’hésitais à devenir membre du PSU. Ivan discutait beaucoup avec moi et essayait de m’aider à franchir le cap. Mais la politique je n’y connaissais pas grand chose et c’était sérieux. Les camarades m’avaient donné à lire.Le manifeste du Parti Communistede Karl Marx etQue faire ?de Lénine. Moi qui passais ma vie à lire, j’avais un mal fou à m’intéresser à ces bouquins-là. Maintenant que j’avais laissé tomber mes cours pour le bac, peut-être. Enfin, quand j’aurais fini de lire Sartre. J'en étais àRéflexions sur la question juiveet là, pas besoin de décodeur.
Mon père me manquait. Lui, il s’y connaissait en politique. Chaque jour, il lisaitCombatet me commentait les grands événements. Comme il serait heureux de la situation actuelle. En Europe, aux USA, tout bougeait. Il y avait manif sur manif. J’aurais dû discuter davantage avec lui et l’écouter parler de sa grande grève.
Samedi 30 Mars 1968.
Je n’avais pas dit au lycée que j’avais abandonné les cours du CNED et comme chaque samedi matin, j’étais allée rejoindre mes anciens camarades pour participer au cours de gym. Je m’y étais rendue à pied, car ma mobylette avait refusé de démarrer. J’avais salué Jojo, Nicole, Christian et Patrick. Patrick était toujours aussi craquant. Il m’avait fait un petit signe amical. Mes idées vagabondaient. J’avais passé toute une année scolaire avec lui, dans la même classe, sans jamais réussir à lui parler une seule fois. Parler réellement, je veux dire. Pourtant il m’intéressait. Maintenant que nous n’étions plus dans le même monde, lui toujours au lycée, moi, dans ma banque, comment aurions-nous pu devenir amis ?
Coude à coude avec Marie-Claude, j’ai couru 500 mètres, au lieu des 600 imposés à l’examen car j’étais hyper essoufflée. Elle en a profité pour s’arrêter elle aussi. Patrick nous a rejointes.
— J'ai bien vu que vous aviez écourté le parcours !
— Tu vas nous dénoncer au prof ? a rigolé Marie-Claude.
Patrick a souri.
— Il est marrant ton gilet, a-t-il dit à Marie-Claude en désignant les multiples petits boutons qui le fermaient. Il a souligné sa phrase en passant son doigt rapidement dessus. Marie-Claude a ri et Patrick est parti rejoindre ses copains.
Je suis restée rêveuse. C’était sans doute là que se situait ma différence. Si Patrick avait eu ce geste envers moi, je serais devenue écarlate en imaginant toutes sortes de choses sur notre relation. Marie-Claude, elle, avait eu l’air de n’y attacher aucune importance.
Nous rentrâmes ensemble. Pour elle, la vie continuait comme l’année dernière. Les mêmes élèves, les mêmes cours. Seuls les profs n’étaient pas exactement les mêmes. Pendant que je m’ennuyais au bureau, elle était en classe et écoutait les cours.
— C’était bien le ciné-club hier soir ? m’a-t-elle demandé.
— Oui. Tu as raté. Le présentateur était marrant. Il avait des cheveux longs, un pantalon large, une veste étriquée. Un peu timide mais très intéressant.
— Ivan était là ?
— Ben oui, comme d’habitude.
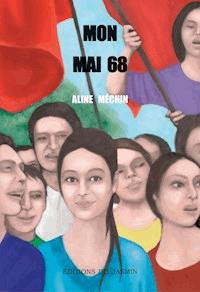













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















