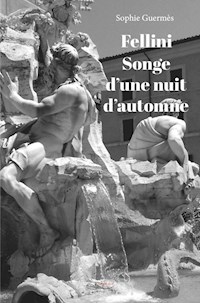Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au début des années 1630, Venise subit une épidémie de peste qui dura seize mois. La narratrice l’apprend en lisant un livre rapporté d’un séjour dans la Sérénissime en février 2020. Le carnaval a été interrompu par l’annonce d’une possible pandémie. Elle et ses enfants, placés en quarantaine à leur retour, habitent une autre lagune, en France ; ils espèrent reprendre rapidement une existence normale. Le temps semble toutefois retourner en arrière : les événements qu’ils vivent entrent en résonance avec ceux que relate la chronique vénitienne. Parmi les survivants, le musicien Claudio Monteverdi, indirectement lié à l’arrivée du fléau dans la ville, a pris une décision capitale. Ce roman déroule le fil d’imperceptibles changements qui mènent à des transformations radicales. Les contagions se propagent à bas bruit ; une union insensiblement se défait, une autre s’affirme, au terme d’un long cheminement intérieur. « Nous sortions de quarantaine pour entrer en confinement. Mais aux confins de quelle contrée, sinon de nous-mêmes ? »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Professeure d’université, auteure d’essais sur la littérature,
Sophie Guermès a aussi écrit plusieurs ouvrages de fiction qui suivent le cours de modifications silencieuses, et dans lesquels l’art tient une place importante : "La Loge" (L’Harmattan, 2002), "Les Ombres portées" (Triartis, 2016), "Bucarelli-Roma" (Les Éditions du Littéraire, 2018), "Fellini. Songe d’une nuit d’automne" (5 sens, 2021).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophie Guermès
MONTEVERDI
VENISE, 1632
Du même auteur
– Fellini, Songe d’une nuit d’automne
5 Sens Editions, 2021
« La vie intérieure de l’homme a sa dynamique, tout s’accomplit en lui en son temps, lentement. »
Wanda Półtawska
I
« Venise, oui, c’est une bonne idée, les enfants sont suffisamment grands pour l’apprécier, maintenant ; il faudra simplement veiller à ne pas les faire trop marcher… »
Ma mère approuvait mon choix ; elle échappait aussi à la corvée de les garder – corvée que, dans ma grande magnanimité, ou indépendance, ou sollicitude, ou peut-être un peu des trois, je lui épargnais, à elle et à mon père, le plus souvent. Mes parents coulaient ainsi des jours paisibles, car, par le hasard d’une situation géographique assez inédite, c’était eux qui habitaient Paris, et nous la province : un village de bord de mer plus associé à l’image des vacances qu’à celle de la vie quotidienne.
Matthias était au Japon. Il y donnait, en français, des conférences pour la troisième année consécutive, et s’était pris pour ce pays d’un engouement singulier. L’idée d’en apprendre la langue, ne serait-ce que ses rudiments, ne l’avait pas effleuré, il avait eu l’air surpris quand je lui en avais parlé. « Quand on aime un pays, on est curieux de tout ce qui s’y rapporte. On apprend sa langue, c’est naturel, c’est logique.
– Pas forcément… »
Il ne semblait pas convaincu. J’insistais. Nos opinions divergeaient. C’était le signe, ténu mais évident, d’une incompréhension mutuelle. Elle commençait à s’étendre dangereusement entre nous, comme ces nappes de pétrole qui envahissent à bas bruit les fonds sous-marins ou apparaissent à la surface de l’eau, semblables à des taches sur un corps malade.
« Mais enfin, qu’est-ce que tu aimes dans ce pays ?
– Tout.
– Tout ?
– Les paysages, le calme…
– Le vacarme des grandes villes, la publicité et les jeux vidéo, les traders qui hurlent à la Bourse de Tokyo ?
– Ce n’est pas seulement cela, le Japon.
– Non, mais c’est tout de même ce que tu vois le plus souvent, puisque tu séjournes dans des villes : la technique, la technologie, et tous les défauts de la vie urbaine, amplifiés.
– Il y a aussi les villas impériales, Katsura, le Pavillon d’or, le Mont Fuji ; les trains qui partent toujours à l’heure exacte ; la propreté des toilettes publiques ; le whisky ; la cuisine… »
Elle avait dû particulièrement lui plaire, car il en parlait souvent, retenant certains noms moins courants que sushi, comme « shabu-shabu », la fondue japonaise, et « teppanyaki », aliments sautés sur une sorte de plancha locale. Il me disait aussi que chaque fruit était emballé avec soin, dans une sorte de papier cadeau, et coûtait un prix astronomique, l’équivalent de dix euros.
Un autre nom qu’il avait retenu était « onsen », ces sources chaudes où l’on se baignait nu, en pleine nature, avec la vue sur une montagne ou un volcan. « Kompai » et « aligato » complétaient la liste de ses compétences linguistiques.
Je ne l’avais jamais suivi là-bas, malgré ses souhaits. C’était très facile, assurait-il. À peine plus loin qu’une capitale européenne, ajoutait-il avec une évidente mauvaise foi. Il ne voyait donc aucun problème à ce que je m’absente. Il oubliait seulement un détail essentiel : si j’étais venue pendant les trois mois, puis six, qu’il y avait passés à donner cours et conférences, sillonner le pays en suivant les traces de Frank Lloyd Wright, le grand architecte américain influencé par les constructions japonaises, qui aurait gardé les enfants ? On pouvait les emmener, selon lui ; impossible, toutefois, de les déscolariser, et je ne me sentais pas capable de les faire travailler seule en suivant leurs programmes, puisqu’il ne fallait pas compter sur Matthias pour ces tâches ingrates et subalternes. Insensiblement, le Japon était devenu pour lui une sorte de folie. Il lui était même arrivé de proposer de déjeuner dans un restaurant japonais pendant un long week-end de vacances à Madrid.
Le Japon lui plaisait, soit. Mais il n’en développait pas les raisons. Lui qui pouvait être intarissable quand il parlait de son travail, qui, non content de me les faire lire, me commentait toutes ses conférences, et ne se lassait jamais d’argumenter, se montrait étonnamment à court d’arguments. Une chose m’étonnait particulièrement : il ne voulait pas lire de livres sur ce pays ; et quand je l’ai informé qu’une grande librairie avait réuni de nombreux romans japonais dans sa vitrine, en lui proposant de lui en acheter quelques-uns, il a décliné l’offre. Aucun auteur, même aussi connu que Mishima, n’attirait sa curiosité.
Nous communiquions tous les jours par visioconférence, en horaires décalés : lui se levait quand j’allais me coucher. Les enfants dormaient depuis longtemps ; quand ils voulaient voir leur père, ou quand leur père demandait à les voir, il fallait se mettre devant l’écran vers midi. Compte tenu de leurs activités scolaires, ce ne pouvait être que le week-end.
« Papa, papa, tu sais où on va partir en vacances de neige ?
– Non.
– À Venise.
– Mais… on annonce de la neige dans un mois et demi à Venise ? »
Mathilde regarde Arthur, quêtant une réponse qu’elle ne veut pas se hasarder à donner sans avoir préalablement consulté son frère. Celui-ci est grand : il vient d’avoir dix ans ; elle n’en a que huit et demi.
– On ne sait pas », dit-il raisonnablement. « Les vacances de neige, c’est comme ça qu’on les appelle à l’école. Mais nous, on n’ira pas skier à Venise, ça, c’est sûr. On va au carnaval ! »
Matthias me cherche des yeux ; j’ai laissé les enfants au premier plan, et l’écran de l’ordinateur est trop petit pour que nous y tenions tous. Je passe une tête : « Oui, c’est vrai. Ils voulaient voir ça après en avoir entendu parler en classe. Mais nous n’assisterons qu’à la fin pour qu’ils voient les costumes et les masques. Après, nous aurons encore deux jours pour profiter de la ville rendue à son état normal. Il y aura moins de touristes.
– Ça fait combien de temps, déjà, que nous y sommes allés ?
– Quatorze ans. Notre premier voyage à l’étranger tous les deux. »
Il sourit. « C’était bien. » Je le sens légèrement nostalgique.
« Oui, c’était bien. Avec les enfants, ce sera différent… mais bien aussi, d’une autre façon. »
Mathilde et Arthur ont brusquement quitté leurs sièges, et reviennent bride abattue, chacun agitant son costume pour le montrer à leur père :
« Regarde, je serai une marquise », dit-elle en lui faisant admirer une longue robe de satin rose pâle, rehaussée de nœuds de dentelle blanche. « Et moi, mousquetaire ! » Arthur exhibe une cape, un chapeau à plumes et une épée en plastique.
Matthias est incrédule. « Ils comptent se déguiser ?
– Bien sûr. Ils ne parlent même que de ça.
– Et toi ?
– Moi, je me contenterai de les accompagner. Les déguisements, très peu pour moi. Souviens-toi que j’ai décliné ton offre de me rapporter un kimono, la dernière fois que tu es rentré de Kyoto. »
II
Notre séjour à Venise, une tardive lune de miel : les premières années de notre vie commune avaient été marquées par des vacances dans l’hexagone, généralement à la montagne, ou au bord de plages glaciales, car Matthias n’aimait pas la chaleur. Il n’était jamais allé à Venise, et c’était, déjà, une conférence qui avait motivé sa venue. Nous y avons passé la dernière semaine de novembre. Il faisait froid, mais le soleil ne cessa presque pas de briller sur la ville. La brusque tombée de la nuit, sans crépuscule, dès cinq heures de l’après-midi, nous surprenait, et nous rappelait que Venise, située à l’est, n’était pas seulement orientale par l’architecture de ses palais.
Dans l’avion, appartenant à une petite compagnie habituée aux liaisons avec l’Italie du nord, on nous avait servi un véritable déjeuner, malgré la brièveté du vol. Nous étions peu nombreux. Une famille d’habitués, la mère élégante en cashmere et vison, accompagnée de ses enfants, déjà presque adultes, allait rejoindre mari et père, probablement industriel, diplomate, ou propriétaire de domaines viticoles. Au moment où, l’atterrissage amorcé, on commençait à voir les îles de la lagune se dessiner, Matthias me serra contre lui. Blottie dans ses bras, admirative et légèrement apeurée (je n’avais plus repris l’avion depuis longtemps), je levais les yeux vers lui et les abaissais pour distinguer les contours, de plus en plus nets, de la géographie terrestre. Il était ému. C’est ainsi qu’il m’aimait.
Enfant, puis adolescente, je n’avais vu Venise qu’en été ; sa découverte à la fin de l’automne ne modifia pas mon émerveillement, mais accrut mon admiration. La lumière déjà hivernale, particulièrement belle, mettait en valeur les teintes rousses des arbres. La brume qui, le soir, envahissait les quais, donnait à ceux-ci un aspect féerique. Les pieux fixés dans l’eau, au loin le campanile pointu de l’église San Giorgio Maggiore semblaient en émerger comme des fantômes.
Nous logions dans un hôtel du quartier Dorsoduro, un palais à ogives, près du pont de l’Accademia où Matthias me photographia au lendemain de notre arrivée. Derrière moi, les deux coupoles et les deux campaniles de la Salute dominaient les toits des palais, à l’orée de la Douane de mer. J’avais retenu quelques noms : « Dorsoduro », facile à mémoriser, et l’appellation particulière de quartier, qui là-bas se dit « sestiere ».
Un puits en pierre blanche ornait la cour intérieure de l’hôtel. Il était sculpté de feuilles à ses quatre extrémités. Je n’avais pas encore remarqué les puits à Venise, et cette fois-ci, j’en découvris partout. Chaque place, ou presque, en avait un, et on en apercevait aussi dans la cour des palais ou des maisons patriciennes. Un socle trapu, posé sur une margelle octogonale, carrée, hexagonale ou rectangulaire. La pierre semblait toujours la même, mais les formes changeaient plus ou moins, sans doute selon l’époque où ils avaient été construits : les uns s’arrondissaient, les autres avaient des angles ; la décoration, souvent florale, agrémentait la plupart d’entre eux, mais certains n’en bénéficiaient pas. Une plaque noire, probablement en bronze, les recouvrait tous ; mais quelques-uns étaient aussi surmontés d’une longue anse de fer forgé, voûtée et décorée, qui servait autrefois au va-et-vient d’une poulie. Ils étaient dans l’ensemble en bon état, parfois même récemment restaurés.
« Pourquoi tous ces puits ? Ils paraissent très anciens. Beaucoup doivent remonter au Moyen Âge. C’était la seule façon de s’approvisionner en eau ?
– Probablement.
– Et tu crois qu’ils fonctionnent encore ?
– Non, je ne pense pas. On les a laissés comme éléments décoratifs.
– C’est vrai qu’ils sont si beaux… Et ils témoignent de ce que fut la civilisation vénitienne pendant des siècles. »
Ces puits me fascinaient. Matthias, lui, plus sensible à l’architecture moderne, découvrit les joies du café italien. Il en prit un, dans un des nombreux bars des Mercerie, et le trouva si bon qu’il en commanda un autre. Ce fut un rituel pendant tout le séjour, qui devait par la suite le pousser à retourner dans la région pour y acheter une cafetière ; elle installa dans notre cuisine un souvenir permanent de la Vénétie.
Pendant les deux ou trois conférences qu’il prononça, je me promenai dans les rues. C’était la première fois que je me trouvais seule en pays étranger. Tout m’était neuf, à commencer par la langue. J’étais environnée de mots que pour la plupart je ne comprenais pas, ayant tenté d’apprendre les rudiments de l’italien dans un petit guide à l’usage des voyageurs, deux ou trois semaines avant le départ, sans en retenir plus que le vocabulaire très courant et quelques tournures usuelles, apprises par cœur pour pouvoir nous faire comprendre, le cas échéant. Ce qui était très particulier, c’était le bruit des voix ; non parce qu’il était plus fort – les Vénitiens ne parlaient pas plus fort que les Allemands, les Américains ou les Français – mais parce qu’il était autre : le brouhaha de fond, qui m’accompagnait, me suivait, ne ressemblait en rien à ce que j’avais entendu jusque-là. Je l’ai retrouvé en retournant là-bas, et le charme de ces timbres, leur mystère aussi, pour qui leur reste extérieur, conservent, maintenant que je suis de retour, toute leur force d’attraction.
Dans le quartier de la Fenice, une vieille femme s’est arrêtée devant la vitrine d’un magasin de luxe. Elle a posé ses paniers et se met à me parler. Je comprends des bribes d’un discours apparemment tourné contre les Asiatiques qui se pressent à l’intérieur pour acheter de la maroquinerie, et lui souris, sans pouvoir lui répondre. Au bout de quelques minutes, elle reprend ses paniers et s’éloigne, comprenant que je ne suis pas italienne.
Ce souvenir-là est resté vivace, malgré son insignifiance. Je me revois aussi arpentant seule le musée Correr, si riche et pourtant désert, admirant les collections en regardant parfois à travers les fenêtres la nuit tomber le long des Procuraties, sur la place Saint-Marc. Le plancher craquait à mesure de mon passage, comme si je réveillais un bois en sommeil depuis des siècles.
L’escalier en forme de tour du palazzo Contarini, vu en photo, m’intriguait. Je l’ai cherché et trouvé au détour d’une rue : il m’a fait peur. L’église San Giorgio Maggiore, qu’on gagne par bateau, m’a laissé une impression de vertige.
On ne nous avait pas donné une « camera matrimoniale ». Ma déception ravit Matthias, qui promit de venir me tenir compagnie. Il s’était arrangé pour rapprocher nos deux lits, qui, avec leurs barreaux, semblaient faits pour de grands enfants ; mais l’exiguïté l’avait forcé à regagner le sien pour dormir, et son sommeil fut inconfortable, vu la longueur de ses jambes. C’étaient nos premières vacances à l’étranger, à Venise de surcroît, et nous ne pouvions dormir ensemble. Nous avons pourtant gardé un heureux souvenir de notre séjour dans cette vaste chambre incommode, en mezzanine, au sol de marbre moucheté et à l’immense plafond.
J’ai voulu inscrire sur un petit carnet tout ce que nous avions vu et fait cette semaine-là, mais Matthias s’est moqué de moi. À présent, je ne me souviens plus si j’ai pris ou non des notes, même réduites à des noms de monuments. J’ai cherché, en vain pour le moment. Les trouver, si jamais elles avaient existé, m’aurait pourtant été utile, en temps de quarantaine – mais les chercher m’a occupée pendant des heures, ce qui n’est pas non plus à regretter.
Nous avons visité le quartier où nous résidions, du musée de l’Accademia à la Salute, en passant par l’église San Gregorio, fermée, on ne sait pourquoi, où j’ai photographié Matthias qui montait les marches du petit pont bordant l’abside principale. En remontant vers le nord de la ville, nous avons visité le Palazzo Grassi, ainsi que la basilique des Frari ; de l’autre côté du canal, nous sommes allés jusqu’à Zanipolo, en passant par l’église Santa Maria dei Miracoli. C’est à peu près l’itinéraire que j’ai pu reconstituer. S’y ajoutent une halte dans un petit salon capitonné du café Florian, par bonheur sans orchestre à ce moment-là, pour y boire une coupe de prosecco, deux dîners pris dans le même restaurant répertorié dans le guide, un autre dans une trattoria où l’on nous avait conseillé de goûter des araignées de mer, et des haltes, pour déjeuner ou dîner, dans des bacari, petits bars semblables à des pubs (ou que j’imaginais tels, n’étant jamais entrée dans un pub) ou des cabines de yacht (que, là encore, j’imaginais telles, n’étant jamais montée sur un yacht), aux boiseries sombres, à la décoration marine, loin du style vénitien traditionnel, et qui me semblaient pourtant plus authentiques. J’ai alors compris que cette ville multi-séculaire, refermée sur ses théâtres et cafés, ouverte sur la mer, n’était pas réductible aux miroirs dorés, aux fines chaises laquées, aux canapés ajourés recouverts de tissus précieux, au carnaval illusoirement figé dans un XVIIIe siècle portant le raffinement à son apogée ; qu’elle était tout cela, mais aussi une cité froide, brumeuse, profondément maritime. Sa vérité me paraissait tenir dans ses quais glacés, le brouillard matinal sur ses canaux, ses places et sa lagune, ses briques rouges et ses puits clairs, plus que dans les tentures de velours, le papier marbré, et les façades sculptées des palais du Grand canal – mais c’était seulement mon goût, celui d’une Venise couleur de mercure, dont je voulais faire la vérité du lieu.
La rue que nous avions prise pour rejoindre la Salute était belle et fleurie, sans doute l’une des plus résidentielles de la ville : l’état des volets l’indiquait à lui seul. Assis dans la basilique, un peu écrasés par son volume, nous admirions les voûtes, agréablement surpris par la clarté de l’ensemble, qui contrastait avec les nefs sombres et parfois sinistres d’autres églises bordant les quais. Quelques jours avant notre arrivée, on avait organisé, comme chaque année, une grande fête pour commémorer la fin de l’épidémie de peste qui avait ravagé la ville au XVIIe siècle, et marqué le début de la construction du monument. Tous les 21 novembre, les fidèles pouvaient le rejoindre depuis le Grand canal, en traversant un pont éphémère.
La basilique des Frari nous avait aussi impressionnés, en particulier une toile monumentale, peinte par Titien, représentant l’Assomption de la Vierge. De loin, nous avions cru qu’il s’agissait de l’Ascension de son fils, en raison de la puissance qui se dégageait de ce corps vêtu de rouge, et de la profondeur de cette couleur qu’on retrouvait à d’autres endroits de la toile, en particulier dans la robe d’un apôtre élevant les bras vers le ciel, accompagnant le mouvement et les gestes de Marie montant vers Dieu. La joie et la force qui marquaient cet envol, je ne les ai jamais oubliées. Je me souviens aussi, en faisant le tour de l’église, très vaste, d’une chapelle fermée par une grille, sur le sol de laquelle on avait déposé une longue rose fraîchement coupée.
Quelques années plus tard, à la recherche d’une machine à café digne de ce breuvage, nous avons visité le reste de la Vénétie : Vérone, Padoue, Asolo, Vicenza, Trévise, et la villa Barbaro au pas de course, à peine le temps d’admirer, en glissant sur des patins, les splendides fresques de Véronèse, de jeter un œil sur les jardins, et d’acheter deux bouteilles de vin blanc, car nous allions prendre le chemin du retour et Matthias, en cette fin de mois d’août, craignait les embouteillages sur l’autoroute qui menait à Milan, puis à Turin avant le tunnel du Mont-Blanc.
III
Aux beaux jours, les enfants ont des cours de travaux pratiques pendant lesquels ils observent, identifient et classent des espèces à marée basse dans la vase jonchée de longues algues qu’ils appellent cheveux de la mer. L’hiver, il faut trouver d’autres occupations. L’école avait lancé, dans toutes ses classes, une grande enquête sur le carnaval de Venise. Mathilde, impressionnée par les photos des costumes, endoctrinait son frère. Son cahier regorgeait de dessins de robes roses et de masques en forme de soleils ; elle y collait aussi quelques paillettes. Arthur, entraîné, dessinait des masques plus sombres et plus anguleux, pour bien marquer les différences avec sa sœur. Elles sautaient d’ailleurs aux yeux dès la couleur de leur cahier, rose pour elle, gris-bleu pour lui. Les adeptes de la théorie du genre n’étaient pas au bout de leurs peines.
La diffusion par les médias d’images catastrophiques de Venise en proie à de fortes crues avait décidé deux professeurs de leur école à montrer aux élèves une autre face de la ville, mondialement connue, et propre à faire rêver. Les semaines précédant les vacances de Noël, les enfants ont cherché sur internet des photos du carnaval, consacré à celui-ci une section de leur cahier, et appris à confectionner des masques avec du papier, de la colle et des chiffons. Certains les ont peints, d’autres coloriés et décorés. Les parents ont pu admirer la créativité de leur progéniture dans une salle où tous les masques étaient exposés. Matthias se trouvait déjà au Japon : j’ai pris des photos pour qu’il participe, de loin et en léger différé, à la fierté des enfants. Mathilde et Arthur lui ont ensuite longuement expliqué, par écran interposé, leurs secrets de fabrication.
L’acqua alta venait de submerger la ville à plusieurs reprises. Les télévisions montraient les images habituelles de planches sur la place Saint-Marc, de cirés et de bottes, de voyageurs portant leurs valises dans les rues inondées ; mais les crues de novembre 2019 avaient été exceptionnelles, par leur hauteur comme par leur répétition. On pouvait faire le pari qu’elles ne se reproduiraient pas au début de l’année suivante, ou du moins qu’elles ne seraient ni si fréquentes, ni si élevées. Quand les enfants m’ont demandé d’y partir pour les prochaines vacances, j’ai pris ce risque – loin d’imaginer que le danger qui nous attendait, invisible et imprévisible, serait bien pire, même s’il ne menaçait ni les monuments, ni les fondements de la cité.
Nous devions arriver le 22 février, à la fin du carnaval, le temps de laisser les enfants s’amuser dans leurs costumes et admirer le spectacle, avant de leur montrer la ville rendue à son existence normale. Beaucoup de touristes regagneraient leurs pays. Le moment était d’autant plus idéal qu’il coïncidait avec les vacances scolaires.
Quelques jours avant notre départ, la rumeur selon laquelle un virus qu’on croyait limité à une région de la Chine commençait à circuler en Italie m’a rendue plus méfiante. J’ai envisagé de tout annuler ; mais en l’absence de consignes strictes, on m’a conseillé de partir. « Le virus a été trouvé dans un petit village de Lombardie. C’est tout de même loin de Venise. Il paraît que deux Chinois fréquentaient un bar du village. Un ingénieur qui est tombé malade revenait de Chine… » Ce sont ces arguments qu’on me répétait. Dans l’avion, les passagers ne semblaient pas inquiets.
Arrivés à l’aéroport, nous avons vu la mer, ce qui a suscité chez les enfants des cris de joie.
Des policiers se sont approchés de chaque voyageur pour prendre sa température. Efficace : le procédé nous a un peu refroidis. Les enfants ont demandé pourquoi on nous accueillait de cette façon. Je leur ai répondu que c’était l’habitude quand il y avait beaucoup de monde, comme en période de carnaval.
Gagnant un embarcadère, nous nous sommes installés au fond d’un petit bateau qui pouvait contenir une douzaine de passagers et nous a fait traverser la lagune en s’arrêtant d’abord sur l’île de Murano. Nous avions déjà oublié la prise de température.
« Ça ressemble à chez nous, en plus grand. On descend là ?
– Non, nous c’est plus loin. Ici, ce n’est pas encore Venise.
– Alors, c’est où ?
– C’est une île tout près, où on fabrique du verre.
– Pour faire quoi ? Pour boire ?
– Pour boire, pour mettre des fleurs, pour décorer.
– Comment on fabrique le verre ?
– En soufflant dedans. Au départ c’est de la poudre, on la mélange avec de l’eau, on la chauffe, et on lui donne une forme en soufflant dedans. On peut y aller, si vous voulez. Les fabriques laissent entrer les visiteurs pour voir les souffleurs de verre. »
Ils acceptèrent immédiatement. Je les mis alternativement debout sur mes genoux pour qu’ils puissent regarder à travers les hublots. Le moteur du bateau laissait un long sillage d’écume. Au loin, on apercevait parfois un rivage ; d’autres fois, on avait l’impression de se trouver en haute mer. Nous sommes descendus devant les jardins de Saint-Marc, que je n’avais encore jamais remarqués.
L’hôtel se trouvait dans le quartier, mais j’ai dû revenir plusieurs fois sur mes pas pour le trouver. Mathilde et Arthur tiraient chacun, gravement, leur petite valise. En sortant du bateau, ils avaient regardé le Grand canal, subjugués ; dans les rues étroites, leur enthousiasme était retombé, car ils se sentaient fatigués. Le premier petit pont les avait amusés. Parvenus au sommet, ils avaient cherché à apercevoir d’éventuels poissons au fond de l’eau verte ; mais des petits ponts, il y en avait partout : il fallait monter des marches, puis en descendre. Parvenu devant le cinquième ou sixième, Arthur s’est arrêté, animé d’une colère froide : il n’irait pas plus loin. Mathilde, imitant toujours son frère, fit à son tour sécession. Mais une fois arrivés à l’hôtel, à peine s’étaient-ils jetés sur leurs lits qu’ils ont voulu repartir, non sans avoir endossé leurs déguisements.
Des costumes, on en voyait moins que prévu. Je les avais prévenus que presque tout le monde, à part moi, serait déguisé ; or, j’étais loin d’être la seule en pantalon, pull et blouson matelassé : les touristes, nombreux, étaient habillés normalement. Ils suivaient et pour beaucoup filmaient avec leur téléphone portable des carnavaliers juchés sur des échasses, ou vêtus de longs manteaux surmontés d’une tête d’animal, porc, souris ou rat, mouton, bœuf et même singe. Les marquises et marquis aux perruques poudrées, qu’on voyait dans tous les reportages sur le carnaval, se faisaient rares. Le satin, la soie, le velours, les dentelles, les éventails, les bourses plissées, les fleurs en tissu, les étoles de fourrure, étaient noyés sous le flot des doudounes et des sacs à dos. Les masques de toutes sortes, formes et couleurs, c’était dans les vitrines qu’on en trouvait le plus.
Nous avons traversé de petites places, et franchi d’autres petits ponts, au rythme de tambours, dans une atmosphère de fête médiévale à laquelle je ne m’attendais pas du tout, mais qui, finalement, correspondait mieux aux origines du carnaval que les fastes déployés du temps de Casanova. Il y avait de l’âpreté, une violence larvée, une folie qui surgissait dans un bond, un cri, un rire découvrant des dents peintes en rouge ou en noir. Les enfants s’amusaient en montrant du doigt les déguisements d’animaux, les diables aux combinaisons à cornes et à la queue en fourche. Parfois, on apercevait un Arlequin égaré. Toute la foule se dirigeait, sans bousculade, vers la place Saint-Marc, où elle se dispersa dans un chaos temporel qui