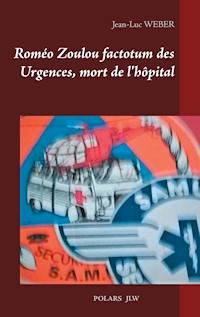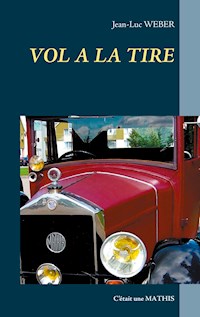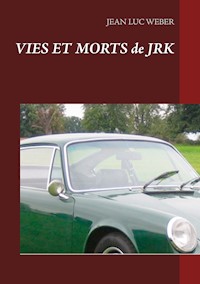10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Une découverte anodine au sous-sol d'un pavillon de banlieue occupé antérieurement par un assassin déjà condamné est le point de départ d'une aventure policière aux convergences diverses. On y découvre les dérapages insoupçonnés d'une bourgeoisie tranquille dont les agissements deviennent publics par le pur fruit du hasard. Un zeste d'humour et l'authenticité du vécu d'un roman basant sur la réalité font que les ressemblances sont fortuites et seul un public averti reconnaitra les convergences avec l'actualité du moment passé. A lire les yeux clos pour éviter d'être éclaboussé par la luminosité d'éléments électriques imprévus alors que sentiments dans les relations humaines ne sont pas exclus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sommaire
L’histoire
Chapitre premier : La découverte
Chapitre second : Le dégagement de l’épave
Chapitre trois : La première enquête
Chapitre quatre : Les voisins
Chapitre cinq : Les « on dit » et les non-dits
Chapitre six : La campagne
Chapitre sept : Des nœuds qui ne gonflent pas à l’humidité
Chapitre huit : Weltz allait-il craquer ?
Chapitre neuf : On attendait Brucher
Chapitre dix : La seconde enquête
Chapitre onze : Les souvenirs
Chapitre douze : Janine
Chapitre treize : Anna
Chapitre quatorze : Magda
Chapitre quinze : Le point
Chapitre dix-sept : L’arrestation de Brucher
Chapitre dix-huit : La prison d’Ensisheim
Chapitre dix-neuf : Du cimetière à la morgue
Chapitre vingt : La presse et les photos inédites
Chapitre vingt et un : L’engueulade
Chapitre vingt-deux : Rue de la Fourmi
Chapitre vingt-trois : Cause commune
Chapitre vingt-quatre : La pute
Chapitre vingt-cinq : Les Weltz
Chapitre vingt-six. : Week-end à Cocheren.
Chapitre vingt-sept : Des comptes à régler
Chapitre vingt-huit : Du pain sur la planche
Chapitre vingt-neuf : Au rapport
Chapitre trente : La théorie
Chapitre trente et un : Blanche-neige et les naines
Chapitre trente deux : Weltz comme en quarante
Chapitre trente quatre : Le déclic
Chapitre trente-cinq : Le jugement
L’histoire
Madame Wagner était descendue ce matin-là à la cave de son petit pavillon coquet du 32 qu’elle occupait depuis maintenant cinq années pour y faire du rangement. Dehors, en cette fin de juillet chaude et ensoleillée, le temps lourd et orageux n’inspirait guère à la pratique du jardinage. Aussi Eva s’était-elle mis en tête de ranger cette partie de la cave encore en terre battue qui recevrait à nouveau à la fin de l’automne ses géraniums auxquels elle comptait bien, comme à l’accoutumée, faire passer l’hiver.
Des résidus de gravats épars l’obligèrent à se munir d’un râteau pour les rassembler. A plusieurs reprises l’une des dents de l’outil aratoire resta accroché à un bout de tuyau en caoutchouc qui dépassait dans le coin gauche de la cave, juste le long de la séparation avec la chaufferie dont le sol était grossièrement cimenté.
Non qu’elle fût peureuse, plutôt avisée, et avec le pressentiment que le tuyau était une gaine électrique qu’elle ferait mieux de ne pas manipuler sans précaution, ni surtout à mains nues, elle se dit qu’elle en parlerait à Pierre-Yves, son fils, qui précisément travaillait à l’ES, Electricité de Strasbourg, comme conducteur de travaux, dès son retour de vacances, afin qu’il la débarrasse de ce bout de boyau.
On était mardi matin, l’après-midi elle recevrait ses copines, retraitées comme elle pour d’interminables parties de scrabble qui se prolongeraient tard dans la nuit. C’était bien ainsi, les quatre du club des « shrapnells » comme les avaient appelées un jour le défunt époux de l’une d’entre elles, en mémoire de ces grenades à mains toujours prêtes à exploser pour un motif futile. Le temps était loin, le défunt bien mort, et son bon mot restait pérenne.
Le dimanche suivant, matin dès neuf heures, Pierre-Yves sonna à la porte de chez sa maman. La veille au soir, rentré de Bretagne avec Angèle, son épouse, il avait annoncé sa visite pour le dimanche matin, soucieux qu’il était de ce qu’un détail pouvait contrarier la jeune septuagénaire et toujours prêt à lui alléger le quotidien, a fortiori après un mois entier d’absence.
Il y avait toujours quelque chose à bricoler dans ce petit pavillon de construction déjà ancienne au caractère désuet certes, mais si charmant. La rue Bastian fait partie du vieux Cronenbourg, faubourg encore calme et surtout très proche à présent du centre-ville de Strasbourg par le jeu du tram intégré depuis une petite dizaine d’années au paysage urbain.
s
Chapitre premier
La découverte
- Allô, Police-Secours ?
- Ouais! … Répondit à la salle de commandement le brigadier de permanence au bord de l’apoplexie, juste avant le Picon-bière servi par son collègue qui venait d’entrer.
- Je, enfin, pouvez-vous vous déplacer chez ma mère ?
- Elle est malade ? Appelez le SAMU !
- Non, monsieur, un cadavre dans sa cave…
- Quelle adresse ?
- 32, rue Bastian à Cronenbourg
- Ne touchez à rien avant l’arrivée des pompiers et de notre patrouille…
Descendu à la cave pour y chercher un pot de confiture sur une des étagères du haut que sa maman ne pouvait atteindre, Pierre-Yves en avait profité pour jeter un œil amusé au bout de tuyau décrit par sa mère, bien persuadé qu’aucune gaine électrique n’affleurait par le fond du sous-sol, le niveau électrique étant dans ce quartier bien en dessus.
Comme il avait raison, Pierre-Yves… En dégageant avec ses mains quelques centimètres de l’objet en question, il en vit un nid entier, à savoir deux groupes de cinq petits tuyaux, comme à la parade qui n’attendaient que lui.
Pas l’ombre d’un volt ni d’un ampère électriques mais quand même de quoi lui faire se dresser les cheveux sur la tête. Il comprit vite qu’il n’irait pas loin et qu’il avait affaire à des orteils, incidemment dépendants sans doute d’un cadavre allongé à quelques centimètres sous terre, au nez et à la barbe, aux poils des pieds des occupants de l’immeuble à vrai dire.
Sans dire un seul mot, ni prendre un seul pot de confiture, il remonta d’un souffle au rez-de-chaussée appeler Police-Secours pour s’entendre répondre d’une voix aussi ennuyée que laconique qu’on allait venir. On sentait bien à l’intonation qu’il ennuyait son interlocuteur. Et l’euphémisme était faiblard.
Tandis qu’il rassurait sa mère inquiète rétrospectivement de sa cohabitation mortuaire, le deux-tons des pompiers remontait déjà la rue. Le FS, fourgon-secours, était venu vite du centre de secours-Ouest situé à moins d’un kilomètre et les trois hommes, au lieu de quatre habituellement, période estivale oblige, en descendirent, vite :
- Respire-t-il encore ?
lorsque déboula l’Espace blanc du SAMU pour la réanimation. Le 17, la salle de commandement, avait fait les choses en grand, mais comme l’indiqua le sous-officier des pompiers, un cadavre est un cadavre, au début comme à la fin de sa mort.
Les deux équipes descendirent à la cave par la porte extérieure donnant sur le jardinet. Très vite les services médicaux se retirèrent, sans même en avoir vu davantage que la couleur cireuse des doigts de pieds mal lavés depuis quelques temps, des mois, des années peut-être. Les gens se soignent si mal…
Les pompiers dégagèrent quelques centimètres supplémentaires, voir un peu de peau qui d’ailleurs se détachait par endroits et par lambeaux et décidèrent d’attendre les Officiels de l’enquête qui ne tarderaient pas.
Ils arrivèrent à dix heures vingt-cinq. Groupés. La patrouilleuse, un vieux J7 défraîchi qu’on aurait volontiers crû sorti d’un film de Louis de Funès si la série avait été celle des Flics et non des Gendarmes, suivie, talonnée pourrait-on dire, d’une 306 encore neuve conduite par un policier en uniforme mais dirigée par un inspecteur en civil.
L’inspecteur était en fait le capitaine Muller, un vieil inspecteur principal qui à force de faire du surplace dans la hiérarchie, faisait à cinquante-quatre ans surtout du placard en attendant impatiemment sa retraite et ne sortait que pour les grandes occasions, les dimanches d’été quand tous les gars valides étaient en congé, vacances ou occupés ailleurs.
Muller laissa aller au-devant les six hommes qu’il coachait, qui suivaient d’ailleurs les pompiers avec lesquels ils faisaient souvent équipe sur le terrain, Strasbourg et ses feux de voitures étant un terrain d’entente pour les hommes de troupe confrontés aux aléas climatiques des quartiers chauds.
Oui, tous sont d’accord, c’est un cadavre, il est mort.
Tous aussi de se demander, comme avait dû en son temps le faire le présumé meurtrier, voire l’assassin, comment se débarrasser de cet encombrant objet, empêcheur de tourner en rond. Ils en feraient bien de même.
Muller arriva.
Les gars, n’y allez pas par quatre chemins, essayez de le sortir proprement, ne le cassez pas trop, que le légiste ait encore quelque chose à décortiquer. Moi, j’enquête. Et s’adressant au brigadier, chef du J7,
- Cabarrus, vous notez bien tout ce qui est important.
Le visage décomposé dudit Cabarrus disait clairement qu’il n’était pas enchanté.
- Pourquoi, vous ne savez pas encore écrire ? Renchérit Muller, plus prompt à donner des ordres quand il était en situation, qu’à agir. Allons, au boulot !
Muller remonta dans l’appartement où était restée Madame Wagner et poliment demanda à entrer.
- Alors ? ma petite madame, on fait des siennes ?
- Euh ! Monsieur le commissaire…
- Capitaine Muller en fait, mais bon entre nous, on s’en fout du capitaine, entre truands. Il est là depuis quand ?
- Qui ? Mon fils ?
- C’est le cadavre de votre fils ? Condoléances…vous plaisantez je suppose
- Non, je réponds à votre question. Vous parliez du cadavre ?
- Evidemment.
- Je ne sais pas, la cave est fermée, toujours, et j’habite là depuis cinq ans, un peu plus même.
- Et il était déjà là quand vous avez emménagé ? Vous auriez dû le signaler de suite, rajouta Muller sans sourciller.
Madame Wagner n’était pas dupe.
- Vous me faites marcher, monsieur Muller. Je n’en sais strictement rien.
- Aux faits, donc vous occupez cette maison depuis ?
- Mai 1996
- Effractions, cambriolages, longues vacances ?
- Huit jours tout au plus. Oui, j’ai été cambriolée un après-midi en 1998, je crois, mais il y avait des témoins et on a retrouvé et arrêté la coupable, une jeune Yougoslave.
- Bon, on verra cela !
Merde, se dit Muller, une affaire de cons, un cadavre qui remonte à la surface, un vieux truc de la guerre peut-être. C’était bien pour lui, ce genre d’histoires. Déjà qu’on le charriait comme une pièce de brocante sans valeur au SRPJ de Strasbourg pour son incompétence, appréciation notoire et justifiée d’ailleurs. On allait lui coller les collabos, les résistants et leurs vengeurs.
Excédé il sortit, se disant que Cabarrus en prendrait pour son grade, cet abruti de fainéant, de gars pas de chez nous, un Français, un vrai qui s’était fait muter en Alsace pour briller…par son incompétence, mutation quasi-disciplinaire sur le front de l’Est.
Muller était un cas.
Bon flic traditionnel intuitif, lauréat de l’Ecole de Police de Nancy en 1968 à 21 ans, il avait à l’époque obtenu Strasbourg dont il était originaire. Dans la foulée des grands recrutements de la refondation de l’après-mai 68 qui avait à l’époque coûté bien des têtes.
Intuitif et brillant dans la léthargie provinciale il avait fait ses classes dans le sillage des vieux pontes, ne déplaisant à personne, furetant et léchant à loisir et avait rapidement été promu Principal. Trente années plus tard, il était toujours Principal, c’est à dire capitaine de police avec la réforme après de multiples mutations, espoirs rétrogradations et stages intermédiaires dus à ses résultats, ses coups de gueules, ses manquements et aussi parfois il faut le reconnaître à sa décharge, la malchance.
A ce propos il se plaisait à raconter, et avec le recul en tirait vanité, que Freudenreich, l’ex-ennemi public N° 1 s’était bien évadé du Palais de Justice grâce à lui et qu’il en percevait la rente.
Et son parcours avait été émaillé de toutes sortes d’incongruités de cet acabit, obstiné qu’il était à se positionner toujours à l’endroit le plus inopportun dans chaque enquête. De plus, son écu était criblé de médailles autant que sa chair des impacts de balles, car son arme de service même semblait attirer plus de projectiles qu’elle n’en émettait. En quelque sorte, la seule chose qu’on put mettre sans erreur à son crédit, c’est qu’il n’avait jamais touché personne, tout au plus ému.
Aux Mœurs on lui avait attaché un relent de souteneur sur le retour, aux Stups l’aura d’un dealer de troisième ordre avait été ébauchée, même la Voie Publique, dans les années 8283, juste avant les Archives où il sévissait depuis par manque d’opportunité, la voie publique lui avait causé les désagréments de mauvaises implantations sécuritaires.
Tout pour plaire.
Ultime promotion, depuis 1998, avec l’arrivée du nouveau commissaire divisionnaire, les restrictions budgétaires autant que d’effectifs, toute cette conjonction lui avait fait reprendre du service… lors des vacances et des week-ends. Il n’avait plus le choix. D’ailleurs, il ne l’avait jamais eu.
Il en revint à Cabarrus qui lui décrivit l’épave que ses hommes avaient recueillie dans leur sac plastique, le sac poubelle à fermeture éclair, avant de l’emporter à la morgue de l’Institut de Médecine légale de la rue Kirschleger.
Fatale erreur, on aurait dû faire venir le légiste, mais celui de permanence pratiquait précisément une césarienne en urgence pour l’institut d’anatomie pathologique. Affirmerait-on sûrement lors de l’enquête de l’IGS. Le coup de grâce pour Muller qui aurait tout vu dans sa vie. Même les bœufs-carottes.
Chapitre second
Le dégagement de l’épave
- Bon, chef, grommela Cabarrus, je ne suis pas toubib mais le client est mort depuis plus de douze heures. Froid, température ambiante, qui irait à un Riesling ou un Sylvaner. Raide, pas un kopeck en poche, d’ailleurs j’y viendrais plus tard, pas de poches, mais je voulais dire rigidité cadavérique. Non, chef il est là depuis, la cave est sèche, pas de vermine, alors je ne peux pas dire depuis quand, vous m’en demandes trop
- Je ne vous ai pas demandé…Poursuivez, cette histoire de pas de poches ?
- Ben, oui, pas de poche parce qu’il était à poil, pourtant il n’a pas pris froid et pas de poches parce qu’on les lui a coupées, ses balloches…
- Quoi ?
- Ben, ben, les c…, les roubignolles, hésita Cabarrus, embarrassé par l’arrivé dans la cour de Madame Wagner.
- Curieux…
- On l’avait pas vu tout de suite, parce qu’il n’y a a priori aucune trace visible de sang et le sexe était en place, mais quand on l’a soulevé on l’a retourné et on a vu la plaie.
Muller devint soucieux, Il savait Cabarrus assez sérieux pour sa propre tranquillité mais allez savoir.
- Dites, c’est pas vous qui me feriez une blague et les lui auriez coupées ?
- Enfin, chef…
- Bon de toutes façons c’est vous qui signerez votre rapport. Ensuite…
- Autour de sa « tombe », rien. Et la terre bien damée, juste qu’avec le temps elle a dû quand même se tasser et s’infiltrer et, peut-être que le balayage… Cela l’aura dégagé peu à peu
- Vous avez fait des photos, on peut lui donner un âge ?
- Oui j’avais mon Polaroïd personnel, pour ma collection, j’en ai faites deux. Si vous voulez et pour les besoins de l’enquête, je vous en donne une en cadeau.
- Y a intérêt. De toutes façons, ce serait détournement de preuve, voire violation de sépulture
- Oh ! Oh ! Oh !
Ils contemplèrent les chefs d’œuvre du photographe improvisé. Cabarrus avait finalement des qualités, quand c’était pour son compte personnel. Le gars, jauni par les ans et sa séquestration, avait l’air âgé, amaigri, mais il avait encore un air. Quelques années, oui, mais sûrement pas depuis la Guerre. Et pour l’âge, pensa Muller, disons, entre trente et cinquante, sans âge ou entre deux âges.
- Vous avez prévenu l’Identité Judiciaire, dit soudain Muller sur un vieux réflexe. Empreintes, photos etc.
- Ben, dites, on aurait dû le laisser dans son trou, on va pas l’y remettre.
- Merde.
- Récupérez discrètement un appareil photo et flashez un max. … On dira qu’on n’a pas pu les joindre. C’est une période de vacances. Vous photographiez tout, murs, entrée, extérieurs. Je vous fais confiance et vous me déposez la pellicule sur mon bureau au 3è. Je ferais développer en douce.
La boulette était de taille. Il n’avait plus enquêté sur un mort depuis…Oh ! plus que cela, et même…Peut-être conquerrait-il ainsi sa dernière promotion, la retraite anticipée et sans solde…
Cette pensée ne le découragea nullement, il en avait vu d’autres, mais il se dit que son chant du cygne serait à la hauteur de son coup tordu.
Il retourna à sa voiture rejoindre le jeune Laurent, un petit con, comme il disait, mais qui conduisait bien. Il s’installa pour fumer une cigarette avant que d’entamer l’enquête de voisinage…
Chapitre trois
La première enquête
Par qui commencer ?
Madame Wagner lui paraissait anodine, mais sait-on jamais…Il se renseignerait. Elle habite là, mais est-elle propriétaire, et depuis quand ? Il retourna chez madame Wagner. Deux képis étaient en faction tandis qu’a priori Cabarrus et une partie de son équipage étaient repartis, de même que les pompiers.
Il sonna deux fois au portillon et demanda à Madame Wagner s’il pouvait revenir la questionner. La réponse était affirmative, d’autant que Pierre-Yves avait l’intention de partir déjeuner avec sa compagne et que dès lors elle serait seule. Muller serait une distraction autant qu’une compagnie, ce trou dans la cave ne lui disait rien qui vaille.
- Mon fils va s’en aller, vous vouliez aussi lui parler ?
- Ah ! Oui il est peut-être descendu plus souvent que vous. Vous n’auriez pas remarqué, depuis que votre maman habite ici, des traces au sol, de la terre renversée ou amollie au sol de la cave.
- Non, d’autant plus que si ma mère habite la maison depuis 96, elle ne dispose de la cave que depuis 99, car le propriétaire voulait en faire un autre usage, puis il s’est ravisé et l’a laissée à disposition sans augmentation de loyer, ce qui est quand même assez avantageux.
- Comme cela je peux rentrer mes géraniums en hiver, rajouta la maman
- Que voulez-vous dire par « un autre usage » ?
- Je ne sais pas, c’est Monsieur Weltz, le propriétaire qui m’a dit un jour que son projet n’avait pas abouti et qu’elle pouvait utiliser la cave, surtout derrière et que plus tard, le cas échéant, on verrait…
Ça va plus vite que je ne pensais, se dit Muller.
Plus tard, à traduire quand le cadavre sera oublié, la terre durcie, ou après avoir coulé une dalle de béton lors de travaux annexes.
- Vous avez dit, surtout derrière ?
- Oui, la buanderie, ce qui est cimenté, alors que devant c’est de la terre battue. Alors dans son esprit il pensait sans doute que ce serait plus pratique pour moi derrière, mais pour les fleurs, vous savez, je salis moins la terre que le béton, lorsque je les arrose.
Muller ne laissa rien paraître de sa satisfaction, mais l’affaire prenait tournure. Il se voyait rajeuni de trente ans, quand les enquêtes tournaient rondement et qu’on n’avait que des fleurs à décerner au jeune Muller qui était le Sherlock des années
70.
- Donc, reprenons, vous habitez là depuis 96 ?
- Oui, mai 96
- Et vous utilisez la cave depuis 99
- Oui, en fait progressivement
- Je peux rentrer ? Demanda poliment Pierre-Yves
- Oui, je pense qu’en cas de besoin je saurai vous trouver.
- Bien entendu
De ce côté, pas de problème ; cette mère et ce fils, tout cela sonnait juste, honnête.
- Donc vous louez cette maison à ce Monsieur Weltz ?
- Oui en fait, je l’ai louée déjà à son père qui est décédé depuis, mais j’ai toujours discuté avec le propriétaire actuel qui s’occupait de beaucoup des intérêts de ses parents avant le décès du père, déjà. D’ailleurs c’est des gens que je connais depuis longtemps, sa mère était ma directrice quand j’étais encore en activité. Vous savez, j’étais institutrice, ajouta-t-elle non sans fierté
- Ah! Oui. Et ce Monsieur Weltz, je peux le rencontrer comment ?
- Je pense qu’il va venir assez vite, je lui ai téléphoné tout à l’heure. Et puis c’est sa cave, non ?
- Oui, très bien, en effet…
Muller n’était pas trop content de la tournure, il aurait préféré surprendre adroitement le gaillard qui était déjà dans sa tête le suspect numéro 1. Il n’avait pas fini de penser qu’on sonna à la porte et que des éclats de voix résonnèrent dans la courette.
Weltz avait appuyé sur le bouton du carillon et s’était engagé dans l’allée ouverte pour se heurter quelques mètres plus loin aux deux « Bleus en faction » qui voulaient lui barrer le passage.
Weltz, sans émotion, expliqua calmement qu’il avait été appelé par Madame Wagner pour une histoire de cadavre et qu’en tant que propriétaire, il était vraisemblablement autorisé à passer.
Muller apparut au haut de l’escalier.
- Monsieur Weltz, sans doute, capitaine Muller de la PJ.
- Oui, Jean Weltz.
- Montez, s’il vous plait.
Weltz gravit les quelques marches et rejoignit les deux interlocuteurs. Madame Wagner, qui connaissait Jean depuis son adolescence, le salua amicalement et le convia à prendre place auprès d’eux. Déplaisant pour Muller, Weltz prit la parole et s’enquit des derniers événements.
Muller le trouvait antipathique et hautain, sûr de lui et narquois à son égard. Il lui donnait du Capitaine avec et sans majuscule, avec des intonations qui laissaient sourdre le peu de considération qu’il portait à un quinquagénaire de policier encore confronté à une enquête de quartier.
- Vous, capitaine Muller, vous voyez les choses comment ?
- Trop peu d’informations.
- Je peux peut-être vous soumettre les élucubrations que j’ai échafaudées lors de mon trajet jusqu’ici. Cette maison a en fait une histoire. Si vous voulez, je vous en fais un rapide tour d’horizon et vous trouverez de quoi alimenter votre propre imagination.
- Une enquête n’est pas affaire d’imagination, mais la résolution scientifique de l’équation posée par un faisceau de conjonctions et de circonstances, mon bon Monsieur.
- Ne le prenez pas mal, mais vous savez que la maison a été habitée par un criminel.
- Vous avez habité cet immeuble ? Echappa à Muller.
Weltz prit la chose très mal.
- Ecoutez, j’étais prêt à vous donner toutes les informations que je pensais utiles, mais si d’emblée vous ne prenez pas mon témoignage au sérieux ou pis, si vous affichez ma présomption de culpabilité, ne comptez pas sur moi pour vous aider. Je ne me mettrais pas en travers des travaux de la Justice, mais ma collaboration en perdra la spontanéité que je réserverai pour ma propre défense.
Madame Wagner, excusez mon emportement, nous nous reverrons…
Monsieur Muller, voici ma carte, si vous voulez me convoquer, je me rendrai à toute injonction ?
Bien le bonjour.
Il se leva et quitta la pièce puis la maison sans mot dire. Dehors il hésita un instant, puis songeant qu’il n’en demeurait pas moins propriétaire, s’empara de son trousseau de clés et se dirigea vers la cave de l’immeuble.
Les deux hommes en faction, dégrisés par le premier incident, ne s’opposèrent pas et c’est ainsi que Weltz put constater le sol défoncé de sa cave. Il se saisit du petit appareil photo automatique qui ne le quittait jamais depuis qu’il avait fait de la photographie plus qu’un hobby et mitrailla la cave en tous sens. Il insista aussi sur différents petits objets qui lui paraissaient incongrus dans cet espace lugubre. Tessons, clous, un portefeuille, un bourre-pipe…
Il en avait juste terminé lorsqu’en grand tapage, Cabarrus entra dans la cave. Weltz se prit la seconde engueulade de son beau dimanche d’été.
- Déjà la presse, qui vous a permis ?
- Je ne suis pas journaliste et n’ai pas besoin de permission, Monsieur. Mais soit, j’imagine que vous faites votre travail. Je ne vous gênerai pas.
Cabarrus voulut s’emparer de l’appareil photo de Weltz alors que celui-ci le glissait dans sa poche.
- Stop, hurla Weltz plus qu’il ne le dit, et jaugeant Cabarrus pour estimer son grade, il reprit un ton en dessous :
Brigadier, n’outrepassez pas vos droits. Je suis entré libre ici et sauf à m’arrêter sous un motif réel, la fouille corporelle est interdite. Je suis…
- M’en fous qui vous êtes, vous n’avez pas le droit de faire des photos, c’est le lieu d’un crime.
- Je ne jurerai de la vérité d’aucune de vos deux assertions. Un, j’ai le droit de photographier ma cave sans votre permission et même le dimanche. Deux, le lieu du crime, j’en doute un peu, je pense que vous voulez dire le lieu d’exhumation d’un cadavre.
Dans le mille.
Attiré par le bruit comme une mouche par l’arrière-train prolifique des chevaux de trait, Muller refit son entrée.
- Cabarrus, que se passe-t-il ?
- Ce Monsieur a fait des photos et ne veut pas me les donner.
- Faites donc les vôtres. Monsieur Weltz, on pourrait reprendre la discussion de tout à l’heure.
- Reprendre, guère, entamer oui, mais sur un autre ton.
- Remontons, si vous le voulez bien.
En remontant dans la courette, Muller profita de l’embellie et reprit :
- Vous pensez avoir des choses à m’apprendre, en rapport avec notre affaire ?
- Enfin, hésita Weltz, installons-nous au jardin de Madame Wagner, vous comprendrez…
Muller apprit que les grands-parents de Weltz avaient acheté le petit pavillon en 1967 sur leurs vieux jours après le décès de la famille Holterbach, précédemment propriétaire. Que cet immeuble était quasi-historique, Holterbach était artiste, poète dramaturge et avait une rue à son nom près du cimetière dans le même quartier.
Après le décès des grands-parents, son père, lui-même décédé depuis et dont il avait hérité la maison, l’avait louée à différents preneurs. Le dernier avant Madame Wagner, un certain Claude Tirette était un cas.
Un emmerdeur au départ qui cherchait maille à partir à tout le monde, querelle à chacun, payait ses loyers épisodiquement et ne répondait à aucune injonction de la Justice. Plusieurs fois condamné à quitter les lieux entre 1990 et 1996, il partit enfin le 6 janvier 1996, contraint et forcé par
« Vos collègues du SRPJ de Metz qui lui avaient tendu une souricière à l’heure légale après une enquête pour meurtre qui durait depuis plus de trois ans. Il en a pris pour vingt-cinq ans aux Assises de la Moselle et c’est seulement ainsi que la maison a été libérée. »
Mon père a pu la relouer.
Je pense mais ce n’est évidemment qu’un montage mental que Claude, je dis Claude par sympathie, a dû faire d’autres victimes, beaucoup de gens en avaient peur, les voisins. Mon père et moi, curieusement ne nous rendions pas compte du danger et de la violence potentiels de l’homme. Peut-être a-t-il aussi tué son épouse et d’autres témoins gênants de son forfait de 1993.
Intéressé, Muller n’en était pas moins circonspect.
L’accusation était claire et directe, Trop, peut-être ? Tout ce que disait Weltz paraissait vrai, pouvait vraisemblablement être vérifié, mais cela n’enlevait rien au malaise qui régnait et à son intuition primaire, Weltz cachait son jeu et surtout n’était pas sympathique. Pis encore, il apparaissait beaucoup plus intelligent et rationnel que lui. Et cela, ça le rendait jaloux, nerveux, irritable et prêt à commettre sur le champ toutes les fautes contre-indiquées au bon déroulement de l’enquête. Ne gonflait-il pas son propos pour contribuer à occulter d’autres faits, moins avouables ?
Sa lucidité aurait pu l’aider, mais comme il n’était pas conscient des deux derniers points, il fit de suite la faute qu’il ne fallait pas
- Et bien sûr, vous pouvez prouver tout cela ?
- Ecoutez, c’est vous le flic, moi je n’ai rien à prouver. Si vous me le demandez, je peux attester certaines dates. Trouver des documents dans les archives de mon père. Le reste sont des suppositions qu’il faudrait étayer par une enquête. Mais là, cela dépasse mes prérogatives et mes compétences.
- Vous, vous faisiez quoi à l’heure du crime ?
- Si cela était permis, je vous poserais la même question. Précisez la date et l’heure, Monsieur le Commissaire. Ce commissaire tomba comme une douche froide.
Oui ! C’était maladroit, inopportun, sot et bête tout à la fois. Ce n’est pas ainsi qu’il marquerait des points contre Weltz, a fortiori qu’il le coincerait, et surtout il s’aliénait son aide spontanée si par hasard le bougre était sincère. En professionnel il se fendit d’un très courtois et souriant :
- Vous restez, s’il vous plait à ma disposition ? interrogatif
- Bien entendu, Monsieur Muller, vous m’appelez quand vous voulez, conclut Weltz. Poursuivant, d’ailleurs : je vous invite chez moi à Retschwiller pour y goûter une prunelle maison dont vous apprécierez sûrement le grand âge.
Weltz prit congé. Finalement, son passage à la cave avait permis d’atténuer la verdeur du premier contact. Il s’était fait un malin plaisir de contrarier le vieux, comme il le surnommait déjà intérieurement, mais d’une certaine façon comptait un peu sur sa perspicacité sournoise pour dénouer cet écheveau délicat.
Bon, ce n’était pas une certitude, mais son petit doigt doté de sa fameuse voix intérieure qu’on ne sait rendre muette lui disait encore et encore que Claude était dans le coup.
Oui ! Alors qu’il ne pariait jamais, il avait failli un soir lors d’une discussion peu après l’arrestation de Claude parier que le décès de Dominique, l’épouse de Tirette n’était pas dû à une tumeur du cerveau mais bien à un hématome sous-dural, qui, bien enkysté, avait trompé la sagacité des médecins de l’hôpital de Hautepierre où elle était décédée.
Deux présomptions supplémentaires, lors de ses dernières souffrances, l’épouse mourante avait confié, aux dires d’une voisine, d’ailleurs une des maîtresses de Claude, qu’elle lui avait révélé que son époux était un meurtrier et que ce recel d’information la faisait mourir moralement autant que physiquement. Point deux, Claude, après le décès de son épouse, s’était empressé de faire incinérer le corps, pour éviter, c’était plausible, qu’une enquête fasse diligenter même plus tard une autopsie révélatrice
Weltz n’avait pas parié, fort de son principe qu’un pari gagné ou perdu tuait au moins une amitié. Et son avis, son intuition d’alors avait rejoint le cabas des souvenirs et venait d’être déterré en cette fin juillet 2001, concomitamment avec ce cadavre.
Chapitre quatre
Les voisins
Muller avisa qu’il était onze heures quarante-cinq et qu’il pouvait, avant son déjeuner, recevoir le témoignage d’un voisin comme on reçoit une confession, pensa-t-il. Qui choisir ?
Les voisins immédiats, dans une rue comme la rue Bastian, c’est comme dans un village. Tout le monde se connaît, se suspecte, se surveille. Bien sûr, ces petits îlots de sécurité se sont peu à peu élargis avec le temps mais ce coin de rues, entre la rue Heidenberg et l’extrémité Nord de la rue Bastian, c’est bien encore cette mentalité typique des années cinquante qui subsiste.
Qui vit là ?
Madame Wagner l’a renseigné. En face d’elle, une retraitée de la CTS, les tramways et bus strasbourgeois, veuve, Anna, presque octogénaire.
A côté un couple de retraités au premier, deux filles célibataires au rez-de-chaussée et un fils toxicomane au second.
De l’autre côté, Madame Weltz mère. L’ancienne collègue de madame Wagner, absente six mois dans l’année, en résidence d’été chez son fils à la campagne.
Plus loin un couple sans histoire, les Chardonneret.
Du côté pair de la rue,
les Bottier, lui la cinquantaine, représentant de commerce, elle diététicienne, trois enfants adultes vivants encore plus ou moins sous le toit parental comme c’est devenu la règle depuis quelques temps.