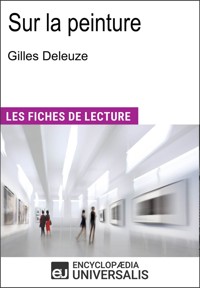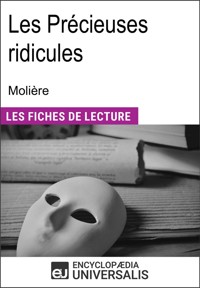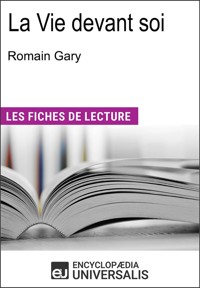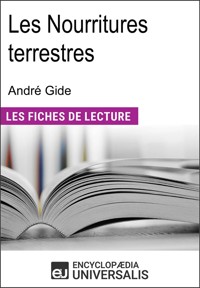Nara, trésors bouddhiques du Japon ancien. Le temple Kōfukuji (Paris - 1996) E-Book
Encyclopaedia Universalis
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Haut lieu de la pensée et de l’art bouddhiques, le monastère du Kofukuji fut un des plus grands temples du Japon entre le vii e et le xii e siècle. Les images du panthéon bouddhique, peintes ou sculptées, qui en ornaient les principaux édifices étaient des objets de culte...
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341010917
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Les grandes expositions sont l’occasion de faire le point sur l’œuvre d’un artiste, sur une démarche esthétique ou sur un moment-clé de l’histoire des cultures. Elles attirent un large public et marquent de leur empreinte l’histoire de la réception des œuvres d’art.
Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches exposition d’Encyclopaedia Universalis associent un compte rendu de l’événement avec un article de fond sur le thème central de chaque exposition retenue : - pour connaître et comprendre les œuvres et leur contexte, les apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause ; - pour se faire son propre jugement sous la conduite de guides à la compétence incontestée.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Nara, trésors bouddhiques du Japon ancien. Le temple Kōfukuji (Paris - 1996)
Haut lieu de la pensée et de l’art bouddhiques, le monastère du Kōfukuji fut un des plus grands temples du Japon entre le VIIe et le XIIe siècle. Les images du panthéon bouddhique, peintes ou sculptées, qui en ornaient les principaux édifices étaient des objets de culte hautement vénérés. Dans un contexte de prospérité et de rayonnement, les ateliers de sculpture du monastère produisirent des œuvres qui aujourd’hui encore reflètent la quintessence des recherches plastiques qui furent menées au Japon dans le domaine de la statuaire bouddhique. Une cinquantaine de pièces des trésors du Kōfukuji sont sorties pour la première fois du temple et ont été présentées au Grand Palais, du 20 septembre au 9 décembre 1996. Cet événement culturel majeur concernait à la fois l’histoire de l’art et l’histoire de la pensée.
Fondé en 669 à Uji sous le nom de Yamashinadera, le temple Kōfukuji fut transféré à son emplacement actuel en 710, lors de la fondation d’Heijōkyō (l’actuelle Nara), première capitale « permanente » du Japon. Temple tutélaire de la famille Fujiwara, il devint l’un des monastères les plus importants du pays. À l’origine temple privé, il est inscrit dès la seconde moitié du VIIIe siècle parmi les établissements bouddhiques dépendant de l’État. Grâce à la protection du clan Fujiwara, qui règne de facto sur le Japon de 969 à 1068, et à l’affermissement de son assise économique par l’acquisition de nombreux domaines, le Kōfukuji continuera à prospérer au cours de l’époque de Heian (794-1185), bien que la capitale ait été transférée à Kyōto.
Le Kōfukuji est un des premiers monastères de l’école Hossō, l’école de l’« Aspect des entités ». Il enseigne l’un des courants majeurs du bouddhisme du Grand Véhicule (Mahāyāna), celui de l’école indienne des yogācāra (« les pratiquants du yoga »), que l’on appelait encore les « tenants de la conscience » (vijñānavādin). Les deux grandes figures de ce courant de pensée sont Asanga et Vasubandhu (en japonais, respectivement Muchaku et Seshin), des frères, d’origine brahmanique, qui vécurent au Ve siècle dans le nord de l’actuel Pakistan. L’essentiel de leurs doctrines est exprimé dans le terme même qui les désigne : le « rien que conscience » (en japonais yuishiki), souvent assimilé à l’idéalisme dans la pensée européenne.
L’école Hossō se fonde sur la doctrine de la « conscience réceptacle », strate la plus profonde de la conscience, qui reste foncièrement pure et recèle la possibilité de devenir bouddha (« éveillé »). La pratique de l’école idéaliste suit les préceptes du yoga bouddhique (méditation, concentration, recueillement) et a pour but d’opérer une « révolution du support » psychique afin de percevoir la réalité des choses. Les choses, ou entités, peuvent être perçues sous trois aspects : imaginaire (celui de la perception vulgaire), dépendant (perception de la causalité qui produit les choses) et, enfin, absolu, qui est la vraie nature des choses et dont la découverte conduit à l’illumination. L’examen des « aspects des entités » (sanskrit dharmalakshana ; japonais hossō) est le fondement de la théorie et de la pratique de cette école.
Les images cultuelles présentées à l’exposition sont avant tout des objets de dévotion et des supports à la méditation, dont on ne peut comprendre l’évolution stylistique qu’au regard de la pensée doctrinale qui les a conçues.
Les premières époques (VIe et VIIe siècles) de la statuaire bouddhique japonaise avaient privilégié le travail du métal, fondu à la cire perdue et repris au ciseau en dernière phase. Techniques, formes et motifs étaient alors dans la continuité des œuvres des dynasties de la Chine du Nord, dont l’influence avait été transmise par le royaume de Paekche en Corée. La tête du Bouddha Yakushi (685), le « Maître aux remèdes », retrouvée dans le socle de la statue principale du sanctuaire de l’Est, atteste la haute qualité des bronzes japonais du VIIe siècle et de la grande pureté des lignes et des plans, simples et amples, symboles de paix et de sérénité.
Les artistes de l’époque de Nara (710-784) s’orientèrent vers des matières plus malléables, adoptant la technique du laque sec (kanshitsu) et de l’argile (sozō). Les sculpteurs du Kōfukuji excellèrent particulièrement dans la technique du laque sec évidé (dakkatsu kanshitsu) : une armature de bois était recouverte d’argile, puis de plusieurs épaisseurs de chanvre imbibé de laque, formant, après séchage, une coque rigide ; on incisait ensuite la statue pour en extraire l’argile, puis on la recousait avec du chanvre ; la couche finale était en laque mêlé d’argile ou de fils de textile (kokuso-urushi), ce qui permettait une précision extrême dans le traitement des surfaces. L’ensemble était rehaussé de couleurs et de dorures à la feuille.
Ces techniques existaient en Chine, mais les sculpteurs du Kōfukuji dépassèrent rapidement leurs modèles. L’assimilation était créatrice, mue par les besoins d’une recherche spirituelle intérieure – et de son expression dans les œuvres –, comme le montre la statue de Subodai (734), l’un des Dix Grands Disciples du Bouddha : ici, la maîtrise du laque sec se ressent particulièrement dans la finesse de l’expression du visage et le rendu des plis pleins de douceur.
Avec la série des Dix Grands Disciples et celle des Êtres des Huit Catégories, de la même époque, l’émancipation stylistique devient manifeste dans le subtil traitement du détail. Le naturalisme des œuvres apparaît dans le mouvement des lèvres, dans la position des mains, dans l’expression de la jeunesse, de la vieillesse ou de la maturité. Grâce à la technique du laque sec, cette diversité du détail, la douceur et la rondeur des formes montrent une expression nouvelle de recherche d’une réalité plus profonde, située au-delà du monde des apparences.
Au cours de l’époque de Heian, l’introduction au Japon du bouddhisme ésotérique (école Shingon), avec son cortège d’images à l’aspect farouche, et les conceptions nouvelles de l’école Tendai, portant notamment sur l’universalité de la nature du Bouddha chez les êtres (niée par l’école idéaliste du Hossō), vont conditionner l’évolution stylistique des œuvres.
À partir du IXe siècle, le bois devient le matériau de prédilection des sculpteurs japonais. Travaillé à cette époque en taille monoxyle (ichiboku-zukuri), ce qui induisait une certaine compacité des masses, il évolue vers la technique dite yosegi-zukuri : un grand nombre de pièces sont sculptées séparément, puis assemblées, ce qui exalte admirablement toutes les possibilités de ce matériau. Dès lors, une grande liberté est acquise, tant dans la souplesse et le mouvement de formes, amples, que dans l’expression du détail, où les sculpteurs japonais excellent en jouant sur les différents grains et les textures veinées du bois. Le Bouddha Yakushi daté de 1013 (bois monoxyle), rend déjà compte de cette souplesse par la rondeur de ses formes parfaitement maîtrisées. Le sculpteur Jōchō sera à cette époque un des plus fins représentants de cet art.
À partir du XIIe siècle, toutefois, le courant naturaliste s’oriente vers la recherche d’un réalisme aigu. Ce mouvement donne naissance à une statuaire d’où se dégagent avec force les choses et les êtres tels qu’ils sont en eux-mêmes et dans tout le poids de leur réalité terrestre. Le réalisme du crâne, des rides du cou et des mains de la statue de Genbō, un des Six Patriarches de l’école Hossō, sculpté par Kōkei en 1189, est représentatif de cette évolution. Du rapport des masses de la robe de moine et des chairs, du traitement des yeux et de l’impressionnante fixité du regard, de l’expression d’une souffrance heureuse et de la sensualité du mouvement des lèvres se dégage la profonde spiritualité de l’adepte de l’école Hossō, présenté pourtant dans tout le détail de sa matérialité terrestre.
Les œuvres réalisées par Unkei à partir de 1207 pour le Kōfukuji témoignent, quant à elles, de la personnalité hors du commun de ce sculpteur. Imprégné des recherches stylistiques de Kōkei, son père, il charge ses œuvres d’une intensité spirituelle et d’une présence charnelle encore inédites. L’expression d’une réalité purement humaine est pleinement traitée. À travers les représentations de Muchaku et Seshin (1208-1212), Unkei atteint au plus haut point de l’art réaliste de l’époque de Kamakura. L’intense présence des moines et de la vie intérieure qui les anime fascine d’autant plus que les représentations de ces personnages ayant vécu en Inde entre le IVe et le Ve siècle sont purement imaginaires. Dénués de symbolisme, de toute dimension abstraite, ces portraits – qui n’ont rien perdu de leur essence divine – échappent malgré leur réalisme à toute temporalité et atteignent à l’universel.
Nicolas FIÉVÉ
JAPON ARTS ET CULTURE
Issu, comme tous les arts de l’Extrême-Orient, de la Chine qui lui a fourni techniques et modèles, l’art japonais se distingue, cependant, par l’originalité de ses créations.
Son développement est scandé de périodes d’absorption, où se manifeste un intérêt avide pour les formules étrangères, et de périodes d’adaptation au cours desquelles se dégagent les tendances autochtones. Aux époques mêmes où la curiosité de l’exotisme est la plus intense subsiste une fidélité aux traditions locales qui resteront sous-jacentes dans les œuvres inspirées de l’étranger.
Lorsque, aux VIe et VIIe siècles, le Japon s’ouvre aux influences continentales sous le couvert du bouddhisme, il se met avec application à l’école des artisans venus de Corée pour l’initier. Dès la fin du VIIe siècle, les modèles Tang, apportés directement de Chine, sont si fidèlement copiés qu’il est parfois difficile de distinguer les œuvres importées de celles qui sont exécutées sur place.
Le message religieux exprimé par l’œuvre d’art semble avoir été assez tôt assimilé, mais les principes esthétiques qui ont présidé à sa création échappent aux artisans chargés de la reproduire.
L’élaboration d’un art national s’est effectuée dans le cadre étroit et raffiné d’une cour où hommes et femmes rivalisent d’élégance et de talents divers. Leur sensibilité très vive s’exprime dans leurs poésies comme dans leurs romans et devient pour eux le moteur primordial de la création artistique. Cette sensibilité se traduit dans l’écriture simplifiée, issue de caractères chinois, par la rapidité nerveuse du trait et par sa douceur harmonieuse. Dans l’art de peindre, cette recherche d’une ligne tout à la fois souple et douce reste jusqu’à nos jours un critère fort apprécié.
L’intimité avec une nature amie fait du paysage un cadre évocateur d’images poétiques et d’émotions, et non, comme en Chine, la traduction d’une conception de l’univers.
À la cour, tout était prétexte à divertissements et à joutes : joutes poétiques, musicales, concours de parfums, de danses et de peinture. L’art devint ainsi, par excellence, l’expression suprême d’un jeu. Cette conception subsistera dans la « cérémonie du thé », divertissement de haut goût où tout – qu’il s’agisse du cadre, de la peinture ornant le tokonoma, de l’arrangement de fleurs et des ustensiles utilisés – doit contribuer par sa perfection et sa sobriété à faciliter l’évasion hors de la vie quotidienne et du temps. Dans le pavillon de thé, s’ouvrant sur un jardin, s’observe une organisation ingénieuse de l’espace, dominée par l’asymétrie, ainsi que l’usage fort heureux de matériaux très frustes (bois à peine équarri, toiture en chaume ou en écorce d’arbre). Dans la céramique, les maîtres du thé ont préféré aux formes parfaites de la porcelaine, qui satisfait les exigences tactiles les plus raffinées, les créations plus spontanées – où jouent les hasards du feu – de la poterie et son contact plus rude.
1. Évolution générale
L’archipel nippon, qui s’étend en arc de cercle du 31e au 46e parallèle le long du littoral asiatique, était, jusqu’il y a environ dix mille ans, rattaché au continent par ses extrémités méridionale et septentrionale. Il a donc, contrairement aux thèses longtemps admises, partagé dans les temps anciens l’évolution des premières cultures continentales. Ce fait et, même après l’effondrement qui transforma la configuration géographique de cette région du globe, la proximité du Nord-Kyūshū des côtes de la Corée, comme celle de Hokkaidō des côtes sibériennes, expliquent les nombreux apports reçus du continent, apports qui furent assimilés avec originalité grâce à l’insularité du pays. À l’intérieur de l’archipel, des communications maritimes aisées ont facilité les échanges. Dans la grande île de Honshū, des barrières montagneuses descendant du nord au sud rendirent difficile le passage du littoral de la mer du Japon vers celui du Pacifique. Ce dernier, favorisé par le climat, a été et est encore le centre du développement de la civilisation japonaise.
On note au Paléolithique le parallélisme du peuplement (Pithécanthrope d’Akashi et Sinanthrope de Pékin) et de l’outillage (hachereaux et galets éclatés) avec ceux du bassin du Huanghe. Au Mésolithique, les microlithes s’apparentent à ceux de la « Chine des sables ».
Longtemps considéré comme le premier témoin de l’activité humaine au Japon et daté de façon relativement tardive, le Néolithique semble remonter au IVe millénaire avant notre ère. Dans la culture dite Jōmon (décor d’impressions cordées des poteries), de petites communautés de chasseurs-pêcheurs, vivant dans des demeures semi-souterraines (tate-ana), ont laissé d’abondants amas de coquillages (kaizuka). Leur matériel lithique est proche de celui de groupements analogues de la Sibérie. La poterie se distingue par ses impressions cordées (Honshū) ou de coquillages (Kyūshū). Au Plein Jōmon (IIIe-IIe millénaires av. J.-C.), les bassins profonds du Kantō, aux bords ourlés de boudins rapportés et modelés, ont un aspect baroque très original.
• Période Yayoi
Vers le IIIe siècle avant J.-C., dans le Nord-Kyūshū, des apports venus du continent entraînent l’apparition de la culture Yayoi (agriculture et surtout riziculture, métallurgie du bronze, puis métallurgie du fer, tissages, différents modes d’architecture et de sépultures, céramiques nouvelles). La culture du riz est attestée dans cette région par la présence, dans la couche supérieure du Jōmon d’Itazuke non loin de Fukuoka, de grains et de couteaux semi-lunaires à œillet, en pierre polie, symbole de l’agriculture de la vallée du Huanghe (Chine). Cette introduction semble correspondre à la période de rayonnement de l’empire des Han et à leur conquête du nord de la Corée, conquête qui favorisa l’évolution des autochtones du sud de la presqu’île. Ceux-ci semblent avoir joué un rôle important dans cette transformation du Japon, et l’on trouve à Kyūshū leurs tombes à cystes, bientôt remplacées par des jarres funéraires, souvent protégées par des dalles en pierre. Dans ces sépultures, on trouve en abondance des armes et des miroirs (à lignes fines et à double bouton), de provenance coréenne, auxquels s’adjoignent de nombreux miroirs Han que l’on peut dater de la période allant du Ier siècle avant J.-C. au début du IIe siècle de notre ère. Il se pourrait que, dès ce moment, les communautés villageoises de Kyūshū aient noué des relations directes avec la Chine par l’intermédiaire de la commanderie de Lo-lang en Corée. Mais il semble que, parmi ces agriculteurs, les armes importées n’aient pas eu de valeur guerrière. Elles disparaissent bientôt des sépultures à jarres et font place à des objets de culte ou de protection magique. Elles prennent alors des dimensions beaucoup plus importantes, et leurs lames, élargies et foliacées, perdent leur tranchant. On les retrouve groupées dans des caches au sommet des collines. Des moules en pierre, découverts au Kyūshū, montrent qu’elles étaient, dès lors, fabriquées sur place. L’agriculture et les armes symboliques semblent avoir progressé rapidement dans l’île principale de Honshū, le long du littoral de la mer Intérieure et dans le sud de Shikoku. Les armes sont alors ornées de motifs de spirales et de stries parallèles.
Dans la région du Kinai et dans le nord-ouest de Shikoku, les armes symboliques sont remplacées par desdōtaku (litt. « cloches de bronze ») issus, semble-t-il, des clochettes coréennes. À l’encontre de ces dernières, de taille très réduite, les dōtaku prennent une ampleur croissante (de 25 à 70 cm). Ils sont, comme les armes, groupés dans des caches isolées au flanc ou au sommet des collines, et leur signification reste encore très discutée. Il paraît hors de doute que les plus petits ont eu un rôle musical. Ils portent à l’intérieur un anneau qui permettait d’y adjoindre un battant ; et on a retrouvé, auprès de certains d’entre eux, ce battant, en fer, qui s’était détaché au cours des âges. De forme semi-cylindrique, ces dōtaku on dû être moulés en éléments séparés (les deux faces bombées et la poignée en quart de cercle), rassemblés ensuite sur les côtés qui se prolongent en bord aplati formant des sortes de nageoires. On y retrouve les spirales, les stries déjà observées sur les armes, ainsi qu’un motif ondé. Bientôt, les deux faces se divisent en registres superposés, séparés par des bandes de lignes croisées. Les nageoires et la poignée sont ornées de spirales dont certaines, dépassant les bords, forment des ponctuations en relief qui correspondent aux différents registres du décor central. Dans les pièces monumentales, ce motif, compartimenté, se peuple de silhouettes, schématiques mais mouvementées, de paysans pilant le riz, de scènes de chasse, de hérons, de libellules et de tortues ; ces dernières, contrairement à l’usage généralisé du profil, sont figurées en vue surplombante.
Outre leur intérêt documentaire, ces grands dōtaku témoignent d’une industrie métallurgique déjà élaborée dont, à l’encontre de celle de la Chine, aucun autre vestige n’a encore été retrouvé. Bien que semblant issue des mêmes sources que le Yayoi de Kyūshū, on peut se demander si la culture du Kinai, où sont retrouvés de façon sporadique des miroirs à lignes fines et des miroirs chinois, n’a pas reçu de nouveaux apports en provenance du continent, apports dont l’origine et la voie de diffusion restent inconnus.
Ces techniques se répandent rapidement le long du littoral de la mer Intérieure et parviennent au Kinki (Kansai) et au Tōkaidō. Les progrès de l’agriculture ont dû favoriser les cultes naturistes, qui seront l’une des composantes de la religion japonaise, ainsi que cette intimité avec la nature qui constitue encore l’une des caractéristiques essentielles de l’âme nippone. Le développement des communautés paysannes à cette époque entraîne des diversifications sociales et l’apparition de petites entités politiques.
• Période des grandes sépultures
L’une de ces entités, établie dans la plaine du Yamato, au nord-est d’Ōsaka, croît rapidement à partir du IVe siècle et noue des relations avec les royaumes de la Corée du Sud. Ses kofun, sépultures de très grandes dimensions, d’inspiration coréenne, ont une forme originale en entrée de serrure (zempō-kōen : avant de forme carrée, arrière arrondi) et sont entourés de fossés. À la base des tumulus sont alignées des rangées de cylindres d’argile fichés dans la terre (haniwa) ; ils seront bientôt surmontés (Ve-VIe s.) de personnages et d’animaux. Les kofun ont livré un important mobilier (armes, parures en bronze ajouré et doré, céramiques en grès ou sueki). Certains de ces objets sont d’origine coréenne, d’autres furent fabriqués sur place par des artisans venus de la péninsule. En 538, le souverain de Paiktche (royaume occidental de la Corée du Sud) envoie au souverain du Yamato, son allié, une image et des sūtra bouddhiques. La religion étrangère – d’abord tenue en échec par les adeptes des cultes locaux organisés au Yamato autour de la déesse solaire Amaterasu, dont se réclame la lignée impériale – sera officiellement imposée à la cour, à la fin du VIe siècle, par le régent Shōtoku, qui gouverne au nom de sa tante l’impératrice Suiko.
• Époque Asuka et Hakuhō (593-710)
Chez Shōtoku (régence 593-621), la ferveur bouddhique se conjugue avec le désir de consolider la prééminence du Yamato sur les clans voisins et de former un État centralisé à la mode chinoise. Des ambassades sont envoyées à la cour des Sui en 607, puis à celle des Tang qui succèdent aux Sui en 618. Shōtoku préside à la fondation des premiers sanctuaires bouddhiques, édifiés par des artisans coréens selon les procédés de l’architecture chinoise. Des praticiens d’origine continentale sculpteront ou peindront les images bouddhiques, tel Tori, descendant de Chinois, qui fondra les premiers Buddha en bronze : triade de Shakamuni (Çākyamuni) du Hōryū-ji, de 622. L’influence du style chinois des Wei du Nord se manifeste dans ces effigies, mais on y décèle aussi des traits empruntés au style des Qi du Nord, introduit dans la seconde moitié du VIe siècle en Corée du Sud : Miroku (Maitreya) du Kōryū-ji et du Chūgū-ji. À partir de 645, la rondeur des formes et le sourire enfantin de la plastique Sui font leur apparition, tandis que les palais impériaux adoptent plan symétrique et structures à la chinoise. À la fin du VIIe siècle, les ambassades rentrant de Chine, accompagnées d’un personnel nombreux de moines et d’étudiants qui se sont perfectionnés sur le continent, apportent au Japon l’art des Tang. Les peintures murales du Kondō (temple d’Or) du Hor̄yū-ji furent, jusqu’à leur disparition dans les flammes en 1949, les témoins prestigieux de la peinture bouddhique des Tang. Le Japon a alors rattrapé son retard, et la grande triade en bronze du Yakushi-ji, dont les plicatures laissent apparaître le modelé des corps, reste le symbole de cette maîtrise nouvelle.
• Époque de Nara (710-794)
En 710, une capitale fixe (Heijō-kyō, aujourd’hui Nara) est établie sur le plan en damier de Chang’an, la métropole des Tang. Le rayonnement de l’Empire chinois atteint alors son apogée. Les plus anciennes Annales japonaises, rédigées en chinois, datent de cette époque. Le bouddhisme, facteur de culture et protecteur de l’État, est florissant, mais la religion japonaise (shintō, « voie des dieux ») subsiste, et ses sanctuaires (Izumo et Ise) conservent le souvenir de l’architecture primitive : plancher surélevé, toiture en écorce de hinoki reposant directement sur des poteaux en bois.
Des monastères fondés à Nara et aux alentours de la capitale, le plus célèbre est le Tōdai-ji, érigé par l’empereur Shōmu (règne 724-748) en l’honneur de Birushana (Vairocana, le Buddha universel), dont l’image en bronze doré était abritée dans le sanctuaire principal (Daibutsu-den).
Les ateliers de la cour réunissent de nombreux artisans – sculpteurs, peintres et calligraphes – qui décorent les palais et les monastères ou copient des sūtra. Tout un peuple de sculpteurs – en bronze, laque sec (kanshitsu) ou plâtre – orne les différents sanctuaires et conserve le souvenir de l’art chinois du VIIe siècle : élégance des proportions, réalisme des visages, rehauts peints. Au Nord-Kyūshū, où abordent les navires japonais, chinois et coréens, parviennent des objets d’art qui sont ensuite dirigés vers la cour. Les motifs ornementaux japonais se constituent à partir de leur décor. Un grand nombre de ces trésors sont aujourd’hui encore conservés au Shōsō-in, où furent entreposées en 756 les collections de l’empereur Shōmu, offertes au Tōdai-ji par sa veuve.
• Époque Heian (794-1185)
En 794, l’empereur Kammu (règne 781-806) s’établit à Heian-kyō (aujourd’hui Kyōto, dans un site entouré au nord, à l’est et à l’ouest par un cirque de montagnes. Le plan de cette cité nouvelle est fidèle aux formules Tang, et l’influence de la Chine demeure prépondérante. L’aristocratie de cour (kuge) s’imprègne de la culture et de la poésie de l’Empire voisin. Revenus du continent au début du IXe siècle, les moines Saichō (Dengyō-daishi) et Kubai (Kōbō-daishi) font connaître l’un le syncrétisme du Tendai (en chinois Tiantai), l’autre le bouddhisme ésotérique du Shingon (en chinois Zhenyan). Ils établissent leurs monastères à l’écart de la capitale, le premier au mont Hiei, le second au mont Kōya (Kōyasan). Abandonnant les plans symétriques en honneur chez les Chinois, leurs monastères s’adaptent au cadre naturel. Une iconographie nouvelle apparaît, principalement dans le panthéon de Shingon : des diagrammes ou mandara (mandala) groupent, autour d’une entité métaphysique – Dainichi Nyorai –, Buddha et Bodhisattva qui en sont l’émanation. Des modèles rapportés de Chine par Kukai sont répétés dans les ateliers des monastères. La somptuosité des cérémonies Shingon plaît à la cour. Les images peintes ou sculptées dans le style ample de la fin des Tang, déjà apparu au Tōshōdai-ji de Nara, à la fin du VIIIe siècle, se multiplient. Les sculptures taillées dans une seule pièce de bois (ichiboku) ont des plis profondément creusés.
Au palais impérial, les paravents (byōbu) s’inspirent du style et des légendes de la Chine. Mais, à la fin du IXe siècle, la décadence des Tang entraîne l’interruption des relations officielles avec l’Empire chinois. Désormais, seuls des navires chinois et coréens assureront les échanges. Le Japon se replie sur lui-même et élabore rapidement une culture et un art proprement nationaux. L’adoption d’un syllabaire ou kana favorise l’éclosion de la littérature : poèmes et romans font leur apparition dans les milieux aristocratiques. On voit alors se développer un art de cour dans lequel s’exprime une sensibilité teintée de mélancolie (mono no aware), due au sentiment de la fugacité des choses de ce monde, en même temps qu’une vive curiosité pour toute nouveauté. Avant la fin du IXe siècle, un atelier de peinture (e-dokoro) avait été établi au palais. Les artistes collaborent avec les poètes et les calligraphes de l’aristocratie pour l’élaboration des paravents impériaux, où sont illustrées les quatre saisons par l’évocation de la campagne et des sites célèbres du pays. C’est ainsi qu’aux paysages féeriques à la manière Tang, aux montagnes étagées, succèdent des compositions plus décoratives dont les deux plans évoquent les contours arrondis des collines environnant la capitale.
Architecture seigneuriale à l'époque Heian. Shinden-zukuri : architecture seigneuriale à l'époque Heian. Résidence du souverain dans le palais impérial de Heian-kyō (Kyōto). Reconstitution datant de 1855 (d'après Ota H., « Japanese Architecture and Gardens », Tōkyō, 1966).
La cour est dominée par les Fujiwara, qui gouvernent au nom des souverains. Ils sont les arbitres d’une élégance qui se manifeste jusque dans les peintures bouddhiques aux vives couleurs rehaussées de fils d’or (kirikane), dans les sculptures aux formes graciles, dans les laques rehaussés d’or et d’argent. Ils vénèrent Amida, maître du paradis de l’Ouest où sont accueillies les âmes de ceux qui l’invoquent à leur dernière heure. Le symbole de cette époque brillante reste le Hōōdō (pavillon du Phénix) du Byōdō-in, établi au bord de la rivière d’Uji en 1053 par Fujiwara Yorimichi, désireux d’évoquer sur cette terre les délices de la Terre pure. Le pavillon se reflète dans un étang. Somptueusement décoré, le sanctuaire abrite une statue d’Amida en bois laqué et doré, œuvre du maître Jōchō et exemple classique d’une technique nouvelle de sculpture par pièces assemblées (yosegi) qui permit à l’artiste de se faire aider par ses élèves et favorisa la constitution de nombreux ateliers. Sur les parois et les vantaux des portes, des peintures représentent le cortège d’Amida et des Bodhisattva traversant la campagne pour se rendre à l’appel d’un mourant. Ainsi, même dans la peinture religieuse, le style nouveau du yamato-e (« peinture du Yamato », peinture nationale), s’opposant au kara-e à la mode chinoise, fait son apparition. Dès ce moment, des rouleaux enluminés (e-maki) illustrent poèmes et romans de l’époque. L’exemple classique est le Genji monogatari e-kotoka, dont il subsiste des fragments alliant le texte magnifiquement calligraphié à quelques représentations d’épisodes caractéristiques. Quoique inspirés des modèles Tang, le style et la composition sont typiquement japonais, les personnages très statiques sont traités en couleurs opaques ou tsukuri-e. On date généralement cette œuvre des environs de 1130. Dans la seconde moitié du siècle, le Shigisan engi révèle un style différent, qui porte l’accent sur la ligne tracée à l’encre de Chine et rehaussée de couleurs transparentes. Une grande place est faite au paysage, et les personnages saisis en mouvement sont très individualisés. Le Ban Dainagon e-kotoba allie ce style masculin (otoko-e) à celui du Genji (onna-e) destiné aux dames de la cour. Ces compositions plus mouvementées semblent le reflet des troubles qui marquent la fin du XIIe siècle. Les Fujiwara ont perdu leur autorité. Pour assurer leur pouvoir, les souverains ont fait appel aux guerriers, établis dans les provinces et possesseurs de vastes domaines. Leurs groupes rivaux ne tardent pas à s’affronter et, en 1185, Minamoto no Yoritomo triomphe.
• Époque Kamakura (1185-1333)
Yoritomo prend le titre de shōgun (général en chef) et crée, loin de la capitale, à Kamakura dans le Kantō, un gouvernement militaire (bakufu). Les buke (guerriers) succèdent aux kuge (aristocrates). Désireux de reconstruire les grands monastères de Nara, détruits au cours des luttes récentes, Yoritomo envoie en Chine Shunjōbō Chōgen, qui ramène du continent de nouvelles formules architecturales et des sculpteurs pour réparer le Grand Buddha du Tōdai-ji. Dans l’art plastique, le réalisme assez pictural de la Chine des Song se conjugue avec un retour aux styles de l’époque de Nara, dans une lignée de grands sculpteurs réunis autour d’Unkei. Ce réalisme s’affirme aussi dans les peintures bouddhiques.
Dans le même temps, les moines de la secte Chan – en japonais Zen – venus de Chine répandent leur doctrine de méditation et connaissent bientôt la faveur des guerriers. Ils introduisent un nouveau mode d’architecture, plus simple et plus dépouillé. Le style kara-yō s’opposera désormais à l’architecture de Heian ou wa-yō. Les e-makimono, où s’exprime le goût narratif des Japonais, traitent des sujets les plus divers. Certains restent fidèles aux formules de l’époque antérieure, d’autres subissent l’influence du réalisme chinois.
En dépit de la résistance opposée aux envahisseurs mongols qui ont tenté d’aborder au Japon en 1285 et en 1291, l’autorité du bakufu est diminuée. Ashikaga Takauji met fin au pouvoir de Kamakura mais, dès son entrée à Kyōto, se proclame à son tour shōgun.
• Époque Muromachi (1333-1573)
Autour de Takauji, établi à Kyōto, dans le quartier Muromachi, et autour de ses successeurs se crée une cour nouvelle où les moines zen font régner la culture des Song. Ils ont le privilège du commerce avec la Chine, et leurs navires en rapportent de nombreuses œuvres d’art. Peintures, laques, soieries, céramiques ornent les demeures somptueuses des abbés, entourées de jardins où s’allient les pierres et les eaux. À l’école des moines zen, les shōgun se font collectionneurs. Dans leurs résidences où le style wa-yō (japonais) se conjugue au kara-yō d’inspiration chinoise, Yoshimitsu (1358-1408) et Yoshimasa (1435-1490) réunissent leurs familiers pour montrer leurs trésors. Au Higashiyama, Yoshimasa mène une vie d’esthète, et sa demeure annonce une architecture nouvelle : tokonoma (sorte de niche), tana (étagères) et tablette écritoire (shoin) ménagée sous une fenêtre ronde, ainsi naît le style shoin. Les fusuma (portes à glissière) s’ornent de peintures à l’encre où jouent traits et taches de lavis (suiboku). Ces œuvres des Ami ou des Shūbun s’inspirent des rouleaux Song et Yuan introduits en grand nombre depuis le XIIIe siècle et imités par les moines zen. Adaptés aux formats en largeur des fusuma, les paysages chinois montrent une tendance décorative.
C’est dans ce cadre raffiné que sont célébrées les premières cérémonies du thé et représentés les premiers nō.
À la fin du XVe siècle, Sesshū Tōyō, initié au suiboku dans un monastère, fait un court séjour en Chine, où il approfondit cette nouvelle technique qui lui permet de rendre l’essence même du paysage japonais. Mais la guerre civile se rallume. Les artistes se réfugient en province. Dans le port de Sakai (près d’Ōsaka), les marchands enrichis par le commerce avec la Chine et l’Asie du Sud-Est élaborent le chanoyu, faisant choix de céramiques japonaises. Vers 1545, les Portugais abordent au Japon. Des hommes nouveaux vont désormais présider aux destinées du pays. Trois dictateurs s’efforcent successivement de l’unifier.
• Époque Azuchi-Momoyama (1573-1603)
En 1573, Nobunaga fait son entrée à Kyōto. Ainsi s’inaugure une des périodes les plus brillantes de l’art japonais, où le désir de luxe des gouvernants se conjugue avec celui de l’exotisme avivé par les voyages lointains et par la présence des Portugais, porteurs du message de l’Occident. Pour décorer son château fort d’Azuchi au bord du lac Biwa, Nobunaga fait appel à Kanō