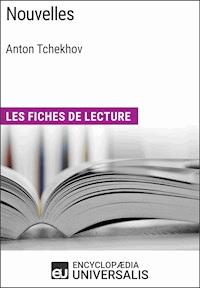
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Anton Tchekhov (1860-1904) a publié des nouvelles depuis l’âge de vingt ans jusqu’à sa mort. Ces textes constituent la majeure partie de son œuvre et lui ont valu la célébrité à l’égal de son théâtre, avec lequel ils sont d’ailleurs organiquement liés. C’est par ses nouvelles aussi qu’il est devenu, en son pays, l’un des classiques les plus lus et probablement le plus populaire.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Nouvelles d'Anton Tchekhov
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 32
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852294790
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Nouvelles, Anton Tchekhov (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
NOUVELLES, Anton Tchekhov (Fiche de lecture)
Anton Tchekhov (1860-1904) a publié des nouvelles depuis l’âge de vingt ans jusqu’à sa mort. Ces textes constituent la majeure partie de son œuvre et lui ont valu la célébrité à l’égal de son théâtre, avec lequel ils sont d’ailleurs organiquement liés. C’est par ses nouvelles aussi qu’il est devenu, en son pays, l’un des classiques les plus lus et probablement le plus populaire.
Chronologiquement, ces nouvelles se situent dans une période de transition, durant laquelle Tchekhov se fraie une voie personnelle et novatrice. Mais, comme tout grand classique, il dépasse son époque pour atteindre la plus large universalité.
• Le prosateur en son temps
Jusqu’alors, de Gogol à Dostoïevski, les grands prosateurs russes avaient fait des débuts éclatants en littérature. Tchekhov, lui, entre par la petite porte. Étudiant en médecine, il écrit à la va-vite de brefs récits pour des feuilles humoristiques : travaux alimentaires, publiés sous divers pseudonymes, et qui n’ont même pas le statut d’œuvres littéraires. Des recueils paraissent, néanmoins : un premier en 1884 (Contes de Melpomène), un deuxième en 1886 qui aura un vif succès (Contes bariolés), d’autres encore. Les sujets sont variés. Ce sont souvent des « fragments de vie moscovite », de rapides et efficaces croquis de vie quotidienne. Pourtant ce n’est pas le fait divers curieux qui prédomine. Très tôt, l’écrivain excelle à se saisir d’un détail minuscule auquel le jeu littéraire va donner sens.
À partir de 1886 Tchekhov, s’il est désormais un talent reconnu, n’en poursuivra pas moins sa voie solitaire, qui contraste nettement avec les traditions de la « grande littérature russe » telles qu’elles se sont institutionnalisées. Il fuit la consécration que donneraient les « grandes » revues prestigieuses (où ont été publiés les gros romans de Dostoïevski et de Tolstoï), les « grandes » idées, les grandes déclarations, les engagements. De contrainte journalistique, la brièveté devient chez lui concision (« sœur du talent »), forme de la rigueur scientifique (on retrouve ici l’acuité du médecin) et de la lucidité intellectuelle (savoir qu’on ne sait rien). D’où une révolution stylistique : de deux mots, il s’agit de choisir le moindre ; il faut miniaturiser pour suggérer. Aux beaux paysages de Tourgueniev, Tchekhov substitue l’impalpable, l’impermanent, en cernant la sensation et en chassant la rhétorique. Ces traits, qu’on retrouve, bien sûr, chez le dramaturge, le rapprochent du symbolisme.
S’il y a là un paradoxe, il n’est qu’apparent. Dans sa révolution tranquille, la pratique littéraire de Tchekhov est en effet une conquête de la modernité. Elle revisite les formes narratives établies dans une parodie critique et créatrice. Plusieurs récits se réfèrent – parfois explicitement, en sous-titre – au genre du roman : roman policier (Drame à la chasse, 1884 ; L’Allumette suédoise, 1884), roman d’aventures (Les Îles flottantes, mini-parodie de Jules Verne, 1883). D’autres sont des explorations linguistiques (Une vie en questions et en exclamations, 1882 ; Cahier de doléances, 1884) assez proches des très intéressants carnets de travail de l’écrivain.





























