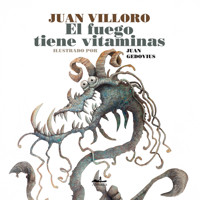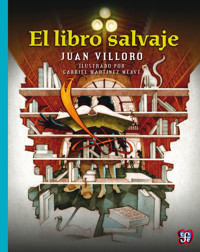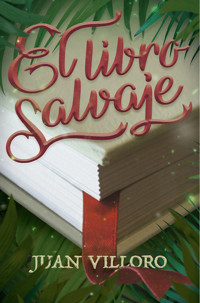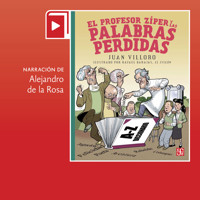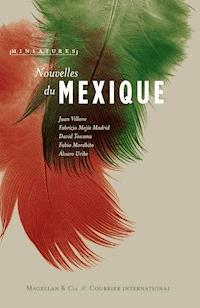
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Miniatures
- Sprache: Französisch
À la découverte des traditions et de la culture du Mexique.
Les Nouvelles du Mexique initient à une littérature résolument moderne, emplie d’humour et d’ironie, qui dépeint sans détours un pays cosmopolite et fascinant.
Les cinq nouvelles, toutes contemporaines, réunies ici témoignent d’un moment particulier de la littérature mexicaine et de l’histoire du pays du serpent à plumes. Un moment où ce grand pays de plus de cent millions d’habitants, à l’histoire brillante et douloureuse à la fois, participe désormais pleinement au concert des nations du monde. Sa littérature est à l’évidence une littérature en devenir. Description du quotidien, condition de l’homme et de la femme dans le monde d’aujourd’hui, flirt avec le fantastique cher aux écrivains latino-américains : tous les ingrédients réunis dans ces fables modernes sont ceux d’une littérature en mouvement.
Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles mexicaines de la collection Miniatures !
À PROPOS DES AUTEURS
Juan Villoro est né en 1956 à Mexico. Étudiant en sociologie, passionné de rock, il anime, de 1977 à 1981, l’émission de radio El lado oscuro de la luna (en référence à The Dark Side of the Moon des Pink Floyd), avant de partir comme attaché culturel à l’ambassade du Mexique à Berlin-Est jusqu’en 1984. Par la suite, il collabore avec de nombreux journaux mexicains tels que Vuelta, Nexos ou La Jornada et enseigne la littérature à Mexico et dans diverses universités américaines. Auteur de quatre romans dont El disparo de Argón (1991), il s’oriente davantage vers la littérature jeunesse où il rencontre le succès international avec El testigo. Il a écrit le scénario du film Vivir mata (2001) de Nicolás Echevarría. Actuellement chroniqueur au quotidien Reforma, il participe aussi au supplément littéraire du journal chilien El Mercurio. En 2008, il a reçu le prix Antonin-Artaud.
Fabrizio Mejía Madrid est né à Mexico en 1968. Après des études littéraires, il a collaboré à diverses revues, La Jornada, Proceso, Letras Libres, Reforma… Responsable culturel à la municipalité de Mexico en 2000, il fut également le représentant du Mexique pour la seconde rencontre des nouveaux écrivains d’Amérique latine et d’Espagne (en 2001) au Convenio Andrés-Bello, en Colombie. Il est l’auteur de plusieurs chroniques sur la vie quotidienne des Mexicains depuis la crise de 1982 à celle de 1995. Son deuxième ouvrage notamment, Hombre al agua (Le Naufragé du Zócalo, Les Allusifs, 2008), offre une vision de la ville de Mexico pleine d’originalité et d’ironie ainsi que les espoirs et les désillusions de toute une communauté au fil du temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Les cinq nouvelles mexicaines, toutes contemporaines, réunies dans ce neuvième volume de la collection « Miniatures », témoignent d’un moment particulier de la littérature mexicaine et de l’histoire du pays du serpent à plumes. Un moment où ce grand pays de plus de cent millions d’habitants, à l’histoire brillante et douloureuse à la fois, participe désormais pleinement au concert des nations du monde. Sa littérature, marquée par les grands Octavio Paz, Juan Rulfo et Carlos Fuentes, est à l’évidence une littérature en devenir.
Dans la nouvelle de Juan Villoro, Je suis Fontanarrosa, après avoir uriné par inadvertance sur la tête de la statue de l’ancien président Benito Juarez, à Ciudad Moctezuma, un écrivain en état d’arrestation se retrouve à devoir disputer un match de football avec des policiers dotés de maillots au nom d’écrivains fameux (Cortazar, Tolstoï, Kafka, Kawabata, Tchekhov, Hemingway, Ben Okri ou Fontanarrosa…), le tout en prélude à une soirée littéraire de promotion de la lecture pour ces mêmes policiers. Dans De l’amour, de Fabrizio Mejía Madrid, à Paris, le narrateur fétichiste tombe éperdument amoureux du pied de Mademoiselle B. (Beatriz), va jusqu’à épouser cette dernière et former ainsi un improbable trio amoureux. Dans Le Bassaris, de David Toscana, un client solitaire se saoule dans un bar mexicain, le Lontananza, et s’abîme dans la contemplation d’un polaroïd et du portrait d’une femme, suscitant chez le gérant du bar, qui jette un regard rétrospectif sur sa propre vie, d’étranges sentiments mélancoliques. Dans la nouvelle de Fabio Morábito, Les Clefs, lors d’un dimanche pluvieux à Mexico, Enrique, dont le couple bat de l’aile, s’échappe d’une réunion de famille pour aller au cinéma tout en y oubliant les clés de son domicile. Pendant ce temps, Lisa, sa belle-mère, est victime d’un infarctus. De retour dans l’atmosphère oppressante de prières de cette famille, une étrange veille commence, sur fond de tango argentin. Dans Le Septième Arcane, d’Álvaro Uribe, un jeune Mexicain, étudiant en philosophie à Paris et « écrivain en herbe », est invité à s’installer chez Don Mateo, son maître mexicain, un célibataire qui voue un véritable culte aux chats, en particulier au sien, Dionysos, tandis qu’il se consacre à l’écriture d’une nouvelle sur un philosophe, inspirée du tableau de Rembrandt : Philosophe en méditation.
Description du quotidien dans Mexico la tentaculaire, condition de l’homme et de la femme dans le monde d’aujourd’hui, flirt avec le fantastique cher aux écrivains latino-américains : tous les ingrédients réunis dans ces fables modernes, urbaines, sont ceux d’une littérature en mouvement.
Pierre ASTIER
Juan Villoro est né en 1956 à Mexico. Étudiant en sociologie, passionné de rock, il anime, de 1977 à 1981, l’émission de radio El lado oscuro de la luna (en référence à The Dark Side of the Moon des Pink Floyd), avant de partir comme attaché culturel à l’ambassade du Mexique à Berlin-Est jusqu’en 1984. Par la suite, Il collabore avec de nombreux journaux mexicains tels que Vuelta, Nexos ou La Jornada et enseigne la littérature à Mexico et dans diverses universités américaines. Auteur de quatre romans dont El disparo de Argón (1991), il s’oriente davantage vers la littérature jeunesse où il rencontre le succès international avec El testigo. Il a écrit le scénario du film Vivir mata (2001) de Nicolás Echevarría. Actuellement chroniqueur au quotidien Reforma, il participe aussi au supplément littéraire du journal chilien El Mercurio. En 2008, il a reçu le prix Antonin-Artaud.
REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES
- El disparo de Argón (1991), traduit en français sous le titre Le Maître du miroir, Éd. Denoël (2001).
- El testigo, (prix Herralde 2004).
- Recueils de nouvelles dont La casa pierde, (prix Villaurrutia 1999), traduit en français sous le titre Les Jeux sont faits, Éd. Passage du Nord-Ouest, (2004).
- Ouvrages pour la jeunesse, et essais et chroniques sur le football, la littérature, les voyages et la politique.
- Mariachi, Éd. Denoël (2009).
JE SUIS FONTANARROSA
Traduit de l’espagnol (Mexique) par André Gabastou
– On va t’expulser, ducon, m’a dit Kafka.
Il y avait des années que je n’avais pas touché un ballon et je me retrouvais tout à coup confronté à l’humeur massacrante de Kafka et aux conseils de Tchekhov qui ne servaient à rien.
Tchekhov était milieu défensif, non parce que ce poste de relayeur correspondait à ses capacités, mais parce qu’il voulait être au centre du terrain où il y a plus de gens à qui prodiguer des conseils. Après le coup de sifflet initial, il a crié des choses enflammées que personne n’a comprises. Comme si ce bon à rien parlait russe. Vers la quatorzième minute, il y eut un arrêt de jeu (la balle était allée dans le terrain d’à côté vers lequel un attaquant avait tiré pour rien un formidable but) tandis que Tchekhov me recommandait de marquer l’ailier gauche deux mètres plus loin. Puis il a dit :
– Il va te massacrer.
Ce n’était plus un conseil, mais une sombre hypothèse. Je ne l’ai pas insulté parce que je n’étais pas en état de me battre.
Nous jouions dans un enclos à chevaux où il y avait plus de trous que de pâture, je ne le dis pas pour me disculper – tout le monde sait que les conditions du terrain affectent à part égale les deux équipes – ni parce que j’ai une bonne frappe, mais j’ai essayé de faire des passes fines, à l’européenne, qui ont été défigurées par un trou. C’était comme pisser dans un violon !
Sur ce terrain, personne ne se montrait à son avantage, mais ce benêt de Kafka me prenait pour le plus mauvais joueur. Quand ils m’ont demandé quelle était ma position, j’ai répondu arrière droit. J’ai toujours été attaquant de pointe, mais, comme j’ai trop fumé, j’ai revu mes ambitions à la baisse.
Je manque de souffle, et le dribble est une habileté prolétarienne que j’ignore. Ainsi que la puissance et la ruse. Mon style est européen, genre portugais. Pas trop de sprints ni de débordements. Des passes élégantes, quelques une-deux, un football de classe qui n’est pas toujours apprécié.
Par malheur, je ressemblais à un Portugais en Angola. Tous les terrains populaires du Mexique se trouvent en Afrique. Il fallait entendre les cris et voir la terre crevassée : un combat intertribal où chaque choc faisait s’élever dans le ciel un tourbillon de poussière comme une prière primitive. Et ils voulaient que je marque l’ailier gauche !
Quand j’ai fait connaissance de l’équipe, j’ai été impressionné par le port de l’un des milieux de terrain, Tolstoï. On aurait dit La Guerre et la Paix. À côté de lui, il y avait Ben Okri, allure de basketteur et terribles yeux noirs comme du charbon.
Je ne sais pas qui est Okri. Je suis écrivain, mais je lis peu pour ne pas me laisser influencer. Je suppose que c’est un Africain. Au football, c’est la mode d’avoir des Africains. En plus, ce terrain était parfait pour quelqu’un qui avait fui les lions. De l’autre côté, s’agitait le fébrile Kawabata, arrière gauche. Un vrai gaucher qui tirait sur d’ahurissantes transversales. Je n’ai pas lu non plus Kawabata, mais j’ai vu un film superchaud tiré de l’un de ses textes.
Notre numéro 10, c’était Cortázar. Le seul, à vrai dire, à avoir une idée de ce qu’il faisait. Il touchait le ballon comme s’il était né en Argentine. Un crack. Le malheur, c’est que ses passes s’adressaient à Joyce, un prétentieux se croyant unique en son genre. Cortázar lui a apporté le ballon sur un plateau et Joyce a tiré dans les nuages ou dans le ciel gris où il aurait dû y avoir des nuages. Puis il a souri comme si ses erreurs étaient géniales.
Même si les autres faisaient, eux aussi, des erreurs, ils se sont acharnés contre moi dès le départ. Vers la vingt-huitième minute, l’ailier gauche m’a dépassé sans difficulté, a continué sur sa lancée, mais Tolstoï et Ben Okri l’ont pris en tenaille. Les milieux de terrain ont montré ce que peut faire la force brute contre un joueur habile : un sandwich. L’arbitre a sifflé un penalty.
Et c’est comme ça qu’ils ont marqué le premier but. Vingt-huit minutes sans but pouvaient passer pour une prouesse de la part de notre équipe, mais Hemingway, qui ne se réveillait que lorsqu’une bronca s’annonçait, m’a regardé avec ces yeux qui, sur les terrains réglementaires, signifient : « Je t’attends dans les vestiaires », et, sur les terrains où il n’y a pas de vestiaires : « Je vais te casser la gueule », sans qu’il soit nécessaire de préciser où.
La deuxième fois où l’ailier a voulu briller, j’ai essayé de lui faire un croc-en-jambe, mais il m’a donné un coup de pied. Carton jaune. C’est à ce moment-là que Kafka m’a dit qu’ils allaient m’expulser parce que j’étais trop con.
C’était notre capitaine. J’ai toujours respecté les règles du football, mais je n’aimais pas qu’un type couvert de poils de rongeur (de hamster, pour être plus précis) mette son autorité en veilleuse pour suivre Tchekhov qui me donnait des ordres comme s’il était Johan Cruyff en personne :
– Ouvre le jeu !
Savait-il que, deux heures auparavant, je fumais ma cinquième cigarette de la journée ? Que la coke et la boisson m’aident à vivre à condition de ne pas avoir à courir ? Que mon ventre est si lourd que j’ai l’impression qu’il appartient à un autre ? Que la dernière fois que j’ai rendu visite à mon ex-femme, l’ascenseur était en panne, aussi ai-je dû monter par l’escalier et, quand je suis arrivé, ma tête était si inquiétante qu’elle s’est abstenue de m’insulter ?
Il n’était évidemment au courant de rien. Lui, c’était Tchekhov, formateur de sans-grade. À côté de lui, Kafka semblait disposé à m’envoyer dans une colonie pénitentiaire.
Je jouais pour ma liberté, comme tous les hommes qui tiennent parole, selon Marcos, le sous-commandant. Mais moi, je devais relever un plus grand défi : j’étais sur le terrain et en état d’arrestation.
Notre équipe avait des noms d’écrivains inscrits au dos des maillots. C’était particulier. Et ce qui l’était encore plus, c’est que mes dix camarades travaillaient dans la police.
J’ai dit, un jour, à mon ex-femme (à l’époque, ma fiancée) que le football est un état d’âme. Les buts du Cruz Azul m’ont déjà fait pleurer, et ma seule fracture, je la dois au football (j’ai donné des coups de pied au réfrigérateur quand le Santos nous a éliminés). Ce n’est pas la passion qui me manque. Chaque fois que je traverse un parc et que je vois des enfants jouer, j’aimerais que la balle leur échappe pour la leur rendre d’une frappe à mes yeux magistrale, même si elle tombe sur le petit chariot de barbe à papa.
J’ai du mal à courir. Cette dépense d’énergie déguisée en exercice détériore l’organisme. Courir est dégradant, et le faire sous les Tropiques ou à deux mille mètres d’altitude l’est deux fois plus. Nous les Mexicains, nous devons marcher.
Le problème, mon problème, c’est que ce match aurait pu être mon salut. Le football était de retour comme le pire état d’âme : l’angoisse de l’homme traqué.
La journée avait mal commencé. J’avais ouvert le journal et vu les chiffres du narcotrafic : quatre exécutions, deux à Zamora, ma ville natale, et deux autres à Guadalajara, où j’ai fait mes études universitaires. Les exécutions étaient devenues mon horoscope. Si les victimes tombaient dans des endroits qui avaient à voir avec moi, la journée serait atroce.
Malgré les signes négatifs, je suis sorti de chez moi et, comme si c’était trop peu, j’ai retrouvé le Mecate1. Il m’a demandé de l’accompagner à Ciudad Moctezuma, où il connaissait un mécanicien très bon marché.
Tout dans la voiture du Mecate montre qu’il a déjà consulté un mécanicien très bon marché, mais il lui en fallait un autre, à quinze kilomètres de l’endroit où nous étions, pour changer son klaxon qui avait l’air grippé.
Tout cela est indigne de figurer dans une histoire, mais quand on se sent en dette, on fait des choses indignes de ce genre. Le Mecate est professeur d’éducation physique dans un collège où les trois femmes qui enseignent l’espagnol sont amoureuses de lui. Moyennant quoi, elles recommandent mes livres pour la jeunesse et m’invitent, une fois l’an, à parler devant un auditoire de mille personnes littéralement captivé. J’ai l’impression de détenir un pouvoir magnifique. Avec le Mecate, j’irais en Patagonie.
Le trajet a duré une heure et demie. J’avais bu une cafetière entière au petit déjeuner. Quand nous sommes passés devant Cabeza de Juárez, j’allais me pisser dessus. J’ai à peine pu jouir du spectacle de cet horrible monument, le crâne colossal du Bienfaiteur des Amériques juché sur un arc qui le rend encore plus hallucinant. Même si certains détails de cette laideur spectaculaire m’ont échappé, l’image était prophétique.
Nous sommes entrés dans un immense lotissement de petites maisons à étage dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce et le toit en terrasse par des chiens, des antennes et des bassines. Quand nous sommes arrivés au garage, je me pinçais la joue pour que la douleur me fasse penser à autre chose.
Quelques minutes après, j’ai arrosé un tas de pierres. Le garage était tout près d’un endroit où l’on faisait des dalles funéraires et des statues de plâtre.
Un homme désespéré peut uriner parmi de futures tombes. Un homme vraiment désespéré peut uriner sur une statue de Benito Juárez2. C’est ce que j’ai fait.
J’aime savoir pendant combien de temps j’urine. Mon record, c’est deux minutes. J’en étais à quatre-vingt-dix-huit secondes quand quelqu’un m’a donné une petite tape dans le dos. Je me suis retourné et j’ai uriné sur les chaussures d’un policier.
– Regarde un peu, ducon !
Il a montré ses pieds, puis ce que j’avais pris pour une pierre.
– Tu as vu ?
– Quoi ?
– Tu pisses sur Juárez !
Je me suis baissé pour voir la pierre, et j’ai en effet constaté qu’il s’agissait d’un buste miniature du Bienfaiteur des Amériques. À côté de lui, il y avait Morelos avec son foulard sur la tête, Carranza et sa barbe, Allende et ses favoris. Comment avais-je fait pour ne pas les voir ?
Quand je me suis relevé, un peloton entourait le policier. Ils m’ont regardé comme si mon urine avait éteint la flamme du Soldat inconnu.
Les policiers étaient là pour choisir une dalle funéraire destinée à un camarade qui avait été criblé de balles. L’instant était solennel. C’est ce qu’ils m’ont dit par la suite. Sur le moment, ils se sont contentés de critiquer ce que j’avais fait. Uriner sur les biens d’autrui (propriété privée) est un délit. Souiller un symbole de la patrie, c’est encore pire.
L’uniforme des policiers de Ciudad Moctezuma était un peu différent de celui de ceux de la capitale. Mais c’est un autre détail qui faisait la vraie différence : c’étaient des partisans convaincus de Juárez. J’avais joué de malchance : la tête de Juárez ressemble comme deux gouttes d’eau à une pierre ronde.
Le zèle historique des hommes en uniforme devenait abus d’autorité, mais un sixième sens m’a signalé que le dire pouvait nuire à ma santé.