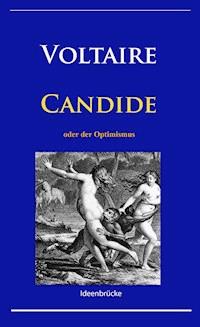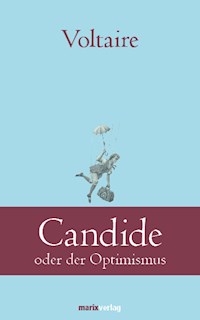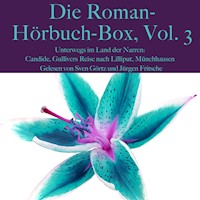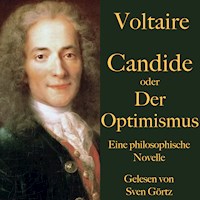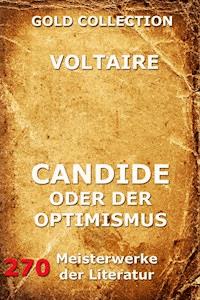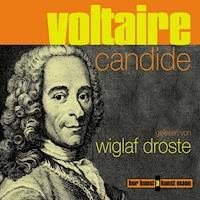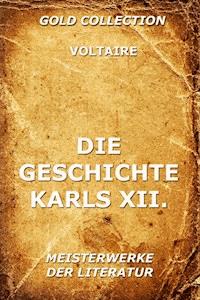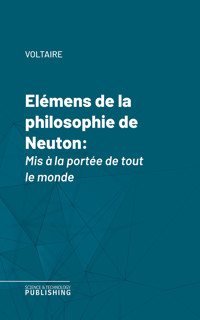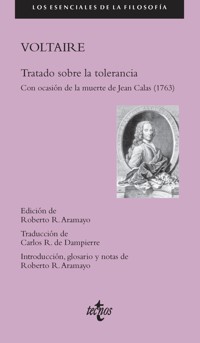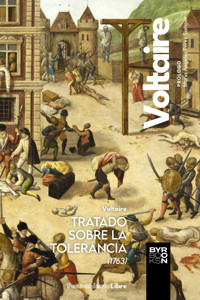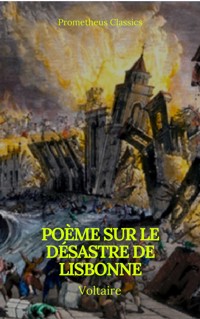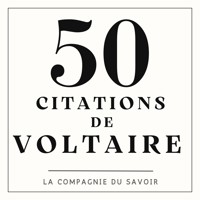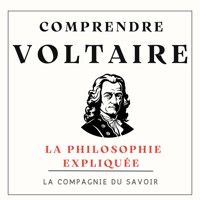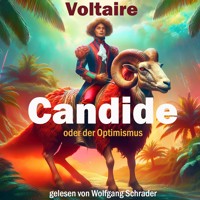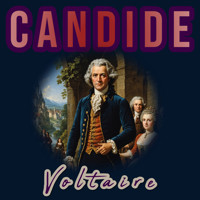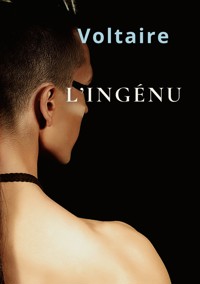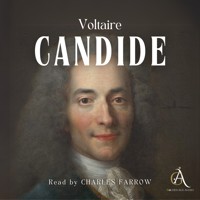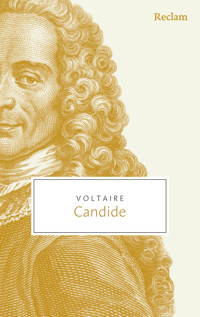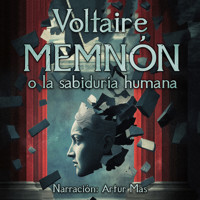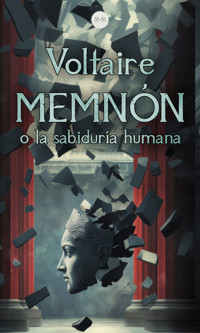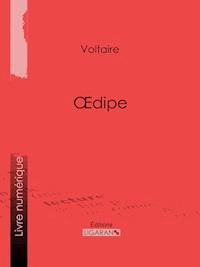
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "DIMAS. Philoctète, est-ce vous ? quel coup affreux du sort Dans ces lieux empestés vous fait chercher la mort ? Venez-vous de nos dieux affronter la colère ? Nul mortel n'ose ici mettre un pied téméraire : Ces climats sont remplis du céleste courroux ; Et la mort dévorante habite."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur composa cette pièce à l’âge de dix-neuf ans. Elle fut jouée, en 1718, quarante-cinq fois de suite. Ce fut le sieur Dufresne, célèbre acteur de l’âge de l’auteur, qui joua le rôle d’Œdipe ; la demoiselle Desmares, très grande actrice, joua celui de Jocaste, et quitta le théâtre quelque temps après. On a rétabli dans cette édition le rôle de Philoctète tel qu’il fut joué à la première représentation.
La pièce fut imprimée pour la première fois en 1719. M. de Lamotte approuva la tragédie d’Œdipe. On trouve dans son approbation cette phrase remarquable : « Le public, à la représentation de cette pièce, s’est promis un digne successeur de Corneille et de Racine ; et je crois qu’à la lecture il ne rabattra rien de ses espérances. »
L’abbé de Chaulieu fit une mauvaise épigramme contre cette approbation : il disait que l’on connaissait Lamotte pour un mauvais auteur, mais non pour un faux prophète. C’est ainsi que les grands hommes sont traités au commencement de leur carrière ; mais il ne faut pas que tous ceux que l’on traite de même s’imaginent pour cela être de grands hommes : la médiocrité insolente éprouve les mêmes obstacles que le génie ; et cela prouve seulement qu’il y a plusieurs manières de blesser l’amour-propre des hommes.
La première édition d’Œdipe fut dédiée à Madame, femme du Régent. Voici cette dédicace : elle ressemble aux épîtres dédicatoires de ce temps-là. Ce ne fut qu’après son voyage en Angleterre, et lorsqu’il dédia Brutus au lord Bolingbroke, que M. de Voltaire montra qu’on pouvait, dans une dédicace, parler à celui qui la reçoit d’autre chose que de lui-même.
« MADAME,
Si l’usage de dédier ses ouvrages à ceux qui en jugent le mieux n’était pas établi, il commencerait par Votre Altesse Royale. La protection éclairée dont vous honorez les succès ou les efforts des auteurs met en droit ceux mêmes qui réussissent le moins d’oser mettre sous votre nom des ouvrages qu’ils ne composent que dans le dessein de vous plaire. Pour moi, dont le zèle tient lieu de mérite auprès de vous, souffrez que je prenne la liberté de vous offrir les faibles essais de ma plume. Heureux si, encouragé par vos bontés, je puis travailler longtemps pour Votre Altesse Royale, dont la conservation n’est pas moins précieuse à ceux qui cultivent les beaux-arts qu’à toute la France, dont elle est les délices et l’exemple.
Je suis, avec un profond respect,
MADAME,
DE VOTRE ALTESSE ROYALE,
Le très humble et très obéissant serviteur,
AROUET DE VOLTAIRE. »
On trouvera, page 47, une préface imprimée en 1729, dans laquelle M. de Voltaire combat les opinions de M. de Lamotte sur la tragédie. Lamotte y a répondu avec beaucoup de politesse, d’esprit et de raison. On peut voir cette réponse dans ses œuvres. M. de Voltaire n’a répliqué qu’en faisant Zaïre, Alzire, Mahomet, etc. ; et jusqu’à ce que des pièces en prose, où les règles des unités seraient violées, aient fait autant d’effet au théâtre et autant de plaisir à la lecture, l’opinion de M. de Voltaire doit l’emporter.
QUI CONTIENNENT LA CRITIQUE DE L’ŒDIPE DE SOPHOCLE, DE CELUI DE CORNEILLE, ET DE CELUI DE L’AUTEUR.
Je vous envoie, monsieur, ma tragédie d’Œdipe que vous avez vue naître. Vous savez que j’ai commencé cette pièce à dix-neuf ans : si quelque chose pouvait faire pardonner la médiocrité d’un ouvrage, ma jeunesse me servirait d’excuse. Du moins, malgré les défauts dont cette tragédie est pleine, et que je suis le premier à reconnaître, j’ose me flatter que vous verrez quelque différence entre cet ouvrage et ceux que l’ignorance et la malignité m’ont imputés.
Vous savez mieux que personne que cette satire intitulée les J’ai vu, est d’un poète du Marais, nommé Le Brun, auteur de l’opéra d’Hippocrate amoureux, qu’assurément personne ne mettra en musique.
Ces J’ai vu sont grossièrement imités de ceux de l’abbé Regnier, de l’Académie, avec qui l’auteur n’a rien de commun. Ils finissent par ces vers :
Il est vrai que je n’avais pas vingt ans alors ; mais ce n’est pas une raison qui puisse faire croire que j’ai fait les vers de M. Le Brun.
J’apprends que c’est un des avantages attachés à la littérature, et surtout à la poésie, d’être exposé à être accusé sans cesse de toutes les sottises qui courent la ville. On vient de me montrer une épître de l’abbé de Chaulieu au marquis de La Fare, dans laquelle il se plaint de cette injustice. Voici le passage :
Ces vers, monsieur, ne sont pas dignes de l’auteur de la Tocane et de la Retraite ; vous les trouverez bien plats, et aussi remplis de fautes que d’une vanité ridicule. Je vous les cite comme une autorité en ma faveur ; mais j’aime mieux vous citer l’autorité de Boileau. Il ne répondit un jour aux compliments d’un campagnard qui le louait d’une impertinente satire contre les évêques, très fameuse parmi la canaille, qu’en répétant à ce pauvre louangeur :
BOILEAU, épître VI, vers 69-72.
Je ne suis ni ne serai Boileau ; mais les mauvais vers de M. Le Brun m’ont attiré des louanges et des persécutions qu’assurément je ne méritais pas.
Je m’attends bien que plusieurs personnes, accoutumées à juger de tout sur le rapport d’autrui, seront étonnées de me trouver si innocent, après m’avoir cru, sans me connaître, coupable des plus plats vers du temps présent. Je souhaite que mon exemple puisse leur apprendre à ne plus précipiter leurs jugements sur les apparences les plus frivoles, et à ne plus condamner ce qu’ils ne connaissent pas. On rougirait bientôt de ses décisions, si l’on voulait réfléchir sur les raisons par lesquelles on se détermine.
Il s’est trouvé des gens qui ont cru sérieusement que l’auteur de la tragédie d’Atrée était un méchant homme, parce qu’il avait rempli la coupe d’Atrée du sang du fils de Thyeste ; et aujourd’hui il y a des consciences timorées qui prétendent que je n’ai point de religion, parce que Jocaste se défie des oracles d’Apollon. C’est ainsi qu’on décide presque toujours dans le monde ; et ceux qui sont accoutumés à juger de la sorte ne se corrigeront pas par la lecture de cette lettre ; peut-être même ne la liront-ils point.
Je ne prétends donc point ici faire taire la calomnie, elle est trop inséparable des succès ; mais du moins il m’est permis de souhaiter que ceux qui ne sont en place que pour rendre justice ne fassent point des malheureux sur le rapport vague et incertain du premier calomniateur. Faudra-t-il donc qu’on regarde désormais comme un malheur d’être connu par les talents de l’esprit, et qu’un homme soit persécuté dans sa patrie, uniquement parce qu’il court une carrière dans laquelle il peut faire honneur à sa patrie même ?
Ne croyez pas, monsieur, que je compte parmi les preuves de mon innocence le présent dont M. le Régent a daigné m’honorer ; cette bonté pourrait n’être qu’une marque de sa clémence ; il est au nombre des princes qui, par des bienfaits, savent lier à leur devoir ceux mêmes qui s’en sont écartés. Une preuve plus sûre de mon innocence, c’est qu’il a daigné dire que je n’étais point coupable, et qu’il a reconnu la calomnie lorsque le temps a permis qu’il pût la découvrir.
Je ne regarde point non plus cette grâce que monseigneur le duc d’Orléans m’a faite comme une récompense de mon travail, qui ne méritait tout au plus que son indulgence ; il a moins voulu me récompenser que m’engager à mériter sa protection.
Sans parler de moi, c’est un grand bonheur pour les lettres que nous vivions sous un prince qui aime les beaux-arts autant qu’il fait la flatterie, et dont on peut obtenir la protection plutôt par de bons ouvrages que par des louanges, pour lesquelles il a un dégoût peu ordinaire dans ceux qui, par leur naissance et par leur rang, sont destinés à être loués toute leur vie.
Monsieur, avant que de vous faire lire ma tragédie, souffrez que je vous prévienne sur le succès qu’elle a eu, non pas pour m’en applaudir, mais pour vous assurer combien je m’en défie.
Je sais que les premiers applaudissements du public ne sont pas toujours de sûrs garants de la bonté d’un ouvrage. Souvent un auteur doit le succès de sa pièce ou à l’art des acteurs qui la jouent, ou à la décision de quelques amis accrédités dans le monde, qui entraînent pour un temps les suffrages de la multitude ; et le public est étonné, quelques mois après, de s’ennuyer à la lecture du même ouvrage qui lui arrachait des larmes dans la représentation.
Je me garderai donc bien de me prévaloir d’un succès peut-être passager, et dont les comédiens ont plus à s’applaudir que moi-même.
On ne voit que trop d’auteurs dramatiques qui impriment à la tête de leurs ouvrages des préfaces pleines de vanité ; « qui comptent les princes et les princesses qui sont venus pleurer aux représentations ; qui ne donnent d’autres réponses à leurs censeurs que l’approbation du public » ; et qui enfin, après s’être placés à côté de Corneille et de Racine, se trouvent confondus dans la foule des mauvais auteurs, dont ils sont les seuls qui s’exceptent.
J’éviterai du moins ce ridicule ; je vous parlerai de ma pièce plus pour avouer mes défauts que pour les excuser ; mais aussi je traiterai Sophocle et Corneille avec autant de liberté que je me traiterai avec justice.
J’examinerai les trois Œdipes avec une égale exactitude. Le respect que j’ai pour l’antiquité de Sophocle et pour le mérite de Corneille ne m’aveuglera pas sur leurs défauts ; l’amour-propre ne m’empêchera pas non plus de trouver les miens. Au reste, ne regardez point ces dissertations comme les décisions d’un critique orgueilleux, mais comme les doutes d’un jeune homme qui cherche à s’éclairer. La décision ne convient ni à mon âge, ni à mon peu de génie ; et si la chaleur de la composition m’arrache quelques termes peu mesurés, je les désavoue d’avance, et je déclare que je ne prétends parler affirmativement que sur mes fautes.
Monsieur, mon peu d’érudition ne me permet pas d’examiner « si la tragédie de Sophocle fait son imitation par le discours, le nombre et l’harmonie ; ce qu’Aristote appelle expressément un discours agréablement assaisonné ». Je ne discuterai pas non plus « si c’est une pièce du premier genre, simple et implexe : simple parce qu’elle n’a qu’une simple catastrophe ; et implexe, parce qu’elle a la reconnaissance avec la péripétie ».
Je vous rendrai seulement compte avec simplicité des endroits qui m’ont révolté, et sur lesquels j’ai besoin des lumières de ceux qui, connaissant mieux que moi les anciens, peuvent mieux excuser tous leurs défauts.
La scène ouvre, dans Sophocle, par un cœur de Thébains prosternés au pied des autels, et qui, par leurs larmes et par leurs cris, demandent aux dieux la fin de leurs calamités. Œdipe, leur libérateur et leur roi, paraît au milieu d’eux.
« Je suis Œdipe, leur dit-il, si vanté par tout le monde. » Il y a quelque apparence que les Thébains n’ignoraient pas qu’il s’appelait Œdipe.
À l’égard de cette grande réputation dont il se vante, M. Dacier dit que c’est une adresse de Sophocle, qui veut fonder par là le caractère d’Œdipe, qui est orgueilleux.
« Mes enfants, dit Œdipe, quel est le sujet qui vous amène ici ? » Le grand-prêtre lui répond : « Vous voyez devant vous des jeunes gens et des vieillards. Moi qui vous parle, je suis le grand-prêtre de Jupiter. Votre ville est comme un vaisseau battu de la tempête ; elle est prête d’être abîmée, et n’a pas la force de surmonter les flots qui fondent sur elle. » De là le grand-prêtre prend occasion de faire une description de la peste, dont Œdipe était aussi bien informé que du nom et de la qualité du grand-prêtre de Jupiter. D’ailleurs ce grand-prêtre rend-il son homélie bien pathétique, en comparant une ville pestiférée, couverte de morts et de mourants, à un vaisseau battu par la tempête ? Ce prédicateur ne savait-il pas qu’on affaiblit les grandes choses quand on les compare aux petites ?
Tout cela n’est guère une preuve de cette perfection où on prétendait, il y a quelques années, que Sophocle avait poussé la tragédie ; et il ne paraît pas qu’on ait si grand tort dans ce siècle de refuser son admiration à un poète qui n’emploie d’autre artifice pour faire connaître ses personnages que de faire dire à l’un : « Je m’appelle Œdipe, si vanté par tout le monde » ; et à l’autre : « Je suis le grand-prêtre de Jupiter. » Cette grossièreté n’est plus regardée aujourd’hui comme une noble simplicité.
La description de la peste est interrompue par l’arrivée de Créon, frère de Jocaste, que le roi avait envoyé consulter l’oracle, et qui commence par dire à Œdipe :
« Seigneur, nous avons eu autrefois un roi qui s’appelait Laïus.
Je le sais, quoique je ne l’aie jamais vu.
Il a été assassiné, et Apollon veut que nous punissions ses meurtriers.
Fut-ce dans sa maison ou à la campagne que Laïus fut tué ? »
Il est déjà contre la vraisemblance qu’Œdipe, qui règne depuis si longtemps, ignore comment son prédécesseur est mort ; mais qu’il ne sache pas même si c’est aux champs ou à la ville que ce meurtre a été commis, et qu’il ne donne pas la moindre raison ni la moindre excuse de son ignorance, j’avoue que je ne connais point de terme pour exprimer une pareille absurdité.
C’est une faute du sujet, dit-on, et non de l’auteur : comme si ce n’était pas à l’auteur à corriger son sujet lorsqu’il est défectueux ! Je sais qu’on peut me reprocher à peu près la même faute ; mais aussi je ne me ferai pas plus de grâce qu’à Sophocle, et j’espère que la sincérité avec laquelle j’avouerai mes défauts justifiera la hardiesse que je prends de relever ceux d’un ancien.
Ce qui suit me paraît également éloigné du sens commun. Œdipe demande s’il ne revint personne de la suite de Laïus à qui on puisse en demander des nouvelles ; on lui répond « qu’un de ceux qui accompagnaient ce malheureux roi, s’étant sauvé, vint dire dans Thèbes que Laïus avait été assassiné par des voleurs, qui n’étaient pas en petit, mais en grand nombre ».
Comment se peut-il faire qu’un témoin de la mort de Laïus dise que son maître a été accablé sous le nombre, lorsqu’il est pourtant vrai que c’est un homme seul qui a tué Laïus et toute sa suite ?
Pour comble de contradiction, Œdipe dit au second acte qu’il a ouï dire que Laïus avait été tué par des voyageurs, mais qu’il n’y a personne qui dise l’avoir vu ; et Jocaste, au troisième acte, en parlant de la mort de ce roi, s’explique ainsi à Œdipe :
« Soyez bien persuadé, seigneur, que celui qui accompagnait Laïus a rapporté que son maître avait été assassiné par des voleurs : il ne saurait changer présentement ni parler d’une autre manière ; toute la ville l’a entendu comme moi. »
Les Thébains auraient été bien plus à plaindre, si l’énigme du sphinx n’avait pas été plus aisée à deviner que toutes ces contradictions.
Mais ce qui est encore plus étonnant, ou plutôt ce qui ne l’est point après de telles fautes contre la vraisemblance, c’est qu’Œdipe, lorsqu’il apprend que Phorbas vit encore, ne songe pas seulement à le faire chercher ; il s’amuse à faire des imprécations et à consulter des oracles, sans donner ordre qu’on amène devant lui le seul homme qui pouvait lui fournir des lumières. Le chœur lui-même, qui est si intéressé à voir finir les malheurs de Thèbes, et qui donne toujours des conseils à Œdipe, ne lui donne pas celui d’interroger ce témoin de la mort du feu roi ; il le prie seulement d’envoyer chercher Tirésie.