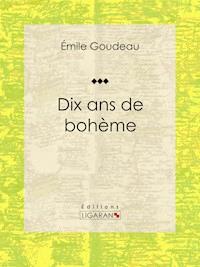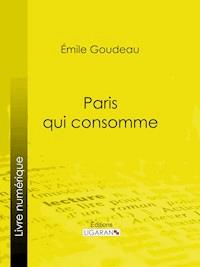
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "A Paris, le besoin de consommer naît avec le jour et ne prend fin qu'avec la nuit : dès l'aurore, la gueule – ainsi disaient nos pères – est ouverte, qui n'est point encore refermée aux ténèbres. Ou mieux, ce besoin d'une si miraculeuse intensité ne commence ni ne finit : cycle ininterrompu s'enroulant sur lui-même, à l'instar du symbolique serpent, ce consommateur singulier qui se mord éternellement la queue."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans ton Tableau de Paris, ô Mercier ! tu écrivais en 1781 :
On compte six ou sept cents cafés. On y juge les pièces de théâtre. Le bavardage y roule incessamment sur la gazette ; la crédulité parisienne n’a point de bornes en ce genre, elle gobe tout ce qu’on lui présente. Tel homme arrive au café sur les dix heures du matin pour n’en sortir qu’à onze heures du soir. En général, le café qu’on y prend est mauvais, la limonade dangereuse, les liqueurs malsaines et à l’esprit-de-vin, mais le bon Parisien, qui s’arrête aux apparences, boit tout, dévore tout, avale tout.
Après cent douze ans écoulés, peut-être seras-tu curieux de savoir, sur l’article consommation, où nous en sommes !
Consommer : qu’est ceci ?
C’est, – ont dit savamment les économistes, – « détruire par l’usage ».
En ce sens on dit que Paris « consomme » actuellement chaque année trois cent mille bœufs, deux cent cinquante mille veaux, un million de moutons, trois cent mille porcs, quinze millions de kilos de gibier, quatre millions de kilos de poissons, sept millions de kilos de lapins (qui l’eût cru ?), cent mille kilos de truffes, vingt millions de kilos de beurre ou soi-disant tel, un demi-milliard d’œufs, cinq cents millions de litres d’un liquide portant à juste ou faux titre le nom de vin, dix-sept millions de litres d’alcool bien ou mal rectifié, trente millions de litres de bière peu ou prou salicylée, etc., etc. ; ce qui, soit dit en passant, fait juste le triple en aliments, et en boisson le quintuple, de ce queconsommait Paris il y a cinquante ans, lorsque paraissait le Paris à Table d’Eugène Briffault.
En ce sens encore, on dit qu’aujourd’hui un Parisien moyen consomme moyennement par an trois cents livres de pain, cent vingt de viande, vingt-quatre de poisson, vingt de volaille, vingt de charcuterie, seize de beurre, quatorze de sel, quatre de fromage, deux cents œufs, deux cents litres de vin et onze de bière : substances que lui fournissent dix-huit cents bouchers, dix-huit cents boulangers, mille charcutiers, quatre mille cinq cents épiciers et un nombre incalculable de débitants, véritables « valets de gueule » chargés d’assurer pour l’ogre Paris la permanence d’une gargantuesque mangeaille et d’une beuverie pantagruélique.
Tout cela est fort bien au point de vue économiste, mais ne nous dit pas ce que dans la vie courante signifie le mot consommer. Par la bonne raison que les économistes n’entendent rien à la vie et au langage usuel : ils ignorent gravement ce que chacun sait. Adressons-nous à n’importe qui, – tenez, au premier gavroche venu qui joue au bouchon dans la rue, – et posons-lui la question :
– Eh ! petit, sais-tu ce que c’est que consommer, toi ?
Et du tac au tac, le gamin, avec son accent le plus gras et le plus gouailleur, nous donne la solution :
– Consommer ? ôlala ! c’te malice ! C’est prendre une consommation, donc !
Nous y sommes. Et qu’est-ce qu’une consommation ?
Ici encore chacun de vous est fixé : il n’y a pour l’ignorer que Jean-Baptiste Say, qui définit – « admirablement », disent ses confrères, – la consommation « une destruction d’utilité » ; et les lexiques, qui en sont à donner comme exemple de consommation… la consommation des siècles !
Rassemblez cent mille Français, proposez de leur payer la consommation des siècles, ou bien conviez-les à prendre avec vous une destruction d’utilité : vous n’obtiendrez qu’une muette stupéfaction. Mais offrez-leur simplement une consommation, au choix, et cent mille cris, variés quant à l’espèce, uniques quant au genre, vous répondront :
– Une demi-tasse ! – Un mazagran ! – Un bock ! – Un verre eud’vin ! – Une fine ! – Un « meulé » ! – Un amer ! – Un « perroquet » ! – Une cerise à l’eau-de-vie ! – Un soyer ! – Une glace vanille-fraise ! – Un cocktail ! – Un punch au kirsch !… etc., etc.
Ce sont là autant de définitions pratiques, empiriques, de la consommation.
Mais la définition théorique ? On pourrait certainement l’établir ainsi :
Consommer, c’est s’introduire dans l’appareil digestif, par manière de plaisir et sans nécessité absolument démontrée, une substance quelconque, plus particulièrement liquide, et de préférence dans un établissement public.
Nous disons : sans nécessité bien établie, parce que le trait essentiel de la consommation est d’être du superflu, cette chose si nécessaire. Prendre, après la journée de travail, son repas autour de la table familiale, absorber le simple et sain dîner, ce n’est point consommer : c’est manger, se nourrir. Et arroser ce repas d’eau rougie ou du coup de vin pur ordinaire, ce n’est pas consommer, c’est boire ; c’est se désaltérer ou se fortifier.
Mais se titiller l’appétit par des apéritifs ; mais s’alourdir de repas surtruffés, aux menus congrûment élaborés ; mais entasser Yquem sur Xérès, Romanée sur Pichon-Longueville, et Porto sur Rœderer ; mais renouveler la faim par des sorbets ; mais forcer la digestion par le café et les liqueurs, ou l’égayer par la fumée du tabac, c’est consommer !
Et c’est également consommer que, le dimanche venu après la semaine de labeur, traiter sa petite famille par les bocks, les gaufres, les gâteaux de Nanterre et les dîners sur l’herbe.
L’extension formidable du besoin de consommer est un fait aussi remarquable dans notre siècle que la transformation des voies de communication. La consommation restreinte est aussi éloignée de nous maintenant que le suffrage restreint. Nous vivons désormais sous le régime de la consommation universelle. La consommation est la reine du Monde. Tandis que, dans les villes d’autrefois, telles que nous les montrent les vieillesestampes et les vieux plans, un fait est frappant, l’agglomération des clochers, la multiplicité des églises, tout pour la nourriture de l’âme, – aujourd’hui les villes sont peuplées de ce que l’Ermite de la Chaussée-d’Antin, avec cette horreur du mot propre qui caractérisait son temps, aurait appelé des « Temples de la Consommation », et que nous appelons, nous, Restaurants, Brasseries, Mastroquets, Cafés, Dégustations, Distillations, Bars, Caboulots, Beuglants, Débits : tout pour le service de l’estomac. Il est des rues parisiennes où, sur cent commerces, quatre-vingt-dix ont trait à la boustifaille ou à la boisson.
À Paris, la consommation est gigantesque. Non point que chaque Parisien soit individuellement un goinfre, un pilier de café ou de brasserie. Mais d’une façon relative : deux millions et demi d’hommes sont forcément un consommateur formidable. Avec un pareil chiffre d’habitants, il y a de quoi garnir les quelques centaines de tables des cafés et donner l’apparence d’une absorption constante et outrée. Mais si absorption constante il y a, elle est le fait de certains consommateurs invétérés et toujours les mêmes, qui se sont délégués à consommer pour ceux qui ne consomment pas.
On consomme : 1° pour se désaltérer (ou se reposer, avoir un prétexte à s’asseoir ou à lire son journal) ; 2° pour s’ouvrir l’appétit ; 3° pour digérer ; 4° pour se rafraîchir ; 5° pour se réchauffer ; 6° pour s’égayer.
Le désaltérant-type est la bière (et pour le peuple, le vin) ;
L’apéritif-type est l’absinthe (très concurrencée aujourd’hui par la série des amers) ;
Le digestif-type est le café (suivi du « pousse-café » : la collection des liqueurs) ;
Le rafraîchissant-type est la glace (avec la série des mixtures frappées) ;
Le réchauffant-type est le grog (et le populaire vin chaud) ;
L’égayant-type est le mousseux champagne (ou le punch flambant).
On consomme aussi par un septième motif, le bon motif, le plus puissant de tous : on consomme pour consommer, pour rien, pour le plaisir. – Comme le duelliste de Marion Delorme alors ? – Tout juste. Et tenez, le duel a été en ce temps-là une manière de consommation ; même plus récemment : rappelez-vous, dans une lithographie de Charlet, ce grognard qui, pour terminer une querelle de conscrits, leur conseille d’aller « se rafraîchir d’un coup de sabre ». L’homme a tourné en consommation même les choses immatérielles. Que consomment l’alcoolique, le fumeur d’opium, la morphinomane ? Est-ce bien l’alcool, la fumée, ou l’alcaloïde ? N’est-ce pas l’ivresse, le rêve, l’oubli ?
Et c’est pour me soûler que je bois, non pour boire,
a dit le consommateur Verlaine.
Mais ne subtilisons pas, et revenons au précis.
On consomme, disons-nous pour le plaisir de consommer. C’estque la consommation prouve le superflu, le loisir, le repos, le congé, le « cœur à l’aise » (air connu), l’« oubli des soins fâcheux » (idem). Dans tout consommateur il y a du hæc otia fecit. Et c’est pourquoi la consommation par excellence est chose du dehors, et prise dans un établissement ad hoc. Il n’y a pas à démontrer que la consommation, fût-elle de premier choix, absorbée à domicile, ne vaut pas le dernier des rogommes siroté à la table d’un café ou sur un comptoir.
Pour cela encore, la consommation consiste beaucoup plus particulièrement en un liquide, – « prendre quelque chose », c’est-à-dire boire sans soif, étant, comme on sait, le propre de l’homme.
Mais être ingénieux pour tourner à volupté les nécessités physiques est aussi son propre. Par des imaginations inouïes il a métamorphosé, toutes les fois qu’il a pu, l’obligation de manger en plaisir de consommer. Petit déjeuner du matin, déjeuner, collation, goûter, lunch, dîner, souper, il a tout transformé en occasions de se délecter ; et qui se délecte consomme.
Dès qu’il cesse de manger uniquement pour vivre, dès qu’il apporte dans la mise en action de son appareil dégustatoire l’idée de superflu en quantité ou en qualité, il consomme.
Affiner le pain en jocko, éduquer et verdir les huîtres, tartariser l’anguille, effilocher la morue en brandade, travestir le veau en thon, le mouton en chevreuil, faire singer la tortue parla tête de veau, gaver les volailles, hypertrophier les foies, truffer les pieds, grossir l’asperge jusqu’à l’éléphantiasis, mouler les turbans, échafauder les belevues, ériger les aspics, enrober les perdreaux en chaud-froid, quintessencier le blanc de poulet en « suprême », injecter le macaroni, macérer le fromage dans le madère, agglutiner les sucreries en édifices ; invoquer Marengo et Navarin à propos de sauces, Condé à propos de pêches, Soubise à propos d’oignons ; accommoder Richelieu en timbale, Talleyrand en coulis et Nesselrode en pudding ; et ainsi de suite à cette fin que, – comme le dit Brillat-Savarin en un mot de la plus gourmande concupiscence, – la bouche « s’inonde de délices », ce n’est plus là se nourrir, morbleu ! mais se préparer les voluptés de la consommation. Pareillement, se carrer au restaurant – que ce soit à l’Anglais ou au Duval, – et, l’esprit méditatif et tendu, dresser sur la carte un plan de campagne déjeunatoire ou dînatoire, et le dicter à un chef d’état-major : maître-d’hôtel, garçon, bonne ou sommelier.
Les consommations, théoriquement innombrables, se réduisent dans la pratique à un chiffre limité de substances, partout les mêmes. Pour diversifier cette répétition, l’homme, ingénieux une fois encore, se met présentement l’imagination à la torture, cherchant la variété et l’inédit par le décor et les accessoires : dorant les parois des restaurants, peignant, – ou peinturlurant – les murs des brasseries, maquillant les cafés en vieilles tavernes, en bouges et en clapiers Moyen Âge, voire en bagne, et même en autre chose, et les garçons en forçats ou en académiciens ; usant de la musique comme condiment, de la chanson comme ravigotant, et de l’éternel féminin comme excitant. C’est là ce que l’on peut appeler la mise en scène de la consommation.
Donc Paris a aujourd’hui des matières et des manières de consommation spéciales à notre temps. Ce qu’est, en 1893, Paris consommant, Goudeau, dites-le ; Vidal, montrez-le !
Le sujet est inépuisable : il y faut opérer une « sélection », suivant un vocable fort consommé aujourd’hui : Vidal, prenez d’un trait alerte quelques « instantanés », Goudeau, commentez-les en observateur, et tous deux, servez-nous un Paris qui Consomme, document dans le présent agréable, et dans l’avenir instructif à consommer.
HENRI BERALDI.
À Paris, le besoin de consommer naît avec le jour et ne prend fin qu’avec la nuit : dès l’aurore, la gueule – ainsi disaient nos pères – est ouverte, qui n’est point encore refermée aux ténèbres. Ou mieux, ce besoin d’une si miraculeuse intensité ne commence ni ne finit : cycle ininterrompu s’enroulant sur lui-même, à l’instar du symbolique serpent, ce consommateur singulier qui se mord éternellement la queue.
À l’heure ultra-matinale où le fiacre suprême, la dernière voiture de cercle, ramène au logis le joueur décavé qui, se remémorant les abatages manqués et les mauvais tirages à cinq, sent naître en lui à la fois un désespoir momentané, un sommeil vague entrecoupé de visions où le huit et le neuf jouent le premier rôle, et une soif ardente qu’il étanche avec le consommé froid ou le verre d’eau sucrée à peine aromatisé par une larme de wisky ou d’alcool de menthe ; à l’heure où quelque autre voiture reconduit à son logis l’amoureux attardé, dont la fatigue trahit enfin le courage, et qui, avant que d’entrer dans le lit de repos, le lit pour un, se réconforte d’un grand verre d’eau fraîche pris goulûment ; – à cette même heure, descendent vers leurs labeurs les ouvriers, maçons, charpentiers, débardeurs, forgerons, zingueurs, serruriers, tourneurs, tous les innombrables corps d’état qui font de Paris une vaste usine.
Car Paris, ce Paris tant calomnié de l’étranger noceur, Paris, la ville du plaisir, est avant tout la ville du travail : avec fièvre, avec génie, Paris industriel abat une besogne immense. D’ailleurs, sans travail point de consommation !
Donc, dès la première aube, le travailleur s’en va vers l’atelier. Mais il a acquis la veille, grâce aux boissons et aux pipes du soir, ce qu’on appelle « le ver », c’est-à-dire une sorte de voile ou de suie qui tapisse l’arrière-bouche et obstrue le canal de la consommation. Les bellevillois comme Coupeau appellent cela « pituite », ou encore « gueule-de-bois » ; expression qu’un monsieur comme il faut, et qui sait du grec, a imaginé de traduire, pour rester distingué dans sa façon de qualifier le classique « mal aux cheveux », par : « avoir le xylorhynque ».
Ce « ver », les travailleurs matinals vont l’exterminer par l’alcool, le « tuer » chez le mastroquet du coin, non loin de l’atelier.
L’œil sur la pendule, le serrurier dit au charpentier, tout en vidant un verre de blanc, un cognac, un « mêlé-cass’ » ou un rhum :
– À la tienne, Étienne !
C’est la formule consacrée ; elle prouve que la rime riche est une consommation usuelle même chez l’illettré qui ignore l’Art poétique.
Un groupe de clients, portant leurs outils variés sur l’épaule, demandent au patron, gros, lippu, encore ensommeillé :
– Ça va-t-il, la toquante ?
Et, sur la réponse affirmative du « bistro », un farceur de la bande crie :
– À nous le zanzibar !
Et les dés roulent sur le comptoir de zinc taché de couleurs diverses, parmi les verres à demi pleins, ou vides et poisseux, tandis que le garçon hâtif aligne encore d’autres rangées de mêlé-cass’ ou de demi-setiers, dans lesquels les joueurs de bon appétit trempent un croissant.
En regardant rouler ces dés, je me remémore une illustration d’un roman écrit – oh ! comme il y a longtemps ! – par le bibliophile Jacob, et que je lus en ma tendre enfance. Cela s’appelait, je crois, la Belle Maugrabine, et l’on voyait le duc de Créqui, fraise au col, dague à la ceinture, jouant aux dés, nouveau Robert le Diable, toute sa fortune en or et pierreries, et même sa haquenée fidèle, contre l’insolente veine d’un marquis quelconque.
Et maintenant, les dés roulent dans la poisse du comptoir, et l’un d’eux va choir en la boîte à ordures, que, pressé d’ouvrir la boutique, le garçon n’a pas eu le temps de porter sur le trottoir.
Mais la cloche de l’atelier voisin sonne, appelant au travail les traînards du bistro, les fanatiques du zanzibar. Et le mastroquet compte les gros sous. Quelques-uns des clients cependant, au lieu d’allonger la monnaie, ont simplement dit : « Je paierai ce soir. »
Sur ce, le « ver » est mort.
La porte de l’atelier ou de l’usine se ferme, et les camarades qui arrivent en retard se glissent encore chez le marchand de vin, pour y attendre que l’on rouvre.
Et voici, le carrick ou la redingote sur le bras, le fouet à la main, la pipe à la bouche, le chapeau ciré renversé en arrière, messieurs les cochers qui viennent aussi « lever le coude » avant le départ.
Il y en a des gras, il y en a des maigres, des barbus et des glabres ; il y en a de mauvais, grossiers et querelleurs, mais il y en a aussi, et en grand nombre, disons-le hautement, de très braves, complaisants, et polis. Malgré la légende qui les représente toujours prêts à consommer le client tout cru, malgré l’exécration du Parisien pour l’espèce automédone, on ne peut avec justice ramener à un type unique et à un même dénominateur (celui de « Collignon », suprême injure abominée des cochers) les fractions diverses d’une corporation dont les membres se comptent par milliers et offrent toutes les variétés que suppose ce nombre. Un trait cependant leur est commun : ce beau teint rouge-brique qui fait la gloire de leur âge mûr ; résultat de la vie en plein air et de l’usage des consommations réchauffantes.
Ils passent vite, debout au comptoir, et disparaissent, regagnant leur station.
Et le mannezingue demeure vide, pour cinq ou six longues heures. Paris travaille !
Mais à midi, à l’heure où les chevaux, eux aussi, consomment, le nez dans la musette, nous les reverrons, ouvriers et cochers, attablés devant la porte, mangeant, ou plutôt consommant solidement la large ration, la « portion » de viande et de légumes d’une coction délicate et irréprochable. Car, détail topique, le peuple est autrement difficile sur la cuisine que les classes dites supérieures. Moins original dans ses menus, et encore ! il veut une base résistante, mais il la veut en gourmet, et ne transige pas comme le bourgeois sur le parachevé de la cuisson d’une daube ou sur le saignant d’un gigot aux soissons.
Sur ce fond inébranlable, sur cette base, il assoira le travail – et les diverses absorptions – de la journée. Pour le matin, le verre destiné à tuer le ver n’a été qu’un simple coup de pioche, le premier terrassement de la consommation.
Les femmes, – sauf de monstrueuses exceptions, – ne connaissent point le tue-ver. Elles vont à la crémerie, prendre le débilitant et bien-aimé café au lait, à qui l’on a fait la réputation d’être le tue-femmes.
La crémerie, symphonie en blanc majeur entre la rougeâtre boucherie et la boulangerie jaune ! La devanture est le plus souvent couleur de lait, parfois avec des tons bleus ; mais fût-elle teinte en note chocolat, en mauve, ou en bouton-d’or, la splendeur immaculée des crèmes, l’innocence des petits suisses ou des gervais, et la candeur parfois mouchetée des œufs frais donnent à son étalage un cachet lilial dont elle a le monopole, à travers tous les visages de boutiques s’ouvrant sur la rue, et qu’elle garde malgré les quelques notes sombres des pruneaux cuits, morceaux de jambon, poires, raisins secs et amandes. C’est le blanc qui domine sans conteste possible, au moins dans la première salle où les ménagères matineuses viennent s’approvisionner.
Mais dans la salle du fond une certaine obscurité règne derrière la cloison de bois découpé. Un jour maigre y descend de la fenêtre donnant sur la cour.
Dans les petits paniers, des pains de toutes formes, ronds ou longs, aplatis ou dodus, sont entassés sur chaque table de bois ou de marbre, à côté d’une épaisse carafe entourée de trois ou quatre verres sans pied, le fond en l’air.
Des femmes surtout viennent là : institutrices ou petites ouvrières, femmes de journée ou demoiselles pauvres. On y voit aussi de ces veuves tout en noir qu’on retrouve à la Bibliothèque Nationale se livrant à de vagues copies pour on ne sait quel journal.
Des appels se succèdent : « Quatre de chocolat ! Deux de café au lait ! Trois de café noir ! » Ce qui veut dire quatre sous, deux sous, trois sous. Fumant en des bols solides et opaques arrivent, portées par une servante à tablier blanc, les consommations demandées. Sur l’assiette épaisse où repose le bol, s’étale une large cuiller à bouche.
Les femmes qui ont des gants aux mains les tirent doucement et les posent sur la table ; celles qui ont une voilette sur le nez la relèvent. Celles qui n’ont rien se hâtent de briser leur pain et d’en jeter les premiers morceaux dans leur chocolat ou leur café, puis, en attendant que ces premiers morceaux soient suffisamment imbibés, elles trempent le reste de leur flûte dans le breuvage brûlant. Les moins pressées jettent un coup d’œil sur le feuilleton de leur Petit Journal, qui continue à lutter avantageusement contre les nouvelles salées de quelques feuilles ou suppléments pornographiques.
Et l’on entend, derechef : « Trois de chocolat ! » ou : « Quatre de café ! »
Ce sont des clientes nouvelles, ou parfois un client : un homme lassé à l’allure pauvre, dont la redingote élimée pleure misère, un bohème à barbe inculte ; ou encore quelque philosophe entre deux âges, portant sous le bras une importante serviette bourrée de papiers et de livres dans lesquels il s’empresse de fourrer son nez, tandis que refroidit son bol.
C’est là la vraie crémerie, celle qui n’offre que du lait ou du chocolat ; mais il en est d’autres où l’on peut entendre demander un œuf au plat, et souvent la domestique annonçant à l’office crie : « Une œuf bien cuite ! »
Les verres s’emplissent de l’eau des carafes, à moins que la dame veuve ou le philosophe, ou parfois la petite ouvrière ne demandent un carafon (ou trois de vin). Parfois le bohème à redingote élimée, sentant au fond de lui une étrange fadeur après son chocolat ou son lait froid, réclame un petit verre de kirsch ou d’eau-de-vie de marc.
Les crémeries ont, sous leur uniforme blanc, des physionomies particulières selon les quartiers. Dans les centres riches, elles n’ont presque pas de salles à manger, elles se contentent de vendre lait, œufs et fromages. Dans les quartiers populeux, très pauvres, elles n’offriront ni vins ni liqueurs à leurs hôtes de passage. Mais vers « Montmertre », pays des rapins, ou encore dans le quartier de la Sorbonne et du Panthéon, elles ressembleront à de véritables restaurants, offrant sur les tables de marbre de la salle du fond, la consommation renforcée de solides, en-cas substantiel : le bifteck aux pommes, la côtelette au cresson, l’omelette aux fines herbes et quelquefois, ô Armand Silvestre ! le cassoulet de Castelnaudary. Et les clients, délaissant l’eau de la carafe, demanderont peut-être une demi-Pomard, ou, pour être plus sûrs de ne point se tromper, une demi-Bercy ; ils ajouteront au repas quatre de café noir « dans un verre » (pour en avoir davantage), et un cognac de la plus inférieure des Charentes.
Il est telle crémerie à juste titre célèbre qui voit, autour du marbre de ses tables, se réunir de curieux personnages lesquels, en mangeant une entrecôte purée et en buvant de l’Argenteuil dans les verres sans pied, se demandent mutuellement des nouvelles de l’Afghanistan ou du lac Tchad, de la Cordillère des Andes ou du Thibet. C’est la Crémerie Belge, rue Mazarine, où l’on a vu, dit-on, Brazza et Stanley, où l’on pleure Flatters, et où l’on exalte Trivier et le commandant Monteil.
Mais, dans les grandes comme dans les minuscules, quand le repas léger ou plus corsé est fini, le client se lève, passe au comptoir et détaille sa consommation. C’est un dialogue entre lui et le patron ou la patronne :
– Quatre de chocolat.
– Quatre.
– Deux petits pains.
– Deux, ça fait six.
– Un carafon.
– Trois, ça fait neuf.
– Voilà neuf sous.
Ou encore, en un langage déjà plus système métrique.
– Entrecôte aux pommes.
– Soixante.
– Une demi-ordinaire.
– Trente.
– Deux petits pains.
– Vingt. Quel dessert ?
– Raisins.
– Quarante. Pas de café ?
– Si, et deux petits verres de marc.
– Vingt et trente, cinquante.
La patronne compte : zéro, six, neuf, onze, quinze, vingt.
– Ça fait deux francs.
Et l’on a laissé un pourboire sur la table pour le garçon. Car la crémerie-restaurant possède un domestique mâle, avec ou sans moustaches.
Entre le tue-ver ultra-matinal des ouvriers et le vermouth de onze heures des boursiers la consommation ne chôme point.
Des employés de bureau, au galop, prennent un rhum, un café au kirsch, ou un simple verre de byrrh hygiénique et pharmaceutiquement chargé de quinquina. Des facteurs de la poste, au cours de leur tournée de neuf heures, lampent un verre sur le comptoir dans la boutique à tabac. Des déménageurs trinquent en l’honneur du « patron » et se soutiennent un peu à l’aide de quelques chopines rouges, parfois bleues.
Ainsi de suite à l’infini. Mais vers midi moins le quart, c’est le bar anglais, le bar anglo-américain plutôt, dont le règne commence.
Perché sur une haute chaise, serré dans une jaquette due à un tailor de l’avenue de l’Opéra, portant du linge blanchi à Londres, dit-il, l’anglomane parisien boit des liqueurs américaines.
L’Anglais véritable passe là en courant. Il demande un cocktail, ce mélange de bitter yankee, de sucre, de citron, d’eau glacée et de cognac (à moins qu’à l’eau-de-vie ne soient substitués le wisky, le kirsch ou même l’absinthe). Pendant qu’on prépare le laborieux breuvage, il jette un coup d’œil hâtif sur un journal de courses, tout en essayant de saisir dans la conversation ambiante quelque bon tuyau. Le cocktail à la fin servi, il l’avale, paie, et fuit vers une destination inconnue.
Le Parisien anglomane reste là, lui.
Venu vers dix heures du matin, afin de chasser les brumes épaisses amassées en son gosier par les wisky, irish-brandy ou old-tom-gin de la veille, il demande un soda-water. On lui débouche la fiole verte (il y faut une certaine adresse, car dès que le bouchon de verre a basculé, le liquide mousseux s’efforce de partir en feu d’artifice, ou si vous voulez, en eau d’artifice). Dès lors, il boit à belles gorgées, et repousse vers son estomac, brûlant comme un sahara, les brouillards de son arrière-bouche, – quelques-uns prononcent arrière-cuite, étant donné que la cuite est ce qu’en termes polis on appelle une forte griserie.
Bientôt l’estomac, lubrifié par le soda, réclame quelque chose de dur. Paulo majora bibamus ! Ainsi la terre, après la pluie, s’ouvre pour les semailles fécondes. Et alors commence une série de cocktails, jaunâtres, opalins, verts, bleus, selon la prédominance de telle ou telle liqueur.
L’art de faire un bon cocktail est très réputé. On a vu à l’Exposition Universelle un nègre qui, tenant un verre plein du mélange dans une main, et un verre vide dans l’autre, lançait la liqueur dans l’espace, aller et retour, sous la forme d’un jet demi-circulaire, recevant dans le verre vide ce que lui envoyait le verre plein. Cette prestidigitation était, paraît-il, prodigieusement favorable à la bonne mixture des divers éléments constitutifs du cocktail, lequel a la spécialité non seulement de donner de l’appétit, mais encore, si l’on en croit ses fervents sectateurs, de raffermir les intestins délabrés par le passage des nourritures. Croyez cela, et buvez… de l’eau, dit un méfiant et hygiénique proverbe.
L’appétit enfin venu, ou plus exactement lorsque midi et demi sonne, l’anglomane se dirige vers quelque taverne anglaise, où le rosbif sans sel ni poivre, fade (oh ! combien fade !), s’accompagne sur l’assiette de pickles enragés et de moutarde vésicante.
Après le repas, nous perdons notre homme de vue : il se livre à ses occupations, qui consistent généralement à aller aux courses, soit sur le mail-coach d’un ami, soit plutôt, pour vingt sous, ou même pour dix, sur un de ces longs breaks à quatre chevaux qui terrifient le passant tardigrade.
Mais nous reverrons l’anglomane à quelque posada (ou bodega), laquelle, malgré son nom espagnol, est tenue par de purs Londonniens.
Là, entre les tonneaux qui ornent la muraille, bruns sous leurs cercles dorés, il s’assiéra à quelque jolie petite table et humera le nectar select qui est un vin blanc du Portugal à un franc le verre, ou encore les xérès variés (viâ London), tels le pale sec, le golden doré, le golden doré doux, le brown doré foncé, ou même le old east India (retour des Indes). Le madère, en cette posada, quitte son nom déjà banal pour arborer ceux très britanniques de good young (bon jeune) à soixante centimes le verre, de full médium (doux) à soixante-dix centimes et de malmsey à un franc. L’anglomane ne manquera pas non plus de goûter le finest scotch wisky, ou le très vieux american-wisky, ou l’irish-wisky, à moins qu’il ne préfère le white-rum, ou le best-Jamaïca-rum, ou le terrible gin-and-gingerale, composé devant lequel tremblent les plus formidables buveurs.
Le soir nous le retrouverons à l’Euréka, dont le nom grec dissimule un bar selectissime quoique étroit, à ce point célèbre que les romanciers élégants le citent volontiers comme le rendez-vous des rares et suprêmes habits rouges.
Là il ingurgitera des pale-ale, des Burton-no, des stout ou des extra-stout ; ou bien, en une pinte sérieuse, il fera half and half, mélangeant la noire et la blonde, puis prendra quelques verres de porter avant le wisky final, et ira se coucher en attendant le soda-water du lendemain.
Après l’anglomane des bars, le germanisé des brasseries : celui-ci est légion.
Nous taxons de germanisé l’assidu de brasserie parce que, AXIOME : la Brasserie est allemande, même lorsqu’elle est française, gérée par des Français qui y vendent de la bière française à des rédacteurs de journaux français et patriotes ; même lorsqu’elle est gauloise, servie par des femmes qui y débitent, comme disaient nos pères, la « petite oie » et encore la grande, si l’on peut risquer ce mot.
La Brasserie est allemande, parce qu’elle est l’opposée du Café, qui, turc d’origine, est devenu essentiellement français.