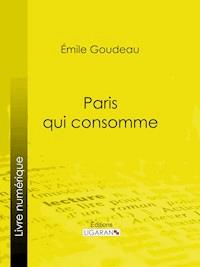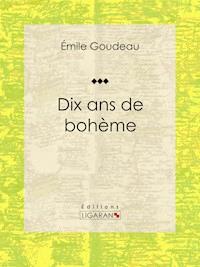
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le moi est haïssable, le je, perpétuel, agaçant; je les emploierai donc ici le moins possible. Toutefois, dire l'auteur, à la troisième personne, devient à la longue insupportablement prétentieux, et prononcer nous appartient aux rois ou aux évêques. Comment faire pour narrer les évènements, grands ou petits, dont on a été un des principaux acteurs? Tant pis, j'entremêlerai les moi, les je, les nous et les l'auteur..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050677
©Ligaran 2015
Dans son numéro du 10 septembre 1887, l’Intermédiaire des chercheurs demandait où se pourraient trouver quelques détails sur ce que furent les hydropathes. Je répondis alors que peu de documents existaient, à part la collection introuvable du journal l’Hydropathe, et une plaquette de Léo Trézenick intitulée les Hirsutes. Cela m’avait fait remuer, en une vieille armoire, quelques très anciens papiers, où j’ai cueilli les notes suivantes, destinées à servir de base à un ouvrage de plus longue haleine sur les hydropathes, les hirsutes et le Chat noir, lorsque tout cela aura subi la nécessaire patine du temps, et l’estompement du lointain.
Moi, l’auteur, je ou nous. – L’hôtel aux fausses truffes. – Les finances de l’État. – Francisque Sarcey. – Le café-forum. – La Renaissance d’Émile Blémont. – La poésie de Paris.
Le moi est haïssable, le je, perpétuel, agaçant ; je les emploierai donc ici le moins possible. Toutefois, dire l’auteur, à la troisième personne, devient à la longue insupportablement prétentieux, et prononcer nous appartient aux rois ou aux évêques. Comment faire pour narrer les évènements, grands ou petits, dont on a été un des principaux acteurs ? Tant pis, j’entremêlerai les moi, les je, les nous et les l’auteur, en priant les lecteurs de ce livre de vouloir bien considérer que, si le moi des autres est profondément haïssable, chacun trouve son propre moi délicieux. Je compte sur cette réflexion psychologique pour me valoir l’indulgence du public, auquel je livre ces légers souvenirs d’une époque de bohème gaie, la dernière peut-être, étant donné que le pessimisme le plus noir obombre aujourd’hui les fronts et les cœurs de vingt ans.
Il ne s’agit point ici de pontifier, ni d’annoncer au monde qu’une génération spéciale valut mieux que ses aînées ou que ses cadettes ; mais de conter, à bâtons rompus, au cours des années, les vicissitudes littéraires ou artistiques, à travers lesquelles se murent et avancèrent des camarades, plus ou moins amis les uns des autres, mais liés par des conformités d’âges et de goûts. Si, deci delà, s’entremêle au récit quelque analyse critique, ce sera celle d’un bon enfant qui ne croit plus aujourd’hui que la littérature soit un sacerdoce, et qui trouve mauvais, hélas ! qu’au milieu de l’indifférence cruelle avec laquelle ce temps-ci accueille les meilleures productions de la poésie, on pousse très inutilement les poètes à se manger entre eux le nez, d’autant plus que plusieurs l’ont fort beau, et que tous tiennent à cet appendice. Le champ littéraire n’est point un conseil municipal où l’on doive s’égorger pour monter à la tribune, il y a de la place pour tout le monde.
Je clos là ces réflexions, et je commence par mon commencement.
J’avais quitté la Gascogne ma mère – ou plutôt, ô calembour ! mon père le Périgord – avec deux cents francs en poche, plus un titre d’employé surnuméraire au ministère des finances, et, dans le fond d’une malle, un drame en vers, une comédie moderne et l’ébauche d’un roman ; très timide de tempérament, très audacieux de volonté, vous voyez le provincial que pouvait être, vers 1874, votre très humble serviteur.
En bon lecteur de la Vie de Bohème, le néophyte parisien s’installa dans le quartier Latin, comme le voulait la tradition ! C’était rue de l’Ancienne-Comédie, un hôtel étroit de façade, haut de mansardes, vieux de partout. Déjà plusieurs camarades du lycée natal avaient élu domicile en cette maison, dont la sénilité suintait par tous ses pores de plâtres, à travers ses ais dès longtemps disjoints et craquelés. Sans doute, ce séjour avait emmagasiné des pluies biséculaires, et la moisissure des plus anciens régimes y florissait dès avant 89. Le souvenir de ce perchoir vermoulu est intimement lié, dans la mémoire des perroquets qui y dormirent, à une indéfinissable senteur de champignons vagues et d’invraisemblables truffes : champignons spectres ! truffes fantômes ! pourriture certaine ! Périgourdins que nous étions, cela ne nous étonnait pas autrement : ainsi fleurent les bois de chez nous, durant les automnes mouillés.
L’administration française m’apparut sous un aspect au moins singulier. Le chef de bureau qui m’accueillit, me demanda :
– Avez-vous déjà été employé ?
– Non, répondis-je avec sincérité, puisque je suis surnuméraire.
– C’est dommage, fit le chef d’un air profond. Enfin, nous allons vous chercher du travail.
Il appela un commis principal, et lui donna quelques instructions. Ce commis m’entraîna dans un bureau, très peuplé de rédacteurs et d’expéditionnaires. Là, il me fit asseoir devant un pupitre, plaça deux gros registres sous mes yeux, un crayon rouge dans ma main, et me dit, sans rire :
– Ce registre de chiffres a été pointé déjà au crayon noir, au crayon bleu, au crayon vert, au crayon jaune ; il s’agit de savoir si les nombres – oh ! mais très attentivement – avec votre crayon rouge.
De dix heures du matin, jusqu’à cinq heures du soir, je surpointai les pointages antérieurs. Admirable opération ! Pour aboutir à ce labeur, j’avais étudié huit années au lycée, passé deux baccalauréats, plus un examen spécial, où l’on m’avait interrogé sur le droit administratif, l’économie politique, la façon d’établir un budget, les ressources ordinaires et extraordinaires des États, les emprunts et la Bourse, etc., etc. De plus, on s’était enquis de ma moralité, de celle de ma famille, y compris les ancêtres. Admirable opération ! pour laquelle d’ailleurs, étant surnuméraire, je ne touchais pas un seul de ces centimes, dont je pointais les formidables additions, sans omettre les demis et les quarts de centimes, jusqu’à la somme inscrite à la fin du registre, à savoir : trente-deux milliards, six cent vingt-cinq millions, quatre cent cinquante-neuf mille, huit cent vingt-sept francs, quarante-deux centimes et un quart.
Le soir, à la modeste table d’hôte de la rue Hautefeuille, où je rencontrais quelques camarades, je me laissais aller à toute l’ironie que mon béotisme périgourdin dénué de tout respect attique pouvait déverser sur l’administration, lorsque l’un des commensaux, devenu depuis député, puis directeur général du ministère des Affaires étrangères, me dit :
– Vous êtes un rouage, un tout petit ressort, mais la machine est grande, superbe dans son ensemble.
Très bien, rouage devenu, je me résignai. Et pourtant ce n’était point pour cela que j’étais débarqué à Paris, mais afin de lancer sur le monde étonné des vers et des proses pareils à des bolides.
Seulement, craintif à l’excès, je n’osais m’adresser à personne, pas même à mes camarades, redoutant les railleries ; si bien qu’au bout d’un an, je me trouvais au même bureau, pointant les centimes, sans avoir fait aucun pas vers la gloire ni vers ceux qui en sont auréolés. Timide, effrayé même, je demeurais en face de mon drame et de ma comédie. Les hommes de lettres m’apparaissaient, à distance, immenses comme des statues de vingt coudées posées férocement sur un piédestal de trois cents mètres. Je m’imaginais que l’orteil de M. Leconte de Lisle mesurait, sur le sol de la Grand-Ville, un arpent au moins, et qu’une armée entière, avec armes et bagages, pouvait très bien dormir à l’ombre du petit doigt de M. Théodore de Banville.
Si, pour accomplir quelques médiocres additions, Paris, représenté au ministère par un chef de bureau grave et décoré, me jugeait à peine capable d’un pointage au crayon rouge, pointage déjà exécuté par tous les crayons de l’arc-en-ciel, quelle outrecuidance n’aurait-ce pas été que de se risquer dans la littérature, ce royaume, où certes, au début, on m’aurait prié non pas même de cirer les bottes des grands hommes, non, mais simplement de regarder comment on les cire, afin d’apprendre.
Sans nul doute, les jeunes, les débutants, déjà célèbres dans le quartier Latin, et vers Montmartre, m’épouvantaient moins ; je les sentais plus proches et abordables et, pourtant, ils m’intimidaient aussi.
Le soir, délaissant les parties de manille ou de polignac des camarades du lycée, j’allais autour de l’Odéon errer vers le café Voltaire ou le café Tabourey ; à travers les vitres, j’apercevais le nez d’un poète, le chapeau d’un prosateur, la barbe d’un dramaturge. Parfois, j’entrais sur la pointe des pieds, me mettant à une table près de la porte, demandant un verre de bière, à voix basse, et un journal qui me servait à garder une contenance. À la dérobée, je jetais des coups d’œil sur le clan sacré ; – on devait me prendre pour un simple mouchard.
Je rentrais, désespéré de cette sotte attitude, et, afin de m’en consoler, me jetais sur ma table de travail, pour parfaire le chef-d’œuvre nécessaire à mon introduction dans ce monde idéal, où, tout en buvant, au lieu de jouer à la manille, on savait faire mouvoir les idées, comme de simples pions, sur l’échiquier immense de la poésie.
Enfin, comme un mouton enragé, je pris un jour ma timidité et la jetai par-dessus bord ; j’allai voir – oh ! non pas un poète, pas un de ces hommes qui tutoient par vocation les dieux et les étoiles, non – mais un littérateur qui me paraissait plus abordable. Encore, de peur du ridicule, je n’emportais aucun manuscrit : ni mon drame ni ma comédie, pas même un sonnet ; et je me rendis, sans armes, chez Francisque Sarcey.
Ce fut, messeigneurs, une belle conférence, au bout de laquelle le prince de la critique me déclara que tout était une affaire de chance et de talent, et que, si je possédais l’une et l’autre, lui, critique, verrait avec plaisir mon nom passer de son écritoire sous sa plume.
Alors, lassé de travailler dans l’ombre de l’hôtel garni, aux senteurs hybrides de truites et de champignons, je me mis à fréquenter les cafés littéraires, comptant sur le hasard pour me faire pénétrer dans l’intimité des héros poétiques, et des demi-dieux du sonnet.
C’est ici le lieu de s’expliquer sur la vie de café. Le vieux dicton : Il vaut mieux écrire une tragédie que d’aller au café, est devenu faux à l’user. Écrire une tragédie dans un coin sombre, semble être aujourd’hui le dernier mot du crétinisme. Les directions de théâtre sont archicloses aux inconnus ; d’autre part, les salons ont perdu beaucoup de leur ancienne influence ; il faut donc, en une ville telle que Paris, descendre dans la foule, se mêler aux passants, et vivre, comme les Grecs et les Latins, sur l’agora ou le forum. Sous le ciel pluvieux de Paris, l’agora ou le forum, c’est le café, voire, pour les politiciens de faubourg, l’humble marchand de vin du coin. Les cafés sont le lieu de réunion, où, entre deux parties de besigue ou de dominos, on peut ouïr de longues dissertations – parfois confuses, hélas ! sur la politique, la stratégie, le droit ou la médecine. De plus, ces établissements ont remplacé le jardin d’Académus, le jardin fameux, où les philosophes promenaient péripatétiquement leurs inductions et déductions ; ils tiennent lieu de l’hôtel Rambouillet, où le sonnet d’Oronte captait les suffrages de Benserade et de Voiture.
Cela est surtout vrai au quartier Latin, et vers Montmartre. De jeunes hommes qui viennent étudier, en des hôtels garnis peu récréatifs, éprouvent un immense besoin de camaraderie et de bavardage à la française ; ils vont en chercher là où on en trouve, c’est-à-dire dans ce prolongement de la rue parisienne qu’on appelle un café. Ceux surtout qui rêvent de littérature, et qui, débarqués de leurs provinces, ne connaissent personne et ne sauraient à laquelle des cent mille portes de Paris frapper, les pauvres troubadours, jetés sur la place de la Grand-Ville, s’estiment heureux d’aller rôder autour des quasi-célébrités et des demi-gloires, que l’on peut coudoyer dans les lieux de réunion ouverts à tous.
Le café devient ainsi la succursale, ou mieux, l’antichambre des bureaux de rédaction.
Car il y a toujours, devers le boulevard Saint-Michel, un journal littéraire, quelquefois deux, qui donne le ton. À cette époque reculée (1874-1875), la petite revue, chargée des destinées poétiques de la rive gauche, s’appelait la Renaissance, dirigée par le poète Émile Blémont. Je lisais attentivement ce recueil où les différentes écoles poétiques d’alors se coudoyaient et parfois se rudoyaient, témoin un article intitulé « les Vieux Ratés », dans lequel Jean Richepin attaquait précisément plusieurs des collaborateurs de la Renaissance. Avec l’intransigeance de la jeunesse, il considérait alors comme de véritables ancêtres, mathusalémiques, vieilles barbes, fossiles, caducs et sentant déjà le cercueil, ceux qui avaient écrit sous l’Empire avant la date cabalistique et noire de 70. L’un des poètes attaqués, blond parnassien de trente-cinq ans, riposta : « Raté ? peut-être ; mais vieux ? allons donc ! »
Néanmoins, on se sentait un peu révolutionnaire dans le clan des nouveaux, de ceux d’après la guerre ; il semblait qu’un fossé se fût élargi entre deux époques parfaitement distinctes ; on criait à la mort de l’opérette, au renouveau du drame, à la renaissance de la poésie, d’une poésie plus vivante, moins renfermée en des tabernacles par les mains pieuses des servants de la rime riche ; on voulait ranimer l’impassible muse, lui rendre les muscles et les nerfs, et la voir marcher, moins divine, plus humaine, parmi les foules devenues souveraines. Bref ! on se battait à coups d’épigrammes pour la possession d’un lambeau du manteau royal, que Victor Hugo, pareil à Alexandre, laissait traîner sur la croupe de son hippogryphe.
Naturellement, du fond de mon hôtel garni, je convoitais un coin de cette pourpre, et, encouragé par la présence de Richepin, de Gabriel Vicaire et de quelques autres, très jeunes alors, dans la rédaction de la Renaissance, je me glissai un soir à la nuit tombante, dans les bureaux du journal, sis rue Jacob 11, en un poussiéreux entresol, et remis une pièce de vers, écrite (comme vous pensez bien) sur du papier ministériel et bureaucratique.
Lorsque je vins chercher la réponse, il me fut répondu que ce poème ne cadrait pas avec le genre de la revue. Ah ! depuis, en lisant avec respect les vers d’Émile Blémont, j’ai compris que nous n’avions guère le même genre.
Dès lors, je retombai dans ma nuit obscure de travailleur acharné.
Le surnumérariat me rendait très pauvre, et dame ! il fallait une rude foi en l’avenir, pour passer des soirées sans feu à limer des vers, après avoir pointé tout le jour des registres interminables. C’est beau la jeunesse ! Et, par là-dessus, ne pas se rebuter, lorsque l’unique revue de poésie qui existât alors condamnait mon genre, par la bouche d’un de ces demi-dieux de la rime, que j’entrevoyais au café Voltaire, humant des demi-tasses, en jugeant les vivants et les morts avec une assurance terrible et péremptoire.
– Vous ne connaissiez personne ! et vous vouliez chanter ? Allons donc, malheureux Périgourdin, sachez que, dans les revues, il en est comme dans les banquets, où chacun chante la sienne au dessert, et où le passant inconnu qui viendrait faire le treizième serait mis à la porte. Il faut être invité, que diable !
Aussi, le dimanche, promenant ma lassitude de la semaine, j’errais seul, essayant de comprendre le grand et solitaire Paris.
Et je l’aimais ce Paris ! Ses rues et boulevards, ses énormes édifices, ses squares, ses Champs-Élysées, ses arbres malingres, ses omnibus, ses stations de fiacres ! Les couleurs dont le soleil ou le gaz revêtent chaque détail dans ce prestigieux ensemble, ou encore la grisaille violette que jette le brouillard frais et onctueux sur le tableau sans cesse renouvelé, sur le kaléidoscope des êtres et des choses. Et, aussi, je vénérais le bruit parisiaque – grondement d’orage, murmure de forêt, plainte d’Océan – qui perpétuellement secoue l’atmosphère. Et, encore, j’adorais la joie de l’imprévu, le chassé-croisé des femmes à froufrous, les folies des vitrines en atours, les pavés que l’on éparpille ou qu’on tasse, la maison qu’on jette à terre, celle que l’on dresse vers le ciel à grands renforts de charpentes, qui de loin ressemblent à de gigantesques filets, et, de plus loin, à des dentelles.
L’amour de Paris, avec sa Seine joyeuse ou morne, fumée de bateaux-mouches dessus, et, dessous, terrible roulement de corps qui se cognent aux piles des ponts.
Ah ! la belle vocation de badaud badaudant, de naïf Méridional amusé de rien, et qui trouvait à cela plus de poésie intense qu’aux élucubrations froides et calculées. C’était, oui, de la poésie bien vivante ! Mais comment la tirer de ces becs de gaz, de ces arbres malingres, de ces omnibus jaunes, verts ou bleus ?
– Il y a de l’arsenic dans le fauteuil du président des assises, disait Raspail au cours du procès Orfila. Il ne s’agit que de l’en extraire.
De même, il y a de la poésie partout.
Et je rentrais dans la cellule froide pour confier au papier des choses dans mon genre, extrayant l’arsenic des fauteuils.
Projet de journal pour les jeunes. – Les autographes de V. Hugo. – Adelphe Froger, la République des Lettres. – Le Sherry-Cobbler. – Quelques chansons. – Les Vivants.
Je fis la connaissance des poètes d’une façon bizarre. Précisément dans un des derniers numéros de la Renaissance, – ce fut le premier journal que je vis mourir ! Combien depuis ! ! – je lus la petite note suivante : « Les poètes qui voudraient s’entendre pour fonder une revue ou un journal, doivent s’adresser à M. M… T…, rue L…, vendredi à huit heures du soir. »
Je me rendis à cet appel.
Comme huit heures sonnaient dans la brume opaque d’un soir d’hiver, plus sombre encore aux Batignolles que partout ailleurs (on n’a jamais su pourquoi), je gravis d’un pas alerte les six étages qui séparaient du sol de la rue Legendre la demeure de l’homme bienfaisant, ayant consenti à créer un journal pour les jeunes.
Je m’attendais à voir là quelque vieux philanthrope, quelque saint Vincent de Paul, portant sur chaque bras un sonnet trouvé, et, suspendus aux pans de sa robe de chambre, une multitude d’alexandrins perdus et d’hémistiches orphelins. Je m’imaginais, dans ma naïveté de provincial, que, puisqu’on trouve de tout à Paris, on y devait rencontrer des pères adoptifs pour les œuvres géniales mais pauvres, qui encombrent les tiroirs, ces berceaux à forme de cercueils.
Telle était ma pensée, au premier étage, sur le palier.
Je poursuivis mon ascension. Mais, au fur et à mesure que j’approchais du but, je sentais naître, en moi, cette forme particulière de la terreur, qu’on appelle le trac, et me livrais à toute une mimique d’hésitation, avant que, prononçant mon alea jacta est ! sous la forme plus moderne de : Allons-y ! je fis tinter la sonnerie, qui, du coup, arrêta les palpitations inutiles.
Un salon très éclairé, orné d’une grande quantité de chaises. Personne. Ah ! si ! si ! dans un coin, à droite, un jeune homme blond, svelte, très imberbe, dissimulant mal un ennui profond ; vers un deuxième coin, un jeune homme brun, petit, qui ne disait rien non plus, mais suçait la pomme de sa canne. Moi, dès lors troisième, je m’assis dans un autre coin. Barbu, très noir, l’œil torve, la conscience un peu rassurée, j’attendis dans ce petit désert, où les lustres flamboyaient sur une caravane de chaises immobiles. Une table au milieu, avec un verre, une cuiller, du sucre, de l’eau, enfin tout ce qui fait présager un conférencier. Un quart d’heure se passa, puis une heure. Le grand blond grognait ; le petit brun, vif, quitta sa chaise, et, avisant le sofa, se coula dedans, croisa ses jambes longuement l’une sur l’autre, et se reprit à sucer sa canne d’un air somnolent. Moi, habitué dès l’enfance, par la destinée, aux évènements les plus sordidement cruels, je demeurais impassible.
Je me disais in petto : Un peu de correction, mon ami ! le petit brun, c’est peut-être une de nos jeunes gloires, le blond est sans doute le fils de quelque célébrité, ne bougeons pas !
Les deux autres devaient se faire les mêmes réflexions. Heureusement tout a une fin ! Une porte s’ouvrit, et un monsieur d’une trentaine d’années, maigre, long, bien peigné, l’air comme il faut, se présenta :
– Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre, Messieurs, dit-il en jetant un salut circulaire.
Notre hôte – car c’était lui ! – gagna le fauteuil, sis en face du verre d’eau sucrée ; il ne toussa point, mais, prenant un air capable, quoique bon enfant, il commença :
– J’ai là, Messieurs, neuf lettres de poètes qui s’excusent de ne pouvoir venir ce soir à la réunion : ce sont MM. de Banville, Leconte de Lisle, de Bornier, Duparc, Lalune, Tartempion, etc. Je ne vous lirai pas leurs missives ; mais je tiens, avant de vous expliquer ce que je compte entreprendre, à vous faire part du superbe autographe que notre illustre et adoré maître, Victor Hugo, m’a envoyé :
« L’heure est aux poètes. Votre entreprise est noble. Je suis avec vous V.H. »
Le blond et le brun se mirent à rire ; je pensais que c’était sympathiquement, mais la suite devait me dévoiler le tréfond de leur pensée obscure.
M. T… continua :
– Nous ne sommes que trois…
– Quatre, interrompit le brun.
– Je ne me comptais pas, reprit M. T… modestement. Donc, il s’agit de fonder une revue hebdomadaire au meilleur profit des poètes, et ce sont les ouvriers de la première heure qui demeureront évidemment les mieux partagés. Mais, avant de vous dévoiler le plan merveilleux que j’ai conçu, afin de tirer la poésie du marasme, car elle est dans le marasme !…
– Ah ! oui, dit le blond svelte.
– Oui ! Il est nécessaire que nous fassions un peu connaissance.
– Ça, c’est juste, dit le brun petit.
On se présenta, comme on put, les uns aux autres : M. T…, M. Adelphe Froger, M. Edmond Nodaret, M. Émile Goudeau.
– Mais, ajouta notre hôte – et il torturait paisiblement du sucre dans de l’eau avec une cuiller, – mais, il faut nous présenter les uns aux autres comme poètes. Si donc vous avez apporté quelque chose : un sonnet, une ode, des triolets ?…
À cette invitation, le blond Adelphe tira de sa poche un manuscrit, et lut des vers très parnassiens : des images, des allitérations, des rimes riches, pour la forme ; pour le fond, un rassemblement de jolis nuages dans un tunnel. Nous applaudîmes. Le blond svelte, triomphant, exhiba aussitôt une lettre de Victor Hugo, qu’il avait gardée pour la bonne bouche. Le maître lui écrivait : « Toujours en avant, et vers la lumière ! – V.H. »
Ce fut au tour d’Edmond Nodaret, le petit brun. Il lut des vers quasi-classiques : de l’esprit, une forme lâchée, un prosaïsme drôle de chroniqueur débutant, qui sera très amusant plus tard. Quand il eut achevé, il prit dans son portefeuille une lettre que Victor Hugo lui avait adressée et nous en donna connaissance : « Ossa et Pélion ne sont rien, il faut gravir le Parnasse ; vous êtes en chemin. Continuez. – V.H. »
Ce fut à mon tour de prendre la parole. Je me sentais cruellement humilié, devant ces élus du Maître, de ne posséder aucune recommandation. Cela me fit de la peine ! Je me sentis abandonné, dégringolant dans le vide, sans aucune main tendue pour me soutenir.
Néanmoins, bravement impavide, je lus un sonnet néo-grec, où j’essayais de donner la sensation d’atavisme hellénique, si remarquable et si remarqué parmi les gens qui jouent au baccarat.
Je fus également applaudi ; mais – ô funeste sort ! – je n’avais pas d’autographe à montrer. Je rentrais immédiatement dans la catégorie des poètes amateurs, des gens qui ne tutoieront jamais les étoiles. J’aurais, peut-être, ce soir-là, dit adieu à tout jamais à une carrière où il faut afficher brevet sur sa porte, à la façon des médaillomanes de l’École des beaux-arts, si, par un hasard heureux, M. T…, notre hôte, n’eût jugé à propos de terminer cette petite séance, où, pour la première fois je voyais des poètes face à face, par l’exhibition d’une œuvre de lui. Cela était un poème dramatique destiné aux Folies-Marigny. Lointain souvenir ! Hélas ! Nous nous tordîmes. Le blond Adelphe Froger se roulait, le brun Nodaret gloussait, moi, torve toujours, mais dépourvu d’impassibilité, je pouffais. Quels vers ! Quelle littérature !
Je compris, en entendant ces choses innommables, que les brevets du maître des maîtres étaient une simple formule de bienveillance, et ne tiraient pas à conséquence. Cela me consola d’en être dépourvu.
Lorsque cette rhapsodie, dont la longueur dépassait les bornes permises, eût été enfin lue, le verre d’eau sucrée à moitié bu, la voix de l’orateur enrouée, le brun Nodaret s’écria :
– Eh bien ! et ce journal !
Alors, posément, avec une attitude de notaire correct, d’avoué irréprochable, M. T… récita un petit discours où il prouvait qu’avec de l’argent on soulevait le monde, d’abord ! Ensuite qu’il suffisait d’être dix littérateurs, jeunes sans doute, mais capables de donner cent francs par mois, pour faire vivre un journal poétique. Il demandait en forme de conclusion, puisque nous étions déjà quatre votants, qu’on le nommât, lui, rédacteur en chef, et nous permît d’aller, par la ville, chercher les six autres futurs actionnaires.
Cela se fait à Paris. M. T…, que je ne nomme point, a pu croire que c’était belle besogne. J’ai vu des gens réputés très respectables faire payer à des naïfs cinquante centimes et un franc par vers inséré. De cette constatation presque banale (tant on connaît d’agences semblables !) je tire deux conclusions : c’est que la poésie est tellement en honneur en ce pays-ci, que, pour conquérir le titre de barde, beaucoup de commandants en retraite, de percepteurs fatigues, de marchands de salade, ou de magistrats, avares sur leur nourriture ou celle de leurs proches, parfois criblés de dettes, n’hésitent pas à dépenser de l’argent, afin de se faire imprimer. Poésie et vanité ! C’est sur ce deuxième péché que tablent les entrepreneurs de petits journaux poétiques, rédigés par les abonnés, dit le prospectus ! où ces malheureux payent sérieusement la gloire d’alimenter la cuisine de deux ou trois sceptiques joyeux qui revendent au poids l’inévitable bouillon de leurs journaux. Pauvres gogos du rêve !
Heureusement, quoique fort naïf moi-même, je mis en garde contre l’industriel en question mes deux jeunes confrères.
Et lorsque ce fantastique M. T… eut fini, nous le quittâmes rapidement, lui, son drame, son sucre, son eau, sa cuiller, son journal et ses lustres éclairant son petit désert, qui, s’il était muni de chaises en guise de palmiers, manquait absolument de sources nombreuses et variées à l’usage des voyageurs perdus en ces parages assoiffants.
Tous les trois, – les trois poètes ! ! – nous descendîmes, et, dans le plus prochain café, nous allâmes disserter sur les destinées de la poésie moderne.
Edmond Nodaret était un chétif employé dans mon genre ; seulement il pointait dans les contributions directes. Adelphe Froger, mineur encore, devait, à sa majorité, toucher une assez belle somme : – ô joie ! – il la devait consacrer à la littérature… et jeter dans la poésie – ô gouffre – la sueur accumulée de ses pères.
C’était un jeune homme épris d’art ; ses vers, qui ne marquaient pas une extrême originalité, valaient autant, mieux que bien d’autres, et un bon juge en pareille matière, Catulle Mendès, ne tarda pas à le lui prouver en partageant avec Froger le titre de rédacteur en chef de la République des Lettres. On fonda – la Renaissance étant morte – une nouvelle revue, sérieuse celle-là et vraiment artistique dont le souvenir n’est point perdu ; car elle abrita l’Assommoir de Zola, exilé de partout alors. Néanmoins elle mourut aussi, après résistance, mais elle mourut.
La vie bohémienne des littérateurs jeunes est pleine de rires, de chansons, sous lesquelles s’entend le Dies iræ profond et le Nunc dimittis d’une foule de journaux mourants. L’histoire des poètes est un nécrologe de feuilles, et Millevoye avait bien raison :
Ou encore, le chansonnier disant :
Mais par Froger, devenu rédacteur en chef, je pus enfin voir de près, ainsi qu’il convient à un myope, et toucher du doigt les poètes, non plus dans la solennité du café Tabourey ou du café Voltaire ; mais dans une minuscule brasserie appelée le Sherry-Cobbler, qui mérite quelques lignes de souvenirs.
Ce Sherry-Cobbler, situé sur le boulevard Saint-Michel – le centre des affaires, ô poésie ! – entre le lycée Saint-Louis et la librairie Derenne, où s’éditait alors la République des Lettres, était présidé par une fort belle blonde, Joséphine, qui, après bien des avatars, a fini par aller fonder une brasserie au Texas. On était servi – servi est une façon de parler, vous verrez pourquoi – par de jeunes et jolies filles, dont plusieurs ont fait leur chemin. Mais ce qui, dès l’abord, distinguait le Sherry-Cobbler de n’importe quelle autre brasserie, c’est qu’il n’y eut jamais là de boisson s’appelant Sherry-Cobbler, ce breuvage américain y étant aussi profondément inconnu que l’homérique ambroisie ; nul des allants ou venants ne peut se vanter d’avoir, à l’aide d’un chalumeau, humecté son gosier de ce nectar spécial, qui servait pourtant d’enseigne au modeste établissement tenu par Joséphine.
Un soir, trois audacieux lycéens – cet âge est sans pitié – trois lycéens, la bouche armée de panatellas énormes, des cigares pareils à des cornes de rhinocéros, entrèrent en ce séjour de lyrisme, et, ô stupeur, demandèrent à la jeune fille qui devait les servir :
– Trois sherry-cobblers !
Trois sherry-cobblers, trois ! Un, c’eût été de l’audace, mais trois ! La blonde préposée, ignorant ce breuvage, crut d’abord à une mauvaise plaisanterie de la part de ces potaches ; puis, sur leur insistance, elle se rabattit vers la caissière, et formula la demande de ces clients sauvages et extravagants.
– Répondez qu’il n’y en a plus, dit la caissière, pour sauver l’honneur du drapeau.
C’est en cet endroit paradoxal que les poètes s’assemblaient, et que je vins moi-même, enfin délivré de ma timidité, m’asseoir à mon tour. Je n’osais pourtant point élever la voix en ce cénacle, j’écoutais, ainsi qu’il sied à un bon néophyte, j’ouïssais les hardis propos, les rudes reparties, les merveilleuses dissertations, qui scintillaient, lorsque Coppée, Mendès, Mérat, Paul Arène, Stéphane Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, Valade, mort depuis, ce poète qui signait Silvius d’adorables chroniques rimées, et dont Monselet a dit :
lorsque tant de poètes parnassiens ou non, baudelairiens ou poësques, se rencontraient avec leurs cadets, Richepin, Bouchor, Bourget, Rollinat, A. Froger, Ponchon, le peintre Tanzi, Michel de l’Hay, Guillaume Livet, l’avocat Adrien Lefort, Alexandre Hepp, qui publiait ses premiers vers, Vautrey, Edmond Deschaumes, frais émoulu du collège.
Ici je cite quelques lignes publiées dans le Voltaire par Guillaume Livet :
« On y (au Sherry) causait beaucoup, on buvait ferme, et on rêvait de l’avenir.