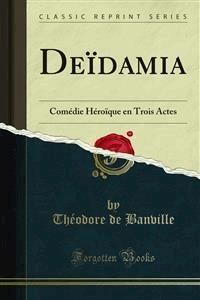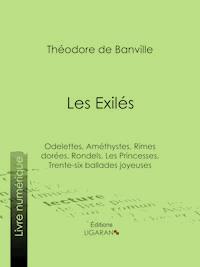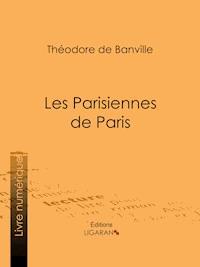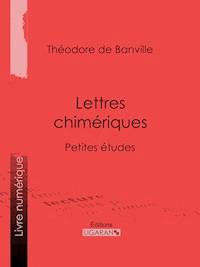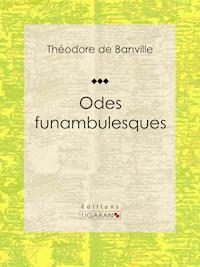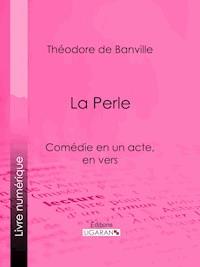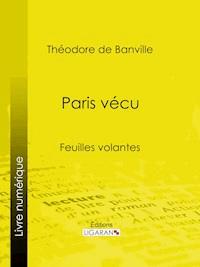
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Vous me demandez l'impossible, mon cher Louis ; eh bien ! j'essayerai de le faire. Car, grâce aux Dieux ! nous autres artistes et poètes, nous avons de tout temps répudié la devise égoïste et lâche, et nous avons adopté celle-ce qui est moins commode, mais plus vaillante : A l'impossible tout le monde est tenu !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
– 1882 –
Vous me demandez l’impossible, mon cher Louis ; eh bien ! j’essayerai de le faire. Car, grâce aux Dieux ! nous autres artistes et poètes, nous avons de tout temps répudié la devise égoïste et lâche, et nous avons adopté celle-ci qui est moins commode, mais plus vaillante : À l’impossible tout le monde est tenu !
Vous êtes un sage, mon ami, et même, à ce que je crois, vous êtes l’unique sage du temps présent. Vous avez commencé par remplir tous vos devoirs, et maintenant vous exercez votre droit, en vous barricadant contre la sottise et contre les importuns, dans une enceinte fortifiée ou peu s’en faut. Né riche et noble ; ce qui n’est ni un vice ni une qualité ; vous avez d’abord servi votre pays et vous avez le visage coupé en deux par une belle balafre. Ensuite, vous avez pendant vingt ans exercé l’art de la médecine, travaillant, luttant, passant les nuits, guérissant vos malades par la science et par la force du désir, courant là où était le danger et vous dévouant dans les épidémies. Vous avez gagné le croup en soignant un enfant, et c’est par miracle que vous n’avez pas succombé à la maladie affreuse dont vous l’avez sauvé. Marié à une femme belle, adorable, charmante, spirituelle, et divinement bonne, vous l’avez aimée du plus profond et du plus fidèle amour, et même après que ses beaux yeux se sont fermés à cette vie terrestre, vous n’avez eu ni une pensée ni un regard pour une autre femme qu’elle.
De la chère absente, vous aviez eu un fils que vous avez élevé avec la tendresse d’un père et d’une mère, et qui promet de se distinguer après vous dans la carrière où vous l’avez précédé. À la Charité, où il fait son internat, Eugène a tout conquis, les malades aussi bien que ses maîtres, par sa fermeté et par sa grâce ; c’est un enfant joli comme une fille, fort comme un lion, et très savant. À propos de lui, ce n’est pas assez de dire, comme Suzanne à propos de Chérubin : « Si celui-là manque de femmes !… » car il ne manquera de rien, et il aura tout ce qu’on peut se procurer avec l’audace, l’obstination, l’esprit et la bravoure.
Cependant, mon cher Louis, vous n’avez pas voulu rester à Paris auprès de ce fils que vous chérissez tendrement, et résolument vous l’avez laissé seul, estimant que pour s’exercer à devenir un homme, un jeune homme doit être seul, maître de lui, responsable, et n’avoir à rendre de comptes qu’à lui-même.
Donc, vous vous êtes réfugié dans votre château antique aux créneaux menaçants et aux tours géantes, dont l’étage qui du côté du village forme le rez-de-chaussée est situé de l’autre côté à cent pieds au-dessus de la vallée ouverte comme un gouffre. Une rivière souvent grossie par les torrents environne presque cette farouche demeure, et au lieu de brins d’herbe, ce sont des arbres chevelus qui ont poussé entre les pierres disjointes. Ce château, où la roche se confond avec le granit, a été jadis assez fort pour soutenir les assauts des Anglais, et vous espérez qu’il le sera encore assez pour vous protéger contre les imbéciles. Vous y vivez, tranchons le mot, en égoïste, lisant Dante, Rabelais, Shakespeare, Balzac, Henri Heine, Edgard Poe, Victor Hugo, La Fontaine, et songeant aux choses éternelles. Vous ne refusez pas vos soins aux pauvres, s’ils les demandent, mais c’est pour eux seuls que vous êtes resté médecin. D’ailleurs vous donnez de l’argent pour les écoles, pour les chemins vicinaux, pour les télégraphes ; vous souscrivez à tout ce qu’on veut ; on peut vous emprunter une charrue, une faucheuse, un sac de blé, un cheval, un bœuf et même ne pas vous les rendre ; mais là s’arrête votre complaisance.
Quant à vouloir vous faire une visite ou vous forcer à entendre des conversations banales et même quelconques, ce serait une folle entreprise, et ceux qui s’étaient bercés d’un tel rêve peuvent laisser toute espérance à votre porte, comme si les trois mots du Dante y avaient été inscrits par un bon peintre, en lettres majuscules. Vous avez près de vous un jeune secrétaire instruit et honnête homme, à qui les gros appointements que vous lui donnez et la jouissance de votre riche bibliothèque permettent de se livrer sans inquiétude à un grand travail historique, dont la complication demande un calme absolu, et qui doit un jour faire sa réputation. Vous ne lui imposez d’autre devoir que celui de lire des journaux et aussi, sans exception (car vous n’avez pas de secrets), toutes les lettres qui vous sont adressées, et d’y répondre s’il y a lieu, sans troubler la paix profonde où vous vivez, en face de la nature, ayant dans les yeux une grande nappe de ciel, et dans l’intimité des génies.
Vous n’allez, mon cher Louis, ni à la chasse ni à la pêche, parce que vous ne voulez assassiner personnellement aucune créature. Les bêtes, par instinct, devinent très bien vos dispositions pacifiques ; aussi les oiseaux, entrant par la fenêtre ouverte, viennent-ils se poser sur le feuillet de votre livre, et quand vous vous promenez à travers les bois, la biche aux yeux bleus vient avec joie manger le pain que vous émiettez pour elle dans le creux de votre main. Libéré de toute fausse étiquette, vous fumez votre cigarette toujours roulée, déroulée et caressée, où et quand cela vous plaît, entre la soupe et le bœuf, si le cœur vous en dit. Pour me résumer en un mot, devant être un exilé toujours pendant les courts instants qui vous restent à passer loin de votre femme éternellement aimée, et ne pouvant être heureux, vous avez voulu être tranquille, et vous l’êtes. Cependant, à ce que vous m’apprenez, mon cher Louis, Paris vous manque un peu, comme il manque à tous les Parisiens qui en sont privés, et vous me demandez de vous le rendre. Sang et tonnerre ! vous n’y allez pas de main morte.
Oh ! je comprends très bien ce que vous voulez ! Vous avez confiance en moi, comme j’ai confiance en vous ; nos deux âmes sont montées à l’unisson, nous avons les mêmes haines et les mêmes adorations, les Bavius et les Mœvius que nous n’aimons pas sont les mêmes, et vous me demandez de vous adresser librement, de cœur à cœur, des lettres écrites sans prétention, qui vous donneront là-bas non pas le tumulte, le bruit, les riens affairés, mais la vraie pensée, le vrai frisson, la vraie extase de Paris.
J’entends bien ! vous n’êtes pas curieux d’évènements, car il ne s’en passe jamais, ni de nouvelles à la main, qui toutes sont copiées dans les livres du dix-huitième siècle, ou construites suivant une formule invariable, qui consiste à trouver un trait, une queue flamboyante et à bâtir au-dessus une historiette chimérique. Non, ce que vous souhaitez de moi, c’est des impressions absolument sincères, exprimées dans un style autant que possible exempt d’ornements inutiles. Cher ami, je vous le répète, j’essayerai de vous obéir ; mais n’auriez-vous pas eu plus court de me demander l’eau qui danse, ou la pomme qui chante, ou un sonnet sans défaut, ou le trou d’aiguille à travers lequel on fait passer la corde à puits ?
Être sincère ! voilà qui est bientôt dit. C’est résolument que beaucoup de gens ne le sont pas ; mais quant à ceux qui veulent bien l’être, que de difficultés ne doivent-ils pas surmonter d’un cœur intrépide ! Être sincère, c’est s’affranchir tout à fait de la convention et du lieu commun ; or, nous les avalons, nous les respirons, ils sont mêlés à chaque goutte de notre sang, à chaque parcelle de notre chair ; nous les emportons collés à notre peau, comme la tunique du centaure. Tout petits, on prend soin de nous les inculquer à grand renfort de mauvais points et de pensums ; plus tard, cette éducation se continue dans les grandes écoles ; le lieu commun est mêlé, amalgamé à nous, et pour s’en débarrasser, il faudrait avoir le courage de vouloir se scalper soi-même et de s’écorcher vif. À quel point les idées apprises sont en possession de notre cerveau ? c’est ce qu’on ne saura jamais, et tenez ! nous avons pu en juger pendant l’affreuse guerre de 1870 !
Des romanciers, des écrivains ont fait partie des bataillons de marche ; ils ont affronté la mort qui vient de loin, invisible ; ils ont vu tomber autour d’eux les rangs entiers fauchés par les boulets des canons rayés, par les obus, par les balles des mitrailleuses ; les cadavres de leurs compagnons qui n’avaient pu combattre en personne, frappés de loin par le fléau, par la force aveugle, et qui maintenant gisaient, les fronts brisés, pâles, perdant leurs entrailles par leurs ventres ouverts,’ils les ont vus de leurs yeux, ivres de douleur et d’une religieuse épouvante. Cependant, au retour, avec la meilleure envie d’être exacts et sincères, que nous ont-ils raconté ? Non pas du tout ce qu’ils avaient vu en effet, et qui était essentiellement neuf, mais la guerre d’après les poètes latins et grecs, la guerre de l’Iliade, tant la leçon apprise nous tient, nous domine et nous marque à son gré, comme un lion qui poserait sur notre épaule nue sa griffe impérieuse !
Et tout est de même. Un jeune homme aime une femme sincèrement, profondément, avec toutes les âmes de la tendresse et avec toutes les furies du désir. Lorsqu’il la voit, mille idées à la fois naissent dans son esprit, plus nombreuses et pressées que les feuilles fouaillées par le vent dans la forêt. Cependant il arrive enfin qu’il peut lui parler : que va-t-il lui dire ? Vous croyez que c’est toutes ces choses qu’il a senties et pensées ; détrompez-vous bien vite ! Ce qu’il lui dira, c’est ce qu’il a appris tout petit et qui lui est resté dans la mémoire, les réminiscences des romans, la scène de Roméo et Juliette !
Aux pieds de celle pour qui il meurt et pâlit d’amour, il écoulera sa provision, son bagage littéraire, car les fils de Japet, les figures d’argile modelées par Prométhée et animées avec le feu du ciel, toute la race humaine enfin n’est qu’une nation de perroquets répétant à satiété : As-tu déjeuné, Jacquot ? sans connaître du tout Jacquot et sans désirer aucunement savoir s’il a réellement déjeuné.
Donc, dire à quelqu’un : « Sois sincère ! » l’engager à vous servir ce que le poète Horace appelle si bien : Carmina non prius Audita, n’est-ce pas lui demander la chose impossible, bien plus impossible qu’il ne l’était de redresser le cheveu circulaire et courbe du conte de La Fontaine ! Et à supposer qu’il y réussît, qu’il vous dît des choses véritablement vues et non des leçons, des lieux communs, des banalités apprises, ne l’arrêterait-on pas au premier mot, en lui disant avec ingénuité : « Vous en avez menti ! »
Il n’en sera pas ainsi avec vous, mon cher Louis, qui savez tout, devinez tout, comprenez tout, et pouvez sans effort suppléer les plus formidables ellipses. Mais vous me demandez une autre perfection encore plus introuvable et rare ; vous voulez que je vous écrive avec simplicité et dans un style non encombré d’ornements parasites ! Mais, mon ami, autant vaudrait me conseiller d’avoir la science infuse ! Car, si je savais par cœur tous les mots techniques, tous les termes spéciaux des arts et des sciences, et, en un mot, tous les dictionnaires, il me serait sans doute très facile d’éviter les mots pompeux et vides, et d’appeler les objets par leur nom. Ayant à décrire, par exemple, une selle arabe, Théophile Gautier, qui sait la sellerie comme un sellier, indiquera sa forme précise, dira de quel cuir elle est faite et dans quel ordre sont disposés les clous qui la garnissent ; au contraire, un ignorant se tirera d’affaire en disant que c’est une selle éblouissante et magnifique, et brodera des fleurs sur son tissu lamentable, pour en dissimuler les trous et les taches.
Mais tout cela n’est pas de raisons ! je vous obéirai, je tâcherai de faire table rase dans mon esprit, de voir Paris avec une innocence de bête et avec des yeux d’enfant, et de vous traduire mes impressions assez naïvement pour qu’elles ne vous semblent pas vulgaires au milieu de votre âpre et tranquille solitude. Et quelle époque fut jamais plus belle, plus curieuse, plus inouïe, plus étonnante que la nôtre, et plus digne d’être chantée et décrite, si on en avait la force !
L’homme moderne a vu tomber à ses pieds les débris croulants de ses Dieux ; il a perdu tour à tour l’idéal religieux, l’idéal guerrier, l’idéal sacré de l’Amour ; il semblerait que, privé des cieux interdits, il dût se résigner à la joie inerte, à la stupide jouissance, à l’avilissant baiser de la matière ; mais non ! il ne cède pas, il n’y consent pas ; à l’engourdissement qui le menace, il oppose la persistance de son désir vivace, il attend l’idéal nouveau, le libérateur qui doit venir, et il sent la divinité encore inviolée et protégée dans l’inexpugnable forteresse de sa conscience. Anxieux, prêtant l’oreille, il interroge la Science qui bégaye encore, mais qui déjà devine, soupçonne, entrevoit des lois, des formules, des mondes inconnus, et qui au bout de ses lentes expériences, trouvera la Vérité, comme le voyageur, au bout d’un passage souterrain plein de nuit, voit tout à coup éclater le jour, et resplendir le rassurant éblouissement de la pure lumière.
L’Homme ne sait pas où il va, mais il y va ; il comprend bien que le moment où nous sommes n’est qu’un tableau pour attendre, que le décor va changer et que nous arriverons enfin à une scène qui aura le sens commun. Parler politique dans une langue à faire danser les ours, promettre la lune à des gens qui n’ont pas de chemise, s’inquiéter de mille balivernes et pas du tout du prix que coûte la viande, se gorger d’une littérature qui a inventé le paysage après Bernardin de Saint-Pierre, le détail patient après Balzac, et l’âme humaine après Shakespeare, entendre des vaudevilles longs comme un jour sans pain, et des opéras ivres-morts qui se chatouillent pour se faire rire, et effleurer des cigares humides et spongieux avec des allumettes incombustibles, si en effet telle était, et devait rester la vie, ce serait à donner sa langue aux chiens ; mais l’Homme ne croit pas que c’est arrivé ; il ne croit pas que cela soit sérieux, et avec son impeccable instinct, la Femme le croit moins encore. La Femme ! elle se fait belle comme elle ne le fut jamais ; elle invente des coiffures seyantes, des chapeaux chiffonnés avec génie, des robes longues, étroites, serrées, drapées, triomphales, auxquelles se mêlent amoureusement les ors, les rubans et les dentelles, et enfin elle se costume, en grande artiste qu’elle est, pour être prête à entrer en scène quand viendra la vraie comédie, la bonne, car pour celle qui se joue à présent, elle se rend très bien compte que c’est une chimérique bouffonnerie et une farce lugubre.
Petite fille, elle est malmenée par un père ivrogne, et s’élève en mangeant des écailles de hareng et des pelures de pommes, heureuse si elle n’est pas violée ou coupée en morceaux par un pâle jeune homme qui a lu des romans-feuilletons ! Jeune fille, elle est séduite par un aimable commis, qui lui promet le mariage, puis épouse une vieille dame, et naïvement s’étonne quand la fille abandonnée avec son enfant lui jette au visage du vitriol, qui serait mieux employé à nettoyer des cuivres ! Comédienne, on lui impose l’obligation d’acheter des robes de Worth avec les trois mille francs de ses appointements ; femme honnête, elle se voit abandonnée par un mari qui mange sa dot avec des filles plâtrées dont le visage est une croûte ; grande dame, elle reste seule à tricoter des bas pour les petits indigents, si elle ne veut pas suivre ses convives dans le fumoir et apprendre à parler l’argot des romans au picrate, qui brûlera ses lèvres comme un fer rouge.
Oui, tout cela va se transformer, inévitablement, et voilà pourquoi le Paris de notre époque est amusant comme une larve en train de devenir papillon, ou comme un serpent qui change de peau. Je vous écrirai tout ce que j’aurai vu, mon cher Louis, et je tâcherai de vous peindre les évènements dans leur esprit, dans leur signification absolue et non dans leur réalité accidentelle. Car est-ce la peine de noircir du papier pour dire qu’un caissier s’est enfui vers la Belgique en emportant deux millions, ou qu’une actrice des Bouffes-Parisiens a épousé un duc ? C’est comme si un pêcheur à la ligne s’enorgueillissait d’avoir captivé un goujon dans la rivière.
Les Femmes s’ennuient, mon cher Louis, parce qu’il n’y a plus personne pour les amuser. Et comment les hommes songeraient-ils à remplir cette tâche délicate, lorsqu’ils ne savent plus s’amuser eux-mêmes ? Ils sont la proie d’un certain NIHILISME, qui consiste à ne rien faire du tout, à rester indifférents et corrects au milieu de l’orgie comme dans les bureaux de la Chambre, et à manger les écrevisses à la bordelaise du même air que s’ils subissaient avec stoïcisme une opération chirurgicale. Cependant les Femmes restent pour compte, n’ayant d’autre passe-temps que de vérifier et collationner leurs robes réciproques, trop belles et parfaites pour prêter à la critique ; car du moins sur ce point notre époque est irréprochable, et pour posséder une indiscutable certitude, elle a dû s’accrocher à cette dernière religion. Où qu’on aille, depuis les salons historiques du faubourg Saint-Germain jusqu’à ceux de la confortable et modeste bourgeoisie, on ne trouve plus qu’un seul homme, toujours le même, qui consente à causer avec les Femmes et à s’occuper d’elles ; c’est Louis Leroy, l’ami de Gavarni, qui a été d’abord peintre et aquafortiste et qui plus tard est devenu auteur dramatique et journaliste infiniment spirituel. Non pas qu’il soit vieux ! il ne le sera jamais et ne consentirait pas à l’être, mais il date d’un temps où on baisait encore les mains ; et où on pouvait sans ridicule employer son esprit à divertir une dame.
L’excentricité est la ressource des gens qui manquent du nécessaire, et les cuisiniers nous font manger force Cayenne, faute de savoir faire les sauces. En vertu de ce principe, quelques ennuyées ont bien tenté de se plonger dans le gouffre de l’absurde ; mais où trouver l’absurde, à un moment où tout est devenu effroyablement raisonnable ? Au siècle dernier, quand la femme d’un duc et pair, énervé et pâli par les veilles dans les petites maisons, imaginait de prendre son laquais pour amant, elle trouvait entre ces deux hommes une antithèse nette et définie ; aujourd’hui il peut lui arriver d’avoir quitté bonnet blanc pour blanc bonnet, et c’est une désillusion de ce genre qu’a éprouvée la comtesse de Frèze, lorsqu’en vraie dame romaine du temps des empereurs elle a entamé avec son cocher Eusèbe une églogue à deux personnages. C’étaient les mêmes façons que celles de son mari, la même élégance anglaise, les mêmes faux-cols ondoyants et cassés, la même odeur d’écurie, les mêmes plaisanteries relevées d’argot édulcoré à l’usage des salons, et à la manière dont Eusèbe faisait sa cour, aux mots familiers qui revenaient le plus souvent dans sa conversation, la pauvre comtesse vit bien que monsieur de Frèze et le cocher devaient avoir eu les mêmes femmes.
Franchement, c’était à avaler sa langue ; car est-ce la peine d’outrager la nature et les Dieux, pour ne trouver absolument rien d’imprévu et de bizarre ? La pauvre dame avait hâte d’échapper à une situation ridicule et qui n’était pas justifiée. Elle s’empressa de congédier le malencontreux Arlequin devenu Dorante, et, ne voulant pas s’être ennuyée pour rien, elle s’arrangea de façon à lui faire tenir une somme d’argent assez ronde et avenante, dont il ignora toujours la provenance. Eusèbe Menneron, qui est un homme pratique, ne perdit pas son temps à des bagatelles ; il devint monsieur Menneron, entra dans la finance, et, unissant l’audace à l’esprit d’ordre, réalisa promptement de gros bénéfices. Il est devenu un personnage ; il est membre des conseils d’administration, prononce des discours autour des tapis verts, et la comtesse de Frèze le rencontre dans son monde. Dernièrement, il protégeait Marguerite Los des Bouffes-Parisiens, avec une prodigalité de bon goût tempérée par la plus sage économie ; son ancien maître, monsieur de Frèze, lui a enlevé cette folle maîtresse, de sorte que les voilà maintenant sur un pied d’égalité parfaite. Vous voyez si la comtesse avait bien perdu ses peines en prétendant échapper à la platitude entêtée de la vie réelle.
Plus à plaindre encore la belle marquise Emma de Saludes ! Celle-là a eu vraiment trop peu de chance, et son mari abuse du droit que nous possédons tous de n’avoir pas le sens commun. Par un caprice dont elle n’a pas à rendre compte, la nature s’est plu à modeler les traits du marquis de Saludes de telle façon qu’il ressemble presque exactement au chanteur Capoul. Il aurait pu négliger cette circonstance, n’y pas faire attention et vivre comme si de rien n’était. Mais, au contraire, ce méchant homme se coiffe, peigne sa moustache et s’habille exactement comme le célèbre ténor. Il a pris son tailleur, il tâche de se faire présenter aux femmes qui l’ont connu, et enfin il ne néglige rien pour être fidèlement son insupportable Sosie. Il porte le même petit bouquet, à sa boutonnière, et bien qu’il n’ait aucune voix et que son éducation musicale ait été extrêmement bornée, par une idée satanique il s’est appris à singer le chant de Capoul, avec une minutieuse inexactitude, qui sans produire aucune illusion suffit à exciter le plus vif agacement. Ainsi la marquise se trouve mariée à un faux Capoul, à un chanteur honoraire, à un ténor qui ne l’est pas, à un comédien travesti, qui n’a pas même le mérite de pouvoir se donner pour un grand ni pour un petit artiste. N’y avait-il pas de quoi se jeter à l’eau, avec une pierre au cou, la tête la première ? Madame de Saludes a voulu faire pis et prendre un parti encore plus décisif et abominable.
Sachez que, par suite d’une aventure qui se reproduit trop fréquemment pour mériter d’être racontée une fois de plus, cette marquise mal mariée connaît la fameuse courtisane Aurélia de Broy. Une parure que monsieur de Saludes destinait à sa femme avait été, par une erreur du marchand, portée chez sa maîtresse. Un quiproquo s’ensuivit ; après s’être vues et expliquées, les deux femmes ne redevinrent pas des étrangères l’une pour l’autre, et à l’insu du monde qui devait l’ignorer toujours, à de très longs intervalles elles se rencontraient furtivement pour quelques minutes, et échangeaient des confidences et des conseils qui leur étaient d’une grande utilité : car à elles deux, elles savaient tout ! Donc, il y a quelques mois de cela, voyant que son mari s’obstinait à être plus Capoul que jamais et mourrait impénitent dans sa peau de faux Capoul, la marquise de Saludes, après s’être assurée qu’elle n’y rencontrerait personne, se rendit chez Aurélia et l’avertit de la résolution qu’elle avait prise de se faire COCOTTE ! La courtisane combattit ce projet stupide avec l’énergie d’une conviction fondée, ah ! sur quelle expérience ! et pour édifier la marquise Emma sur la profession qu’elle voulait embrasser, lui en fit une description exacte et naturaliste qui, s’il l’avait entendue, aurait blanchi les cheveux d’Émile Zola en cinq minutes.
Et comme elle le dit en terminant, Aurélia, elle, trouvait cette vie de rouges, de fards, d’écrevisses pimentées et de chemises transparentes si effroyablement hideuse, qu’elle se décidait à se marier. Elle avait accepté les offres de Ragnier, l’épicier millionnaire, qui connaissait par le menu son passé et son présent, et la prenait telle quelle, avec une crânerie d’autant plus méritoire qu’il avait toutes les chances possibles d’arriver à la députation.
Cependant, comme madame de Saludes ne voulait entendre à rien, Aurélia épouvantée la supplia de ne pas perdre sa vie et son âme sans avoir fait auparavant une expérience concluante, ce à quoi la dame consentit, comme vous allez le voir. Comme toutes ses pareilles, la savante de Broy a pendant quelques années joué la comédie, et comme à ce moment-là elle était déjà fort riche, elle a gardé de son passage au théâtre une collection d’admirables perruques, faites non avec du crin, de l’étoupe, de la soie, et autres chiffons dissimulés par des pommades et des poudres, mais avec de longs, fins, soyeux, précieux cheveux de femme, et qui représentent une somme énorme. Déguisée ; grimée, coiffée de cheveux blonds, si bien muée, changée et travestie que sa mère ne l’aurait pas reconnue au soleil de midi, madame de Saludes a passé toute une journée chez Aurélia, et là, sans être courtisane, elle a vu au naturel ce qu’est la vie des courtisanes, de même que, sans être mort, le Poète a pu voir jadis les chemins, les murailles, les forteresses et les lacs glacés des sombres Enfers !
– « Je ne serai jamais cocotte ! » s’écria la marquise, lorsque la toile se fut baissée sur la comédie aux cent actes divers, et lorsqu’on eut congédié le dernier gommeux qui, après avoir été trop poli en entrant, avait fini par mettre ses bottes sur les divans de soie blanche.
Mais guérie par la courtisane, madame de Saludes n’a pas voulu être en reste avec elle, et elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. À son tour parfaitement grimée, son front d’or caché sous une délicieuse perruque noire, idéalement bien déguisée en présidente, Aurélia de Broy, devenue pour la circonstance une parente de province, a passé une soirée chez la marquise, rue de Lille. Elle a joué son rôle à ravir, ne parlant que successions et héritages, et enfilant les cancans de petite ville, comme un tas de perles ! Elle a retrouvé chez la grande dame les mêmes hommes qu’elle reçoit chez elle ; mais après avoir vu tant de fois comme ils sont lorsqu’ils ne se gênent pas, elle a pu voir comme ils sont lorsqu’ils se gênent ; elle les a trouvés encore plus hideux et niais dans ce nouvel avatar, et c’est avec un dégoût profondément sincère qu’elle s’est écriée à son tour : « Foin du mariage ! »
Madame de Saludes s’est résignée, comme on se suicide, et elle ne sourcille plus désormais, lorsqu’elle entend son mari, coiffé en lyre, chanter au piano : Par quel charme, dis-moi, m’as-tu donc enchanté ! La seule ressource qui lui reste, c’est d’aller voir sa sœur Isabelle, mariée au député Antony Hévro. Chez cet intransigeant mâtiné d’opportunisme, on cause commissions, interpellations, groupes, sous-groupes, et il n’y a pas là de quoi chanter : « Voilà le plaisir, mesdames ! » Dans ce milieu lugubre, madame Hévro, qui sait causer, a essayé d’introduire un peu de joie en invitant des hommes d’esprit, mais ceux-là regardent toujours la porte en gens qui ont envie de fumer, et même parfois tourmentent visiblement dans leur poche la bourse à tabac en cuir de Russie. En principe, monsieur Hévro est beaucoup trop démocrate pour permettre qu’on fume chez lui. Cependant sa femme a eu une idée ingénieuse, qu’elle a su lui faire adopter.
Sur un guéridon est placée une bourse que le maire de l’arrondissement emporte à la fin de chaque soirée, et voici comment elle s’emplit. Celui des convives qui a trop envie de fumer y met un louis et fume une cigarette ; mais le prix de cette petite débauche augmente ensuite par une progression mathématique ; pour le même invité, la seconde cigarette coûte deux louis, la troisième quatre, la quatrième seize, et ainsi de suite. Cette combinaison était bonne ; ce qui a découragé la jeune femme, c’est que le maire a trouvé dans la bourse, en guise de louis, quelques-uns de ces jetons de jeu qu’on vend chez les papetiers, et qui imitent grossièrement les pièces d’or.
Elle a dû renoncer à la fumerie, et par conséquent, aux hommes d’esprit, et à présent son salon ressemble à un couloir de la Chambre, comme une goutte d’eau à une autre goutte d’eau.
Que devenir ? De rage, madame de Saludes et madame Hévro ont entrepris une série de tapisseries représentant les exploits d’Amadis et ses amours avec la belle Oriane, dont Mazerolle a exécuté les dessins exprès pour elles, et qui doivent leur prendre quinze ans, à dix heures par jour. Mais, hélas ! elles se sont aperçues qu’on leur a vendu rue Saint-Martin, aux magasins de la Chèvre Amalthée, des laines inférieures et mal teintes, suprême déconvenue ! Cela prouve, mon ami, qu’il faut toujours plaindre les Femmes, et que tout n’est pas rose dans la vie de ces êtres couleur de rose.
Hier, mon cher Louis, comme je revenais à pied d’une soirée, éprouvant un vif besoin de respirer un peu d’air, relativement délicieux et pur, je vis une fillette coiffée en chien fou, les cheveux dans les yeux, qui causait sous un bec de gaz avec un beau jeune homme. Ce Parisien n’était pas coiffé d’une casquette à pont, uniquement parce que la mode en est abolie, sans quoi il aurait eu d’incontestables droits à cet ornement symbolique. Très crâne sous son petit chapeau melon, il était vêtu en parfait cavalier, si ce n’est que son col était trop cassé, que son veston ouvrait un peu par derrière, que son gilet manquait de boutons et que ses souliers éculés paraissaient anxieux et las d’user le bitume. D’ailleurs, quoique parlant sans gestes et d’une voix calme, ce Lauzun du trottoir était en proie à une exaspération évidente, et la fille, dont je voyais briller les dents blanches, tâchait de le calmer par de bonnes raisons.
– « Voyons, monsieur Alexandre, lui disait-elle, ne vous faites pas de mal pour si peu de chose, vous savez bien que tout le monde vous respecte !
– Il n’y a pas de tout ça, murmurait monsieur Alexandre, en tâchant de ranimer son cigare exténué, je dis, moi, que si Euphrasie ne me donne pas les quarante francs, je suis déshonoré. »
Bien entendu, il s’était servi d’un vocable plus énergique et précis que le mot DONNE ; mais j’évite à dessein les mots éhontés qui font des trous dans la solide étoffe du style. En entendant la singulière exclamation de monsieur Alexandre, je m’étais mis à rire tout seul dans la sombre nuit, et j’avais d’abord pensé que ce gentleman plaçait drôlement son honneur. Mais un peu de réflexion me fit voir que j’avais eu tort de rire et que le créancier d’Euphrasie agissait précisément comme vous et moi, et comme tous les mortels. Il vit sans doute dans un monde spécial, où il serait en effet déshonoré si Euphrasie ne lui donnait pas les quarante francs, et l’opinion de son monde est la seule qui lui importe. Un axiome de droit disait jadis que nul ne peut être jugé que par ses pairs ; cet axiome juridique est devenu aujourd’hui une maxime sociale, et chacun en fait l’unique règle de sa conduite, excepté dans les sociétés qui vivent pour un idéal supérieur et extrahumain. Or, ce cas n’est pas le nôtre, et le temps est bien passé où des ouvriers fidèles sculptaient délicatement pour l’amour de Dieu et pour l’amour de la perfection, des dessous d’escalier, destinés à n’être jamais vus de personne !
Chaque groupe, chaque petite province parisienne, chaque profession a son honneur particulier, qui ne ressemble en rien à l’idée générale et absolue que représente le mot : HONNEUR, pris dans son acception réelle. Pour les députés, l’honneur consiste à s’écrier d’une voix tonitruante : « Dans cette enceinte », chaque fois qu’ils parlent de la salle où ils tiennent leurs séances, et nous, au contraire, nous nous regarderions comme parfaitement déshonorés, s’il nous arrivait d’employer de tels mots impropres. Un cabaretier s’honore aux yeux des autres cabaretiers, lorsqu’il sert à ses convives un chat déguisé en gibelotte de lapin, et les jeunes comédiennes instruites au Conservatoire mettent leur honneur à prononcer : mon amont et mon onfont, au lieu de : mon amant et mon enfant. Pour tout le monde, cette prononciation est absurde et grotesque ; néanmoins, les jeunes comédiennes la conservent avec soin, parce que si elles la changeaient, elles seraient méprisées de leurs compagnes, et, pour parler comme le grand-prêtre Joad, elles n’ont pas d’autre crainte !
Le vieux Brusa, qui était un épicier de l’ancien jeu, a marié sa fille avec un million de dot, au jeune Paul Hidrio. Bien que follement riche, Paul, selon la mode anglaise, continue le commerce ; c’est un épicier qui fait courir, qui se promène à cheval au Bois avec sa femme, et qui passe ses soirées au cercle, ou sur la scène de l’Opéra, ou dans les coulisses des Bouffes. Il prête de l’argent à ses amis, comme Timon d’Athènes, se fait faire des couvre-lits avec les plus belles robes japonaises, et lorsqu’il achète les comédies de Molière dans les éditions originales, veut des marges de huit centimètres ! Madame Hidrio a ses lundis, où elle reçoit des femmes à la mode, et même des grandes dames, dont une duchesse pauvre. Cependant le vieux Brusa surveille le commerce de son gendre, et de temps en temps, pour se retremper dans l’air de la boutique, vient feuilleter les livres, examiner les comptes, vérifier la caisse. Un matin, en voyant figurer sur le livre d’achat l’article Poivre, il poussa une exclamation indignée, et fronça rageusement ses sourcils gris, emmêlés comme des broussailles.
– « Qu’est cela ? demanda-t-il à son gendre, en feignant ironiquement d’avoir mal lu.
– Cela, dit Paul Hidrio, c’est Poivre.
– Est-ce qu’on achète du poivre ! s’écria le vieux millionnaire. De mon temps, on achetait du poivre une fois pour toutes, en fondant un commerce ; ensuite et toujours, on le continuait avec ceci et cela, avec n’importe quoi, avec ce qui se trouve, avec les balayures, avec les raclures des tiroirs !
– Ah, beau-père, fit doucement le jeune homme, regardez le prix de revient et le prix de vente ! Vous pouvez voir que pour tous les objets la même proportion existe, et que je gagne cinq cents pour cent sur le poivre. Pourquoi m’amuserais-je à le remplacer par des épluchures ?
– Pourquoi ? dit le vieillard en redressant sa large tête, puissante et chevelue. Pourquoi ? Mais, monsieur, POUR L’HONNEUR ! »
C’est ainsi que, selon qu’on appartient à tel ou tel petit monde, l’Honneur s’affuble de travestissements variés, et, comme le dieu Protée, se transforme et se mue en cent figures diverses. Les filles de joie et de douleur qui, fardées et pensives, et souriant à rien du tout, arpentent silencieusement le boulevard, ne sont nullement humiliées de montrer des lèvres plus banales que le seuil d’un palais, et de remplacer sur leurs joues par un cosmétique grossier l’héroïque pourpre du sang, et de vendre ce qui ne doit pas être vendu ; mais, oh ! comme elles se trouveraient déshonorées, si une de leurs pareilles (car elles se moquent bien du public !) les rencontrait avec une robe fanée, achetée chez la revendeuse, ou avec un chapeau mal chiffonné, orné de plumes indigentes ! Comme l’expérience le prouve, quand les peintres s’amusent à jouer la comédie dans leurs ateliers, des loques, des oripeaux, des paillons, des verroteries disposées avec art, composent des costumes dont l’effet est infiniment plus beau que s’ils étaient réels. Pourquoi donc les actrices font-elles un métier plus dur que celui des casseurs de cailloux, pour pouvoir acheter de vraies étoffes, de vrais diamants qui, vus de la salle, brillent d’un éclat médiocre ? Uniquement parce que ces richesses, admirées et enviées de tout près, disent à la femme rivale : « Je suis plus riche que toi, donc plus aimée, donc plus belle ! » Si mademoiselle Mars mit sur ses cheveux une teinture à base de plomb, qui la fit mourir empoisonnée, c’était pour cacher aux autres comédiennes que le Temps jetait déjà un peu de neige sur son front charmant. Elle s’est tuée PAR HONNEUR.
Un de mes amis avait ramené de Bretagne une petite servante dévouée, laborieuse, propre, fidèle, d’une probité absolue, et qui savait faire la cuisine ! Ses maîtres jouissaient d’un bonheur généralement inconnu des Parisiens ; mais, ne voulant pas voler, cette pauvre fille, malmenée par les cordons-bleus de la vieille garde, fut à la fin dénoncée, accusée d’infanticide, bien qu’elle fût, comme dit Musset, Vierge du cœur à l’âme, et de la tête aux pieds, et, bien entendu, renvoyée par le juge d’instruction qui trouva en elle une Agnès, elle s’en retourna dans sa Bretagne, les cils usés et brûlés par les pleurs. Mais auparavant, comme elle fut tourmentée, houspillée, assassinée à coups de langue par les commères indignées !
– « Oui, disait un jour en parlant d’elle, chez la fruitière, la célèbre madame Marguerite, cuisinière du docteur Tyrone, qui fait la pluie et le beau temps et mène tout le marché Saint-Germain à la baguette, cette Bretonne est une pas grand-chose et une rien du tout ! Il faut croire qu’elle sait où est le cadavre, car, au lieu de faire voir le tour à ses maîtres, elle marchande pour ménager leur bourse, et ne demande même pas le sou pour livre !
– Et, ajouta madame Adèle, en plissant avec mépris sa lèvre où serpente une noire moustache, avec ça pas un amoureux ! La bonne pièce garde ça pour le serin qui l’épousera. C’est une fille qui n’a pas pour deux sous d’HONNEUR. »
Car parmi certaines peuplades conquérantes de cuisinières, l’honneur, c’est de faire danser l’anse du panier comme si elle avait la danse de Saint-Guy, et de rôtir les balais infiniment mieux que les gigots ! Mais croyez-vous qu’on en ait une meilleure notion dans des sphères infiniment supérieures à celle-là ? Le géomètre Campa et le chimiste Gorius, deux amis intimes, sont des savants sérieux, travailleurs, modestes, exempts de toute affectation. Chez le ministre et aux bals officiels, l’un et l’autre n’a jamais montré à sa boutonnière autre chose que la rosette de la Légion d’honneur, et il est difficile de savoir qu’ils sont bardés de cordons, de plaques, d’étoiles, chamarrés de presque tous les ordres de l’univers. Cependant, en dehors des profondes voluptés que leur donne la Science, ils n’ont pas d’autre préoccupation que d’allonger leur brochette, Campa pour désoler Gorius, et Gorius pour faire enrager Campa. Cette brochette, ils ne s’en parent en tout et pour tout que pour aller dîner l’un chez l’autre ; mais quelle joie pour chacun de ces vieux compagnons, qui sont alors brouillés pendant huit jours, lorsqu’il arbore une croix nouvelle, à laquelle l’autre ne s’attendait pas ! Ils luttent et ripostent avec les Tours, les Éléphants, les Soleils, les Roses, les Épées, tout cela à huis clos, au quatrième étage, dans le haut de la rue Monge, espérant toujours triompher dans ce duel qui ne finit jamais, et c’est là qu’ils mettent leur HONNEUR.
En même temps, madame Rose Campa et madame Stéphanie Gorius, étroitement liées et encore plus inséparables que leurs maris, se sont adjoint une amie commune, madame Léonie Malo, afin d’avoir quelqu’un à qui elles puissent dire du mal l’une de l’autre, et, de plus, elles ont contracté l’habitude invétérée de se voler leurs amoureux. En général, comme elles les choisissent bien, la pénitence est douce. Mais dernièrement, sans doute pour embarrasser son amie Rose, Stéphanie a jeté son dévolu sur un avocat sans cause et sans effets, un certain Lorieul, qui possède et réunit dans sa personne tout ce qu’il faut pour ne pas réussir à plaire. Madame Campa ne s’est pas laissé étonner par une telle embûche ; elle a raflé ce robin comme les autres, et son amie Léonie Malo n’a pu s’empêcher de lui en faire des reproches.
– « Ah ! lui a-t-elle dit, comment avez-vous pu prendre à Stéphanie ce petit avocat vieux, chauve, marqué de la petite vérole, entièrement dénué d’esprit, et qui par-dessus le marché se ronge les ongles ! À votre place, je l’aurais joliment laissé pour compte à madame Gorius ! »
À ces mots, la jolie Rose, avec une moue enfantine, regarda sa confidente entre les deux yeux, comme si elle eût émis quelque proposition absurde.
– « Eh bien ! ET L’HONNEUR ! » dit-elle, en montrant ses petites dents de loup qui, bien supérieures à celles de notre mère Ève, mordraient, s’il le fallait, dans des pommes en pierre dure, comme en vendent les marbriers italiens.
Si vous le voulez, mon cher Louis, nous parlerons un peu de l’Académie. Pardonnez-moi un tel excès d’orgueil et de bravoure : j’aime à traiter les sujets à ce point hérissés de niaiseries, de lieux communs et de phrases toutes faites qu’il y faut entrer la hache à la main, comme dans une forêt déserte ! En dépit de la tradition, qui continue à leur donner une certaine raison d’être, les plaisanteries contre l’Académie sont tombées dans le dernier avilissement, aussi bas, si c’est possible, que les plaisanteries contre la Tragédie et contre les belles-mères, et si elles font encore sourire quelque vague percepteur ou quelque dame en chapeau jonquille, c’est dans les bourgades lointaines où n’ont pas encore pénétré les chemins de fer. Jetons donc au rebut ces détestables friperies et tâchons d’être plus hardi et plus neuf !
Il n’y a plus de bêtises à écrire contre l’Académie, parce que toutes ont été écrites. Entre autres billevesées, on conteste à l’illustre compagnie le droit de se gouverner comme elle veut et de faire ce qui lui plaît. On dit, par exemple : « L’Académie n’a pas le droit de repousser tel ou tel homme de talent. » Rien de plus absurde. Une compagnie, comme une personne, peut et doit agir à sa guise et elle jouit d’une liberté que rien ne limite. Mais, comme une personne encore, elle conserve ou perd plus ou moins de sa responsabilité, selon qu’elle use de sa liberté d’une manière plus ou moins conforme, au bon sens ou à la justice. Nul ne peut empêcher un citoyen majeur d’obéir à son seul caprice et de se livrer aux actions les plus illogiques.
Il peut, si cela lui plaît, abandonner les amis les plus honorables pour vivre avec les paillasses de la foire, ou vendre ses éditions des bons poètes et mettre à leur place des romans pour les cuisinières, ou faire démolir à grands frais sa belle maison pour en construire une qui soit laide et incommode, ou même réaliser en or toute sa fortune et la jeter pièce à pièce dans la rivière en s’amusant à regarder l’eau couler. La seule chose qu’il risque à ce jeu, c’est d’être traité comme une femme, comme un enfant, comme un être irresponsable. Car, assemblée ou individu, nul ne peut être pris au sérieux que dans la mesure où il a désiré l’être.
Si nous nous plaçons à ce point de vue, il est certain que l’Académie SEMBLE avoir agi depuis assez longtemps comme une personne qui veut être irresponsable, et avec la toute-puissante fantaisie d’une femme qui saccage un verger et déchire les fruits verts, ou d’un enfant qui mange tous ses bonbons en une fois et casse son Polichinelle, uniquement parce que tel est son bon plaisir. Mais ce n’est là qu’une apparence et j’expliquerai tout à l’heure le mot SEMBLE. Si l’on considère, non la liste des immortels que l’Académie a cru devoir sacrer, mais seulement la liste des mortels qu’elle a jugés indignes d’être immortels, la docte assemblée paraît en effet avoir agi avec peu de discernement, surtout si l’on examine de sens rassis les motifs qu’elle donne pour justifier ses exclusions. Le dix-neuvième siècle voit un Molière nouveau, non inférieur au premier, le grand Balzac, dont La Comédie Humaine restera un monument impérissable. L’Académie le repousse sous prétexte qu’il a des dettes, et ne veut pas voir que, par une lutte héroïque, cet honnête homme paye ses dettes de marchand avec son labeur d’écrivain, donnant ainsi un exemple de probité aussi beau que rare. Ce dramaturge puissant, en qui revit l’âme d’un Schiller, ce conteur égal à ceux des Mille et une Nuits, ce consolateur qui a enchanté et charmé trois générations, Alexandre Dumas n’est pas nommé, parce qu’il a des collaborateurs ; ainsi les quarante s’effrayent d’une paille, et ne voient pas dans leurs prunelles l’énorme poutre qui se nomme : monsieur Scribe !
Le grand, l’impeccable poète Théophile Gautier, écrivain parfait dans tous les genres, perfectionne, embellit, assouplit la langue, et, comme jadis Rabelais, l’enrichit de tournures, d’expressions, de mille mots nouveaux ; il est vrai que l’Académie ne le nomme pas ; mais du moins contre celui-là l’Académie pouvait invoquer un grief sérieux. Il est certain que le poète d’Albertus et de La Comédie de la Mort avait été doué d’une noire, épaisse, abondante, soyeuse et ruisselante chevelure, dont le voisinage eût été inconvenant auprès des crânes chauves et des mèches indigentes ; mais cette infirmité méritait peut-être quelque indulgence ? Après tout, ce n’était pas la faute de Théophile Gautier s’il avait des cheveux qui tenaient solidement, et il ne pouvait pas faire venir à ses frais des Ioways ou des Peaux-Rouges qui l’auraient scalpé, pour le rendre digne de s’asseoir dans le Palais Mazarin.
Baudelaire, ce poète sensitif, délicat, intense, affranchit la poésie moderne du lieu commun et de la rhétorique ; il ose être sincère, il puise son inspiration au plus profond de l’âme humaine, il fait tressaillir nos fibres les plus secrètes, et nous donne ses Fleurs du Mal, qui, après l’œuvre de Hugo, resteront au premier rang parmi les chefs-d’œuvre lyriques. Un autre poète, Leconte de Lisle, a dans ses fortes mains ressaisi la lyre épique ; il est grand parmi les plus grands, l’Europe entière acclame sa gloire et nous l’envie, et ses poèmes sont comme de purs diamants solides et éclatants de lumière, dont pas une tâche ne déshonore la divine pureté. Cependant l’Académie repousse l’auteur des Poèmes barbares parce que sa candidature a été trop chaudement patronnée par Victor Hugo ; et pourtant, soyez justes, elle ne pouvait pas l’être par un vaudevilliste ! Quant à Baudelaire, lorsqu’il se présenta, les Académiciens furent pris d’un rire inextinguible, comme les Dieux dans la salle du festin pavée d’or. Ce rire, l’auteur de Madame Bovary et de Salammbô put l’entendre d’assez loin pour rester chez lui et se tenir tranquille ; d’ailleurs l’Académie adressait à lui et à Baudelaire le même reproche, celui de n’avoir pas écrit des ouvrages moraux à la manière de La Morale en action, et ayant une utilité morale immédiate.
Certes, mon cher Louis, si, comme le dit monsieur de Pourceaugnac, les Limosins ne sont pas des sots, monsieur Oronte a raison de lui répondre que les Parisiens ne sont pas des bêtes. L’Académie sait très bien que la morale est une science particulière qui n’a nul besoin des fictions de la poésie, et que l’art n’a d’autre objet que l’expression du beau. Elle ne croit pas du tout que ce soit un crime d’avoir des dettes et de les payer, ou de faire de longs et attachants récits comme Les Mousquetaires, ou d’avoir le front ombragé d’une belle chevelure. Si elle n’avait pas eu d’autres raisons de repousser Balzac, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Baudelaire, Flaubert, Leconte de Lisle, elle les aurait accueillis certainement. Mais (c’est ici que j’explique le mot SEMBLE) si elle semble, en dédaignant ces hommes illustres, n’avoir suivi d’autre règle que son caprice, en réalité elle a agi avec une logique irréprochable, elle a obéi au plus puissant de tous les mobiles qui est l’instinct de la conservation ; elle a résisté, uniquement pour ne pas mourir, et qui oserait lui en faire un reproche ?
Oui, ici comme partout s’applique la loi invincible de Darwin ; l’Académie, comme tous les êtres, suit cette loi primordiale qui se nomme : la lutte pour la vie. Procédons méthodiquement ; si nous voulons savoir pour quelle cause réelle elle a exclu les hommes dont nous parlons, tâchons de trouver le caractère qui leur est commun : ce caractère est évidemment LE GÉNIE. Or, en éliminant le Génie, tout être collectif, tout corps constitué travaille à sa préservation, car le Génie, qu’il le veuille ou non, partout où il est, devient le maître et exerce une puissance dominatrice ; il est donc tout naturel qu’on ne l’admette pas dans les assemblées qui doivent avoir l’égalité pour principe et pour règle. Quand les Animaux se réunissent pour causer de leurs petites affaires, ils ont grandement raison de ne pas inviter l’hôte incommode qui se nomme le Lion. C’est pourquoi Balzac aurait pu, comme Mercadet, devenir créancier, Dumas infécond, Théophile Gautier chauve, Leconte de Lisle brouillé avec son maître, Flaubert et Baudelaire chanteurs d’églogues, ils auraient toujours eu contre eux (pelés et galeux dont venait tout le mal) cette indignité dont le signe était visiblement écrit sur leurs fronts : LE GÉNIE !
On m’objectera que Victor Hugo est académicien ; mais, soyons de bonne foi, ce n’est pas la faute de l’Académie. Elle lui avait suffisamment et assez clairement exprimé par trois refus successifs, qu’elle désirait ne le posséder jamais ; elle a fini par lui ouvrir la porte, sans joie ! parce qu’il ne voulait pas s’en aller, après lui avoir éperdument préféré des candidats illusoires. Elle avait rechigné aussi ouvertement que possible, et n’eut pas de reproches à se faire. Mais comme la proportion doit toujours être gardée, si le dieu même de la poésie moderne a été trois fois accueilli à la porte du petit local comme un chien dans un jeu de quilles tremblantes, quel bon poète ne tiendrait à honneur d’être refusé au moins trente fois par l’Académie, jalouse d’entasser dans son sein les plus exquis, les plus parfumés et les plus vanillés d’entre les professeurs ? Mais c’est beaucoup d’allées et devenues, et peut-être le jeu n’en vaudrait-il pas la terrifiante chandelle !
Enfin, il ne faut pas oublier que les femmes sont toutes-puissantes en matière d’élections, et que le vrai poète, uniquement occupé de son œuvre, ne connaît pas de femmes. Sans transition, mon cher Louis, voici une touchante historiette, que je trouve dans le recueil d’une correspondance manuscrite du siècle dernier. Il y avait alors un certain chevalier de Bigni, qui plus tard porta un autre nom, resté parfaitement inconnu. Ce seigneur avait le visage heureux, les dents belles, la jambe bien faite, et faisait de grands ravages parmi les marquises de Versailles. Il avait allumé une vive passion dans le cœur d’une très aimable et spirituelle femme, nommée madame de Chandinier ; mais cette veuve était laide malgré ses beaux yeux noirs, âgée de trente ans déjà, marquée de la petite vérole ; elle n’osait se déclarer, et souffrait mille supplices en voyant que le chevalier songeait à faire toutes les conquêtes, excepté la sienne.
Cependant Bigni, qui, au milieu de ses folies amoureuses, trouvait encore des loisirs, avait composé deux ou trois quatrains presque réussis et ébauché un acrostiche ; aussi désirait-il avec raison faire partie des quarante. On l’avertit officieusement que madame de Chandinier avait l’oreille de toutes les académiciennes et pouvait tout pour un candidat qu’elle protégerait. L’intérêt fit ce que la pitié n’avait pu faire ; le chevalier se départit de ses rigueurs et fut tout étonné de trouver en Clarisse la plus experte, la plus attentive et la plus désirable des amies. Toutefois il ne perdait pas de vue le fauteuil, et de temps en temps rappelait à la dame sa candidature ; mais alors, avec une tendresse et une épouvante qui eussent désarmé des pierres, madame de Chandinier lui disait : « Oh ! pas encore ! » tant elle savait bien que le chevalier la laisserait là comme un livre déjà lu, le jour même où pour la première fois il se serait paré des palmes vertes ! Par une nuit d’hiver où Clarisse attendait ce Bigni trop adoré qui ne venait pas, elle resta debout pendant des heures à une fenêtre ouverte, et gagna un refroidissement dont elle mourut. Pour le coup, le chevalier croyait déjà ses espérances ruinées et se reprochait déjà ses complaisances inutiles ; mais un billet anonyme lui ordonna de se présenter à l’Académie, où effectivement il fut nommé. Avant d’exhaler son dernier soupir, madame de Chandinier avait eu le temps de signifier sa volonté à ses amies les académiciennes, qui avaient tenu à honneur de lui obéir.
Cela prouve que pour réussir il faut être du monde. Et le vrai chanteur obstiné, qui lutte avec la Rime comme Jacob avec l’Ange, et qui, par une ambition effrénée et titanique, voudrait, avant de mourir, composer dix bons vers de suite ! doit rester chez lui à relire Homère, Dante, Shakespeare, Hugo, et craindre les élections académiques et autres, comme un chat échaudé craint l’eau froide.
Quarante-cinq années déjà se sont écoulées, depuis le temps où le grand Balzac écrivait Les Employés, et par l’organe de Rabourdin, le chef de bureau à qui il prêtait son génie, proposait de couper quelques millions de bras à l’obsédante pieuvre qui se nomme : la Bureaucratie !
Car sur ce point comme sur tous les autres, l’inventeur de La Comédie Humaine s’était montré prophète ; mais, excepté lui, personne au monde n’eût deviné en 1836 jusqu’où s’étendrait le fléau enfermé alors dans les ministères, et à quel point la langue administrative et politique arriverait à dévorer et à supprimer la langue française ! Aujourd’hui le mal est arrivé à son dernier période ; tous les Français sont des employés portant, idéalement du moins, des manches vertes, et tout est des ministères !
Vous avez besoin d’un livre ; pour l’acheter, vous entrez chez un libraire ; vous vous figurez naïvement qu’il suffira de débourser votre argent, et que tout de suite en échange on vous donnera le livre ; quelle n’est pas votre erreur ! On vous adresse d’abord à un premier comptoir, où, après avoir pris acte de votre demande, un monsieur sévère vous remet un papier imprimé que de comptoirs en comptoirs vous échangez contre d’autres papiers imprimés. Après quoi vous êtes admis dans une salle d’attente où on vous remet un numéro 354, et à de longs intervalles vous entendez appeler le numéro 6 ou le numéro 7, avec une solennité qui évoque dans votre souvenir l’appel des victimes sous la Terreur. Vous avez cru entrer dans une librairie, c’est un ministère.
Ces jours derniers, un jeune homme, arrivé de sa province avec l’idée essentiellement pratique de faire du théâtre, envoya cinq actes manuscrits à Léon Pladys qui en ce moment fait toutes les pièces à tous les théâtres, et, à son grand étonnement, reçut une lettre de convocation. Il fut reçu, non bien entendu par le vaudevilliste lui-même, mais par son chef de cabinet Dory, qui très obligeamment lui dit sans préliminaires :
« Monsieur, votre comédie nous convient, et en vertu du traité passé entre nous et monsieur Raymond Deslandes, nous devons la livrer dans trois jours ; mais, comme nous avons cette semaine deux autres comédies finissant par des mariages, la vôtre se terminera par un suicide ! » Puis appelant un chef de bureau : « Monsieur Marès, dit-il, faites-moi chercher le dénouement n° 17, dans le carton X, troisième série des Suicides. » Au bout d’un moment, Marès revenait tout confus : « Monsieur, murmura-t-il avec embarras, le dénouement n° 17 ne se retrouve pas ; il aura sans doute été égaré dans les bureaux ! » C’est ainsi, mon cher Louis, que le jeune homme dont je vous parle a fait le premier apprentissage du théâtre, et de prime abord il a pu se convaincre que le métier d’auteur dramatique, si fructueux, constitue aujourd’hui une profession sérieuse.
La chanteuse Flora Satsko, dont la beauté farouche et le chant étrange attirent tout Paris à un lointain café-concert, est très légitimement mariée à un vieillard de l’aspect le plus digne, dont les cheveux blancs rappellent ceux du baron de Wormspire. Il est fort probable que son grade de colonel et ses décorations variées ne résisteraient pas à un examen sérieux ; mais enfin, il est d’une bonne force en escrime et présente son roman d’une manière suffisamment acceptable.
Or, fût-il aussi petit qu’une feuille de papier à cigarette, aucun papier n’arrive à Flora : toute la correspondance est lue, classée, étiquetée, répondue par le colonel. Les visiteurs qu’en tout bien tout honneur il juge à propos d’admettre près de sa femme, n’entrent qu’à leur tour, au moyen de numéros qu’il leur délivre lui-même, et l’huissier est incorruptible, ou du moins ne se laisse corrompre que s’il y a été dûment autorisé. Enfin, ce qui montre dans son vrai jour le génie du vénérable Satsko, c’est qu’il a fondé un magasin de bijouterie, uniquement alimenté par les joyaux offerts à la diva, et qui lui arrivent seulement après avoir été soumis à la sagace appréciation du colonel.
Tout est des ministères ! Le jeune écrivain Joseph Ulmo, qui modestement habite un troisième étage au-dessus de trois entresols, et d’ordinaire défend sa porte pour pouvoir travailler, attendait à heure fixe la visite d’un éditeur. Il avait eu grand soin de lever la consigne habituelle, cependant la journée se passa tout entière sans qu’il reçût le mécène attendu, et soupçonnant quelque fatale erreur, voulant mettre un terme à l’énervante incertitude, il prit le parti d’aller faire une visite à son portier.
Introduit dans le petit salon japonais de la loge, encombré d’amusants bibelots, il trouva ce fonctionnaire élégamment vêtu d’un veston de peluche vieil or, paresseusement couché dans un fauteuil de damas blanc, et tout en fumant un cigare d’un blond fauve, occupé à lire un roman de Montépin, sur lequel il fixait ses impressions diverses, en écrivant avec un crayon d’or et en couvrant l’exemplaire de notes marginales. Joseph Ulmo lui expliqua son embarras, et, je dois l’avouer, fut écouté avec bienveillance.
– « Je n’y comprends rien, dit le portier surpris lui-même, » et après avoir approché de ses lèvres un joli sifflet de chasse :
– « Zarine, dit-il à son valet nègre aussitôt accouru, faites venir mon secrétaire.
– Mais, fit Zarine, en brossant sa toque écossaise avec sa manche écarlate, monsieur doit savoir que monsieur le secrétaire est à la commission ! »
Il est permis de supposer que ce nègre parle un français approximatif. Voulait-il dire que le secrétaire du portier était allé faire une commission, ou bien qu’il faisait partie d’une commission, et assistait à une de ces séances où l’on discute des questions autour d’un tapis vert ? J’incline, quant à moi, pour cette dernière leçon, comme plus conforme à l’idée qu’on doit se faire d’un employé supérieur ayant l’honneur d’appartenir à un portier de premier ordre.
Cependant, mon ami, si les mœurs officielles et la phraséologie politique se sont emparées de la société tout entière, comment nous étonnerions-nous de voir qu’elles possèdent complètement les politiciens pour qui elles sont devenues une seconde et même une première nature ? Édouard Valrive, qui fut si souvent ministre sous l’empire, est un homme tout à fait charmant, beau cavalier, gai, indulgent, serviable, et on pourrait même le trouver spirituel, s’il avait pu se défaire de l’argot spécial à son ancienne profession ; mais de même que les galériens traînent la jambe qui a porté le boulet, il serre sur son flanc le bras qui, si longtemps, a tenu le portefeuille, et il a gardé les habitudes ministérielles collées à sa peau, comme la robe envenimée du centaure.