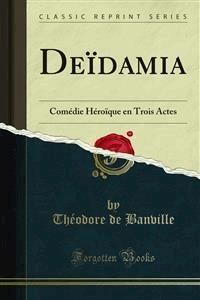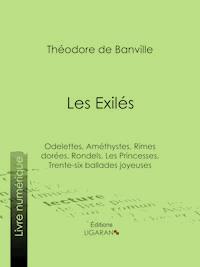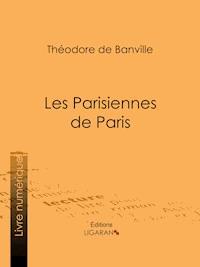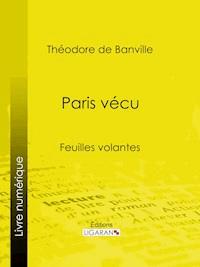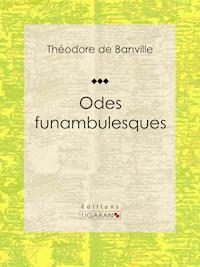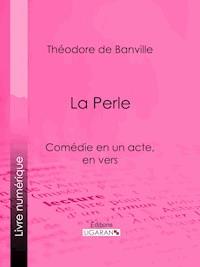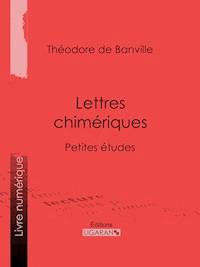
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Mon cher ami, La Savoie et son duc sont pleins de précipices, a dit le maître dans la grande apostrophe de Ruy Blas. Mais si cela fut vrai de la Savoie et de son duc, combien plus de théâtre ! Le théâtre n'est qu'un tas, une série, une accumulation, une agglomération de précipices ; il est précipice lui-même !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Être bizarre, ô mon chien Zinzolin,
Noir comme un arbre en sa prison d’écorce,
Sois fier ! c’est toi, le Français né malin.
Car du laurier fuyant la vaine amorce,
Tu n’écris pas, c’est ce qui fait ta force.
Oh ! l’écriture ! à Tunis, à Canton,
Même chez nous, dans le dernier canton,
Pour être sage on devrait la proscrire.
Et cependant, Musset l’a dit, quand on
N’a pas d’argent, c’est amusant d’écrire.
Voici des Lettres qui, si vous le voulez, sont bien des lettres, dans le sens absolu de ce mot comminatoire, mais dont l’existence n’a rien de réel, et demeure tout idéale. Je veux dire par là qu’elles n’ont jamais été revêtues d’un timbre de trois sous, ni enfermées dans des enveloppes gommées, ni même écrites sur le papier spécial affecté à ce genre de compositions, ni surtout envoyées à leurs titulaires ! Car, grâce aux Dieux immortels, je ne possède pas, je ne posséderai jamais de papier à lettres, et l’homme qui envoie une lettre à son semblable, avec la complicité de monsieur Cochery, me paraît être un tyran et un scélérat. Quoi ! lorsque je suis tranquillement assis dans mon fauteuil à oreilles, brodé au petit point, dont le dos représente Orphée attendrissant les bêtes, et que je lis Atta Troll ou l’Intermezzo, ou Le Scarabée d’Or, le premier importun venu, uniquement parce qu’il a donné trois sous, aurait le droit de me raconter ses ennuis dénués d’intérêt, et ses ridicules passions !
Non, par Hercule ! et ce qu’autrui ne doit pas me faire, je ne veux pas non plus le faire à autrui. Cependant, il se peut que les actes ou les écrits de tel contemporain éveillent en moi un besoin de causerie ou de discussion ; dans ces cas-là, je n’hésite pas. Sur n’importe quoi, sur le premier papier venu, j’écris à ce contemporain, pour me débarrasser vite de l’idée qui m’obsède. Mais la lettre finie, il faut avec soin la jeter dans un tiroir, ou en allumer des cigarettes, et le plus sûr est encore de la faire imprimer dans un volume ; car, selon la sagace observation d’Émile de Girardin, c’est le meilleur moyen pour que le destinataire, inconnu, indifférent, ennemi ou ami, ne la lise pas. J’ai donc pris ce dernier parti, sachant, comme le célèbre écrivain, qu’un livre ne parvient jamais à l’intéressé mis en cause, et c’est pourquoi je confie à la discrétion de Georges Chamerot et de Georges Charpentier une innocente et naïve série de Lettres Chimériques.
À EDMOND CONDINET
Mon cher ami, La Savoie et son duc sont pleins de précipices, a dit le maître dans la grande apostrophe de Ruy Blas. Mais si cela fut vrai de la Savoie et de son duc, combien plus du théâtre ! Le théâtre n’est qu’un tas, une série, une accumulation, une agglomération de précipices ; il est précipice lui-même ! Pour éviter d’y tomber dans les trous, et de devenir comme Hippolyte un triste objet, il ne suffit pas d’avoir le pied assuré de la mule, le coup d’œil de l’aigle, la prudence d’un Indien et cent mille diables dans le corps ; il faut encore être né coiffé et avoir obtenu, on ne sait comment, la chance inexplicable. Cependant, mon ami, dans ce monde jonché de trappes, au propre et au figuré, le meilleur moyen de réussir à coup sûr, vous l’avez bien prouvé par votre exemple, c’est encore d’avoir beaucoup d’invention, beaucoup d’imagination, beaucoup d’esprit, de ne rien donner au hasard et de savoir très bien son métier.
Non seulement vous avez tiré de votre cerveau cent pièces vivantes et agissantes, turbulentes comme la vie, et qui excitent le rire et les pleurs, mais combien de centaines de pièces vous avez rendues jeunes, belles et séduisantes, qu’on vous avait apportées mal venues, à peine dégrossies, traînant la patte et faites pour dormir lourdement dans un coin sombre, plutôt que pour réjouir les hommes sous l’éblouissante clarté des lustres ! Mais vous les preniez dans vos mains agiles et puissantes, vous les pétrissiez à nouveau, vous leur donniez les proportions normales, l’accent qui leur manquait ; puis après, le feu, l’âme, le je ne sais quoi, le souffle de vie, et ces momies mal ficelées devenaient des bacchantes couronnées de raisins, montrant leurs belles jambes nues et faisant sonner leurs cymbales d’or ! Ce miracle, vous l’avez recommencé tant de fois qu’il ne peut sembler inconscient ; aussi nous faites-vous croire, avec raison, que pour réussir au théâtre, il faut être un habile et patient ouvrier, avec quelque chose en plus, qui est la pointe de génie.
Tel n’était pas l’avis de Paul Siraudin, cet excellent camarade que nous venons de perdre. Il pensait qu’au théâtre, le soin, l’application, la recherche de la perfection servent très peu, et que tout, absolument, y dépend du hasard. Il faut dire qu’un très étrange concours de circonstances avait enfoncé en lui cette idée bizarre, comme un coin obstinément frappé par le marteau. Siraudin, qui connaissait tout le monde, mais que très peu de gens ont réellement connu, était un lettré, un délicat, du plus vif, du plus subtil esprit et d’une érudition profonde ; mais il cachait tout cela avec un soin jaloux, et s’appliquait à ne paraître rien de plus qu’un vaudevilliste. D’ailleurs, dans ma pensée comme dans la sienne, ce n’est pas là un titre méprisable. Plût aux Dieux que beaucoup de poètes de profession fussent capables d’écrire les couplets exquis des Petites Danaïdes, et beaucoup d’autres applaudis par nos pères, du temps que les Brazier et les Désaugiers faisaient des vaudevilles ! Siraudin pensait ainsi, et c’est pourquoi il se parait orgueilleusement d’un titre dédaigné aujourd’hui, comme beaucoup d’autres raisins trop verts.
Il a eu peut-être les succès les plus inouïs, et les chutes les plus extraordinaires dont on se souvienne, et justement ses pièces tombées étaient celles qu’il avait caressées avec le plus d’amour, tandis qu’il obtint des représentations innombrables avec des comédies brochées à la hâte, dont il faisait très peu de cas. Aussi était-il devenu absolument sceptique. Il prétendait que toutes les finesses, que toutes les recherches de style, même du style le plus franchement bouffon, sont au théâtre des perles semées, comme celles de Buckingham, qu’il faut tailler les pièces à coups de serpe, et qu’il ne faut jamais s’appliquer ! En dépit de ces théories nihilistes, parmi les innombrables pièces que Siraudin a fait représenter, il ne serait pas difficile de trouver et de mettre à part vingt complets chefs-d’œuvre ; je citerais tout d’abord l’admirable comédie intitulée E.H. et aussi Le Misanthrope et l’Auvergnat, ce célèbre chef-d’œuvre où il est si facile de reconnaître l’esprit de Siraudin, aussi bien que l’esprit de Labiche.
C’est à lui, sans nul doute, que j’ai dû mes plus grands étonnements ; le premier qu’il me donna ne date pas d’hier, et dure encore. C’était le 17 juin 1841 ; j’avais alors dix-huit ans, trois mois et trois jours. J’étais allé au théâtre du Palais-Royal, et j’y étouffais ; car à cet heureux théâtre, où Gavaud, Minard, Le plus Heureux des trois et d’autres pièces encore m’ont procuré de si vives joies, j’ai souvent ri à me décrocher les mâchoires, mais j’ai toujours étouffé. Achard jouait, et moi j’écoutais un monologue appelé Les Économies de Cabochard, dont tout ce que je puis dire est qu’il me parut quelconque. Hormis les Dieux, nul ne pouvait alors prévoir la future naissance de Coquelin cadet. Aujourd’hui qu’il existe et que je l’aime beaucoup, j’ai fait ce que j’ai pu pour me vaincre ; mais en ce temps-là je préférais franchement à tous les autres monologues le monologue d’Hamlet : To be or not to be, et le monologue de Figaro : Ô femme ! femme ! femme ! J’écoutais donc tranquillement, avec une résignation mêlée d’un vague désespoir, comme un homme qui, enfermé dans une cave, s’amuse à ce qu’il peut. Mais tout à coup il me sembla que la cave s’écroulait. À la place de ses murs grossiers, parurent à mes yeux éblouis des escaliers de rubis, des arches de saphir sous lesquelles coulaient des fleuves d’or en fusion ; des escaliers de jade s’élancèrent vers des cieux de cristal de roche, et des statues embrasées, taillées dans un seul diamant géant, tenaient dans leurs mains transparentes des torches de lumière rose.
L’orchestre venait d’attaquer un air de danse qui m’était bien connu. Il jouait l’air de ce Pas Styrien, que tant de fois j’avais vu danser avec d’agaçants collants gris, des robes courtes et des bottes historiées, et je m’étais dit : « Pourquoi, en effet, ne danserait-on pas une fois de plus le Pas Styrien ? » Mais non, aucun danseur ne montra son immobile sourire écarlate ; Achard se mit à chanter, et alors, ô stupeur ! j’entendis une chanson agile, dévergondée, envolée, précise, dont les syllabes étroitement tressées et collées aux notes de l’air de danse, dansaient elles-mêmes le Pas Styrien ! Et aussitôt dans ma caboche lyrique, épouvantée d’un pareil tour de force inouï, se décomposa tout le mécanisme de cette odelette enfiévrée, les vers de dix, de neuf, de huit, de sept, de six, de cinq, de quatre, de trois, de deux syllabes, soudés et rivés avec un art diabolique, frappant le parquet de leurs invisibles souliers d’or, et les redoublements de rimes faisant éclater le même son de cuivre trois fois, quatre fois, cinq fois, et jusqu’à six fois de suite ! Ces deux strophes, que chantait le comédien Achard, je n’en ai certes pas oublié une syllabe, ni une note, depuis le 17 juin 1841. Les voici :
Et ce jour-là nous ne lûmes pas plus avant ! – En d’autres termes je sortis, au risque de bousculer mes voisins, et je n’entendis plus la fin du monologue, ni cette fois, ni une autre. Étant donnée l’incommutable formule de cet art du théâtre, qui passe pour si difficile, et qui consiste dans le retournement pur et simple flétri par Edgar Poe, je crois pouvoir affirmer que la pièce étant intitulée : Les Économies de Cabochard, et que Cabochard, dans le récit qui sert d’exposition, ayant annoncé le désir de faire des économies, il devait, au contraire, ne réaliser aucune économie, et même dépenser indûment, par un audacieux et involontaire système de crédit, un argent qu’il n’avait pas. Mais ce soir-là, j’avais bien d’autres chats à peigner ! Je sortis dans le jardin du Palais-Royal, la tête en feu, déchiré par la griffe d’une invisible sphinge, et me disant à part moi : « Certes, je connais à peine deux ou trois poètes de profession capables d’écrire un tel morceau ; cependant le poète de cette chanson doit être un vaudevilliste ; mais lequel ? »
Le lendemain matin, je suivis, comme on suit une femme, le premier des afficheurs qui parut avec sa brosse et son pot à colle ; ivre de curiosité, je le regardai poser l’affiche du Palais-Royal, et sur cette affiche, je lus : Deuxième représentation. – Les Économies de Cabochard, vaudeville en un acte, par MM. Dumanoir et Paul Siraudin. – Ainsi je tombais de Scylla en Charybde, et la question, au lieu d’être résolue, se posait à nouveau, avec un second point d’interrogation plus anxieux que le premier. Car la difficulté d’appliquer des vers sur les notes du Pas Styrien, excluait toute idée de collaboration ; la chanson : Mon Aldégonde ne pouvait donc être de Dumanoir ET de Siraudin ; elle était nécessairement de Dumanoir ou de Siraudin ; mais duquel des deux ?
Quelques mois plus tard, en plein carnaval de 1842, je soupais chez Vachette (le Brébant d’aujourd’hui) avec de jeunes romantiques et des femmes costumées en débardeurs de Gavarni : il y en avait encore ! Étant sorti un instant du petit salon, pour quêter au hasard du papier à cigarettes qui me manquait, j’aperçus un jeune homme au bel œil intelligent, à la lèvre épaisse et rouge, à la longue barbe soyeuse, un peu chauve déjà, et j’entendis une femme, avec qui il causait, lui dire : « Mais mon cher Siraudin !… » – J’étais follement jeune, un peu étourdi par la vertigineuse causerie et par les fumées du champagne ; je ne doutais de rien ; venant donc interrompre la conversation commencée, avec un sans-façon que rien ne justifiait, j’interpellai le jeune dramatiste.
– « Ah ! lui dis-je, c’est vous qui êtes Paul Siraudin ! Parbleu je suis bien content de vous voir.
– Moi de même, fit-il aimablement, car vous ne m’êtes pas inconnu.
– Mais, repris-je, soyez franc. Est-ce vous qui avez fait le chef-d’œuvre ; ne vous étonnez pas, oui, la chanson des Économies de Cabochard, ou est-ce Dumanoir qui l’a faite ?
– Ah ! dit Siraudin avec bonhomie, c’est donc un chef-d’œuvre ?
– Certes, m’écriai-je. Mais qui l’a écrite ?
– Bon ! me dit Siraudin en souriant, qu’est-ce que ça fait ?
– Comment ce que ça fait ! dis-je avec mes violences de jeune poète, alors chevelu, qui ne savait pas encore vivre ; mais dans l’association Dumanoir et Siraudin, il y a un grand homme, que j’éprouve le besoin d’admirer, et un autre homme, qui peut-être n’est rien de plus qu’un auteur estimable. Je demande à être fixé.
– Bah ! me dit Siraudin, qui avec une tranquille philosophie était sorti dans le corridor pour fumer sa pipe, réservez donc vos admirations à ce qui les mérite. Tout ce que nous faisons est justement suffisant pour favoriser la digestion des gens qui ont dîné à quarante sous dans le Palais-Royal ! ».
À ce moment-là, mon ami, Siraudin me parut cacher un orgueil effréné sous cette apparente modestie. Plus tard, je devins son ami, et je sus alors combien il accordait peu de prix à ses inventions, car c’était un vrai sage, qui savait le fin mot des choses, et qui s’enfermait à triple verrou pour lire tranquillement un chapitre de Balzac ou une page de La Fontaine.
Oui, mon ami, il est difficile de se figurer à quel point Paul Siraudin prétendait peu à la gloire, et certes si tous les écrivains lui eussent ressemblé, il eût été impossible de créer jamais la fameuse Société du doigt dans l’œil, qui, ainsi que son nom l’indique, se compose de gens qui n’y voient goutte. Lui, au contraire, il regardait résolument en face le visage effroyable de la Réalité, et il ne se laissait pas étonner par l’expression profondément indifférente de cette tranquille Méduse. En d’autres termes, il appartenait à la famille restreinte des inventeurs de théâtre qui ne croient pas être Aristophane ou Shakespeare : modestie extrêmement rare, dont il faudrait, autant que possible, encourager l’exemple !
Voici un fait qui s’est renouvelé vingt fois sous mes yeux. Nous dînions, cinq ou six camarades très unis, chez Nestor Roqueplan. Là on mangeait des nourritures sincères, on buvait du vin fait avec du raisin, et tout le monde avait réellement de l’esprit, car si on avait quelque chose à dire, on le disait en peu de mots et tout de suite ; et on ne parlait pas, si on n’avait rien à dire. Ainsi les heures s’écoulaient dans un bien-être profond ; or ceci arriva bien souvent, vers les dix heures du soir, alors que chacun fumait, selon la volupté propre qui l’entraînait, son cigare ou sa pipe, Roqueplan disait à Siraudin :
– « Ah ! ça mais, vous avez ce soir une première au Gymnase ? une comédie en trois actes.
– Oui, répondait Siraudin, avec le ton de la plus parfaite indifférence. »
Et on en restait là. Et, telle fut l’éducation supérieure de ce groupe vraiment parisien, personne n’était tenté de dire à l’auteur philosophe : « Vous n’y allez pas ? Vous n’avez pas envie de savoir comment cela se passe ? » Ses amis le connaissaient trop pour lui adresser des questions si saugrenues, et savaient que détestant les émotions turbulentes et stériles, il fuyait comme la peste les premières représentations de ses pièces. Mais surtout ce qu’on nomme en langage technique : le service, c’est-à-dire l’ensemble des billets donnés à l’auteur pour qu’il puisse satisfaire à ses obligations personnelles, fidèlement Siraudin le vendait au marchand de billets, en empochait le prix sans réserver une seule place, et cette place unique, il ne l’eût pas gardée par devers lui pour la personne qu’il aimait le plus au monde. Dans sa pensée, les gens que nous aimons et qui nous aiment étaient à la comédie particulièrement redoutables, et ne pouvaient que nuire, par leurs terreurs involontaires ou par leur admiration maladroite.
Être auteur et se dérober, ne pas subir les ennuis de l’auteur, lui semblait charmant. Un jour vers midi, je le rencontrai dans le Palais-Royal. – « Ah ! me dit-il, en me montrant le théâtre, je vais là répéter une petite pièce qui se joue demain ; viens donc avec moi, tu verras à quel point c’est absurde. Mon cher, continua-t-il en passant son bras sous le mien, je ne sais quelle démence m’a pris ; j’ai broché ça en une heure, ça s’appellera Grassot embêté par Ravel, et c’est dénué de toute espèce de sens commun ; car, par suite d’une aberration que je ne m’explique pas, j’ai fait parler Grassot et Ravel comme ils ne parlent jamais ; aussi Grassot représentera-t-il lui-même un faux Grassot, et Ravel un Ravel peu conforme à la nature ! »
Cependant, nous étions entrés dans le théâtre, où la répétition commença tout de suite. Plus la petite pièce marchait, plus je trouvais que Siraudin l’avait bien jugée, et qu’elle ne valait pas le diable ; mais au contraire, le directeur semblait enchanté, riait de bon cœur, et il était évident qu’il se promettait le plus heureux succès.
– « Mon cher, me dit Siraudin quand nous sortîmes, il est hors de doute que demain la scène sera jonchée de pommes cuites, et pour remplir leur inévitable fonction, les pommes se cuiront d’elles-mêmes ! Mais cela m’est tout à fait égal, et j’ai une façon bien simple d’échapper à ce vulgaire incident.
– Ah ! dis-je, un peu surpris, comment feras-tu ?
– Mais, reprit Siraudin, je vais partir tout à l’heure pour Dieppe, et quand Dormeuil me cherchera pour me maudire, je serai en train de manger des crevettes ! J’ignorerai ma chute, parce que je mettrai un soin extrême à ne lire aucun journal. Mais quand même je l’apprendrais, je n’y croirais pas ou plutôt cette nouvelle ne représenterait rien à mon esprit, par une raison bien simple. C’est qu’une fois les fortifications passées, je ne crois plus du tout à l’existence d’Hyacinthe, de Grassot et du Palais-Royal. Tout cela, c’est des visions de notre fièvre, des fantômes suscités par l’étouffement parisien ; mais ces rêves s’évanouissent en fumée et se dissipent au contact de la nature. »
Le surlendemain matin, Siraudin se promenait tranquillement à Dieppe, sur la plage, savourant en gourmet la mélodieuse chanson de la mer, lorsque de loin, de très loin il aperçut, courant à lui avec une rapidité vertigineuse, un être qui, avec son manteau envolé dans le vent, lui parut affecter une allure démoniaque. Le vaudevilliste fut frappé d’une certaine terreur, mais il ne pouvait s’enfuir en pleine mer, et il attendit. À mi-chemin, il reconnut celui qui venait. Ce coureur effréné n’était autre que le grand Meyerbeer qui, avec ses traits convulsés, sa chevelure flottante et son œil fixe et terrible, n’avait rien de rassurant. Quel était son dessein ? Allait-il, comme il en avait le pouvoir, déchaîner les ouragans et les démons et emporter l’auteur des Économies de Cabochard dans quelque valse infernale, dans quelque Pas Styrien qui ne s’arrêterait jamais ? La chose ne pouvait être longtemps incertaine. Bientôt, comme une flèche rapide, le maître des tonnerres atteignit sa victime ; Siraudin se sentit serré, pressé entre ses bras d’acier, et, après l’avoir baisé sur les deux joues avec ses lèvres fatidiques, Meyerbeer s’écria, dans un transport d’admiration :
– « Ah ! mon ami, c’est du Molière !
– Quoi ? demanda Siraudin stupéfait. Qu’est-ce qui est du Molière !
– Mais, dit le grand homme, Grassot embêté par Ravel ! »
Ce qu’il y a de plus fort, c’est que Siraudin s’était trompé, et que Meyerbeer avait raison. La petite aristophanerie innocente et berquinesque représentée au Palais-Royal devait être en effet du Molière, ou quelque chose d’approchant, car à Paris le succès en avait été immense, et ce succès allait bientôt se répandre sur la province et l’Europe et l’univers entier, comme une tache d’huile. On ne s’avise jamais de tout, et Siraudin n’avait pas deviné à quel point sa conception serait favorable à l’amour-propre des comédiens en tournée ; car jouant la pièce dans les pays exotiques, il était facile de remplacer le nom de Grassot par celui du comique Brulé, par exemple, et celui de Ravel par Dubar ; si bien que la comédie devenait ici Brulé embêté par Dubar, là Delbœuf embêté par Flambert, et ainsi de suite ! Partout, les comédiens avaient à leur disposition une pièce dont ils étaient personnellement les héros, où ils représentaient leur propre personnage, marchant ainsi dans leur rêve étoilé, qui est d’être à la fois les Homères et les Achilles d’une Iliade peut-être dénuée d’intérêt.
Mais surtout, l’indifférence de Siraudin, le peu de souci qu’il prenait de ne pas offenser Aristote, avait cette fois mis dans son enjeu une carte formidable. Un jour, comme il faisait répéter Grassot embêté par Ravel, un jeune comique, nommé Augustin, s’approcha de lui, l’air suppliant, troublé comme s’il voulait demander quelque chose d’inouï, et c’est en effet ce qu’il allait faire.
– Ah ! monsieur Siraudin, dit-il, je voudrais bien être de la pièce ! J’ai beau travailler, m’appliquer, on ne me connaît pas, tandis que si j’étais de cette machine-là, ça me mettrait en vue tout de suite.
– Mais, mon ami, dit Siraudin, la pièce s’appelle Grassot embêté par Ravel, il est donc dans sa nature de ne comporter que deux acteurs : Grassot et Ravel. Je ne demande pas mieux que de vous être agréable, et je voudrais bien vous fourrer là-dedans ; mais comment, diable, voulez-vous que je m’y prenne ?
– Oh ! monsieur, fit le jeune Augustin, ce serait bien simple. Quand M. Grassot, résolu à quitter le théâtre, ne veut entendre à rien, M. Ravel, après avoir tenté en vain de le retenir, lui adresse ses adieux. Eh bien ! à ce moment-là, qui l’empêcherait de dire : « Il y a un de nos camarades, le petit Augustin, qui voudrait bien prendre aussi congé de toi ? »
Siraudin était trop bon prince pour refuser de faire un heureux ; sans tergiverser, il adopta la leçon du jeune Augustin, et elle fit sa fortune, car en province ou à l’étranger, dans les représentations à bénéfice, lorsqu’on jouait la piécette devenue n’importe quel Dorinval embêté par Florville, l’initiale transition inventée par le petit comique, vu son infinie élasticité, servait à faire entrer chez Dorinval autant d’acteurs qu’on voulait ; en Italie, dans la troupe Meynadier, il en entra jusqu’à vingt. La formule une fois adoptée, il n’était pas difficile de dire : Il y a aussi Voluisant, notre premier rôle… – Il y a aussi madame Mezzara, la grande coquette, qui voudrait prendre congé de toi. – Il y a aussi le jeune premier Giralt…, et ainsi de suite. Grâce à cette combinaison si simple, qui faisait de Grassot embêté par Ravel une roustissure toute prête pour les bénéfices, Siraudin fut joué des milliers de fois, recueillit des droits d’auteur énormes, et par là fut ancré davantage dans cette idée qu’il ne faut jamais s’appliquer en faisant les pièces.
Et même, pour éviter de s’appliquer involontairement, il avait supprimé chez lui les outils matériels de l’application, et il avait pris soin de ne posséder que très imparfaitement ce que monsieur Scribe nomme : « Tout ce qu’il faut pour écrire. » Un matin que j’étais monté chez Siraudin, je le trouvai très pressé. Il avait à faire des béquets attendus pour une répétition. Il me demanda la permission de les terminer devant moi, et, comme je le vis, non sans un peu d’étonnement, il travaillait sur un piano, son papier étant posé sur les touches qui, à mesure qu’il écrivait, cédaient sous sa main, de sorte que j’entendais des grognements sourds.
– « Mais à la fin, lui dis-je, tu méprises par trop la vérité et la nature des choses. Le piano est un instrument destiné à faire danser les jeunes demoiselles et à motiver les attaques nerveuses des Hongrois chevelus ; mais jamais, au grand jamais on n’a écrit sur un piano ! »
Siraudin ne me répondit rien, mais c’était le moins entêté des hommes, et il cédait volontiers à de bonnes raisons. Quelque temps après, je retournai chez lui, à sa prière, pour entendre des vers de parodie, et je m’assis en silence, sans lui parler, parce qu’il était en train d’achever la scène qu’il voulait me lire.
Mais il s’interrompit spontanément, et se retournant vers moi :
– « Eh bien ! me dit-il, j’ai réfléchi au reproche que tu me faisais l’autre fois, et décidément c’est toi qui étais dans le vrai ; on n’écrit pas sur un piano. Aussi tu vois, j’ai acheté un orgue ! »
En effet il écrivait maintenant sur un orgue ; mais qu’on ne voie pas là une frivole recherche de l’étrange ! Ces apparentes excentricités n’étaient que des moyens pour s’appliquer le moins possible. Siraudin n’aimait pas la cliquette du piano, ni le gémissement de l’orgue, et comme il ne pouvait écrire sans leur arracher des plaintes désolées et féroces, il se hâtait de finir sa scène, en quelques traits de plume. Il avait même fait un rêve plus audacieux et plus grandiose, celui de ne pas écrire du tout les pièces et de les faire représenter cependant. Cet idéal au premier abord peut sembler excessif, et cependant peu s’en est fallu qu’il ne le réalisât.
Siraudin, convoqué au Palais-Royal, allait lire une pièce aux acteurs. On le regarda déployer son manuscrit en s’étonnant un peu que les feuillets fussent, non calligraphiés par un copiste, mais écrits de sa propre main, et qu’ils formassent un cahier extrêmement mince ; mais tout cela fut attribué au manque de temps, car, sur les instances de M. Dormeuil, l’auteur avait dû improviser sa pièce en quelques jours. Il se mit à lire, et les jeux de scène bouffons, les mots jaillis, les cascades imprévues d’une violence fantasque charmaient les auditeurs. Mais tout à coup, Siraudin s’arrêta court, et se mit à retourner, à brouiller, feuilleter fiévreusement son manuscrit, comme un escamoteur qui mêle ses cartes. Et comme on suivait ses mouvements avec une curiosité avide :
– « Ah ! mon Dieu ! s’écria-t-il ; il me manque du feuillet 37 au feuillet 60, et j’aurai oublié ce paquet-là chez moi. »
On fit observer à Siraudin qu’il demeurait très près du théâtre, et que rien n’était plus facile que d’aller chercher ces feuillets. Mais il s’y refusa obstinément, par la raison très simple qu’ils n’existaient pas et qu’il ne les avait jamais écrits.
– « C’est inutile, dit-il négligemment. Je les apporterai demain pour la collation. »
Le lendemain, Siraudin n’apporta pas les feuillets pour la collation ; même il ne les apporta jamais, par l’excellente raison que j’ai dite. Mais le jour de la première répétition sur le théâtre, comme Grassot se révoltait, et prétendait ne pas pouvoir réciter une scène dont le texte lui était parfaitement inconnu :
– « Voyons, lui dit l’auteur fantaisiste, pas d’affectation ! tu connais la vie et tu sais très bien ce qu’on doit dire dans une circonstance donnée. D’autant plus que, dans l’espèce, c’est extrêmement simple. Hyacinthe est l’amant de ta femme, tu dois savoir qu’il s’est caché dans une armoire, et tu t’apprêtes à le pincer. Tu vas à l’armoire, et tu l’ouvres ; qui est-ce qui en sort ? c’est Lassouche. Alors tu es contrarié, naturellement, et tu lui dis : Si tu n’es pas l’amant de ma femme, qu’est-ce que tu viens faire dans mon armoire ? »
Ainsi de suite, Siraudin expliqua le mouvement de la scène, affirmant à ses comédiens qu’ils pouvaient parler à leur guise, et que ce serait toujours très bien. Ne pouvant se dérober à ce périlleux honneur, ils improvisèrent en effet leurs arabesques, peut-être sur le thème qui leur avait été indiqué, peut-être sur un autre. Peu à peu, le souffleur se mit à écrire, à mesure qu’ils les jouaient, les scènes absentes du manuscrit ; et ainsi fut créé le texte définitif, qui subsiste encore dans la pièce imprimée. Peut-être ce système serait-il insuffisant pour composer Polyeucte ou Andromaque ; mais c’est celui de la Commedia del arte, qui de tout temps a très bien réussi à la farce et aux farceurs ; et en effet est-il besoin d’avoir pâli sous la lampe et mis la tête dans ses mains pour que le nez d’Hyacinthe soit démesuré et pour qu’il y ait entre le nez et la bouche de Grassot un espace infini, pareil au désert sans bornes ?
Une autre pièce, je crois bien que c’était La Chambre à deux lits, ou Les Deux Sans-Culottes, mais je n’en suis pas sûr, – tant j’ai, en vieillissant, oublié mes classiques, – montrait au dénouement les deux comiques se levant en chemise et les jambes nues, comme des demi-dieux. Alors arrivait une Anglaise qui, ayant loué la chambre, croyait la trouver libre, et dans son indignation, elle devait exprimer violemment tout ce que peut inspirer à une pudique Ophélie l’horreur d’un pareil spectacle. Ce petit rôle de l’Anglaise comportant quelques lignes à peine, Siraudin avait toujours retardé le moment de l’écrire, et le directeur s’en inquiétait avec raison, car on voit, par l’exemple même des maîtres les plus illustres, combien il est difficile d’être plaisant avec des baragouins.
Toutefois l’auteur insistait pour qu’on ne se mît pas en peine, et affirmait que, le moment venu, il saurait parfaitement trouver ce qu’il faudrait. En effet, à l’avant-dernière répétition, il amena avec lui une Anglaise, une vraie Anglaise, ne sachant pas un mot de français, qu’il avait entraînée, je ne sais par quels artifices. Il causait avec elle derrière un portant, de la façon la plus aimable ; mais tout à coup, d’un geste furieux, il la poussa brutalement en scène. Alors, apercevant les acteurs aux jambes nues, humiliée, blessée, rougissante, ne sachant pas ce qu’on lui voulait et se croyant la victime d’un guet-apens, la pauvre demoiselle débagoula un anglais irrité, exaspéré, intarissable, pareil aux flots de la mer en furie, et qui semblait ne devoir s’arrêter jamais.
– « Bravo ! bravo ! admirable » s’écrièrent les assistants, qui attribuaient à Siraudin le rythme, la volubilité et le mouvement vraiment prodigieux de cette scène. Alors un ami, à qui le vaudevilliste avait donné rendez-vous exprès et qui parlait l’idiome de Dickens comme sa langue maternelle, expliqua à la jeune Anglaise que, pour gagner chaque soir une somme fort honnête, elle n’avait qu’à recommencer régulièrement le même exercice, ce qui eut lieu. Et la chaste insulaire eut d’autant moins de peine à montrer toujours la même indignation qu’elle l’éprouvait en effet, et trouva toujours excessif d’être condamnée à contempler ces jambes nues, dans les luisants maillots de soie rose. Quand il s’agit de donner la pièce à l’impression, Siraudin eut de nouveau recours à son ami, qui savait l’anglais. Il le pria de lui écrire sur un bout de papier ce que disait l’actrice improvisée, le mettant d’ailleurs à l’aise, et l’assurant que, s’il écrivait autre chose, cela ne ferait absolument rien. Ainsi fut pour la première fois sapé le préjugé ridicule qui naguère, chez nous, forçait les personnages de nationalité étrangère à patoiser un français absurde. Il est si naturel au contraire qu’ils parlent leur propre langue !
Certes, lorsqu’il rêvait de faire représenter des pièces sans les avoir écrites, Siraudin écoutait un peu la bienveillante paresse ; mais surtout il était guidé par l’expérience, et il obéissait à une idée profondément philosophique, ayant remarqué avec raison que le succès d’une pièce est souvent dû à des motifs purement accessoires, et que le texte écrit y contribue d’une manière très restreinte. Celui qui fut l’un des auteurs du Courrier de Lyon pouvait-il oublier que le personnage de Chopart dit l’Aimable, fortune de ce drame éternel, était né à l’insu des auteurs, et peut-être même à l’insu de Paulin Ménier ? D’ailleurs il se dérobait, non seulement au travail, mais à tous les autres ennuis de la vie, et à la vie elle-même. Presque toujours, c’est par amour-propre que nous en acceptons les charges fastidieuses ; mais, comme je vous l’ai dit, Siraudin était un sage, qui remplaçait l’amour-propre, absent chez lui, par le dandysme le plus raffiné. Malgré le commerce qu’il sembla exercer dans la rue de la Paix, il acceptait avec reconnaissance des confitures dénuées d’artifice, faites tout bonnement avec des fruits et du sucre, que lui offrait la femme d’un de ses amis ; et en revanche, au jour de l’an, il n’oubliait pas d’apporter des bonbons à cette bonne ménagère. Mais ces bonbons, il se fût bien gardé de les prendre dans la boutique fastueuse qui portait son nom, et il les achetait au passage des Panoramas : tout Siraudin est là. Il savait mieux que personne combien le moi est haïssable, et quoiqu’auteur de profession, il lâchait d’être auteur le moins possible, même à propos de bonbons.
Du temps qu’il en existait encore, il savait découvrir, et souvent il me les fit connaître, de bons petits restaurants où on-savait cuisiner des choses excellentes, mais qui étaient inconnus de la bonne société, et où on eût vainement cherché un seul gentleman. Notamment, je me rappelle une de ces gargotes, où le plat favori de Théodore Barrière, les haricots rouges à l’étuvée, cuits dans le vin, avec des lardons grillés, était exécuté avec une rare perfection. Mais des indiscrétions furent commises ; le succès s’en mêla, le cabaretier devint riche, et il fallut renoncer à ce régal, aussi oublié aujourd’hui que le fameux Poulet à la Paysanne du Café de Paris.
Rien ne fut doux, silencieux, amusant et discret à la fois, comme les logis de Siraudin, où en plein Paris bruyant, au milieu de la ville, il avait l’art d’être à mille lieues du monde, au fond d’un désert. De belles cires antiques dans des cadres sculptés, d’un or vieilli, des tapis d’un grand style aux couleurs harmonieuses et tendres, des fauteuils d’un travail exquis, vêtus de précieuses étoffes de soie dont les déchirures n’avaient pas été raccommodées, quelques bronzes originaux, d’un prix inestimable, dorés à l’or moulu, donnaient un aspect d’une distinction rare à ces demeures inconnues, où personne ne venait, où personne ne pouvait venir. On eût dit quelque nid d’amour, abandonné autrefois par Églé ou Chloris, et la spirituelle tête de Siraudin, chauve et barbue, produisait l’effet le plus piquant dans le gracieux petit lit réchampi en blanc avec de légères dorures où se voyaient, sculptés au chevet, l’arc et la torche adoptés par la Pompadour, et qui peut-être lui avait appartenu.
L’avant-dernier appartement qu’habita Siraudin était situé rue de la Victoire, dans la maison dont le rez-de-chaussée est occupé par la salle Herz. Comme je lui demandais quelles considérations avaient guidé son choix : – « C’est bien simple, me dit-il, je demeure là pour que personne ne puisse avoir l’idée de venir me voir, et parce que ce domicile est invraisemblable ! En effet, on vient à la salle Herz pour assister à des concerts ou aux assemblées de la Société des Auteurs Dramatiques, mais nul ne saurait supposer qu’un simple particulier, désintéressé de la musique jusqu’à l’abnégation, demeure dans cet édifice. Moi qu’épouvante l’idée d’un seul piano, comment imaginerait-on que je me suis réfugié dans l’endroit où aboie, hurle et mugit tout le troupeau des pianos ? Cependant tu le remarqueras, perdu au haut de la maison, et éclairé sur une cour fleurie, ce logement est profondément silencieux quand les pianos ne jouent pas ; et aux heures où les pianos jouent, je suis ailleurs, je m’évade ! »
Là, dans ce réduit de douairière amoureuse, ne faisant rien, n’ayant rien à faire, somptueusement défrayé par Le Courrier de Lyon et par La Fille de Madame Angot, Siraudin, vêtu d’une chaude robe de chambre et les pieds chaussés de bonnes pantoufles, assis devant un feu clair, lisait et relisait son auteur favori, Balzac, pour qui son culte allait jusqu’à l’adoration. Cependant, ce qu’il demandait à La Comédie Humaine, ce n’étaient pas des sujets de pièces ; il n’en cherchait ni là ni ailleurs, par cette excellente raison qu’il les connaissait tous. Il avait su, et c’était là son grand luxe, créer une inouïe, fabuleuse, prodigieuse bibliothèque dramatique, où il y avait tout, et qui rangée dans une sorte de corridor éclairé par une fenêtre, admirablement ordonnée sur des tablettes, classée dans des portefeuilles, tenait, en somme, très peu de place. Dès qu’il mettait le pied hors de chez lui, il reprenait et continuait sa chasse, le nez au vent, cherchant la proie à dévorer, fouillant les paniers des bouquinistes, scrutant les étalages, et s’occupant d’acheter les pièces, devenues de plus en plus rares, qu’il ne possédait pas. Il avait des pièces manquant dans la collection Soleinne, et dans l’étonnante bibliothèque de Francisque jeune, devenue plus tard celle de la Société des Auteurs Dramatiques.
Il n’y avait pas un mimodrame, pas un monologue, pas un ballet dont il n’eût déniché un exemplaire. On pouvait lui demander couramment Les deux Valladomir, Richardini, Nourjahad et Chérédin, Les mines de Pologne, Tankmar de Saxe, et même cette introuvable Forêt d’Hermanstadt que Hostein voulait toujours faire refaire, voyant là une fortune, et dont les exemplaires, imprimés sur du papier à chandelles, ne se vendent pas moins de cinq cents francs. Aussi, les ayant rassemblés chez lui, sous sa main, Siraudin avait lu toutes les tragédies, toutes les comédies, tous les drames, tous les opéras, toutes les farces, et c’est ce qui, en fait de théâtre, le rendait extrêmement sceptique. Il savait que toutes les pièces ont été faites depuis longtemps, et lorsqu’à une première représentation, il voyait se dérouler une scène chaudement applaudie, il aurait toujours pu dire d’où venait cette scène, en faire l’historique, et raconter sa généalogie. Il connaissait aussi la genèse de toutes les historiettes et de tous les bons mots, depuis l’Égypte et l’Inde antique, jusqu’au plus récent numéro du journal en vogue ; c’est pourquoi il fuyait comme la peste les bavards et les conteurs d’anecdotes, dont pas un n’eût pu lui apprendre une chose qu’il ne sût pas.
De là aussi sa grande admiration pour le génie du style, et sa prédilection pour les poètes, les seuls artistes littéraires qui paient comptant et qui doivent, ainsi qu’il le disait, opérer comme les bons escamoteurs, avec rien dans les mains, rien dans les poches. Et encore, m’affirmait-il un jour avec mélancolie, il ne faut rien trop creuser, pas même cela ! – Il m’assura alors que, tout au commencement du siècle, avant Chateaubriand, avant Lamartine, avant Hugo, un poète dramatique dont les œuvres furent toujours ignorées, même de son vivant, avait eu le pressentiment du vers romantique, du seizième siècle renouvelé, avec toutes les ressources symphoniques de la rime-protée, agile, robuste, envolée et sonore. Je pris cela pour une mystification, dont je ne voulais pas être la dupe, et très éloquemment, je crois, j’expliquai à mon ami, par des raisons techniques, en savetier qui parle de la chaussure, comme quoi ce qu’il me racontait était impossible. Siraudin n’aimait pas la discussion, il ne me répondit rien ; mais le lendemain, il m’envoya deux pièces de cet auteur inconnu, dont je regrette amèrement d’avoir oublié le nom. Ô stupeur ! les sujets en étaient chimériques, les scènes incohérentes, mais tout cela était versifié et rimé comme par un très bon poète actuel, ayant toute sa vie étudié profondément Hugo, tant il est vrai que rien n’est vrai, pas même les époques, pas même le temps, et que la fabuleuse réalité se joue de nos faibles intelligences !
Siraudin était si modeste, parce qu’il savait tout ; il fuyait les fonctions, les distinctions, tous les plumets, et je crois qu’il a poussé l’originalité jusqu’à mourir sans être même chevalier de la Légion d’Honneur. Je ne veux pas le traîner de force dans la gloire, où il ne voulait pas être ; mais il me semble que tout aussi bien que le sonnet d’Arvers, sa chanson, un vrai chef-d’œuvre lyrique, mérite de vivre. Combien de rimeurs se munissent d’un laurier, par précaution, et se cognent le front contre les étoiles, dont toute l’œuvre, classée et réunie à grands frais, ne vaut pas Mon Aldégonde !
À M. LE BARON HAUSSMANN
J’admire, monsieur, le Paris que vous nous avez fait sous l’Empire, mais je ne l’aime pas. Et ne voyez pas là, je vous prie, la partialité d’un ennemi politique ! Ennemi, je pourrais l’être de quelqu’un, à la rigueur, bien que cela ne me soit jamais arrivé ; mais politique, c’est une autre affaire, et jamais ce qu’on nomme, sans doute par antiphrase, les idées politiques, n’ont pénétré sous mon crâne. Du moment qu’il ne m’est pas permis de vivre dans les prairies et dans les déserts de fleurs du capitaine Mayne-Reid, monté sur un cheval rapide, armé d’un bon rifle, et me rendant à moi-même la justice à la façon de Thésée et d’Hercule, peu m’importent les gouvernements que je subis. Alfred de Vigny m’a trop bien appris dans ses Consultations du Docteur noir qu’ils se connaissent en vers aussi bien les uns que les autres, et qu’ils se valent pour laisser mourir de faim Chatterton et Gilbert et guillotiner André Chénier.
Non, si je n’aime pas votre Paris, c’est pour d’autres causes ! C’est parce que dans vos grandes rues splendides et babyloniennes, longues comme un jour sans pain et bêtes comme des oies, on s’ennuie avec frénésie. L’hiver, on y gèle, l’été on y est cuit, grillé comme un bifteck, rôti comme dans le Sahara. On y chancelle sous le vent qui vous terrasse et vous soufflette, – et en face du jour blanc, on perd la vue. Les Parisiens ne sont pas tous aveugles, mais ils le sont déjà presque tous, et quand les derniers d’entre eux auront senti s’éteindre leurs prunelles, pour se diriger ils ne pourront pas avoir recours aux caniches, devenus aveugles aussi !
Hier, comme messager d’une vieille dame de mes amies, qui a eu l’imprudence de se loger sur un boulevard neuf, et qui désormais n’y voit goutte, je suis allé rue Hautefeuille, savoir à quelles heures a lieu la clinique du célèbre oculiste Desmares. Il n’y a plus de clinique du docteur Desmares ! et la maison écroulée et détruite, dont il ne reste plus que les quatre murs, est en proie aux maçons. Seule une vieille concierge habite encore, à l’entresol, une chambre à laquelle conduit un escalier incomplet. Interrogée par moi, cette dame, qui soignait un de ces pot-au-feu caressés et mijotés avec amour comme un sonnet sans défaut, m’a appris qu’à force d’entrer, de sortir, de gravir l’escalier et de parcourir les chambres, les apprentis aveugles produits par la lumière crue dont s’inondent les rues et les boulevards blancs, ont usé la maison, et qu’il faut maintenant la reconstruire. Que d’aveugles, monsieur, grâce à ces rues larges comme des fleuves d’Amérique, et à ces maisons blanches comme des visages de Pierrots ! et encore je n’ose espérer que parmi eux il se rencontrera un seul Homère !
L’Orient, grâce aux rues étroites, savoure la fraîcheur et les délices de l’ombre, et nos aïeux avaient rapporté des croisades cette invention de génie, qu’avec non moins de génie vous avec plus tard désinventée. On me dira que ces rues étroites étaient dangereuses pour la santé publique ; mais l’ophtalmie et les fluxions de poitrine valent-elles mieux que la peste ? Un savant archéologue, dont les travaux sont illustres, n’a pu s’habituer aux belles voies qui font notre orgueil, et sous aucun prétexte il n’a consenti à habiter parmi leurs ouragans. Cependant, comme il est retenu à Paris par ses fonctions de conservateur d’un musée, il a pris un parti définitif et d’une rare audace. Il a loué une masure dans la rue de Venise, une rue que vous avez oubliée, monsieur, ou épargnée ! et après avoir fait réparer l’intérieur en conservant soigneusement la façade où le Moyen Âge a laissé de curieuses sculptures, il l’a ornée de tapisseries, de meubles antiques et dans cet hôtel de Cluny en miniature, dont les vitraux ont été merveilleusement restitués, il se console d’avoir vu sur sa route tant de pierres plus candides que la neige et les cygnes !
Certes, la rue de Venise fleure moins bon que la rose, et on n’y voit pas clair en plein midi, mais qu’à cela ne tienne ! l’archéologue allume sa chandelle de cire, (car il n’a pas adopté la lumière électrique) et, à sa bonne clarté honnête, lit les manuscrits copiés sur parchemin en lettres gothiques, et ornés de miniatures curieusement peintes. Mais, hélas ! monsieur, tout le monde malheureusement ne peut pas demeurer dans la rue de Venise, où l’on est certain de ne pas être écrasé, parce qu’elle n’est pas assez large pour le passage d’une voiture.
Les voitures ! c’est la grosse question, celle qui nous promet mille morts, et après les avoir promises tient parole, et nous les donne. Vous aviez pensé, et bien d’autres avec vous, qu’en ouvrant des rues énormes, on y trouverait la place des voitures, et aussi celle des piétons. C’était une grave erreur ! en ces immensités il n’y a de place que pour les voitures, et les piétons n’y peuvent être accueillis, sinon sous la figure de piétons écrasés.
C’est que c’est précisément ce vaste espace qui crée les voitures, et il y aurait mille fois plus d’espace qu’il y aurait mille fois plus de voitures. Équipages, fiacres, tramways, omnibus à deux chevaux et à trois chevaux, charrettes chargées de pierres de taille, baquets, trucs à roues portant des arbres vivants dont la tête est voisine du ciel et dont les racines pendent avec horreur, tous ces monstres se choquent, se culbutent, montent les uns sur les autres, entrent les uns dans les autres, se brisent réciproquement et s’émiettent, les plus forts éventrant les plus faibles, en raison du principe sacré de la lutte pour la vie. Quant aux simples passants, est-il utile de dire qu’ils sont concassés, pilés, réduits en bouillie et dispersés aux quatre vents du ciel ?
Dans le remaniement que vous avez fait de notre ville, monsieur, il y avait deux opérations ; l’une économique, et dont la beauté me frappe ; car il fut en effet admirable de créer de grands capitaux avec des terrains qui ne valaient pas deux sous, et de changer en voies monumentales les cloaques habités par ces bouges où la Torpille recevait Carlos Herrera ; l’autre, architecturale, qui m’inspire moins d’enthousiasme. Car étant donnés les prix nouveaux des terrains, il fallut naturellement élever dessus, et jusqu’aux astres, des maisons droites, rigides, infinies, si bien qu’on a l’air de se promener entre deux paravents démesurés. Les architectures de tous les temps, Moyen Âge, renaissance, dix-septième et dix-huitième siècles, toutes excepté celle-là, ont eu des pointes, des saillies, des lignes courbes, un dessin, une physionomie quelconque ; mais aujourd’hui nous nous agitons entre deux planches, et comme dans un conte d’Edgar Poe, on se figure qu’elles vont se rapprocher lentement, et qu’on sera pris d’abord, puis scié entre deux planches, selon la formule d’un supplice connu.
Et les Parisiens ont beau adorer leur ville, et en aimer les verrues, les ruisseaux, les fanges et tout le reste ! désormais le rêve de tout Parisien est de fuir Paris et de ne plus être écrasé devant les encombrants magasins qui tiennent tant de place et où il est si difficile d’acheter pour deux sous de fil ! Certes, ils voudraient s’en aller pas bien loin, pas plus loin que l’oiseau familier dont parle Juliette, ou tout au plus, aux rives prochaines, comme le pigeon du fablier. Eh bien ! il faudrait que quelque grand architecte, un Garnier par exemple, créât ce qui n’a pas été trouvé : LA VILLE MODERNE, et la construisît très près de Paris, à une heure de chemin de fer. Il pourrait même bâtir deux villes, l’une pour les gens du monde et les artistes, l’autre pour les ouvriers des métiers, qui ici manquent d’air et de soleil et de joie et sont condamnés à des bouges infects. Mais j’entends : des villes où on pourrait vivre, où selon le système si simple proposé par Théophile. Gautier, les rues dans toute leur longueur seraient, à la hauteur du premier étage, ourlées d’une marquise vitrée sur de légères armatures de fer ; des villes où ne manqueraient ni les chemins souterrains, ni les ponts suspendus au-dessus des rues, ni les chemins aériens, ni les jardins, ni les promenoirs couverts, ni rien de ce qu’il serait si facile d’imaginer et de réaliser, sur des terrains qui ne coûteraient pas mille francs le mètre.
Quant au Paris proprement dit, on pourrait l’abandonner définitivement aux tramways et aux administrations publiques, si bien que les tramways voitureraient uniquement des employés, et que tous les employés iraient à leurs travaux en tramways, de telle sorte que l’écrasement cesserait, faute de piétons. Mais soit qu’on bâtisse les Paris nouveaux que je réclame, soit qu’on s’en tienne à l’ancien, sans se soucier de la vie des hommes, qu’au bout du compte la nature reproduit et remplace avec une incontestable facilité, il se peut, monsieur le baron, que vous soyez appelé de nouveau à repétrir la face de la Cité, car la République aurait grandement raison d’employer votre talent, votre expérience et votre rare puissance d’initiative.
Eh bien ! si ce cas, qui peut être prévu, se présentait, vous pourriez, après avoir jadis inventé les larges rues, inventer maintenant les rues étroites, où l’on aurait chaud en janvier, où on jouirait en juin d’une délicieuse fraîcheur ; et aussi les maisons basses, où l’on pourrait, pendant les mois d’été, dormir sur les terrasses, à l’ombre des caisses de myrtes et de lauriers-roses. Je sais qu’au premier abord le prix des terrains semble s’opposer à cette combinaison si pratique ; mais après que nous avons conquis l’électricité, vaincu le temps et la distance, et forcé les Dieux à nous livrer un à un tous leurs secrets, comme les perles d’un collier qu’on égrène, ne serions-nous pas bien infirmes si nous étions tenus-en échec par la question des sous, et si nous n’arrivions pas à deviner une simple énigme financière, trois mille quatre-vingt-seize ans après le jour où le roi Œdipe a vaincu la Sphinge ?
À M. VICTORIEN SARDOU
En dépit de vos luttes, de vos victoires, de vos triomphes, de vos glorieuses défaites, de votre patience obstinée, de votre bravoure intrépide, il n’y a pas d’homme qui ait été plus mal jugé et plus calomnié que vous. Toutes les cinq minutes, on vous accuse d’avoir volé les tours de Notre-Dame, et cependant, monsieur, vous ne les avez jamais volées, et elles sont toujours à leur place. Un grand magistrat prétendait qu’en pareille occurrence il faut commencer par s’enfuir ; mais, à ce compte-là, vous vous enfuiriez toujours, vous passeriez votre vie en bateau et en chemin de fer, vous seriez forcé de parcourir tous les pays décrits par Jules Verne, y compris le pays des fourrures et les icebergs de la mer de glace, et même, à un moment donné, de vous faire bombarder, à l’aide d’un coup de canon, à travers les montagnes glacées de la lune.
Car dans le monde du théâtre, aussitôt que quelque chose disparaît, ou même ne disparaît pas, on s’écrie tout de suite : « C’est Victorien Sardou ! » À entendre ces rumeurs, on penserait que vous devez avoir des poches gonflées comme celles du Bertrand de L’Auberge des Adrets, et au contraire vos poches sont vierges, parfaitement régulières, et personne n’y retrouvera sa montre et ses couverts d’argent, non plus que son mouchoir de poche.
Je le sais bien, monsieur, moi, poète exilé, qui ai si longtemps gardé les feuilletons chez Admète, et qui ai curieusement suivi tous vos travaux, depuis La Taverne des Étudiants et Les Gens nerveux jusqu’à Fédora, non seulement vos sujets, vos conceptions, vos situations, vos personnages, vos caractères, votre style sont à vous, mais votre art lui-même, dans son ensemble, vous appartient. Et il vous appartient si bien en propre que, s’il était possible de jouer une pièce de vous sans que nulle indiscrétion révélât le nom de l’auteur, tout le monde se mettrait à crier, et légitimement, cette fois : « C’est Victorien Sardou ! » Non, cette agilité, cette adresse, cette ingéniosité toujours en éveil, ce don de faire jaillir l’effet prévu de façon qu’il surprenne même ceux qui l’attendent le plus impatiemment, cet art de grouper mille détails subtils de façon à les faire concourir à une impression large et simple, cette mobilité nerveuse et raisonnée cependant, ce tact dans la fougue, ce dandysme qui consiste à creuser exprès des abîmes pour les côtoyer toujours sans y tomber jamais, vous ne les avez empruntés ni de Scribe, ni de Beaumarchais ; tout cela vous ne le devez qu’à vous-même, à votre tempérament, à vos études, à votre originalité native cultivée par l’expérience, par la réflexion et par les plus sagaces recherches.
Non, vous n’êtes pas, vous ne serez pas, vous ne fûtes jamais un plagiaire ; et en général, sauf d’honorables exceptions, ceux qui vous accusaient de les avoir dérobés étaient à l’abri des voleurs, naturellement et par la force même des choses. Vous n’êtes pas un plagiaire, quoi qu’en aient dit les honnêtes gens qui, pour cause, sont empêchés de rien voler jamais, et c’est pourquoi je puis librement causer avec vous du Plagiat, et sur ce point mettre à nu pour vous mon âme tout entière.
Eh bien ! monsieur, je n’y vais pas par quatre chemins, et je regarde bien où est le plat, pour mettre mes pieds dedans. Absolument, résolument, passionnément, je suis partisan du Plagiat, à tous les degrés et sous toutes les formes, et je pense que rien n’est plus juste, plus honnête, plus salutaire et plus légitime.
À l’axiome d’Alphonse Karr : La propriété littéraire est une propriété, je ne change moi, qu’un seul mot, mais décisif, et je dis : La propriété littéraire n’est pas et ne saurait pas être une propriété.
Ici se place un dilemme impérieux, et auquel il n’est pas possible d’échapper : ou l’œuvre pour laquelle je me suis inspiré de mon prédécesseur existe, et alors elle a eu raison de naître, puisqu’elle a en elle la force sacrée de la vie ; ou elle n’existe pas, et alors je n’ai rien pris, rien dérobé, rien volé : ce n’est qu’une cendre vaine, qui tout à l’heure sera dispersée aux quatre vents du ciel. On a dit très spirituellement qu’en littérature, lorsqu’on dépouille un homme, il faut avoir soin de l’assassiner. Ceci est très ingénieux, mais parfaitement faux, car, dégagé du style figuré, cet axiome signifie que pour avoir le droit de vivre, l’œuvre inspirée d’une œuvre précédente doit avoir détruit et anéanti sa devancière. Or, les exemples sont là, évidents et clairs, pour nous prouver que cette prétendue vérité n’en est pas une. Il est, n’est-ce pas ? hors de toute discussion que Balzac a fait Le Père Goriot, ce merveilleux chef-d’œuvre ! sous l’obsession directe du Roi Lear de Shakespeare ; eh bien ! son roman durera aussi longtemps que la langue française, et je ne vois pas qu’il ait fait le moindre tort à la tragédie immortelle.
Le même Balzac, en composant Le Lys dans la Vallée, a suivi pas à pas un conte de la reine de Navarre ; c’est la même invention, les mêmes scènes, les mêmes péripéties, les mêmes personnages. Cependant, en prenant tout à son modèle, à chaque ligne, à chaque mot, à chaque virgule, le grand Tourangeau a fait œuvre de créateur, car le génie transfigure tout ce qu’il touche ! et il n’a pas du tout détruit l’historiette primitive ; la mère et l’enfant se portent bien. Et qui de nous oserait regretter que Balzac ait écrit Le Lys dans la Vallée et Le Père Goriot ?
Si je regarde un peu dans le passé, je vois tout de suite que le plus effronté des plagiaires est précisément le plus grand des poètes français : le divin, l’adoré, l’inimitable, le prodigieux La Fontaine ! Celui-là ne s’en cache pas, il dit les choses comme elles sont, il a toute honte bue, il ne prétend pas avoir inventé un seul des sujets de ses fables, et il écrit tout naïvement sur le titre : « Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine. » Oui, il les avait choisies où il avait voulu, partout, chez les anciens, chez les modernes, chez les contemporains, chez Abstémius, chez Aristote, chez Bidpaï, chez Lokman, chez Hippocrate, chez Pulci, chez Philoxène de Cythère, chez Planude, chez Plutarque, chez Regnier, chez madame de Sévigné, après quoi il les avait mises non seulement en vers, mais en chefs-d’œuvre ; il en avait fait cette comédie aux cent actes divers dont le décor est le monde entier ; il avait même sans scrupule dévalisé Homère, et croyez-vous qu’en prenant ces privautés, il eût détruit quelque chose ou quelqu’un qui eût le droit de vivre, Homère par exemple, ou Rabelais, ou Boccace ? Non, certes, nous possédons le trésor des Fables, et pour cela nous n’avons pas perdu l’Iliade, ni Gargantua, ni Le Décaméron ; nous avons acquis de nouvelles richesses sans être appauvris des anciennes, et pour nous dans cette affaire tout est gloire, orgueil, renommée justement acquise – et bénéfice !