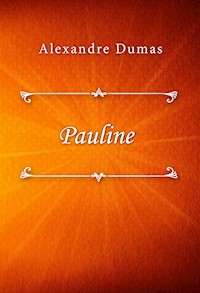
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pauline est un des premiers romans de Dumas. C’est un livre qu’il a écrit seul, et qui se déroule de son temps. La fiction brode sur les thèmes du roman gothique, en « noir », nuit, cottage en ruine, sentes perdues, passages secrets, brigands impitoyables, héroïne enterrée vivante, substitution de cadavres.
Pauline fait face à un bourreau mystérieux, « homme fatal ». C’est le roman d’une jeunesse déboussolée qui tente de se faire une place dans une société mesquine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alexandre Dumas
PAULINE
Copyright
First published in 1838
Copyright © 2018 Classica Libris
1
Vers la fin de l’année 1834, nous étions réunis un samedi soir dans un petit salon attenant à la salle d’armes de Grisier, écoutant, le fleuret à la main et le cigare à la bouche, les savantes théories de notre professeur, interrompues de temps en temps par des anecdotes à l’appui, lorsque la porte s’ouvrit et qu’Alfred de Nerval entra.
Ceux qui ont lu mon Voyage en Suisse se rappelleront peut-être ce jeune homme qui servait de cavalier à une femme mystérieuse et voilée qui m’était apparue pour la première fois à Fluélen, lorsque je courais avec Francesco pour rejoindre la barque qui devait nous conduire à la pierre de Guillaume Tell : ils n’auront point oublié alors que, loin de m’attendre, Alfred de Nerval, que j’espérais avoir pour compagnon de voyage, avait hâté le départ des bateliers, et, quittant la rive au moment où j’en étais encore éloigné de trois cents pas, m’avait fait de la main un signe, à la fois d’adieu et d’amitié, que je traduisis par ces mots : « Pardon, cher ami, j’aurais grand plaisir à te revoir, mais je ne suis pas seul, et... » À ceci j’avais répondu par un autre signe qui voulait dire : « Je comprends parfaitement. » Et je m’étais arrêté et incliné en marque d’obéissance à cette décision, si sévère qu’elle me parût ; de sorte que, faute de barque et de bateliers, ce ne fut que le lendemain que je pus partir ; de retour à l’hôtel, j’avais alors demandé si l’on connaissait cette femme, et l’on m’avait répondu que tout ce qu’on savait d’elle, c’est qu’elle paraissait fort souffrante et qu’elle s’appelait Pauline.
J’avais oublié complètement cette rencontre, lorsqu’en allant visiter la source d’eau chaude qui alimente les bains de Pfeffers, je vis venir, peut-être se le rappellera-t-on encore, sous la longue galerie souterraine, Alfred de Nerval, donnant le bras à cette même femme que j’avais déjà entrevue à Fluélen, et qui là m’avait manifesté son désir de rester inconnue, de la manière que j’ai racontée. Cette fois encore, elle me parut désirer garder le même incognito, car son premier mouvement fut de retourner en arrière : malheureusement le chemin sur lequel nous marchions ne permettait de s’écarter ni à droite ni à gauche ; c’était une espèce de pont composé de deux planches humides et glissantes, qui, au lieu d’être jetées en travers d’un précipice, au fond duquel grondait la Tamina sur un lit de marbre noir, longeaient une des parois du souterrain, à quarante pieds à peu près au-dessus du torrent, soutenues par des poutres enfoncées dans le rocher. La mystérieuse compagne de mon ami pensa donc que toute fuite était impossible ; alors, prenant son parti, elle baissa son voile et continua de s’avancer vers moi. Je racontai alors la singulière impression que me fit cette femme blanche et légère comme une ombre, marchant au bord de l’abîme sans plus paraître s’en inquiéter que si elle appartenait déjà à un autre monde. En la voyant s’approcher, je me rangeai contre la muraille afin d’occuper le moins de place possible. Alfred voulut la faire passer seule ; mais elle refusa de quitter son bras, de sorte que nous nous trouvâmes un instant à trois sur une largeur de deux pieds tout au plus : mais cet instant fut prompt comme un éclair ; cette femme étrange, pareille à une de ces fées qui se penchent au bord des torrents et font flotter leur écharpe dans l’écume des cascades, s’inclina sur le précipice et passa comme par miracle, mais pas si rapidement encore que je ne pusse entrevoir son visage calme et doux, quoique pâle et amaigri par la souffrance. Alors il me sembla que ce n’était point la première fois que je voyais cette figure ; il s’éveilla dans mon esprit un souvenir vague d’une autre époque, une réminiscence de salons, de bals, de fêtes ; il me semblait que j’avais connu cette femme au visage si défait et si triste aujourd’hui, joyeuse, rougissante et couronnée de fleurs, emportée au milieu des parfums et de la musique dans quelque valse langoureuse ou quelque galop bondissant : où cela ? je n’en savais plus rien ; à quelle époque ? il m’était impossible de le dire : c’était une vision, un rêve, un écho de ma mémoire, qui n’avait rien de précis et de réel et qui m’échappait comme si j’eusse voulu saisir une vapeur. Je revins en me promettant de la revoir, dussé-je être indiscret pour parvenir à ce but ; mais, à mon retour, quoique je n’eusse été absent qu’une demi-heure, ni Alfred ni elle n’étaient déjà plus aux bains de Pfeffers.
Deux mois s’étaient écoulés depuis cette seconde rencontre ; je me trouvais à Baveno, près du lac Majeur : c’était par une belle soirée d’automne ; le soleil venait de disparaître derrière la chaîne des Alpes, et l’ombre montait à l’orient, qui commençait à se parsemer d’étoiles. La fenêtre de ma chambre donnait de plain-pied sur une terrasse toute couverte de fleurs ; j’y descendis, et je me trouvai au milieu d’une forêt de lauriers-roses, de myrtes et d’orangers. C’est une si douce chose que les fleurs, que ce n’est point assez encore d’en être entouré, on veut en jouir de plus près, et, quelque part qu’on en trouve, fleurs des champs, fleurs de jardins, l’instinct de l’enfant, de la femme et de l’homme est de les arracher à leur tige et d’en faire un bouquet dont le parfum les suive et dont l’éclat soit à eux. Aussi ne résistai-je pas à la tentation ; je brisai quelques branches embaumées et j’allai m’appuyer sur la balustrade de granit rose qui domine le lac, dont elle n’est séparée que par la grande route qui va de Genève à Milan. J’y fus à peine, que la lune se leva du côté de Sesto, et que ses rayons commencèrent à glisser aux flancs des montagnes qui bornaient l’horizon et sur l’eau qui dormait à mes pieds, resplendissante et tranquille comme un immense miroir : tout était calme ; aucun bruit ne venait de la terre, du lac ni du ciel, et la nuit commençait sa course dans une majestueuse et mélancolique sérénité. Bientôt, d’un massif d’arbres qui s’élevait à ma gauche et dont les racines baignaient dans l’eau, le chant d’un rossignol s’élança harmonieux et tendre ; c’était le seul son qui veillât ; il se soutint un instant, brillant et cadencé, puis tout à coup il s’arrêta à la fin d’une roulade. Alors, comme si ce bruit en eût éveillé un autre d’une nature bien différente, le roulement lointain d’une voiture se fit entendre venant de Doma d’Ossola, puis le chant du rossignol reprit, et je n’écoutai plus que l’oiseau de Juliette. Lorsqu’il cessa, j’entendis de nouveau la voiture plus rapprochée ; elle venait rapidement ; cependant si rapide que fût sa course, mon mélodieux voisin eut encore le temps de reprendre sa nocturne prière. Mais cette fois, à peine eut-il lancé sa dernière note, qu’au tournant de la route j’aperçus une chaise de poste qui roulait, emportée par le galop de deux chevaux, sur le chemin qui passait devant l’auberge. À deux cents pas de nous, le postillon fit claquer bruyamment son fouet, afin d’avertir son confrère de son arrivée. En effet, presque aussitôt la grosse porte de l’auberge grinça sur ses gonds, et un nouvel attelage en sortit ; au même instant la voiture s’arrêta au-dessous de la terrasse à la balustrade de laquelle j’étais accoudé.
La nuit, comme je l’ai dit, était si pure, si transparente et si parfumée, que les voyageurs, pour jouir des douces émanations de l’air, avaient abaissé la capote de la calèche. Ils étaient deux, un jeune homme et une jeune femme : la jeune femme, enveloppée dans un grand châle ou dans un manteau, et la tête renversée en arrière sur le bras du jeune homme qui la soutenait. En ce moment le postillon sortit avec une lumière pour allumer les lanternes de la voiture, un rayon de clarté passa sur la figure des voyageurs, et je reconnus Alfred de Nerval et Pauline.
Toujours lui et toujours elle ! il semblait qu’une puissance plus intelligente que le hasard nous poussait à la rencontre les uns des autres. Toujours elle, mais si changée encore depuis Pfeffers, si pâle, si mourante, que ce n’était plus qu’une ombre ; et cependant ces traits flétris rappelèrent encore à mon esprit cette vague image de femme qui dormait au fond de ma mémoire, et qui, à chacune de ces apparitions, montait à sa surface, et glissait sur ma pensée comme sur le brouillard une rêverie d’Ossian. J’étais tout près d’appeler Alfred ; mais je me rappelai combien sa compagne désirait ne pas être vue. Et pourtant un sentiment de si mélancolique pitié m’entraînait vers elle que je voulus qu’elle sût du moins que quelqu’un priait pour que son âme tremblante et prête à s’envoler n’abandonnât pas sitôt avant l’heure le corps gracieux qu’elle animait. Je pris une carte de visite dans ma poche ; j’écrivis au dos avec mon crayon : « Dieu garde les voyageurs, console les affligés et guérisse les souffrants. » Je mis la carte au milieu des branches d’orangers, de myrtes et de roses que j’avais cueillies, et je laissai tomber le bouquet dans la voiture. Au même instant le postillon repartit, mais pas si rapidement que je n’aie eu le temps de voir Alfred se pencher en dehors de la voiture afin d’approcher ma carte de la lumière. Alors il se retourna de mon côté, me fit un signe de la main, et la calèche disparut à l’angle de la route.
Le bruit de la voiture s’éloigna, mais sans être interrompu cette fois par le chant du rossignol. J’eus beau me tourner du côté du buisson et rester une heure encore sur la terrasse, j’attendis vainement. Alors une pensée profondément triste me prit : je me figurai que cet oiseau qui avait chanté, c’était l’âme de la jeune fille qui avait dit son cantique d’adieu à la terre, et que, puisqu’il ne chantait plus, c’est qu’elle était déjà remontée au ciel.
La situation ravissante de l’auberge, placée entre les Alpes qui finissent et l’Italie qui commence, ce spectacle calme et en même temps animé du lac Majeur, avec ses trois îles, dont l’une est un jardin, l’autre un village et la troisième un palais, ces premières neiges de l’hiver qui couvraient les montagnes, et ces dernières chaleurs de l’automne qui venaient de la Méditerranée, tout cela me retint huit jours à Baveno ; puis je partis pour Arona, et d’Arona pour Sesto Calende.
Là m’attendait un dernier souvenir de Pauline ; là, l’étoile que j’avais vue filer à travers le ciel s’était éteinte ; là, ce pied si léger au bord du précipice avait heurté la tombe ; et jeunesse usée, beauté flétrie, cœur brisé, tout s’était englouti sous une pierre, voile du sépulcre, qui, fermé aussi mystérieusement sur ce cadavre que le voile de la vie avait été tiré sur le visage, n’avait laissé pour tout renseignement à la curiosité du monde que le prénom de Pauline.
J’allai voir cette tombe : au contraire des tombes italiennes, qui sont dans les églises, celle-ci s’élevait dans un charmant jardin, au haut d’une colline boisée, sur le versant qui regardait et dominait le lac. C’était le soir ; la pierre commençait à blanchir aux rayons de la lune : je m’assis près d’elle, forçant ma pensée à ressaisir tout ce qu’elle avait de souvenirs épars et flottants de cette jeune femme ; mais cette fois encore ma mémoire fut rebelle ; je ne pus réunir que des vapeurs sans forme, et non une statue aux contours arrêtés, et je renonçai à pénétrer ce mystère jusqu’au jour où je retrouverais Alfred de Nerval.
On comprendra facilement maintenant combien son apparition inattendue, au moment où je songeais le moins à lui, vint frapper tout à la fois mon esprit, mon cœur et mon imagination d’idées nouvelles ; en un instant je revis tout : cette barque qui m’échappait sur le lac ; ce pont souterrain, pareil à un vestibule de l’enfer, où les voyageurs semblent des ombres ; cette petite auberge de Baveno, au pied de laquelle était passée la voiture mortuaire ; puis enfin cette pierre blanchissante où, aux rayons de la lune glissant entre les branches des orangers et des lauriers-roses, on peut lire, pour toute épitaphe, le prénom de cette femme morte si jeune et probablement si malheureuse.
Aussi m’élançai-je vers Alfred comme un homme enfermé depuis longtemps dans un souterrain s’élance à la lumière qui entre par une porte que l’on ouvre ; il sourit tristement en me tendant la main, comme pour me dire qu’il me comprenait ; et ce fut alors moi qui fis un mouvement en arrière et qui me repliai en quelque sorte sur moi-même, afin qu’Alfred, vieil ami de quinze ans, ne prît pas pour un simple mouvement de curiosité, le sentiment qui m’avait poussé au-devant de lui.
Il entra. C’était un des bons élèves de Grisier, et cependant depuis près de trois ans il n’avait point paru à la salle d’armes. La dernière fois qu’il y était venu, il avait un duel pour le lendemain, et, ne sachant encore à quelle arme il se battrait, il venait, à tout hasard, se refaire la main avec le maître. Depuis ce temps Grisier ne l’avait pas revu ; il avait entendu dire seulement qu’il avait quitté la France et habitait Londres.
Grisier, qui tient à la réputation de ses élèves autant qu’à la sienne, n’eut pas plus tôt échangé avec lui les compliments d’usage, qu’il lui mit un fleuret dans la main, lui choisit parmi nous un adversaire de sa force ; c’était, je m’en souviens, ce pauvre Labattut, qui partait pour l’Italie, et qui lui aussi allait trouver à Pise une tombe ignorée et solitaire. À la troisième passe, le fleuret de Labattut rencontra la poignée de l’arme de son adversaire, et, se brisant à deux pouces au-dessous du bouton, alla, en passant à travers la garde, déchirer la manche de sa chemise, qui se teignit de sang. Labattut jeta aussitôt son fleuret ; il croyait, comme nous, Alfred sérieusement blessé.
Heureusement ce n’était rien qu’une égratignure ; mais, en relevant la manche de sa chemise, Alfred nous découvrit une autre cicatrice qui avait dû être plus sérieuse ; une balle de pistolet lui avait traversé les chairs de l’épaule.
– Tiens ! lui dit Grisier avec étonnement, je ne vous savais pas cette blessure ?
C’est que Grisier nous connaissait tous, comme une nourrice son enfant ; pas un de ses élèves n’avait une piqûre sur le corps dont il ne sût la date et la cause. Il écrirait une histoire amoureuse bien amusante et bien scandaleuse, j’en suis sûr, s’il voulait raconter celle des coups d’épée dont il sait les antécédents ; mais cela ferait trop de bruit dans les alcôves, et, par contrecoup, trop de tort à son établissement ; il en fera des mémoires posthumes.
– C’est, lui répondit Alfred, que je l’ai reçue le lendemain du jour où je suis venu faire assaut avec vous, et que le jour où je l’ai reçue je suis parti pour l’Angleterre.
– Je vous avais bien dit de ne pas vous battre au pistolet. Thèse générale : l’épée est l’arme du brave et du gentilhomme ; l’épée est la relique la plus précieuse, que l’histoire conserve des grands hommes qui ont illustré la patrie : on dit l’épée de Charlemagne, l’épée de Bayard, l’épée de Napoléon, qui est-ce qui a jamais parlé de leur pistolet ? Le pistolet est l’arme du brigand ; c’est le pistolet sous la gorge qu’on fait signer de fausses lettres de change ; c’est le pistolet à la main qu’on arrête une diligence au coin d’un bois ; c’est avec un pistolet que le banqueroutier se brûle la cervelle... Le pistolet... ! fi donc... ! L’épée, à la bonne heure ! c’est la compagne, c’est la confidente, c’est l’amie de l’homme ; elle garde son honneur ou elle le venge.
– Eh bien ! mais, avec cette conviction, répondit en souriant Alfred, comment vous êtes-vous battu il y a deux ans au pistolet ?
– Moi, c’est autre chose : je dois me battre à tout ce qu’on veut ; je suis maître d’armes ; et puis il y a des circonstances où l’on ne peut pas refuser les conditions qu’on vous impose...
– Eh bien ! je me suis trouvé dans une de ces circonstances, mon cher Grisier ; et vous voyez que je ne m’en suis pas mal tiré...
– Oui, avec une balle dans l’épaule.
– Cela valait toujours mieux qu’une balle dans le cœur.
– Et peut-on savoir la cause de ce duel ?
– Pardonnez-moi, mon cher Grisier, mais toute cette histoire est encore un secret ; plus tard vous la connaîtrez.
– Pauline ? ... lui dis-je tout bas.
– Oui, me répondit-il.
– Nous la connaîtrons, bien sûr... ? dit Grisier.
– Bien sûr, reprit Alfred ; et la preuve, c’est que j’emmène souper Alexandre, et que je la lui raconterai ce soir ; de sorte qu’un beau jour, lorsqu’il n’y aura plus d’inconvénient à ce qu’elle paraisse, vous la trouverez dans quelque volume intitulé Contes bruns ou Contes bleus. Prenez donc patience jusque-là.
Force fut donc à Grisier de se résigner. Alfred m’emmena souper comme il me l’avait offert, et me raconta l’histoire de Pauline.
Aujourd’hui le seul inconvénient qui existât à sa publication a disparu. La mère de Pauline est morte, et avec elle s’est éteinte la famille et le nom de cette malheureuse enfant, dont les aventures semblent empruntées à une époque ou à une localité bien étrangères à celles où nous vivons.
2
– Tu sais, me dit Alfred, que j’étudiais la peinture lorsque mon brave homme d’oncle mourut et nous laissa à ma sœur et à moi chacun trente mille livres de rente.
Je m’inclinai en signe d’adhésion à ce que me disait Alfred, et de respect pour l’ombre de celui qui avait fait une si belle action en prenant congé de ce monde.
– Dès lors, continua le narrateur, je ne me livrai plus à la peinture que comme à un délassement : je résolus de voyager, de voir l’Écosse, les Alpes, l’Italie : je pris avec mon notaire des arrangements d’argent, et je partis pour le Havre, désirant commencer mes courses par l’Angleterre.
Au Havre j’appris que Dauzats et Jadin étaient de l’autre côté de la Seine, dans un petit village nommé Trouville : je ne voulus pas quitter la France sans serrer la main à deux camarades d’atelier. Je pris le paquebot ; deux heures après j’étais à Honfleur et le lendemain matin à Trouville : malheureusement ils étaient partis depuis la veille.
Tu connais ce petit port avec sa population de pêcheurs ; c’est un des plus pittoresques de la Normandie. J’y restai quelques jours, que j’employai à visiter les environs ; puis, le soir, assis au coin du feu de ma respectable hôtesse, Madame Oseraie, j’écoutais le récit d’aventures assez étranges, dont, depuis trois mois, les départements du Calvados, du Loiret et de la Manche étaient le théâtre. Il s’agissait de vols commis avec une adresse ou une audace merveilleuse : des voyageurs avaient disparu entre le village du Buisson et celui de Sallenelles. On avait retrouvé le postillon les yeux bandés et attaché à un arbre, la chaise de poste sur la grande route et les chevaux paissant tranquillement dans la prairie voisine. Un soir que le receveur général de Caen donnait à souper à un jeune homme de Paris nommé Horace de Beuzeval et à deux de ses amis qui étaient venus passer avec lui la saison des chasses dans le château de Burcy, distant de Trouville d’une quinzaine de lieues, on avait forcé sa caisse et enlevé une somme de 70 000 francs. Enfin le percepteur de Pont-l’Évêque, qui allait faire un versement de 12 000 francs à Lisieux, avait été assassiné, et son corps, jeté dans la Touques et repoussé par ce petit fleuve sur son rivage, avait seul révélé le meurtre, dont les auteurs étaient restés parfaitement inconnus, malgré l’activité de la police parisienne, qui, ayant commencé à s’inquiéter de ces brigandages, avait envoyé dans ces départements quelques-uns de ses plus habiles suppôts.
Ces événements, qu’éclairait de temps en temps un de ces incendies dont on ignorait la cause, et qu’à cette époque les journaux de l’opposition attribuaient au gouvernement, jetaient par toute la Normandie une terreur inconnue jusqu’alors dans ce bon pays, très renommé pour ses avocats et ses plaideurs, mais nullement pittoresque à l’endroit des brigands et des assassins. Quant à moi, j’avoue que je n’ajoutais pas grande foi à toutes ces histoires, qui me paraissaient appartenir plutôt aux gorges désertes de la Sierra ou aux montagnes incultes de la Calabre qu’aux riches plaines de Falaise et aux fertiles vallées de Pont-Audemer, parsemées de villages, de châteaux et de métairies. Les voleurs m’étaient toujours apparus au milieu d’une forêt ou au fond d’une caverne. Or, dans tous les trois départements, il n’y a pas un terrier qui mérite le nom de caverne et pas une garenne qui ait la présomption de se présenter comme une forêt.
Cependant force me fut bientôt de croire à la réalité de ces récits : un riche Anglais, venant du Havre et se rendant à Alençon, fut arrêté avec sa femme à une demi-lieue de Dives, où il venait de relayer : le postillon, bâillonné et garrotté, avait été jeté dans la voiture à la place de ceux qu’il conduisait, et les chevaux, qui savaient leur route, étaient arrivés au train ordinaire à Ranville, et s’étaient arrêtés à la poste, où ils étaient restés tranquillement jusqu’au jour, attendant qu’on les dételât : au jour, un garçon d’écurie, en ouvrant la grande porte, avait trouvé la calèche encore attelée et ayant pour tout maître le pauvre postillon bâillonné. Conduit aussitôt chez le maire, cet homme déclara avoir été arrêté sur la grande route par quatre hommes masqués qui, par leur mise, semblaient appartenir à la dernière classe de la société, lesquels l’avaient forcé de s’arrêter et avaient fait descendre les voyageurs ; alors l’Anglais ayant essayé de se défendre, un coup de pistolet avait été tiré : presque aussitôt il avait entendu des gémissements et des cris ; mais il n’avait rien vu, ayant la face contre terre : d’ailleurs, un instant après, il avait été bâillonné et jeté dans la voiture, qui l’avait amené à la poste aussi directement que s’il eût conduit ses chevaux, au lieu d’être conduit par eux. La gendarmerie se porta aussitôt vers l’endroit désigné comme le lieu de la catastrophe : en effet on retrouva le corps de l’Anglais dans un fossé : il était percé de deux coups de poignard. Quant à sa femme, on n’en découvrit aucune trace. Ce nouvel événement s’était passé à dix ou douze lieues à peine de Trouville ; le corps de la victime avait été transporté à Caen : il n’y avait donc plus moyen de douter, eussé-je même été aussi incrédule que saint Thomas, car je pouvais, en moins de cinq ou six heures, aller mettre comme lui le doigt dans les blessures.
Trois ou quatre jours après cet événement et la veille de mon départ, je résolus de faire une dernière visite aux côtes que j’allais quitter : je fis appareiller le bateau que j’avais loué pour un mois, comme à Paris on loue un remise ; puis voyant le ciel pur et la journée à peu près certaine, je fis porter à bord mon dîner, mon bristol et mes crayons, et je mis à la voile, composant à moi seul tout mon équipage.
– En effet, interrompis-je, je connais tes prétentions comme marin, et je me rappelle que tu as fait ton apprentissage entre le pont des Tuileries et le pont de la Concorde, dans une embarcation au pavillon d’Amérique.
– Oui, continua Alfred en souriant ; mais cette fois ma prétention faillit m’être fatale : d’abord tout alla bien ; j’avais une petite barque de pêcheur à une seule voile, que je pouvais manœuvrer du gouvernail ; le vent venait du Havre et me faisait glisser sur la mer à peine agitée avec une rapidité vraiment merveilleuse. Je fis ainsi à peu près huit ou dix lieues dans l’espace de trois heures ; puis tout à coup le vent tomba, et l’océan devint calme comme un miroir. J’étais justement en face de l’embouchure de l’Orne ; : j’avais à ma droite le raz de Langrune et les rochers de Lion, et à ma gauche les ruines d’une espèce d’abbaye attenante au château de Burcy ; c’était un paysage tout composé ; je n’avais qu’à copier pour faire un tableau. J’abattis ma voile et je me mis à l’ouvrage.
J’étais tellement occupé de mon dessin que je ne saurais dire depuis combien de temps je travaillais lorsque je sentis passer sur mon visage une de ces brises chaudes qui annoncent l’approche d’un orage : en même temps la mer changea de couleur, et de verte qu’elle était devint gris de cendre. Je me retournai vers le large : un éclair sillonnait le ciel couvert de nuages si noirs et si pressés, qu’il sembla fendre une chaîne de montagnes ; je jugeai qu’il n’y avait pas un instant à perdre : le vent, comme je l’avais espéré en venant le matin, avait tourné avec le soleil ; je hissai ma petite voile et je mis le cap sur Trouville en serrant la côte afin de m’y faire échouer en cas de danger. Mais je n’avais pas fait un quart de lieue que je vis ma voile fasier contre le mât ; j’abattis aussitôt l’un et l’autre, car je me défiais de ce calme apparent. En effet, au bout d’un instant, plusieurs courants se croisèrent, la mer commença à clapoter, un coup de tonnerre se fit entendre ; c’était un avertissement à ne pas mépriser ; en effet, la bourrasque s’approchait avec la rapidité d’un cheval de course. Je mis bas mon habit, je pris un aviron de chaque main et je commençai à ramer vers le rivage.
J’avais à peu près deux lieues à faire avant de l’atteindre ; heureusement c’était l’heure du flux, et, quoique le vent fût contraire, ou plutôt qu’il n’y eût réellement point de vent, mais seulement des rafales qui se croisaient en tous sens, la vague me poussait vers la terre. De mon côté, je faisais merveille en ramant de toutes mes forces ; cependant la tempête allait encore plus vite que moi, de sorte qu’elle me rejoignit. Pour comble de disgrâce, la nuit commençait à tomber ; cependant j’espérais encore toucher le rivage avant que l’obscurité ne fût complète.
Je passai une heure terrible : mon bateau, soulevé comme une coquille de noix, suivait toutes les ondulations des vagues, remontant et retombant avec elles. Je ramais toujours ; mais, voyant bientôt que je m’épuisais inutilement, et prévoyant le cas où je serais obligé de me sauver à la nage, je tirai mes deux avirons de leurs crochets, je les jetai au fond de la barque, auprès de la voile et du mât, et, ne gardant que mon pantalon et ma chemise, je me débarrassai de tout ce qui pouvait gêner mes mouvements. Deux ou trois fois je fus sur le point de me jeter à la mer ; mais la légèreté de la barque même me sauva ; elle flottait comme un liège, et n’embarquait pas une goutte d’eau ; seulement il y avait à craindre que d’un moment à l’autre elle ne chavirât ; une fois je crus sentir qu’elle touchait ; mais la sensation fut si rapide et si légère, que je n’osai l’espérer. L’obscurité était d’ailleurs tellement profonde, que je ne pouvais distinguer à vingt pas devant moi ; de sorte que j’ignorais à quelle distance j’étais encore du rivage. Tout à coup j’éprouvai une violente secousse : il n’y avait plus de doute cette fois, j’avais touché ; mais était-ce contre un rocher ? était-ce contre le sable ? Une vague m’avait remis à flot, et pendant quelques minutes je me trouvai emporté avec une nouvelle violence. Enfin la barque fut poussée en avant avec tant de force, que, lorsque la mer se retira, la quille se trouva engravée. Je ne perdis pas un instant, je pris mon paletot et sautai par-dessus bord, abandonnant tout le reste ; j’avais de l’eau seulement jusqu’aux genoux, et, avant que la vague, que je voyais revenir comme une montagne, ne m’eût rejoint, j’étais sur la grève.
Tu comprends que je ne perdis pas de temps : je mis mon paletot sur mes épaules, et je m’avançai rapidement vers la côte. Bientôt je sentis que je glissais sur ces cailloux ronds, qu’on appelle du galet, et qui indiquent les limites du flux ; je continuai de monter quelque temps encore ; le terrain avait de nouveau changé de nature ; je marchais dans ces grandes herbes qui poussent sur les dunes : je n’avais plus rien à craindre, je m’arrêtai.
C’est une magnifique chose que la mer vue la nuit à la lueur de la foudre et pendant une tempête : c’est l’image du chaos et de la destruction ; c’est le seul élément à qui Dieu ait donné le pouvoir de se révolter contre lui en croisant ses vagues avec ses éclairs. L’océan semblait une immense chaîne de montagnes mouvantes, aux sommets confondus avec les nuages, et aux vallées profondes comme des abîmes ; à chaque éclat de tonnerre, une lueur blafarde serpentait de ces cimes à ces profondeurs, et allait s’éteindre dans des gouffres aussitôt fermés qu’ouverts, aussitôt ouverts que fermés. Je contemplais avec une terreur pleine de curiosité ce spectacle prodigieux, que Vernet voulut voir et regarda inutilement du mât du vaisseau où il s’était fait attacher ; car jamais pinceau humain n’en pourra rendre l’épouvantable grandiose et la terrible majesté. Je serais resté toute la nuit peut-être, immobile, écoutant et regardant, si je n’avais senti tout à coup de larges gouttes de pluie fouetter mon visage. Quoique nous ne fussions encore qu’au milieu de septembre, les nuits étaient déjà froides ; je cherchais dans mon esprit où je pourrais trouver un abri contre cette pluie : je me souvins alors des ruines que j’avais aperçues de la mer, et qui ne devaient pas être éloignées du point de la côte où je me trouvais. En conséquence, je continuai de monter par une pente rapide : bientôt je me trouvai sur une espèce de plateau ; j’avançai toujours, car j’apercevais devant moi une masse noire que je ne pouvais distinguer, mais qui, quelle qu’elle fût, devait m’offrir un couvert. Enfin un éclair brilla, je reconnus le porche dégradé d’une chapelle ; j’entrai, et je me trouvai dans un cloître ; je cherchai l’endroit le moins écroulé, et je m’assis dans un angle à l’ombre d’un pilier, décidé à attendre là le jour ; car, ne connaissant pas la côte, je ne pouvais me hasarder par le temps qu’il faisait à me mettre en quête d’une habitation. D’ailleurs j’avais, dans mes chasses de la Vendée et des Alpes, dans une chaumière bretonne ou dans un chalet suisse, passé vingt nuits plus mauvaises encore que celle qui m’attendait ; la seule chose qui m’inquiétât était un certain tiraillement d’estomac qui me rappelait que je n’avais rien pris depuis dix heures du matin, quand tout à coup je me rappelai que j’avais dit à Madame Oseraie de songer aux poches de mon paletot : j’y portai vivement la main ; ma brave hôtesse avait suivi ma recommandation : je trouvai dans l’une un petit pain et dans l’autre une gourde pleine de rhum. C’était un souper parfaitement adapté à la circonstance ; aussi, à peine l’eus-je achevé que je sentis une douce chaleur renaître dans mes membres, qui commençaient à s’ [...]





























