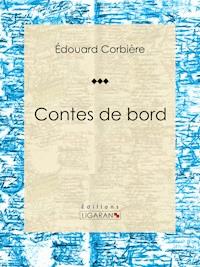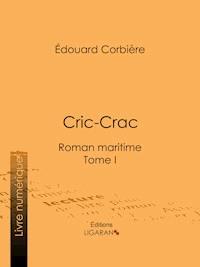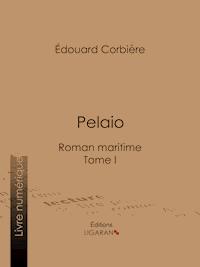
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La céleste Providence qui, dans ses décrets éternels, m'avait sans doute condamné à être marin, me fit naître dans la patrie des Duguay-Trouin et des Surcouf, entre le rocher sur lequel était adossée la cabane de mes parents et le rivage que baigne la rade de Saint-Servan. L'auteur de mes jours, Mathurin Flou, pauvre pêcheur s'il en fut jamais, ne salua pas mon avènement au monde avec ces transports de joie que, depuis Abraham jusqu'à nos jours..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La céleste Providence qui, dans ses décrets éternels, m’avait sans doute condamné à être marin, me fit naître dans la patrie des Duguay-Trouin et des Surcouf, entre le rocher sur lequel était adossée la cabane de mes parents et le rivage que baigne la rade de saint-serran. L’auteur de mes jours, Mathurin Flou, pauvre pêcheur s’il en fut jamais, ne salua pas mon avènement au monde avec ces transports de joie que, depuis Abraham jusqu’à nos jours, font éclater tous les pères, en recevant dans leurs bras le premier gage d’une longue postérité. Le malheureux homme, qui n’avait pour tout bien qu’une partie de la barque dont il était patron et le tiers d’un canot à l’aide duquel il essayait parfois un peu de contrebande sur les côtes d’Angleterre, ne vit pas, sans quelque inquiétude pour son propre avenir, le présage de la fécondité que lui faisait craindre ma mère. Mais, soit que le ciel prit en pitié la misère de Mathurin Flou, ou soit plutôt que la nature eût fait, en me créant, un effort qu’elle ne fut pas tentée de renouveler, je restai l’unique héritier présomptif de la cahutte que nous habitions, et qui, semblable à une grosse chaloupe chavirée la quille en l’air sur le sable, avait été construite des débris abandonnés d’un vieux bateau que le naufrage avait jeté autrefois sur le lieu même de notre domicile.
Le prénom tout hibérique que je reçus sur les fonts baptismaux, fut inspiré à Mathurin Flou par un souvenir de gloire auquel se mêla peut-être bien, dans ce moment, certaine réminiscence de friande cupidité. Ancien marin de l’État, il avait jadis contribué à faire, sur les Espagnols, une capture, dont il avait eu et bu sa petite part. Cette capture qui était un joli brick chargé de vin d’Alicante, s’appelait le Pelaïo, et pour consacrer dans sa famille la mémoire de ce fait d’armes que mentionnaient au reste ses états de services, mon père, au lieu de m’appeler Jacques, Pierre, Jean, Benoit ou Mathurin comme lui et comme tant d’autres, me donna le nom patronimique de la prise qui lui rappelait l’éclat d’un succès et le total tout aussi doux de la somme, qu’en sa qualité de capteur, il avait touchée au bureau des classes de son quartier.
Les pauvres gens se préoccupent bien rarement du sort futur de leurs enfants, quoiqu’ils soient cependant, parmi tous les êtres civilisés, ceux qui devraient songer le plus sérieusement à assurer à leurs rejetons, les moyens de subsister ou de parvenir. Mais, par l’effet d’une contradiction morale qui se retrouve à chaque instant dans les choses les plus ordinaires de la vie, il semblerait que la prévoyance des besoins de ce monde ne regarde exclusivement que les riches, et que les pauvres n’ont autre chose à faire qu’à abandonner à la providence du hasard, le soin de leur avenir ou de leur conservation.
J’avais atteint déjà l’âge de onze ans sans que mes parents eussent encore cherché à deviner le goût que je pourrais avoir pour un métier quelconque, et, par une bizarrerie que l’on remarque assez souvent chez les vieux marins, mon père, qui aurait dû voir avec satisfaction le penchant que je montrais pour son état, s’était obstiné à ne pas permettre que je partageasse avec lui les rudes travaux dans lesquels il allait chercher chaque jour son pain et le nôtre. Voilà, disait-il quelquefois en parlant de mes dispositions maritimes, voilà un enfant qui tourne autour du pot pour arriver à manger à la même gamelle que moi : ça voudrait déjà, je le vois bien, être mousse à la pêche. Mais je lui déclare sec et ferme que s’il s’entête à prendre le scélérat d’état que je fais depuis vingt-cinq ans à la damnation de mon âme, je lui tordrai le cou net comme à un canard.
Cette aversion profonde de maître Mathurin pour la noble profession qu’il avait exercée toute sa vie, prenait surtout sa source dans l’inutilité des efforts qu’il avait faits jusque-là pour élever convenablement sa petite famille en allant chaque matin ou chaque nuit, demander aux flots, aux vents et aux hasards de la contrebande, la subsistance de la journée. Sa haine contre son métier n’était inspirée, comme on le voit, que par un honorable motif ; mais quelque excusable que fût sa colère à peu près continuelle contre les inconvénients de sa position, nous n’en avions pas moins, ma mère et moi, à supporter assez souvent les effets de la maritale et paternelle irritabilité de maître Mathurin.
Ma mère, fort heureusement pour elle et pour moi, avait reçu du ciel une de ces bonnes et belles humeurs conjugales contre lesquelles viennent se briser tous les orages de la vie domestique. Jamais je n’ai vu de femme plus résignée à la misère et plus riante au sein de l’indigence. On aurait dit, à la voir toujours alerte et réjouie, qu’elle se plaisait à braver par stoïcisme toute notre mauvaise fortune et les privations que lui imposait une à une la nécessité. Mon père l’avait trouvée servante d’auberge à Matignon. La grosse et belle fille avait plu au jeune et sauvage matelot. Ces deux pauvres êtres, plutôt faits pour vivre tant bien que mal ensemble, que pour ne plus former qu’une seule et même nature, avaient mis en commun leurs misères et leurs espérances ; et c’est à cette union que je dus, douze ans après l’établissement du nouveau couple sur la grève de Saint-Servan, ce que les gens contents de leur sort continuent, même en parlant des malheureux, à appeler le bienfait de l’existence.
La religion, qui n’est considérée par quelques philosophes que comme un frein aux mauvaises passions du vulgaire, devient quelquefois, pour les âmes simples et fortes, la source des plus nobles et des plus aimables vertus. La confiance un peu aveugle que ma mère avait placée en Dieu, paraissait lui rendre sa résignation toujours facile ; et quand mon père s’emportait le plus violemment contre ce qu’il appelait, dans son langage trivial, la canaillerie du sort, l’enjouement inaltérable que la bonne Jacquette opposait à l’aigreur de ses plaintes, parvenait presque toujours à ramener cette espèce d’esprit malade à des senti mens plus paisibles. Une assez vive teinte de superstition se mêlait, il est vrai, dans l’imagination de Jacquette, à la pieuse soumission dont elle nous donnait l’exemple ; mais la crédulité de cette excellente femme était remplie de tant de bonne foi, que personne au monde n’aurait eu, j’en suis sûr, le courage de condamner chez elle une faiblesse à laquelle elle savait pour ainsi dire donner l’apparence d’une évangélique humilité.
J’ai dit qu’outre les ressources assez bornées que maître Mathurin trouvait dans son métier de pêcheur et dans le peu de pilotage que lui procuraient parfois les navires rencontrés au large, il cherchait à l’occasion, dans la contrebande, les moyens d’augmenter les minces profils de son état de marin. À l’époque dont j’ai à parler, la fraude était encore en assez grand honneur sur les côtes de la Normandie et de la Bretagne. Saint-Malo, situé à quelques lieues des îles anglaises de Jersey et de Guernesey offrait aux smogleurs, tant anglais que français, des avantages que les autres points du littoral ne possédaient pas au même degré. En partant au commencement de la nuit avec beau temps, soit d’une de ces îles ou de la côte de France, les fraudeurs pouvaient aisément débarquer, au lieu de destination, les marchandises dont ils étaient chargés, et revenir avant le jour à l’endroit d’où ils étaient partis avec le soir. Aussi, dans les longues nuits d’hiver, n’était-il pas rare de voir les barques françaises et anglaises s’échappant à la fois, les unes de Saint-Malo et les autres des îles voisines, venir se croiser deux fois dans leur trajet ; les premières pour déposer leur fraude sur le sol de nos voisins, et les autres pour introduire sur nos côtes leurs articles de prohibition. Cet échange incessant de produits frustrés au nez du fisc, et contre lequel les deux gouvernements qui en étaient victimes ne se lassaient pas de protester, ne se faisait pourtant qu’avec l’autorisation et sous les yeux de chacun de ces gouvernements. Et en effet, comme chaque barque française ne partait que chargée de marchandises indigènes dont l’exportation était permise, il était de l’intérêt de la France de favoriser ce débouché, et c’était à la douane anglaise seule de s’armer pour nous le fermer rigoureusement ; et d’un autre côté, comme les fraudeurs anglais appareillaient de leur pays avec des produits qu’ils tiraient de leurs manufactures, il n’y avait que la maltôte et la gabelle françaises qui pussent trouver mauvais qu’on cherchât à infester nos rivages de ces objets étrangers. Des bateaux français, par exemple, qui auraient voulu à la fois couper sur les côtes d’Angleterre pour y jeter de la fraude, et revenir chargés de contrebande anglaise pour l’introduire sur notre territoire, auraient infailliblement couru deux risques pour un, et n’eussent pas manqué d’être saisis, surtout en rentrant au port du départ, où toujours ils étaient attendus. Mais en combinant entre les aventuriers des deux nations, le service de la contrebande de manière à laisser à chacun le soin de faire sa fraude sur la côte étrangère, le smoglage allait son petit train et faisait vivre les smogleurs des deux pays dans la meilleure intelligence du monde, quoique sous des bannières différentes et en vue du même intérêt.
Cependant ce rude métier, qui avait son attrait comme toutes les carrières hasardeuses, ne laissait pas que d’avoir aussi de temps à autre ses mécomptes et ses tribulations. Outre le danger que l’on courait à aborder des côtes toujours palissadées de douaniers, on risquait à tout moment de rencontrer à la mer des avisos impitoyables qui, sous le nom de cotres du costum-house, en Angleterre, et sous celui de pataches ou de gardes-pêche, en France, appuyaient aux malheureux fraudeurs de la nation opposée des chasses, dont la brutalité égalait presque toujours l’opiniâtreté.
Comme la plupart des officiers et des équipages qui montaient ces sortes de bâtiments de la gendarmerie maritime, avaient vécu au milieu des gros péchés qu’ils étaient habitués à faire expier sévèrement à leurs pénitents, il était souvent assez difficile de mettre leur vigilance en défaut et d’inventer des ruses propres à tromper leur inquiète pénétration. Toutefois, dans cette guerre interminable de roueries et d’embûches, que se livraient les fraudeurs et leurs ennemis naturels, sur une certaine partie de l’espace compris entre les côtes d’Angleterre et celles de France, il arrivait quelquefois qu’à force d’invention et de témérité, les smogleurs parvenaient encore à apprendre, aux vieux routiers du fisc, des tours que leur longue expérience ne leur avait pas fait deviner et dont leur amour-propre de redresseurs de torts pouvait avoir à rougir.
Les petites embarcations longues et légères convenaient généralement mieux pour accomplir ces courses aventureuses, que les caboteurs d’une certaine dimension, trop lourds dans le calme ou les faibles brises, et trop visibles à l’œil perçant des garde-côtes. La grande contrebande se faisait néanmoins sur des sloops, des chasse-marées ou des goélettes, lorsque l’espace à exploiter offrait beaucoup de route à parcourir. Mais la petite contrebande ne se pratiquait guère qu’avec des pirogues ou des canots habilement construits pour ce genre de lamanage interlope.
Pour qu’une de ces pirogues, destinée à ne faire en quelque sorte qu’une navigation de voisinage, fût jugée bonne par les connaisseurs, il fallait que les canotiers qui la montaient pussent aisément la porter sur leurs épaules. Cinq, sept ou même neuf hommes y compris le patron, bordaient les quatre, six ou huit avirons du canot. Avec le vent favorable, on matait de petits bouts de bois sur lesquels on orientait deux légères voiles latines et un foc. Mais dans le calme, c’était à la rame que l’on cherchait, en donnant un bon coup de nage, à fuir les gardes-côtes suspects, ou à accoster vivement et finement la terre promise.
Afin d’être moins facilement aperçus pendant le jour, soit des vigies des pataches ou des douaniers perchés sur les parties les plus élevées du rivage, on enveloppait d’une toile blanche toute la partie extérieure de la pirogue. Les canotiers eux-mêmes s’habillaient en toile, et se coiffaient d’un chapeau ou d’un bonnet blanc ; c’était là ce qu’ils appelaient faire la toilette du matin à l’équipage et au bateau. Le soir, au contraire, pour tromper, les regards ennemis, on déshabillait la pirogue pour laisser à nu son bordage noir, et les hommes reprenaient leurs vêtements de gros drap bleu ou brun ; les voiles mêmes dont on se servait alors, étaient des voiles tannées soit en rouge foncé, soit en goudron, pour ne pas blanchir au clair de lune, ou pour mieux se confondre avec l’obscurité de la nuit.
Chaque aviron était garni au portage du plabord avec de la flanelle ou de la lisière. Les plus prévoyants allaient jusqu’à faire doubler de serge la pelle, c’est-à-dire l’extrémité destinée à plonger dans l’eau, pour amortir du mieux possible le bruit que les rames devaient produire en grinçant sur le tolet ou la toletière, et en frappant la mer à coups égaux.
Rases comme une planche, légère comme une mauve, et obéissant avec la souplesse d’un plongeon à tous les caprices de la lame qui les cachait à chaque mouvement dans ses mobiles replis, il était bien rare que les pirogues fussent aperçues au large par les chasseurs, qu’elles mettaient toute leur attention à guetter et toute leur agilité à fuir. Pour peu que, poussées par une brise qui arrondissait fraîchement leur souple voilure, elles vinssent à découvrir de loin un navire suspect, vite elles abattaient leur mâture, pliaient leur toile, et se faisaient le plus petites possible pour échapper à la vue, à la curiosité ou à la poursuite du bâtiment rencontré. En accostant la terre à l’aviron et presque toujours la nuit ou de temps brumeux, elles avaient soin de choisir pour point de contact avec le rivage, les excavations de rochers, les criques bien sombres formées dans les falaises, et enfin les endroits les plus cachés et les moins accessibles ; car, ainsi que le disaient les smogleurs eux-mêmes : « Pour bien pondre sa fraude, il fallait faire comme les oiseaux de mer, placer son nid à la vue du ciel, et le plus loin possible de la malice des hommes. »
Pour bien exécuter un coup de flibuste, nous parlons ici le langage des gens de l’art, deux choses étaient indispensables : de bons lurons en partant, et un fin dénicheur d’œufs frais au point d’arrivée. Avec l’intelligence complète de la pratique du métier et la connaissance des localités, un correspondant actif devinait, à la direction de la brise et à la nature du temps, l’endroit où aborderait l’embarcation qu’il attendait ; et si de leur côté, les douaniers et les pataches établissant leurs calculs d’après les mêmes circonstances, arrivaient au même résultat que le correspondant pour en tirer un parti tout contraire, il fallait que celui-ci trouvât le moyen de prévenir ses complices du danger qu’ils courraient en accostant le rivage ; et ordinairement, soit la nuit, soit le jour, des signaux de convention, exécutés sur la côte, avertissaient à temps les smogleurs de se tenir au large, pour y attendre le moment favorable de tenter le débarquement.
Quelques-uns de ces braves esquiveurs d’impôts, pour éviter le risque attaché à voir les douaniers de trop près, coulaient à fond à une distance respectable du rivage et dans des caisses ou des barils hermétiquement fermés, les objets qui composaient leur chargement. Les correspondants, instruits d’avance par une lettre détaillée de l’endroit où ils devraient aller pêcher leurs commandes, venaient eux-mêmes de terre, soulever dans leurs canots, le chapelet de colis sur lesquels les importateurs avaient eu la précaution d’attacher un orin et une bouée flottante. Mais comme la douane-navigante avait aussi le soin de visiter toutes les bouées de pêcheurs qu’elle voyait surnager à l’aventure, il advenait quelquefois que les correspondants, arrivant sur le fond, d’où ils croyaient exhumer leur trésor du sein de l’onde, ne trouvaient plus à sa place qu’un mouillage déjà visité et dragué par les griffes de la fiscalité.
Le seul expédient auquel on pût avoir recours pour soustraire aux recherches des pataches la contrebande coulée, était de l’envoyer tout simplement par le fond sans orin de mouillage et sans bouée indicative, et d’informer les correspondants des points de remarque qu’il leur faudrait prendre à terre pour trouver l’endroit où l’on devrait draguer pour trouver les objets ainsi confiés à la discrétion des flots. Ces perquisitions sous-marines, qui demandaient toujours du temps, avaient de plus l’inconvénient de signaler les dragueurs à l’attention des douaniers et de mettre ceux-ci sur la trace de la partie du fond qu’ils devraient racler pour exercer la saisie des morceaux que leur friandise accoutumée avait déjà flairés. Mais quelque pénible et quelque chanceux que fût ce moyen de contrebande, c’est encore celui qui, jusqu’ici, a le mieux réussi et qui se trouve de nos jours mêmes le plus fréquemment employé par les praticiens dont une longue expérience a dû perfectionner le talent dans un siècle aussi progressif que le nôtre en toutes choses.
Le tort réservé aux fraudeurs français surpris flagrante delicto, ne leur laissait ni incertitude ni illusion. On sciait bien proprement et très légalement leur barque ou leur pirogue en deux, au moyen d’un large trait de scie, et ceux-ci étaient jetés en paquet dans un cachot jusqu’à ce qu’il plût au gouvernement de leur nation, de les réclamer comme sujets du roi, quand le gouvernement n’avait rien de mieux à faire ni à demander.
C’était à ce joli métier que mon respectable père consacrait une partie de ses loisirs, lorsque la pêche donnait peu et que le pilotage ne rendait plus.
Aussi toutes les fois que je le voyais hâler son lourd bâtiment, à sec près de notre cabane, pour s’embarquer en jurant, comme à son ordinaire, dans la pirogue où lui et ses quatre compagnons attachaient une longue file de petits barils d’eau-de-vie, je me disais tristement en les regardant faire et s’éloigner ensuite avec les premières ombres du soir : Ils vont à un coup de fraude et papa n’a pas voulu de moi !
J’ai dû, avant d’aller plus avant dans le récit des petits évènements dont ma carrière a été semée, plus que, remplie, entrer dans les détails un peu techniques que l’on vient de lire et qui m’ont semblé nécessaires à l’intelligence des faits que je me propose de retracer au lecteur.
À quelques centaines de pas du bateau renversé que nous habitions, s’élève un antique donjon, appelé la Tour-de-Solidor, et qui a donné son nom au petit port sur la rive duquel il est assis depuis environ cinq siècles. Construit par Jean V, duc de Bretagne, pour forcer l’évêque de Saint-Malo, Josselin de Rohan, à lui rendre hommage, cette vaste masure féodale devint, sous la monarchie, un lieu de détention pour les prisonniers de marque pendant la guerre, et une sorte de magasin pour les navires de l’État pendant la paix.
La garde de la Tour-de-Solidor devait, comme on le comprendra aisément, perdre une grande partie de son importance, lorsqu’aucun détenu n’occupait ses murs, et que sous ses voûtes épaisses on ne déposait que les quelques bouts de cordage et de mâture dont on avait dégarni les bâtiments désarmés dans le port de Solidor. Aussi, bien qu’autrefois le commandement de ce poste eût été confié à un officier supérieur, on avait jugé que depuis la paix, un sous-officier pourrait fort convenablement remplir tout à la fois, à l’entrée de la vieille ruine militaire, les fonctions de gouverneur, de concierge et de portier.
Un ancien sergent du Régiment des Vaisseaux, avait été depuis quelques années investi de ces trois attributions, réunies en un seul fonctionnaire, pour avoir bravement perdu à la prise de la Grenade, son bras droit et son œil gauche du même coup de mitraille. Au lieu de n’accorder qu’une modique retraite au vieux soldat mutilé, on l’avait enchaîné dans une niche à la porte de la citadelle abandonnée ; et comme l’amour-propre des héros qui ont fait leur temps, sait presque toujours tourner les plus petites choses du côté de leur vanité, le sergent. Crochard se faisait ou se laissait complaisamment appeler par ses amis, commandant du château dont il n’était à peu près que le chien de garde. Aussi fallait-il voir les airs de dignité et d’autorité que se donnait notre invalide, quand la flatterie de ceux qui allaient visiter son château jadis fort, s’amusait jusqu’à lui donner le titre de gouverneur ! Je crois qu’alors le brave homme aurait été capable de pousser la folie jusqu’à lever l’étendard de la révolte à la tête des cinq ou six vétérans éclopés qui composaient sa garnison, pour peu qu’on eût voulu ébranler sa fidélité, au profit de son orgueil et de son ambition.
Cet infirme guerrier était au surplus un des amalgames humains les plus incohérents et les plus plaisants que l’on puisse s’imaginer. Fils d’un ancien maître-valet d’une société de jésuites, il avait appris dans son enfance à lire assez couramment quelques auteurs, pour les citer à tout moment et à tout propos, mais en brouillant tellement leurs maximes et en altérant si singulièrement leur texte, qu’il devenait presque toujours aussi difficile de comprendre son baragouin littéraire, que de ne pas lui rire au nez. Grand politique avant tout et philosophe très voltairien, parce que, disait-il, il avait été élevé trop près d’une jésuitière, il vous entassait dans toutes ses conversations et avec tant de précipitation et de confiance, Montesquieu sur Pascal, les encyclopédistes sur Port-Royal, Solon sur Licurgues, Rome sur Athènes, et Ninon de l’Enclos sur madame de Maintenon, que l’on aurait été fort embarrassé de le suivre dans son escalade, pour peu qu’on se fût avisé de prendre un instant au sérieux la grotesque universalité de ce pauvre fou.
Une petite fille de mon âge était restée au sergent Crochard d’un mariage fort équivoque, dont il avait à peu près oublié la date, lui qui pourtant se piquait d’être un chronologiste de certaine force. L’intéressante enfant, à laquelle le guerrier du Régiment des Vaisseaux, se flattait d’avoir donné le jour, se nommait Angélique, et quoique sans ressembler à son héroïque père, qui n’avait dû être rien moins que beau, même avant la prise de Grenade, la petite fût presque laide, elle avait tant de gentillesse dans les manières et un son de voix si doux et si fin, que ma mère, la bonne Jacquette, s’était éprise pour elle d’une partie de la tendresse maternelle qu’elle avait pour moi. Mais loin de concevoir de la jalousie du sentiment qu’Angélique avait inspiré à mes parents, je me montrais au contraire heureux de partager avec elle l’affection des êtres que j’aimais le plus au monde.
Mon père et le sergent Crochard se voyaient comme voisins et s’estimaient mutuellement en leur qualité d’anciens serviteurs. Mais, malgré les relations assez intimes qui existaient entre nos deux familles, il s’en fallait beaucoup que les caractères des deux amis fussent de nature à établir entre eux des rapports toujours sympathiques. Le commandant de Solidor, avec ses prétentions à la science et à la philosophie, croyait avoir sur son voisin une supériorité intellectuelle trop évidente pour qu’elle put être toujours incontestée. Mathurin Flou, de son côté, malgré toute la déférence qu’il était disposé à accorder aux hautes lumières du commandant, ne laissait pas quelquefois, avec son entêtement et sa brusquerie ordinaires, de secouer violemment le joug qu’on prétendait lui imposer et de ce choc d’humeurs diverses il jaillissait souvent entre les deux voisins des étincelles de colère que ma mère avait seule le pouvoir d’éteindre quand elle n’avait pas eu le bonheur de les prévenir ; car il faut le dire, Jacquette était parvenue à inspirer à mon père et au commandant surtout, un sentiment de respect qu’aucun d’eux n’aurait jamais osé oublier ou méconnaître, même dans l’animosité de leurs plus vives contestations.
Entre gens qui ne possèdent pas le grand art du savoir-vivre, les querelles ont presque toujours les motifs les plus futiles ou le prétexte le plus déraisonnable, et je me rappelle à ce propos le grave sujet qui, après avoir brouillé les deux voisins, eut pour eux et pour nous des suites que je ne dois pas passer sous silence.
Le sergent Crochard, entre autres manies plus ou moins ridicules, avait conçu contre ce qu’il appelait les doubles-emplois et le pléonasme des superfluités, la haine la plus systématique. L’idée fixe de ramener toute chose à la plus grande simplicité possible, s’était si fortement emparée de son esprit, qu’après avoir exigé que sa fille retirât de son habit la manche que ne pouvait remplir le bras qu’il n’avait plus, il alla lui-même jusqu’à faire sauter de ses lunettes le verre qui se trouvait du côté de l’œil qui lui manquait. La grande et invincible raison qu’il alléguait pour justifier cette double suppression, était que tout homme à qui il manquait un bras avait toujours assez d’une manche et de la moitié d’une paire de lunettes pour faire sa besogne à demi et pour n’y voir qu’à moitié clair. Un jour, mon respectable père, qui n’avait pas tenu assez exactement compte de l’austérité somptuaire de notre Lacédémonien, osa se présenter à lui, chaussé d’une vieille paire de bottes à retroussis, que le pauvre diable avait reçue de la munificence de quelque fashionable de Saint-Servan. À la vue de cette chaussure aristocratique, le commandant de Solidor demanda à son voisin la raison pour laquelle il portait des bottes dont la tige se trouvait surchargée fort inutilement d’un double-cuir ?
– Ma foi, lui répondit Mathurin, je les porte telles qu’on me les a données, parce que ce n’est pas moi qui les ai commandées comme ça, et qu’elles me vont aussi bien avec des retroussis qu’autrement.
– Beau raisonnement pour un homme qui n’a pas tout à fait perdu le sensum commune, s’écria Crochard. C’est absolument comme si j’avais dit, lorsqu’on m’a apporté mon dernier habit d’uniforme : le tailleur me l’a fait ainsi, et il faut que je l’endosse avec deux manches pour un seul bras, parce qu’il a plu à mon tailleur d’être plus stupide que moi.
– Oh ! je sais bien, répliqua Mathurin, que vous avez fait raser une de vos manches à votre frac d’ordonnance, pour éviter ce que vous nommez le double emploi. Mais aussi, tout le monde s’est moqué de vous, et moi j’aime mieux porter mes bottes à retroussis, que de faire rire à mes dépens un tas de chenapans comme ceux qui vous tournent en bourrique.
– Ceux qui rient d’une chose rationnelle sont des imbéciles !
– Mais comment nommez-vous ceux qui paient à rire de gaîté de cœur à ces imbéciles-là ?
– Maître Mathurin, vous ne savez pas assez souvent ce que vous dites !
– Sergent Crochard, je crois que vous battez la campagne plus souvent qu’à votre tour de rôle.
À ce mot de sergent Crochard, articulé avec l’intention trop apparente de blesser la chatouilleuse dignité du commandant de Solidor, le fonctionnaire outré de colère jeta, du haut de sa supériorité outragée, un regard de mépris sur le pêcheur grossier, et disparut aux yeux de son interlocuteur, pour aller dévorer dans sa niche son trop juste dépit et sa muette indignation.
À la suite de cette chicane, dont la conséquence avait été une rupture fort nette, un raccommodement devenait difficile à opérer, eût-il même été entrepris par ma mère. Mais, quoique les deux anciens voisins eussent cessé de se voir, aucun d’eux fort heureusement n’avait songé à pousser l’animosité jusqu’à vouloir prescrire à leurs enfants l’éloignement qu’ils s’étaient imposé à eux-mêmes. La petite Angélique, qui voyait dans Jacquette une mère, et qui pour moi était devenue une sœur, semblait au contraire se rapprocher de nous, avec d’autant plus de plaisir dans tous ces moments de crises passagères, que son père paraissait plus irrité de la résistance qu’il rencontrait quelquefois dans l’opiniâtreté de maître Mathurin.
– Vois-tu, Pelaïo, me disait-elle souvent avec la naïveté de sa précoce raison, mon père ne veut jamais avoir tort, et le tien ne veut jamais lui céder. Ils finiront, sois-en sûr, par se brouiller tout de bon. Mais promets-moi de m’aimer toujours, comme je te promets de toujours aimer ta mère et toi. Quand les parents ont des raisons pour se détester, est-ce qu’il faut aussi que les enfants ne s’aiment plus ?
– Non, Angélique, disais-je alors à cette gentille enfant ; nous serons toujours frère et sœur nous autres, qui avons chacun un père, mais qui n’avons qu’une mère pour tous les deux. Eh bien ! si le commandant et maître Mathurin se séparent parce qu’ils se disputent sans cesse, qu’ils nous laissent ensemble, nous qui nous arrangeons si bien !
Ton père, d’ailleurs, te fais si souvent pleurer…
– Oui, c’est vrai, mais quand il n’a pas toutes ces vilaines idées en tête, il est bon pour moi ! Tiens, c’est comme le tien, quand il gronde ta mère, et qu’ensuite il lui demande pardon de lui avoir fait du chagrin.
– Ah ! sans doute, tu as raison, Angélique, il faut aimer ses parents comme ils sont, et sa mère surtout, quand elle est bonne comme la nôtre. Mais il faut que les enfants s’aiment bien aussi entre eux, n’est-ce pas ?
Et, lorsque dans notre babillage ingénu, nos deux petites âmes s’étaient épanchées l’une dans l’autre avec cette innocence que l’on n’a qu’à douze ans, les confidences arrivaient, et les secrets de l’existence des deux ménages faisaient souvent les frais de ces sortes d’entretien, dans lesquels chacun de nous laissait percer, sans le savoir, cet instinct d’observation et d’indiscrétion dont les enfants sont en général si amplement doués.
Un jour, Angélique vint me trouver avec un petit air de mystère, qui m’annonça tout d’abord qu’elle avait à m’apprendre tout autre chose qu’un de ces riens que nous étions habitués à nous confier comme s’il se fût agi des plus grandes affaires du monde.
– Tu ne sais pas, me dit-elle, hier au soir, il est arrivé à la Tour un prisonnier, avec une femme et une toute petite fille ?
– Et que va-t-on en faire, demandai-je à Angélique ?
– Ah ! pour cela, papa ne l’a pas dit ; mais il croit que ça lui fera beaucoup d’honneur, et qu’à présent qu’il a des prisonniers d’État à garder, on ne s’avisera plus de l’appeler sergent Crochard, comme l’a encore dernièrement fait ton père.
– Comme ça, il a dit hier lui-même, que c’était un prisonnier d’État ?
– Ah ! mon Dieu oui, et il l’a fait mettre dans la petite chambre basse qui donne là sur la rade, du côté du port Saint-Père.
– Eh sais-tu, Angélique, ce que c’est qu’un prisonnier d’État ?
Non, mais je crois que ce doit être quelqu’un de bien riche.
Si nous pouvions faire sortir celui-là de sa prison ?
– Et pourquoi, puisque papa l’a fait renfermer pour le garder ?