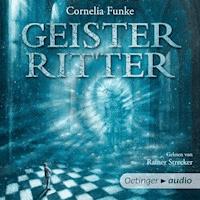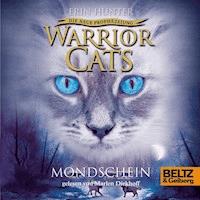Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
L’éducation nationale a toujours eu cette arrogance du « mammouth » comme l’a présentée Claude Allègre, ancien ministre de cette illustre maison face à cette école de la 2ème, voire 3ème et si ce n’est dernière chance qu’a longtemps constitué l’enseignement agricole. Innovant pédagogiquement, ancré sur les territoires, il a cependant toujours été au rendez-vous de la réussite des jeunes.
Il a fait depuis de nombreuses années l’expérience de la mixité sociale, de la réussite scolaire en offrant des parcours de très haut niveau, tout en accueillant des jeunes abîmés par un système éducatif qui les rend un peu trop invisibles.
La pédagogie de projet sur laquelle il s’appuie constitue un des facteurs de sa réussite, comme la taille familiale de ses établissements ou bien la qualité des professeurs qui ont lait le choix de cet enseignement. Et si l’enseignement agricole était finalement ce trésor du système éducatif ? Pétri d’histoire, d’ancrage sur les territoires, bénéficiant d’une autonomie responsable, il a bénéficié d’une forme de construction en perpétuel mouvement. Michel Rocard, un de ses emblématiques ministres, n’y a pas été pour rien. Mais pour qu’il demeure un enseignement à haute valeur éducative, encore faut-il innover encore et toujours…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Economiste,
Bertrand Gaufryau a été expert-associé au Bureau International du Travail, en charge du développement des micro-entreprises en Afrique noire francophone. Il a enseigné en France et au Canada, dans le secondaire et le supérieur avant de devenir chef d’établissement dans l’enseignement agricole, fonction qu’il exerce depuis 25 ans. Citoyen engagé, militant de la pédagogie, il est aussi assesseur au tribunal pour enfant depuis 2009.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Titre
Petit éloge d’une école qui va bien…
Vive l’enseignement agricole !
de Bertrand Gaufryau
Le temps d’un roman
Editeur
Collection «Essai»
Introduction…
Il faut parfois du temps. Laisser du temps au temps, disait avec malice l’ancien Président François Mitterrand. Cet incroyable rapport au temps, souvent intime et difficilement explicable m’a amené à vous écrire. L’idée saugrenue m’est venue de raconter celle de 25 années au service de l’enseignement agricole. Peut-être non sous forme académique ou trop sérieuse mais un peu toutefois. Pas de pédagogie de pédagogues ou une histoire d’historiens, mais celle d’une rencontre, d’une volonté, d’un chemin. Car l’école n’est pas simplement affaire de spécialistes, de sachants, mais de tout citoyen engagé. Alors, je vous propose de plonger au cœur de ce que l’enseignement agricole offre de meilleur et de découvrir quelques illustrations singulières. Embarquons pour ce voyage inédit.
Il était une fois...
Je voudrais vous raconter une histoire, celle d’une école qui pourrait aider des jeunes à réussir, à vivre une insertion professionnelle et sociale réelle, à devenir des citoyens soucieux des questions de société. Je voudrais vous raconter l’histoire d’une pédagogie qui sans faire de bruit peut accompagner cette réussite, être une aide à leur émancipation, à une excellence qui ne soit pas une chimère mais une réalité, aider le jeune à se construire et non les construire – qui serions-nous, adultes, enseignants, chefs d’établissements, parents, pour être “Dieu plus que Dieu” ? Peut-être après pour les déconstruire ? Quelle folie...L’éducation ne peut être une folie humaine – hormis dans les dictatures, mais au contraire une aventure des plus exigeantes, palpitantes, pour peu que la coopération ne s’oppose pas à la concurrence, la réussite des uns à celle des autres, l’excellence irrigue l’ensemble des voies de formations du système éducatif sans les hiérarchiser. Ce serait d’une arrogance coupable et destructrice.
J’aurais pu écrire une somme sur la pédagogie. A un moment de mon histoire personnelle et professionnelle où il me semble que j’ai acquis ce que d’aucun nomment sagesse ou d’autre expérience accumulée, cela ne semble pas incongru. Pour l’enfant de l’école publique que je suis, à qui elle a tout donné et beaucoup appris, il est assez singulier de commencer à plonger dans le monde de la pédagogie avec Jean-Baptiste de La Salle. Comme Obélix est tombé dans la potion magique au commencement d’Astérix, j’ai dû tomber dans la pédagogie au début des années 2000, à la fin d’un mois d’août où j’allais embarquer sur le vaisseau de la direction d’établissement. Mais pas n’importe lesquels : agricoles, privés catholiques et pour couronner le tout et entamer le parcours, sous tutelle congréganiste des Frères des Ecoles Chrétiennes. Et ce chemin qui se poursuit aujourd’hui n’est pas le moins singulier. Si je reste fidèle à l’enseignement agricole privé, c’est pétri d’expériences successives que je peux et regarder dans le rétroviseur et l’école d’aujourd’hui pour mieux ouvrir les champs du possible pour demain. C’est le parti pris que je prends volontiers et comme tous les partis pris, celui-ci contient un soupçon de subjectivité, mais aussi ce zeste d’inattendu qui autorise à emprunter des chemins de traverse. Mais revenons à nos moutons. Cette somme n’aurait été qu’une fausse habileté intellectuelle visant à faire une longue liste des pédagogues à travers l’histoire, de Jean Baptiste de La Salle à Philippe Meirieu, en passant par Montessori, Don Bosco, Ferdinand Buisson et pourquoi pas Tolstoï et tant d’autres...Que celles et ceux que je n’ai pas cité, que je considère parmi les plus brillants – certes qui ne se définissent pas comme pédagogues - comme François Dubet, Alain Bentolila, feu Albert Jacquard n’en prennent ombrage. Une liste à la Prévert n’est pas mon intention. Cela aurait pu constituer un nouveau dictionnaire des pédagogues, comme il en existe d’ailleurs de très grande qualité, mais avec un certain parti pris. Après un dictionnaire des amoureux de Jean d’Ormesson, ou de Victor Hugo ou dernièrement d’Albert Camus, un éditeur aurait-il pris le risque de donner un espace à la pédagogie ? Je ne le crois pas et il aurait eu raison ! Quelques centaines de pages pour réécrire de manière plus approximative sur le fond et plus hasardeuse sur le plan littéraire un tel ouvrage aurait été un outrage à l’histoire de ce que certains nomment une science mole tandis que d’autres osent à peine prononcer le terme de science...humaine ! Et pourtant, qui ne se saisit pas de ce concept, tellement dévoyé aujourd’hui : dans les médias, chez le citoyen “lambda” avec tout le respect que cela impose, bien entendu. Qu’il s’agisse d’un retour à l’âge d’or de la méthode de lecture syllabique, du calcul mental, qui serait passé par pertes et profit d’un pédagogisme porté par les “pédagogos”, l’abandon de l’orthographe, des dictées, des leçons à apprendre...La liste est longue, de ce procès de ce qu’un éditeur se refuserait peut-être d’éditer, mais qui fait partie de la vie, de l’école, de l’instruction, de la construction du futur citoyen. La pédagogie, ai-je dit ? Toutes ces réformes allant du collège unique –certains feront le mauvais jeu de mot en le qualifiant d’inique, au baccalauréat cent fois voué aux gémonies mais 1000 fois ressuscité, réformé, renouvelé ! Ah la pédagogie, dont tout le monde parle – et c’est une victoire pour le “monde de l’éducation” et la société dans son ensemble – mais avec tellement d’approximations, de présupposés idéologiques ! Il y a des domaines – alors que l’école est considérée comme un des piliers de la République, sanctuaire pour les uns, lieu inviolable des consciences pour d’autres, qu’il ne viendrait à personne de pénétrer, comme ceux de la physique nucléaire, la génétiques ou la question de l’hématologie ! Mais la pédagogie, si ! Et à toutes les sauces. Alors, en écrire une nouvelle somme n’aurait finalement que peu de sens. Et il m’est apparu insensé de me lancer dans une telle aventure.
Peut-être aussi aurai-je pu prendre un autre chemin de traverse, celui de l’école buissonnière ou qui sent la noisette, chanson chère à Mireille et picorer ici ou là de brillantes idées des illustres pédagogues cités plus hauts ou d’autres oubliés ou moins médiatiques et prolixes ? Il y a eu des fulgurances, des appuis théoriques qui ont permis de construire des modèles qui ont permis la massification, la démocratisation, l’élévation des niveaux de qualification. D’autres ont construit des “modèles” alternatifs, comme Maria Montessori qui a voué comme bien d’autres sa vie aux enfants, dans un monde dont la direction est la standardisation, les normes, l’idéologie de l’acceptation de la différence alors que le tsunami de l’indifférenciation est en marche. Ainsi, j’aurai pris le chemin de me prendre pour un “Dieu de la pédagogie”, celui qui réinvente l’eau chaude à l’aide des milliers de gouttes d’eau que j’aurai agrégées. Je n’aurai été que le pitre de service, ne réinventant rien, mais simplement en faisant comme si...La pire des malhonnêtetés intellectuelles ou de cette paresse intellectuelle que je dénonce tant depuis des années dans le monde de l’éducation auquel je participe. Un clin d’œil à l’actualité ? N’est-ce pas Jean Baptiste de La Salle qui a créé les “groupes de niveau” fin XVIIème début XVIIIème siècle et dont se fait le chantre l’actuel plus jeune premier ministre donné à la France par un Président de la République, avec une pédagogie révolutionnaire ? Alors, rassembler de bonnes idées, de très bonnes idées issues d’écoles différentes en termes de pédagogies, relèverait de l’imposture. N’ayant pas vocation à être ni un imposteur, ni le cheval de Troie de quelque idéologie sous tendant une pédagogie, et encore le simple scribe des pédagogues de tous les temps. Alors vous l’aurez compris, loin de moi l’idée de réaliser une encyclopédie de la pédagogie, des pédagogues. Des spécialistes ont déjà réalisé cet exercice magistral et avec un savoir qui relève…du miracle ! Simplement vous dire ce que je crois, ce que je vis, ce que je propose afin, non de retrouver les temps d’un âge d’or d’une école qui n’a jamais existée mais plutôt de mettre en exergue les outils aidant à passer d’une école en berne à un avenir éducatif qui ait du sens. Car si bâtir est compliqué, même lorsque l’on sait les « règles de l’art », enseigner l’est tout autant et l’a toujours été comme ouvrage dirigé par Jean François Condette le montre. Finalement, l’école serait-elle un éternel recommencement ? Le croire serait un alibi sclérosant, bien utile aux conservateurs de tout poil ! Nier le passé, ses richesses, serait tout autant intellectuellement malhonnête et malhabile. Alors allons-y franchement, sans idéologie ni baratin comme le chante si bien Renaud.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)