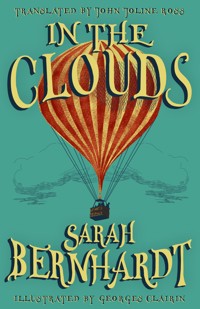Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans la petite salle à manger d'une élégante maison du boulevard Raspail, toute la famille Darbois était réunie autour de la table ronde, table familiale sur laquelle une toile cirée, blanche cerclée par toute la lignée des rois de France dans des médaillons d'or, servait de nappe pour les déjeuners."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335096903
©Ligaran 2015
Dans la petite salle à manger d’une élégante maison du boulevard Raspail, toute la famille Darbois était réunie autour de la table ronde, table familiale sur laquelle une toile cirée blanche, cerclée par toute la lignée des rois de France dans des médaillons d’or, servait de nappe pour les déjeuners.
La famille Darbois se composait de François Darbois, professeur de haute philosophie, homme éminent et d’allure distinguée ; de Mme Darbois, sa femme, charmante petite créature, douce, un peu effacée ; de M. Philippe Renaud, frère de Mme Darbois, homme jovial, directeur d’une usine à gaz, très honnête et très fortuné brasseur d’affaires ; de son fils, un beau garçon de vingt-deux ans, Marcel Renaud, jeune peintre plein de confiance dans l’avenir, car il venait d’obtenir un grand succès au dernier Salon. Un vieux parent très éloigné, conseiller de la famille, petit rentier sentencieux, vieux garçon égoïste, répondait au nom d’Adhémar Meydieux ; il était le parrain d’Espérance Darbois, fillette autour de laquelle se groupait tout ce petit monde.
Elle avait alors quinze ans révolus ; elle était longue et mince, sans angles ; une tête adorable surmontait cette tige flexible, blonde comme le sont les tout petits enfants, d’un blond pâle argenté ; son visage n’avait en vérité aucun trait purement sculptural, ses yeux longs, couleur de la fleur de lin, n’étaient pas grands, son nez n’avait aucun caractère, les narines, mobiles et transparentes, donnaient une certaine race à ce joli visage ; la bouche, rouge, charnue, un peu grande, découvrait une mâchoire ronde ornée de dents taillées en amandes toujours humides et luisantes ; seuls un petit front grec et un cou merveilleux dans sa gracilité prêtaient à Espérance une personnalité aristocratique que nul ne pouvait nier. Sa voix produisait une impression presque sensuelle à ceux qui l’entendaient ; elle était douce et vibrante ; sans le vouloir, Espérance modulait ses phrases et mettait, sans s’en douter, deux ou trois inflexions dans le même mot, ce qui donnait à son langage une particularité indéfinissable.
La jeune fille était à genoux sur une chaise, les bras tendus, appuyant ses mains sur la table ; sa robe bleue, espèce de blouse, était retenue à la taille par une étroite ceinture lâche ; l’enfant semblait très en bataille, mais elle mettait tant de joliesse dans ses mouvements et tant de musicales notes dans ses arguments, qu’il était impossible de se fâcher contre cette attitude combative.
« Papa, mon papa, disait-elle à François Darbois, placé en face d’elle, tu dis aujourd’hui tout le contraire de ce que tu disais à maman, l’autre jour à dîner. »
Son père dressa la tête ; sa mère, au contraire, essaya de se faire plus petite.
« Mon Dieu ! pensait-elle, pourvu que François ne se fâche pas ! »
Le parrain avança sa chaise, le jovial Renaud éclata de rire.
« Que veux-tu dire ? » demanda François Darbois.
Espérance regarda tendrement son père : « Tu te souviens ; mon parrain dînait avec nous, vous avez discuté très fort ; mon parrain était contre la liberté donnée à la femme et prétendait que les enfants n’avaient pas le droit de choisir leur carrière, mais qu’ils devaient, sans raisonner, obéir à leurs parents, seuls maîtres de leur destinée. »
Adhémar opinait du chef et se préparait à parler ; mais François Darbois, visiblement gêné, bégaya :
« Et puis ! quoi… après… où veux-tu en venir ?
– À ceci que tu as répondu, papa. »
Son père la regardait, mais Espérance soutint le regard interrogateur et continua :
« Tu as dit à parrain : Mon cher Meydieux, vous avez tout à fait tort, tout être a le droit et le devoir de choisir et d’échafauder son avenir. »
Darbois voulut parler…
Tu as même raconté à maman, qui l’ignorait, que ton père avait voulu te mettre dans les machines et que tu t’étais révolté.
– Oh ! révolté, murmura Darbois en haussant légèrement les épaules.
– Oui, révolté, et tu as ajouté : « Mon père m’a coupé les vivres pendant un an, mais j’ai tenu bon, j’ai fait travailler les malheureux cancres qui n’arrivaient pas à passer leurs examens et j’ai vécu tant bien que mal, mais j’ai vécu, et j’ai pu continuer mes études philosophiques. »
L’oncle Renaud approuvait visiblement la fillette. Adhémar Meydieux s’était levé lourdement et développant sa taille en deux ou trois mouvements, se rejeta en arrière, puis, se sentant d’aplomb, il commença à pérorer :
« Vois-tu, ma fille, si j’étais ton père, je t’aurais pris par l’oreille et je t’aurais chassée de cette pièce. »
Espérance devint pourpre.
« Je le répète, les enfants doivent obéir sans discuter.
– Non, pas sans discuter. J’espère, par le raisonnement, prouver à ma fille qu’elle a peut-être tort.
– Mais non, s’écria sentencieusement Adhémar, tu dois ordonner à ta fille et non pas discuter avec elle.
– Ah ! monsieur Meydieux, exclama le jeune peintre Marcel Renaud, vous allez un peu loin. Les enfants doivent respecter, autant qu’il leur est possible, les désirs de leurs parents ; mais lorsqu’il s’agit de leur propre avenir, ils ont le droit de se défendre. Si le père de mon oncle Darbois avait triomphé, mon oncle serait probablement un médiocre ingénieur au lieu d’être le brillant philosophe admiré et connu du monde entier. »
La douce Mme Darbois se redressa. Espérance regarda son père avec une infinie tendresse.
« Oui, mon garçon, dit Adhémar, seulement, ton oncle aurait peut-être fait fortune dans les machines, tandis qu’il a végété longtemps et durement, continua-t-il, gonflé d’importance.
– Nous sommes très heureux, fit entendre Mme Darbois. »
Espérance avait sauté de sa chaise et, arrivée près de son père, elle lui entoura la tête de ses deux bras :
« Oh ! oui, très heureux, murmura-t-elle tout bas, et tu ne voudras pas, père chéri, briser le bonheur de notre vie intime ! »
La figure du professeur de philosophie s’illumina sous cette caresse. Il écarta les mains de la jeune fille, puis il la fit tourner lentement et la tint assise sur ses genoux :
« Réfléchis, un peu, ma petite Espérance ; ce que j’ai dit à ta mère regardait uniquement les hommes ; en ce moment, il s’agit de l’avenir d’une jeune fille et cela devient plus grave !
– Pourquoi ?
– Mais parce que les hommes sont plus armés pour la lutte que les femmes, et la vie est, hélas ! un éternel combat.
– Soit, père, tu as raison pour ce qui est de la défense animale, mais les armes pour la défense intellectuelle sont les mêmes pour une jeune fille que pour un jeune homme. »
Adhémar haussa les épaules. Voyant qu’il voulait parler :
« Non, s’écria Espérance, non parrain, laissez-moi convaincre papa. Admets, papa, que je te demande de suivre la même carrière que mon cousin Marcel. De quelles armes serais-je privée ? »
François écoutait tendrement sa fille, il la serra contre lui :
« Comprends-moi bien, ma chère petite Espérance. Je ne repousse pas ton désir pour faire acte d’autorité paternelle ; non, c’est la seconde fois que tu exprimes ta volonté pour le choix de ta carrière. La première fois je t’ai demandé de réfléchir pendant six mois ; les six mois écoulés, tu m’as mis en demeure de !…
– Oh ! Papa, quel méchant mot !
– Mais oui, mais oui, dit-il en la serrant contre lui, tu m’as mis en demeure de te répondre définitivement ; j’ai convoqué le Conseil de famille, car je ne me sens pas le courage et peut-être n’ai-je pas le droit de te barrer la route que tu veux prendre. »
Adhémar fit un effort violent pour se lever d’un seul coup, et de sa voix grasse :
« Si, François, tu dois te mettre au travers de cette route qui est la plus mauvaise, la plus dangereuse à parcourir, surtout pour une femme. »
Espérance, frémissante, avait quitté les genoux de son père ; elle se tenait debout, les bras pendants ; le rose de son visage avait disparu, ses yeux bleus se couvraient de nuages gris. Son cousin Marcel crayonnait à la hâte une quantité de croquis, d’après elle, jamais il n’avait trouvé sa cousine aussi intéressante.
Adhémar continua :
– « Permets, ma chère enfant, que j’achève ma pensée. Je suis revenu exprès de la campagne, appelé par ton père. Je veux mettre ma responsabilité à l’abri. Ton père et ta mère ne connaissent rien de la vie. François ne respire que dans l’atmosphère des grands philosophes, morts ou vivants, ta mère ne vit que pour vous deux. J’ai exprimé de suite mon horreur pour la carrière que tu veux prendre, je vous ai fait toucher du doigt toutes les plaies adhérentes à cette carrière maudite ; tu sembles n’avoir rien compris ; ton père, toujours hésitant grâce à sa philosophie, car, dit-il d’un air prudhomesque, la philosophie est la plus perfide conseillère, c’est l’essence même de l’égoïsme. Quand un problème difficile se dresse, l’homme de combat cherche à le résoudre, le philosophe, lui, bat en retraite, laissant au hasard le soin d’arranger les choses. »
Il ne put continuer sa harangue, Espérance, de sa voix vibrante, lui coupa la parole :
– Je ne veux pas, mon parrain, je ne veux pas que vous parliez ainsi de mon père ; mon père vit pour ma mère et moi, mon père est bon et généreux ; c’est vous qui êtes égoïste, mon parrain ! ! François fit un mouvement pour arrêter sa fille, mais Espérance continua :
– Quand maman a été si malade, il y a cinq ans, papa m’a envoyée chez vous avec Marguerite, notre bonne ; il vous écrivit. Oh ! j’aurais tant voulu lire sa lettre, elle devait être si belle (les yeux de l’enfant se mouillèrent de larmes). Vous m’avez répondu verbalement…
Adhémar voulut placer un mot, Espérance frappa du pied :
Vous m’avez répondu verbalement : « Petite, tu diras à ton père que je lui donnerai tous les conseils qu’il voudra pour sortir de ce mauvais pas, mais j’ai comme principe de ne jamais prêter d’argent, surtout à mes meilleurs amis, cela finit toujours par une brouille ! Alors je suis partie et j’ai couru chez mon oncle Renaud qui m’a donné plus qu’il ne fallait pour maman. »
Le gros Renaud devint rouge et gêné. Marcel, son fils, lui serra si tendrement la main sous la table, que les yeux du brave homme devinrent humides.
« Depuis ce temps-là, mon parrain, je ne vous aime plus ! »
La petite salle à manger semblait subitement frigorifiée ; le silence n’était troublé que par les battements de cœur d’Espérance, ce brave petit cœur, si droit, si loyal et si impératif ! Adhémar était effondré sur sa chaise, la langue sèche, la pensée bégayante, ne pouvant trouver un argument.
Pour rompre cette gêne, Marcel Renaud proposa d’aller aux voix afin de donner une réponse définitive à sa brave petite cousine. Le projet fut accepté. Tous se concentrèrent autour de la table et se mirent à parler bas. Espérance s’était assise sur l’unique fauteuil de la pièce. Elle était très pâle et ses yeux s’étaient cerclés de bleu. La discussion semblait vouloir recommencer quand, tout à coup, Marcel se leva.
« Ah ! Mon Dieu ! s’écria-t-il, Espérance est malade. » L’enfant s’était évanouie, sa tête renversée en arrière faisait de son long cou une gorgerette de pigeon qui se gonflait sous la pression du souffle. Ses cheveux auréolaient ce petit visage pâle aux lèvres mortes. Tous se levèrent dans un brouhaha ému ; Marcel avait enlevé la fillette, il la tenait dans ses bras. Mme Darbois l’entraîna dans la chambre d’Espérance, il la déposa doucement sur le petit lit étroit. François Darbois mouillait légèrement d’eau de Cologne les tempes de sa fille. Marcel regardait cette petite chambre si fraîche, si blanche avec ses deux pots de marguerites placés sur la cheminée ; un sentiment indéfinissable s’emparait de lui, était-ce l’amour pour tant de joliesse ou l’adoration pour tant de pureté.
Mme Darbois avait soulevé la tête d’Espérance, lui faisant respirer un peu d’éther.
Philippe Renaud, reste dans la salle à manger, avait retenu d’autorité Adhémar Meydieux qui avait voulu suivre les Darbois.
Espérance ouvrit les yeux et, voyant près d’elle son père et sa mère, ces êtres qu’elle aimait si profondément, presque si violemment, elle étendit ses bras graciles et ramena près d’elle les deux têtes chéries. Marcel s’était retiré doucement.
« Papa chéri, maman adorée, pardonnez-moi, ce n’est pas ma faute, » et elle pleura.
– Ne pleure pas, ne pleure pas, s’écria Darbois ; puis, se penchant sur la fillette, il lui murmura tout bas : « C’est décidé, tu seras… »
Et la phrase se perdit dans la petite oreille d’Espérance.
Elle devint toute rose et se soulevant sur son lit, elle chuchota à son tour :
– Ah ! merci, merci. Combien je vous aime tous deux ! merci ! merci !
– Calme-toi, n’aies pas de chagrin, ne souffres plus ! Tu seras artiste, tu seras comédienne, avait murmuré François Darbois !
Espérance resta seule avec sa mère qui lui faisait boire du thé à petites gorgées ; son ravissant visage avait repris toute sa fraîcheur :
« Vois-tu, maman, disait-elle, il faut que demain nous allions au Conservatoire pour me faire inscrire pour l’examen d’admission qui doit avoir lieu.
– Comment sais-tu cela ?
– C’est la fille du pharmacien, Juliette Camus, qui me renseigne.
– La petite Camus, elle a onze ans à peine, comment sait-elle cela ?
– Mais, maman, dit Espérance en embrassant gentiment Mme Darbois, tu ne sais donc pas que Juliette vient d’avoir un gros succès au Conservatoire. »
Mme Darbois fit un mouvement négatif, s’excusant de ne pas savoir.
« Eh ! oui, dit Espérance, sautant à bas de son lit. Elle a eu un second prix de piano et il paraît qu’elle méritait le premier, mais qu’on a préféré la garder encore un an, parce qu’elle est si jeune !
– Alors toi, murmura Mme Darbois, tu vas être trop vieille pour te présenter ? »
Espérance fit entendre un rire argentin en frappant ses deux mains :
« Oh ! la maman chérie qui ne sait rien ! Ce n’est pas la même chose pour la déclamation ! J’ai l’âge voulu pour commencer mes études théâtrales.
– Tu désires, demanda Mme Darbois, que nous allions demain ?
– Oui, aujourd’hui nous resterons près de papa, il est si bon ! »
Les deux femmes s’attendrirent un instant dans un mutuel silence ; puis Espérance continua :
« Nous allons l’entraîner à la promenade, veux-tu, maman ?
– Tu as raison, fillette, cela lui fera le plus grand bien de prendre l’air et à toi aussi. »
Mme Darbois laissa sa fille mettre un peu d’ordre dans sa toilette.
Restée seule, Espérance retira sa robe bleue pour la déchiffonner ; elle se regarda dans la glace de son armoire ; son regard interrogateur expliquait l’émoi de son être ; elle se haussa légèrement sur la pointe de ses pieds :
« Oh ! oui, je serai grande, je n’ai que 15 ans et je suis déjà grande pour mon âge ; oh ! oui, je serai grande ! »
Elle s’approcha tout près de la glace et se regarda longuement, s’hypnotisant peu à peu. Elle se voyait sous mille aspects différents. Il lui sembla que sa vie se déroulait devant elle ; des ombres passaient, disparaissaient ; une ombre plus falote allongeait sans cesse ses longs bras vers elle. Elle frissonna, eut un mouvement de recul et, passant la main sur son front, elle écarta le vertige qui s’emparait d’elle.
Quand sa mère vint la chercher pour la promenade, Espérance était absorbée par Victor Hugo. Elle étudiait Doña Sol, dans Hernani. Elle n’avait pas entendu la porte s’entrouvrir et poussa un petit cri en voyant sa mère si près d’elle, les yeux fixés sur son livre :
– Tu vois, je ne perds pas de temps, dit-elle en fermant le volume. Ah ! maman, je suis si heureuse, si heureuse ! !
Mme Darbois mit un doigt sur sa bouche :
« Chut, fit-elle, ton père est là qui nous attend pour la promenade. »
Espérance prit vivement son chapeau, sa jaquette et se rendit près de son père ; elle le vit pensif, la tête dans ses deux mains ; elle comprit la lutte que se livraient en ce moment l’amour et la raison, et sa petite âme si droite s’angoissa. Alors, penchée sur son père, elle lui dit :
« Ne te fais pas de chagrin, papa, tu sais bien que je ne puis jamais être malheureuse tant que vous serez là tous deux ; et si je me suis trompée, si la vie ne m’apporte pas ce que j’espère d’elle, je me consolerai dans l’atmosphère de votre tendresse. »
François Darbois leva la tête et son regard plongea dans les jolis yeux d’Espérance :
« Que Dieu te garde, fillette. »
La promenade fut délicieuse ; le mois d’août touchait à sa fin ; les arbres changeaient leur toilette de verdure pour se parer de tuniques brunes et d’écharpes d’or. Le soleil avait quitté le zénith et descendait doucement vers l’horizon ; le bois de Boulogne était presque solitaire.
François Darbois, les deux mains appuyées sur sa canne, se tenait droit les yeux fixés vers l’au-delà. Mme Darbois s’enfonçait dans le landau, jouissant simplement de la beauté de la nature. Espérance, assise devant eux, regardait défiler les arbres, les prairies, les routes sans rien voir ; parfois, elle levait les yeux vers son père, alors son cœur fondait dans une immense reconnaissance ; elle admirait cette figure fine, un peu ravagée par l’étude, ces mains blanches aux doigts fuselés comme ceux d’une femme, et tout de suite sa pensée évoquait son oncle, Philippe Renaud, très brave homme aux allures un peu vulgaires, son détestable parrain, si lourd, si commun !… Et dans un mouvement irraisonné, elle embrassa son père.
Une noce qui passait à pied se mit à rire ; le cocher du landau se retourna, regardant dans la voiture, mais ses clients étaient calmes et silencieux, même un peu tristes, pensa-t-il.
Le lendemain, Espérance était prête pour se rendre au Conservatoire bien avant l’heure indiquée, Darbois était avec un de ses élèves dans son bureau-bibliothèque ; elle se rendit alors dans la chambre de sa mère qu’elle trouva rangeant des papiers :
« Tu as mon acte de naissance ? dit-elle après l’avoir embrassée.
– Oui ! oui !
– Et l’autorisation écrite de papa ?
– Oui, oui, soupira Mme Darbois.
– Il a hésité à te la donner ?
– Oh ! non, tu connais ton père, sa parole donnée est chose sacrée, mais il souffrait beaucoup ! Oh ! ma chère fillette, ne lui fais jamais regretter… »
Espérance mit la main sur la bouche de sa mère :
« Maman, tu sais bien que je suis honnête et droite et comment pourrait-il en être autrement, étant fille de deux êtres aussi purs que vous deux ? J’ai la passion du théâtre. Je crois que si papa m’avait refusé son autorisation, je serais tombée malade et que la neurasthénie m’aurait emportée. (Mme Darbois pâlit.) Oui, tu te souviens, il y a un an, j’ai failli mourir d’anémie, de consomption. Eh ! bien, maman chérie, cette maladie venait des luttes intérieures auxquelles je me livrais n’osant pas parler, ayant entendu souvent mon père s’exprimer contre le théâtre avec amertume, et toi, maman, tu as dit un jour (c’était, je me souviens, le jour de fête de mon père, la conversation s’était engagée sur le théâtre à propos du suicide d’une artiste aimée), tu as dit : “Ah ! la malheureuse mère, Dieu me préserve de voir ma fille au théâtre !”
Mme Darbois resta un instant silencieuse ; deux lourdes larmes tombèrent sur ses joues ; puis un sanglot brisa l’atmosphère calme de la chambre :
“Ah ! maman, maman, cria Espérance, aies pitié, ne me fais pas voir ta douleur, je la pressentais, je ne voulais pas la voir : je suis une fille ingrate, vous m’aimez tant ! vous m’avez gâtée, je devrais céder ; je ne peux pas et je souffre de te voir souffrir. Je souffrais hier en voiture en voyant papa si lointain, je sentais qu’il s’éloignait de nous pour oublier et voilà que tu sanglotes, voilà ton visage couvert de larmes, voilà que le sel de tes pleurs rend amer les baisers que je te donne ! Maman, c’est atroce ! Il faut que je vous rende le bonheur ou tout au moins le calme ; mais, hélas ! le bonheur je ne puis vous le donner, car je sens que je mourrai de mon renoncement !” Mme Darbois tressaillit, cela était vrai, l’enfant mourrait. Subitement elle offrit sa vie en sacrifice et d’une voix autoritaire que ne lui connaissait pas Espérance :
“Allons, fillette ; partons, l’heure passe, j’ai tous les papiers nécessaires, viens !”
Arrivées au Conservatoire, elles trouvèrent, déjà installées sur des banquettes, plusieurs femmes attendant le moment de faire inscrire leur fille.
Quatre jeunes gens s’étaient groupés en petit clan séparé, dévisageant les jeunes filles qui se tenaient près de leur mère. Dans un coin de la salle, était installé un bureau entouré de grillage, dans lequel se tenait l’employé chargé de recevoir les inscriptions ; c’était un homme d’une cinquantaine d’années, hargneux, ayant le faciès des êtres atteints par une maladie de foie. Il regardait d’un air entendu les jeunes filles dont il prenait les noms et sa physionomie était des plus expressives.
Quand Mme Darbois entra, suivie d’Espérance, la réelle distinction des deux femmes éveilla un mouvement de sympathique curiosité. Le groupe des jeunes gens se rapprocha des nouvelles venues. Mme Darbois regarda autour d’elle, puis, voyant une banquette vide près de la fenêtre, elle s’y dirigea avec sa fille. Le soleil, éclairant la tête blonde d’Espérance, l’auréola subitement d’un nimbe d’or. Il y eut un murmure d’admiration parmi ce petit monde mêlé d’éléments hétéroclites.
“En voilà une, murmura une bonne grosse femme dont les mains étaient gantées de fil blanc, en voilà une qui peut être sûre de son avenir !”
L’employé du bureau avait levé la tête et fut ébloui par la vision radieuse. Une bouffée de sang éclaira sa face blême ; il se leva et, tout à fait indifférent au manque de courtoisie qu’il affichait pour les personnes venues avant Mme Darbois, il s’avança, et soulevant sa calotte de velours noir :
“Vous désirez vous faire inscrire pour l’examen d’admission, demanda-t-il à Espérance ?”
Celle-ci désigna sa mère d’un mouvement de tête un peu hautain. L’employé comprit et fut ravi de recevoir une leçon de politesse de cette adorable enfant.
“Oui, dit Mme Darbois, mais je ne voudrais pas vous causer un ennui, monsieur ; je suis arrivée après les personnes qui sont là, assises, j’attendrai mon tour. ”
L’homme haussa les épaules, et, d’un air suffisant :
– Veuillez me suivre, mesdames. »
Les deux femmes suivirent ; un mouvement de houle se fit entendre :
« Silence, cria l’employé furieux. Si cela recommence, je vous mets tous dehors. »
Le calme se rétablit de suite, car beaucoup de ces femmes venaient de loin.
Une couturière avait quitté son atelier pour accompagner sa fille, belle enfant de dix-sept ans. Une grosse femme de chambre de cocotte avait obtenu sa matinée ; sa fille se tenait près d’elle, belle fille de seize ans, aux cheveux décolorés, effrontée comme un meneur de cotillon. Une maîtresse de piano s’était excusée près de ses élèves ; ses deux filles étaient près d’elle, deux fleurs de Paris, pâles, anémiques, mais charmantes et modestes. Toutes deux voulaient passer l’examen d’admission, l’une dans les ingénues comiques, l’autre dans la tragédie. Il eût été impossible d’indiquer laquelle des deux était comique ou tragique !
Il y avait aussi une marchande à la toilette couverte de bijoux ; elle se tenait droite, assise très en avant sur la banquette. La pauvre femme était sanglée dans un corset Gach Saraute qui remontait tous les organes en une poche de polichinelle ; ses jambes trop courtes touchaient à peine le sol ; sa figure tuméfiée par le sanglé dans lequel elle se débattait en vain faisait peine à voir. Sa fille allait et venait dans la longue salle, telle une jument piaffant d’impatience dans le manège. Cette fille était belle, d’une beauté correcte, sans une tare sur son visage, mais les attaches étaient lourdes et le cou s’enfonçait sans grâce dans ses larges épaules. Une chiromancienne aurait pu, sans risquer de se tromper, lui prédire un honorable avenir comme tragédienne de province.
Mme Darbois s’était assise sur l’unique chaise du petit bureau, chaise que lui avait offerte, aussi poliment que possible, l’employé bureaucrate.
Quand il eut pris connaissance de l’acte de naissance d’Espérance, il se pencha vers Mme Darbois :
« Comment, mademoiselle est la fille du fameux professeur de philosophie ? »
Les deux femmes se regardèrent étonnées.
– Vous connaissez mon mari ? disait le regard de Mme Darbois.
– Vous connaissez mon père ? interrogeaient les yeux d’Espérance.
– Mais oui, mesdames, répondit l’employé rayonnant, mon fils suit les cours de M. François Darbois à la Sorbonne. Ah ! je suis content de vous connaître… (puis son visage prit une expression inquiète)… mais comment se fait-il que M. Darbois ait permis ?… sa phrase s’étrangla dans sa gorge.
Le visage de Mme Darbois était devenu tout blanc ; les narines de la jeune fille battaient, telles les ailes d’une hirondelle éperonnée par l’orage.
L’employé referma les papiers, les remit avec une extrême politesse à Mme Darbois et lui murmura :
« Ne vous frappez pas, madame, l’enfant aura un bel avenir ! »
Les deux femmes saluèrent l’employé en le remerciant et se dirigèrent vers la porte ; le groupe des jeunes gens salua la jeune fille qui inclina sa jolie tête.
– Oh ! là ! là ! hurla la grosse femme de chambre.
Espérance s’arrêta sur le seuil de la porte qu’elle allait franchir, regardant cette femme qui rougit et se tut de suite.
Quand Espérance fut sortie :
« Ah ! bien, ricana un des jeunes gens du groupe, elle vous en a bouché un coin, dites, la grosse mère ? »
Une discussion s’engagea dans le langage le plus fleuri…
Espérance se sentait frémissante de bonheur ; toute la vie était à elle ; pour la première fois, elle avait eu connaissance de sa personnalité, pour la première fois, elle sentait en elle une force. Serait-elle créatrice ou dévastatrice, cette force ? L’enfant comprima son cœur de ses deux mains.
M. Darbois attendait à la fenêtre.
Espérance avait vu son père, elle sauta hors de la portière avant que la voiture ne fût arrêtée.
« Quel petit être excessif ! » pensa le professeur.
Le premier élan d’Espérance avait été de courir remercier son père, mais elle revint sur ses pas pour aider sa mère à descendre de voiture.
Espérance rayonnante froissa, sans qu’elle en eût conscience, M. Darbois, et, quand sa fille l’entoura de ses deux bras pour lui exprimer sa tendre reconnaissance, il détacha vivement les mains de l’enfant, disant d’une voix blanche :
« Bien, bien, ne parlons plus de cela, veux-tu ? Mettons-nous à table. Marguerite grogne un peu ; le déjeuner va être brûlé. »
Espérance pensa que le déjeuner n’avait aucune importance ; mais, docile pour tous les petits faits de la vie, elle retira son chapeau, avança la chaise de son père, et s’assit entre ces deux êtres qu’elle adorait mais qu’elle torturait en ce moment en extériorisant la joie qu’elle ne pouvait ni ne voulait dissimuler.
Les semaines s’étaient écoulées, amenant trop lentement, au gré d’Espérance, le jour tant attendu pour l’examen d’admission. La fillette avait choisi, pour son examen de comédie, une scène des Femmes savantes (rôle d’Henriette), en tragédie, une scène d’Iphigénie (rôle d’Iphigénie).
Adhémar Meydieux, son parrain, venait souvent savoir où en étaient les études de sa filleule. Il voulait lui donner quelques conseils, mais Espérance avait énergiquement refusé ; elle lui gardait rancœur de son opposition première ; elle ne voulait travailler qu’avec sa mère.
Cette pauvre Mme Darbois mettait tout son cœur à servir les études de sa fille ; chaque matin, elle faisait répéter Espérance. Le rôle d’Henriette lui paraissait inexplicable ; elle avait consulté son mari qui lui avait répondu :
« Henriette est une petite philosophe pleine de bon sens, Espérance a bien fait de choisir cette scène des Femmes savantes ; le génie de Molière ne s’est jamais montré plus finement railleur que dans cette pièce. »
Et il expliqua longuement à sa femme toute la psychologie du caractère d’Henriette. Mme Darbois fut surprise de trouver sa fille si complètement d’accord avec les idées émises par son père pour l’étude de ce rôle. Espérance était si jeune qu’il lui semblait qu’elle ne pouvait comprendre encore toutes ces phrases à double sens…
Elle avait fait sa première communion à onze ans, et ses études religieuses finies, elle n’avait plus pensé qu’à la poésie, essayant de faire elle-même quelques vers. Son père l’avait encouragée, lui donnant un professeur de littérature. L’enfant se passionna dès lors pour l’art dramatique, apprenant par cœur et récitant à haute voix les plus beaux morceaux de la littérature française.
Ses parents ne se doutaient pas, alors qu’ils l’écoutaient souriants réciter Ronsard ou Victor Hugo, ses parents ne se doutaient pas que l’enfant ne rêvait déjà que théâtre. Bien souvent, depuis, Mme Darbois se reprochait de n’avoir pas été plus clairvoyante ; mais son mari, qui savait plus de choses et dont la science subtile avait reconnu l’inutilité des regrets, son mari la calmait et, hochant ta tête : « Ne te reproche rien, ma chère femme, tu ne pouvais rien empêcher ; le destin est une force contre laquelle tout se heurte, tout se brise. Écartons les embûches et les pierres de la route que doit parcourir Espérance, et attendons. »
Le jour tant désiré arriva enfin. Jamais la jeune fille n’avait été plus séduisante, plus attractive. Quand François Darbois la vit entrer dans la bibliothèque, il était à son bureau, travaillant ardemment à la correction d’un livre qui allait paraître. Il se retourna, entendant la porte s’ouvrir : sur le seuil se tenait Espérance ; il crut voir l’archange de la victoire ; un rayonnement émanait de cet être si frêle. Le philosophe eut la prescience qu’il avait devant lui, enveloppé de langes matériels, un destin unique, une force mystérieuse. Un frisson parcourut son être quand il tint devant lui l’enfant qu’était encore Espérance.
« J’ai voulu t’embrasser, père, avant de partir… là-bas, disait la voix musicale ; tu me pardonneras de t’avoir dérangé. »
Il serra fortement la fillette contre son cœur sans dire un mot, ne voulant pas laisser échapper les phrases de regret qui lui montaient aux lèvres. Espérance resta un instant hésitante, devinant le trouble de son père ; puis, dans un élan de tout son être, se jeta au cou de François Darbois :
« Ah ! père, père chéri, je suis si heureuse qu’il ne faut pas souffrir ; tu m’aimes tant que tu dois jouir du bonheur que je te dois. Demain, peut-être, m’apportera des larmes. Vivons pour aujourd’hui. »
Le professeur caressa doucement la joue veloutée de la jeune fille :
« Va, ma chérie, va, et reviens triomphante. »
Arrivées dans la salle d’attente qui précédait celle des examens, Espérance et Mme Darbois prirent les mêmes places, sur la même banquette qui leur avait servi de siège lors de leur première visite au Conservatoire.
Il y avait là une cinquantaine de personnes : l’employé bureaucrate vint au-devant d’elles s’informer de la santé de la jeune fille et, interrogeant une liste qu’il tenait dans la main :
« Il y a encore cinq élèves avant vous, mademoiselle ; deux garçons et trois jeunes filles ; quelles sont les personnes qui vous donnent la réplique dans les Femmes savantes et dans Iphigénie ? »
Espérance regarda l’employé :
« Je ne comprends pas, » dit-elle.
La figure de Mme Darbois devint inquiète :
« Mais oui, reprit l’employé, vous devez avoir une Armande pour la comédie, un Agamemnon et une Clytemnestre pour la tragédie.
– Ah ! nous ne savions pas, dit Mme Darbois. » L’employé sourit, et prenant plus d’importance : « Attendez un instant, » dit-il en s’éloignant.
Quelques minutes après, il revint accompagné d’une grande jeune fille à l’air distingué et d’un jeune homme au faciès autoritaire : « Voici Mlle Hardouin qui consent à vous donner les répliques d’Armande et de Clytemnestre et M. Jean Perliez qui vous donnera Agamemnon ; seulement, ajouta-t-il, il est, je crois, nécessaire que vous répétiez avec eux. Je vais vous installer tous les quatre dans mon bureau ; nul ne vous dérangera. » Ainsi fut fait !
Mlle Hardouin était une belle et modeste jeune fille de dix-huit ans, très bien élevée. Orpheline, elle vivait avec sa sœur plus âgée qu’elle de dix ans et qui lui servait de mère. Les deux sœurs s’adoraient. L’aînée s’était fait une très bonne clientèle dans les modes. Toutes deux étaient très estimées et très aimées.
Jean Perliez était fils d’un chimiste. Son père n’avait pas voulu l’autoriser à prendre la carrière théâtrale avant qu’il eût passé son bachot. Il avait obéi ayant brillamment terminé ses études, il se présentait à l’examen d’admission comme tragédien.
Les trois jeunes gens répétèrent les deux scènes choisies par Espérance.
« Ah ! quelle jolie voix vous avez, mademoiselle, » dit timidement Geneviève Hardouin.
Après la répétition des Femmes savantes, quand la scène d’Iphigénie fut terminée, Jean Perliez demanda à Mme Darbois quel avait été le professeur de la jeune fille.
« Mais, personne, répondit-elle ! Ma fille a travaillé toute seule ; je lui donnais la réplique »
Elle sourit de ce doux et délicieux sourire qui prêtait à sa physionomie un charme plein de bonté et de distinction.
« C’est très intéressant, » murmura Jean Perliez en regardant la fillette ; puis se penchant sur Mme Darbois :
« Oserai-je, madame, demander à mademoiselle de me donner la réplique de Junie dans Britannicus ; la jeune fille qui devait me seconder est malade. »
Il montra la petite lettre qu’il venait de recevoir.
Mme Darbois resta consternée, sans répondre ; elle regardait Espérance :
« Oh ! oui, maman ; tu permets, » fit en battant des mains le jeune fille.
Et sans attendre la réponse :
« Répétons, monsieur, voulez-vous ? répétons tout de suite. »
Le jeune homme lui présenta la brochure.
« Oh ! c’est inutile, dit en riant Espérance, je sais Junie par cœur. »
Et, en effet, la petite répétition se termina sans un accroc.
Les trois jeunes gens se séparèrent. Après avoir salué Mme Darbois, Geneviève Hardouin pressa la main fine que lui tendait Espérance.
Jean Perliez reçut le plus affectueux : merci, alors qu’il se confondait lui-même en remerciements…
Un jeune homme lui demanda :
« Est-ce qu’elle dit bien, la jolie blonde ?
– Très bien, répondit-il froidement. »
Tout se passa selon le désir d’Espérance ; son entrée sur la petite scène des examens causa un émoi parmi les professeurs juges.
« Quelle adorable enfant ! » dit Victorien Sardou.
– Elle est vraiment d’une grâce pleine de race, murmura Régnier, sociétaire de la Comédie-Française.
La voix musicale et pure d’Espérance fit tressauter l’aréopage. Tous ces juges blasés étaient suspendus aux lèvres de la jeune fille. Quand elle eut fini, un murmure approbateur, discrètement retenu par le respect dû à leurs fonctions, arriva cependant jusqu’à elle.
« Scène d’Iphigénie, » graillonna la voix de l’homme préposé aux annonces…
Il y eut un mouvement de chaises se calant pour permettre aux membres du jury de se mettre à l’aise pour mieux entendre.
Ce fut un véritable petit triomphe, étouffé par la dignité que s’imposait chacun des juges, mais qui n’échappa pas à Espérance.
Elle salua avec cette grâce qui lui était si personnelle. Geneviève Hardouin et Jean Perliez serrèrent discrètement la main de la jeune fille.
Sardou l’arrêta au passage, alors qu’elle allait sortir.
« Dites-moi, mademoiselle, êtes-vous de la famille du professeur de philosophie ?
– C’est mon père, monsieur, répondit Espérance enorgueillie subitement par cette demande. »
Régnier s’était levé :
« Ah ! vous êtes la fille de François Darbois, mademoiselle. Eh ! bien, nous sommes heureux de vous faire tous nos compliments. Vous avez un père remarquable. Dites-lui que sa fille a tous nos suffrages. »
Espérance le regarda et découvrit sur son visage tant de respect et de sincérité qu’elle salua, disant :
« Mon père sera bien heureux que ces paroles aient été dites par M. Régnier dont il est un des plus fervents admirateurs. » Puis elle disparut, légère.
Il y eut comme un regret du bris de ce charme indéfinissable :
« Quelle Doña Sol charmante ce serait ! » dit Delaunay.
Le silence se rétablit et les juges énervés virent sur la scène, se préparant à déclamer, un gros garçon à l’allure un peu vulgaire, mais sain, bien portant, joyeux ! Ils respirèrent : c’était un pont pour arriver à d’autres jeunes filles si désespérément banales.
Rentrées boulevard Raspail, les deux femmes se dirigèrent vers la bibliothèque, mais Marguerite les arrêta :
« Monsieur le professeur est sorti, il ne pouvait pas tenir en place. Mademoiselle est contente ?
– Je l’étais, murmura Espérance, je ne le suis plus, Marguerite, puisque papa n’est pas là. Est-ce qu’il avait de la peine ?
– Peuh ! il n’était pas gai, mademoiselle, mais je ne peux pas dire qu’il avait de la peine ! »
Les deux femmes tressaillirent, car on montait l’escalier. Espérance n’hésita pas un instant : c’était son père qui montait. Elle courut à la porte, l’ouvrit et tomba dans les bras de ce père tant chéri. Il l’embrassa tendrement les yeux humides.
« Viens, viens, que je te raconte ! » Elle entraîna son père.
« On peut servir, demanda Marguerite ?
– Oui, oui, répondit vivement Espérance. Papa, maman et moi mourons de faim. »
Mme Darbois retira doucement le chapeau de sa fille et le mit avec le sien sur une chaise.
« Voilà, papa chéri ; je vais tout te dire.
– Inutile, dit François Darbois, je sais tout. »
Les deux femmes sursautèrent.
« Hein ! Comment sais-tu ?
– Par mon ami, le chimiste Victor Perliez qui, comme moi, est un père un peu endolori pour la carrière choisie par son fils. »
Espérance fit un mouvement.
« Non, fillette, continua François Darbois, je ne veux pas te faire le moindre chagrin. Ce sont des échappées de ma pensée qui se manifestent malgré moi, mais tout s’apaisera… Je sais que tu as été surprenante de simplicité dans Henriette et d’émotion dans Iphigénie. Le fils de Perliez, que j’ai vu grand comme ça (fit-il en étendant la main) était enthousiaste ! C’est, du reste, un garçon distingué qui aurait fait peut-être un avocat remarquable (il soupira tristement). Enfin !
– Mais, père chéri, il sera l’avocat du beau ; il peut avoir, au théâtre, une influence plus utile, plus bienfaisante, plus immédiate qu’au barreau. »
Mme Darbois, intéressée, interrogea sa fille du regard.
« Oh ! souviens-toi, maman, toi si bonne, si douce, qui étais révoltée de la plaidoirie de Maître Dubare qui voulait faire acquitter l’assassin de la petite Jeanne Verdier. Eh bien ! je pense qu’il est plus noble d’être l’avocat des poètes et même de porter à la connaissance du public les idées progressives de la science, de l’art et de la politique…
Souvent discutables, dit Darbois.
– Oh ! oui, cela je le crois, mais qu’est-ce que cela fait ? N’as-tu pas dit cent fois que la discussion était nécessaire à l’éclosion des idées nouvelles ? »
Le professeur de philosophie regarda sa fille. Ainsi, tout ce qu’il avait dit devant l’enfant avait été semence dans ce jeune cerveau.
« Peut-être as-tu raison, fillette, murmura-t-il.
– Mais, demanda Mme Darbois à son mari, où donc as-tu vu M. Perliez ? »
Le professeur eut un franc sourire :
« Autour du Conservatoire. Perliez et moi nous nous sommes rencontrés poussés par le même excès d’inquiétude irraisonnée, vers le lieu du sacrifice. Ah ! ce n’est vraiment pas la peine, ajouta-t-il, d’une voix un peu lasse, de commenter tous les grands philosophes pour arriver à cette pénurie de volonté !
– Oh ! de la crème au chocolat, dit en riant Espérance ; Marguerite a voulu me récompenser. »
La cuisinière sourit de sa large bouche :
« Oui, mademoiselle, je savais bien que vous… »
Un coup de sonnette lui coupa la parole. Tous se regardèrent, et, silencieux, entendirent la porte s’ouvrir, puis un colloque, et la femme de chambre parut tenant une carte à la main.
François Darbois se leva vivement.
« Faites entrer au salon, » dit-il à la femme de chambre ; puis, passant la carte à sa femme, il alla au-devant du visiteur. Espérance s’était penchée vers sa mère et lut en même temps qu’elle le nom célèbre : Victorien Sardou. Elles commentèrent cette visite sans en deviner le motif réel.
François venait d’entrer dans le salon. Sardou était debout, les mains derrière le dos, regardant en clignant des yeux un ravissant pastel signé Chaplin, représentant Mme Darbois à vingt ans. L’entrée du professeur lui fit tourner la tête et, avec cette familiarité spirituelle qui était un de ces charmes :
« C’est tout à fait joli, et d’une couleur !… » puis s’avançant :
« C’est à monsieur François Darbois, que j’ai l’honneur de parler ? »
La surprise un peu hautaine du professeur ne lui avait pas échappé. Ce dernier s’inclina légèrement, indiquant un siège au visiteur.
« Un peu réfrigérant, le père, » pensa Victorien Sardou en s’asseyant ; puis, après un instant de silence :
« Laissez-moi vous dire avant tout, mon cher professeur, que je suis un de vos adeptes les plus fervents : Votre dernier livre est, à mon avis, une œuvre de toute beauté. Votre philosophie n’est pas décourageante pour la jeunesse et c’est après avoir lu votre livre, que j’ai envoyé mon fils à vos cours. »
François Darbois remercia le grand auteur. La glace était rompue. Ils discutèrent vivement sur Platon, Aristote, Montaigne, Schopenhauer, etc.
Victorien Sardou entendit sonner l’heure ; il avait déjeuné à la hâte et devait retourner au Conservatoire à 2 heures, le jury ayant encore à entendre onze élèves. Il se mit à rire, et, parlant très vite, selon son habitude :
« Il faut cependant que je vous dise pourquoi je suis venu. Votre fille, qui a passé son examen ce matin, est tout à fait surprenante. Il y a là l’étoffe d’une artiste admirable : la voix, le sourire, la grâce, la distinction, la mesure, le rythme : cette enfant de quinze ans a tout. Je prépare en ce moment une pièce destinée au Vaudeville. Le rôle principal est une très jeune fille. Je ne la trouverai pas, il n’y en a pas de jeunes filles au théâtre en ce moment ; ce sont toutes des dindes prétentieuses, dit-il en se levant. Donnez-moi votre fille. Je lui ferai faire un bel engagement rien que pour ma pièce et je vous promets pour elle un véritable triomphe. »
François, qui s’était levé en même temps que l’académicien, resta étonné, réservant sa réponse, laquelle était attendue avec une certaine impatience.
« Voulez-vous me permettre, demanda-t-il en sonnant, de faire chercher ma fille ? C’est avec un bien grand chagrin, je l’avoue, que j’ai dû l’autoriser à se destiner au théâtre ; mais maintenant je dois la consulter, tout en essayant de la guider. »
Puis, s’adressant à la femme de chambre qui venait d’ouvrir la porte :
« Priez Madame et Mademoiselle de venir. »
Sardou s’était approché du professeur, lui serrant affectueusement la main.
« Vous êtes logique avec vos principes ; je vous en félicite : c’est très rare ! »
Les deux femmes venaient d’entrer.
« Ah ! continua-t-il, après avoir salué Mme Darbois, tout en jetant un regard vers le pastel : voilà le modèle de ce magnifique portrait. »
L’aimable femme rougit, un peu gênée, mais flattée. Après les présentations, Sardou renouvela sa proposition à Espérance, qui, très émue, interrogeait du regard son père.
« C’est le premier problème qui se dresse, ma fillette, murmura-t-il ; bien d’autres surgiront dans cette carrière. C’est un perpétuel appel aux phases les plus inattendues de la vie.
– Il me semble, dit timidement Mme Darbois, que c’est bien vite ; te sens-tu la force ?
– Je me sens toutes les forces, dit vivement, d’une voix claire, la ravissante enfant. »
Sardou dressa la tête et la regarda.
Si vous croyez, monsieur Sardou, que je puis être votre interprète, il faut me prendre ; la main que vous me tendez me semble celle du Destin. Je dois le plus vite possible retirer à mon cher papa le remords de m’avoir accordé son autorisation.
François voulut parler, mais elle se serra près de lui.
« Oh ! père chéri, c’est malgré toi que ce méchant remords s’insinue ; mais moi, je veux en triompher. Je veux le chasser de ta pensée,
– Alors, fit vivement Sardou pour briser la petite émotion qui envahissait l’atmosphère, alors c’est convenu. »
Puis, s’adressant à Mme Darbois, qui tremblait de tout son corps :
« Calmez-vous, chère madame, nous avons six ou huit mois devant nous avant l’accomplissement de ce projet, qui, je crois, nous donnera à tous satisfaction complète. »
Puis, voyant que les deux femmes étaient vêtues comme prêtes à sortir :
« Est-ce que vous retournez au Conservatoire ?
– Mais oui, je dois donner la réplique de Junie à M. Jean Perliez.
– Ah ! le fils d’un autre savant ! Le Conservatoire nous gâte aujourd’hui, dit Sardou. Eh ! bien, je vais vous conduire, madame, dit-il en s’inclinant courtoisement devant Mme Darbois. Cette enfant me fera connaître en route ses idées sur l’art dramatique ; elle doit en avoir de très intéressantes. »
Puis s’adressant à Darbois :
« N’êtes-vous pas de mon avis ? la compréhension d’une étude qui nous est familière, par un nouvel adepte fervent, ouvre le champ sur de nouveaux horizons et féconde parfois des idées ébauchées par notre cerveau.
– C’est vrai, » dit le philosophe.
L’heure avançait, les deux hommes se serrèrent la main, sentant qu’une amitié réelle allait désormais les unir. Resté seul, François regarda le pastel qui le laissait indifférent depuis longtemps.
Le portrait souriait de ce sourire qui l’avait tant charmé ; il se revoyait, demandant à M. de Gossec, riche industriel, la main de sa fille Germaine. Il effleura son front comme pour chasser le souvenir de la réponse négative qui lui avait été faite à ce moment-là, puis son visage s’illumina à la nouvelle vision qui se présentait à son esprit : Il se voyait dans l’église Saint-Germain-des-Prés, agenouillé près de Germaine de Gossec, tremblant d’émotion et de bonheur. Puis un voile de tristesse envahit son visage ; il suivait maintenant le cercueil de son beau-père qui s’était suicidé, laissant derrière lui un déficit assez important.
Le regard du philosophe s’enorgueillit : les treize premières années de son mariage avaient été consacrées au paiement de ce déficit ; et, la sœur du suicidé étant morte il y a quatre ans laissait à sa nièce six cent mille francs, dont cinq cent mille avaient servi au complet paiement du déficit. Depuis quatre ans, la famille était venue s’installer dans le très confortable appartement du boulevard Raspail et vivait heureuse et sans soucis matériels. Mais que ces treize premières années avaient été cruelles pour la jeune femme !
Il regarda longuement le pastel, ses yeux se remplirent de larmes.
« Ah ! chère femme, murmura-t-il ! »
Dans la voiture qui conduisait au Conservatoire Victorien Sardou, Mme Darbois et sa fille, la conversation était des plus animées. L’auteur dramatique, très intéressé, écoutait l’impulsive jeune fille développer ses théories sur l’art et la vie.
« Quel être curieux pensait-il, » et son regard scrutateur essayait en vain de découvrir la tare qui pourrait peut-être faire dévier ce petit être qui semblait si parfait.
« Comment cette paisible femme (il regardait Mme Darbois) et cet homme si calme, si mesuré (il pensait au philosophe), avaient-ils engendré cette puissance attractive qui était là devant lui ? »
La voiture s’arrêta au Conservatoire.
Sardou aida Mme Darbois à descendre, puis, après avoir vivement payé le cocher, il disparut, faisant de la main un petit signe à la jeune fille.
Jean Perliez attendait en bas de l’escalier ; son visage rayonna en voyant les deux femmes.
« Je craignais que vous ne m’ayez oublié, dans la joie de votre succès. » La jeune fille le regarda, étonnée :
« Est-ce qu’on peut oublier une parole donnée ?
– Vous connaissiez Victorien Sardou ? demanda le jeune homme.
– Non, dit en riant Espérance, nous le connaissons aujourd’hui, mais hier nous ne le connaissions pas ; il est venu voir papa tout à l’heure, et, comme il avait une voiture, il a proposé à maman de nous conduire ici. » Ils étaient arrivés dans la salle d’attente qui présentait le même aspect que le matin ; cependant le bruit semblait plus impérieux ; il y avait prise de possession pour beaucoup de candidats qui se croyaient déjà reçus. Quelques-uns, en effet, avaient eu des marques d’approbation encourageantes ; mais d’autres, qui n’avaient pu constater qu’un accueil glacial, se flattaient d’avoir été écoutés dans un silence religieux.
Une grosse fille, genre soubrette, avenante, clamait son succès :
« Ah ! mes enfants, je les ai épatés : ils étaient bouche bée. »
Puis s’adressant à l’employé bureaucrate :
« Toi, l’homme à la jaunisse, faudra voir à être plus poli, maintenant que je suis de la maison ! sans cela je te ferai mettre dehors ; j’ai le bras long, tu sais ! »
L’interpellé murmura : « J’t’écoute, ma fille, mais j’ai le bras plus long que toi ; tu n’es pas encore de la maison ! »
Il savait, cet homme, que, grâce à son parrain (qu’on affirmait être son père), et qui était maintenant un personnage important, nul ne pouvait rien contre lui et que sa modeste place, rétribuée de façon très honorable, était, pour ainsi dire, inamovible.
Quand Jean Perliez et Espérance firent leur entrée dans la celle d’audition, il y eut un bourdonnement flatteur, tant pour la jeune fille, qu’on revoyait avec joie, que pour le jeune homme, fils du distingué chimiste.
« Scène de Britannicus : M. Jean Perliez (Néron) Mlle Espérance Darbois (Junie), clama l’annonciateur ! »
La scène fut si parfaitement enlevée par les deux jeunes gens qu’un très bien s’échappa de l’aréopage entourant la table. Lequel de ces juges n’avait pu contenir son admiration ? Cela resta mystère pour les deux jeunes gens. Chacun d’eux pensa très sincèrement que le succès était dû à l’autre, et ils se complimentèrent avec bonne grâce.
« Nous serons amis, voulez-vous, monsieur Perliez, dit Espérance ? »
Le jeune homme rougit d’émotion et, Mme Darbois lui ayant tendu la main, il baisa respectueusement cette main, ce qu’il n’avait osé avec Espérance.