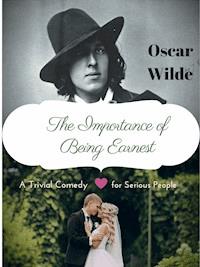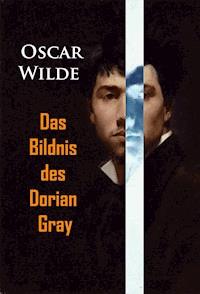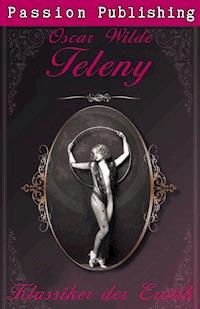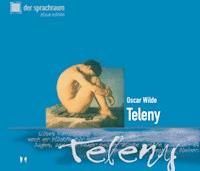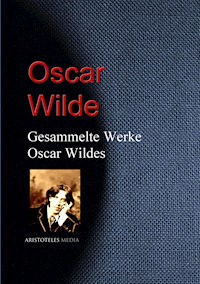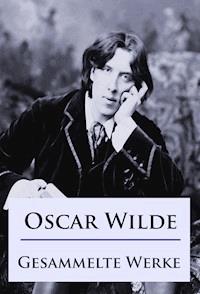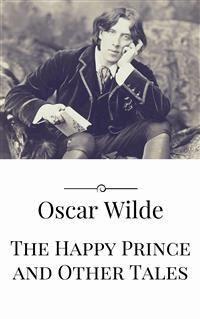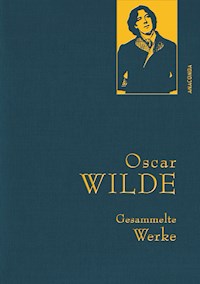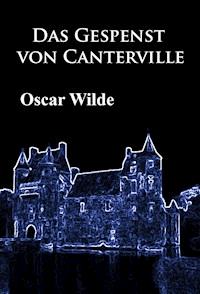Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
« Les Poèmes ont été publiés en 1881, puis réimprimés en 1882 aux États-Unis. Né en 1856, Oscar Wilde venait alors d'achever ses études à Oxford où il avait passé cinq années au Magdalen collège, remportant, en 1878, le prix Newdegate pour son poème Ravenne, écho des émotions et des souvenirs qu'il avait rapportés, l'année précédente, de son voyage en Italie et en Grèce avec le professeur Mahaffy. Les Poèmes firent grand bruit dans les cercles littéraires londoniens. Wilde fut très discuté. On ne peut douter de l'émoi suscité par les poèmes d'Oscar Wilde dans la très conservatrice aristocratie anglaise du 19ème siècle, car sous la prose enchanteresse initiée par ses voyages et son admiration pour les civilisations antiques, se glissent quelques vérités sur une société bien pensante qu'il n'aura de cesse de défier, sa courte vie durant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Poèmes
Pages de titreLES POÈMES D’OSCAR WILDEHÉLAS !LE JARDIN D’ÉROSLA NOUVELLE HÉLÈNECHARMIDÈSPANTHÉAHUMANITADSONNET À LA LIBERTÉAVE, IMPERATRIXÀ MILTONLOUIS-NAPOLÉONSONNET SUR LE MASSACRE DES CHRÉTIENS EN BULGARIEQUANTUM MUTATALIBERTATIS SACRA FAMESTHEORETIKOSREQUIESCATSONNET COMPOSE EN APPROCHANT DE L’ITALIESAN MINIATOAVE, MARIA, GRATIA PLENAITALIASONNET ÉCRIT PENDANT LA SEMAINE SAINTE À GÈNESURBS SACRA ET AETERNASONNET COMPOSÉ APRÈS L’AUDITION DU DIES IRAE CHANTÉ DANS LA CHAPELLE SIXTINEPÂQUESE TENEBRISVITA NUOVAMADONNA MIALA CHANSON D’ITYSIMPRESSION DU MATINPROMENADES DE MAGDALENATHANASIASÉRÉNADEENDYMIONLA BELLA DONNA DELLA MIA MENTECHANSONIMPRESSIONSLA TOMBE DE KEATSTHÉOCRITE – VILLANELLEDANS LA CHAMBRE D’OR – HARMONIEBALLADE DE MARGUERITE NORMANDELE SORT DE LA FILLE DU ROI BRETONNEAMOR INTELLECTUALISSANTA DECCAUNE VISIONIMPRESSION DE VOYAGELA TOMBE DE SHELLEYPRÈS DE L’ARNOFABIEN DEI FRANCHIPHÈDREPORTIALA REINE HENRIETTE-MARIEGLUKUPICROS ERÔSPage de copyrightPoèmes
Oscar Wilde
LES POÈMES D’OSCAR WILDE
Les Poèmes ont été publiés en 1881, puis réimprimés en 1882 aux États-Unis.
Né en 1856, Oscar Wilde venait alors d’achever ses études à Oxford où il avait passé cinq années au Magdalen collège, remportant, en 1878, le prix Newdegate pour son poème Ravenne, écho des émotions et des souvenirs qu’il avait rapportés, l’année précédente, de son voyage en Italie et en Grèce avec le professeur Mahaffy.
Les Poèmes firent grand bruit dans les cercles littéraires londoniens. Wilde fut très discuté.
Pour les uns, son oeuvre n’était que la réunion des informes essais d’un collégien sans originalité, rejetant en hâte dans la circulation ce qu’il avait pu s’assimiler plus ou moins étroitement des idées et de la civilisation des Anciens.
Pour d’autres, les Poèmes affectaient la plus fausse, la plus artificielle recherche d’originalité.
On y voyait, à les entendre, régner ce style alambique, contourné, bizarre que fut jadis celui de Lily et des Euphuistes, de Gongora et des Précieuses, et tout cela réussissait mal à masquer le vide d’une âme incapable de penser par elle-même.
Pour un troisième groupe enfin, il fallait voir dans les Poèmes comme « l’Évangile d’un nouveau Credo ». Wilde n’était-il pas l’apôtre et le pontife de l’art pour l’art, l’homme qui faisait bon marché du « puissant empire aux pieds d’argile », de la « petite île désertée par toute chevalerie » ? Chez lui plus de patriotisme, plus de haine invétérée du Papisme…
… « Parmi ses collines (de l’Angleterre), disait un de ses sonnets, s’est tue cette voix qui parlait de liberté. Oh ! Quitte-la, mon âme, quitte-la ! Tu n’es point faite pour habiter cette vile demeure de trafiquants où chaque jour
« On met en vente publique la sagesse et le respect, où le peuple grossier pousse les cris enragés de l’ignorance contre ce qui est le legs des siècles.
« Cela trouble mon calme. Aussi mon désir est-il de m’isoler dans des rêves d’art et de suprême culture, sans prendre parti ni pour Dieu ni pour ses ennemis. »
On ne pouvait lui refuser toute attache dans le passé et ce culte des choses d’autrefois qui est une partie du patrimoine intellectuel de l’artiste. S’il ne voulait prendre parti ni pour Dieu ni pour ses ennemis, son dédain de la bataille vile, des cris enragés de l’ignorance, érigeait une sorte d’autel au passé. »
« Esprit de beauté, reste encore un peu, chantait-il dans son Jardin D’Eros, ils ne sont pas tous morts, tes adorateurs de jadis. Il en vit encore un petit nombre de ceux à gui le rayonnement de ton sourire est préférable à des milliers de victoires, dussent les nobles victimes tombées à Waterloo, se redresser furieuses contre eux. Reste encore, il en survit quelques-uns. »
« Qui pour toi donneraient leur part d’humanité et te consacreraient leur existence. Moi, du moins, j’ai agi ainsi. J’ai fait de tes lèvres ma nourriture de tous les jours et dans tes temples j’ai trouvé un festin somptueux, tel que n’eût pu me le donner ce siècle affamé, en dépit de ses doctrines toutes neuves où tant de scepticisme s’offre sous une forme si dogmatique. »
« Là ne coule aucun Céphise, aucun Hissus. Là ne se retrouvent point les lois du blanc Colonos. Jamais sur nos blêmes collines ne croit l’olivier, jamais un pâtre simple ne fait gravir à son taureau mugissant les hautes marches de marbre et l’on ne voit point par la ville les rieuses jeunes filles t’apporter la robe brodée de crocus… »
Peut-être cet amour de l’antiquité, ce dédain du mercantilisme moderne, on eût pu de l’autre côté de la Manche les pardonner à Oscar Wilde s’il avait accepté de suivre la foule dans quelques-unes de ses ruées contre ce qu’elle haïssait. Mais là encore l’abîme s’ouvrait entre Wilde et ses contemporains.
Il a depuis exprimé ce regret que son père l’eût empêché alors de se faire catholique, seul contrepoids aux déviations qui allaient faire dérailler son âme sur les chemins de la vie.
La démonstration de cette tendance à une conversion catholique n’est pas inscrite dans ses Poèmes mais de leur lecture il résulte nettement que Wilde avait rapporté d’Italie le respect et le regret des âges passés de la Papauté. Il appartenait à cette petite élite protestante d’artistes et de musiciens à qui il parut, après 1870, qu’il y avait quelque chose de rompu dans l’esthétique romaine et qu’avec son Pontife-Roi Rome avait perdu un de ses plus beaux fleurons.
Pour moi, dit Wilde, pèlerin des mers du Nord, quelle joie de me mettre tout seul à la recherche du temple merveilleux et du trône de celui qui tient les clés redoutables.
Alors que tout brillants de pourpre et d’or, défilent et prêtres et saints cardinaux et que porté au-dessus de toutes les têtes arrive le doux pasteur du troupeau.
Quelle joie de voir, avant que je meure, ce seul roi qui soit oint par Dieu et d’entendre les trompettes d’argent sonner triomphalement sur son passage.
Ou lorsqu’à l’autel du sanctuaire, il élève le signe du mystérieux sacrifice et montre aux yeux mortels un Dieu sous le voile du pain et du vin.
Aussi chez le poète, quelle désillusion lorsqu’il voit dans là cité « couronnée par Dieu, découronnée par l’homme », flotter « l’odieux drapeau rouge, bleu et vert ».
Ce n’est pas qu’il ait abjuré le culte de la liberté, mais il n’a jamais aimé celle-ci pour elle-même. Il n’est que « sur certains points » avec ces Christs qui meurent sur les barricades. Il n’aime guère les enfants de la Liberté « dont les yeux mornes ne voient rien si ce n’est leur misère sans noblesse, dont les esprits ne connaissent rien, n’ont souci de rien connaîtra ». En somme, Malgré cette démangeaison moderne de liberté, je préfère le gouvernement d’un seul, auquel tous obéissent, à celui de ces démocrates braillards qui trahissent notre indépendance par les baisers qu’ils donnent à l’anarchie !
Ce qui lit vibrer son cœur, c’est que
… Le grondement des démocraties. Les règnes de la Terreur, les grandes anarchies, reflètent pareilles à la mer mes passions les plus fougueuses et donnent à ma rage un frein. Liberté ! Pour cela uniquement tes cris discordants Enchantent mon âme jusqu’en ses profondeurs. Sans cela tous les rois pourraient, au moyen du knout ensanglanté et des traitreuses mitraillades, dépouiller les nations de leurs droits inviolables,
« Que je resterais sans m’émouvoir… »
C’était un irréductible aristocrate, de cet « heureux petit nombre » qui concentre autour de soi la joie de vivre.
Et voilà pourquoi le monde, se vengeant, lui fut si cruel !
Albert Savine.
HÉLAS !
Être entraîné à la dérive de toute passion jusqu’à ce que mon âme devienne un luth aux cordes tendues dont peuvent jouer tous les vents, c’est pour cela que j’ai renoncé à mon antique sagesse, à l’austère maîtrise de moi-même.
À ce qu’il me semble, ma vie est un parchemin sur lequel on aurait écrit deux fois, où en quelque jour de vacances, une main enfantine aurait griffonné de vaines chansons pour la flûte ou le virelai, sans autre effet que de profaner tout le mystère.
Sûrement il fut un temps où j’aurais pu fouler les hauteurs ensoleillées, où parmi les dissonances de la vie, j’aurais pu faire vibrer une corde assez sonore pour monter jusqu’à l’oreille de Dieu !
Ce temps-là est-il mort ? Hélas ! Faut-il que pour avoir seulement effleuré d’une baguette légère le miel de la romance, je perde tout le patrimoine dû à une âme.
LE JARDIN D’ÉROS
Nous voici en plein printemps, au cœur de juin ; pas encore les travailleurs hâlés ne se hâtent sur les prairies des hauteurs, où l’opulent automne, saison usurière, ne vient que trop tôt offrir aux arbres l’or qu’il a mis de côté, trésor qu’il verra disperser par la folle prodigalité de la brise.
Il est bien tôt, vraiment ! L’asphodèle, enfant chérie du Printemps, s’attarde pour piquer la jalousie de la rose ; la campanule, elle aussi, tient déployé son pavillon d’azur. Et, pareil à un fêtard égaré, perdu, que ses frères ont laissé là, pour s’enfuir des bosquets, d’où les a chassés la grive, messagère de juin, seul, un pâle narcisse reste là, tout apeuré, tapi dans un coin d’ombre, où des violettes, presque inquiètes de leur propre beauté, se refusent à regarder face à face l’or du soleil, par effroi d’une trop forte splendeur. Ah ! C’est bien là, ce me semble— que viendraient se poser les pieds de Perséphone, quand elle est lasse des prairies sans fleurs de Pluton, — là que danseraient les adolescents arcadiens, là qu’un homme pourrait trouver le mystère secret de l’éternelle volupté, ce secret que les Grecs ont connu. Ah ! Vous et moi, nous pourrions le découvrir ici, pour peu que l’Amour et le sommeil y consentent.
Ce sont là les fleurs qu’Héraklèsen deuiisema sur la tombe d’Hylas, l’ancolie, avec toutes ses blanches colombes agitées d’un frisson, quand la brise les a froissées d’un baiser trop rude, la mignonne chélidoine qui, dans son jupon jaune, chante le crépuscule du soir, et le lilas en robe de grande dame, — mais laissons-les fleurir à l’écart, laissons là-bas, les spirales de la rose trémière, aux rouges dentelures, agiter sans bruit leurs clochettes, sans quoi l’abeille, son petit carillonneur, irait chercher plus loin quelque autre divertissement ; l’anémone qui pleure dès l’aube, comme une jolie fillette devant son galant, et ne laisse, qu’à grand-peine les papillons ouvrir toutes grandes, auprès d’elle, leurs ailes bigarrées, laissons-la languir dans la pâle virginité, La neige hivernale lui plaira mieux que des lèvres comme les tiennes, dont la brûlure ne saurait que la flétrir. Va-t’en plutôt cueillir cette fleur amoureuse qui s’épanouit solitaire, et que le vent, entremetteur, poudre de baisers savoureux qui ne sont pas de lui.
Les liserons aux fleurs en forme de trompette, et qu’aiment tant les jeunes filles ; la reine des prés, à la teinte de crème, plus blanche que la gorge de Junon, odorante autant que l’Arabie entière ; l’hyacinthe, que les pieds de Diane chasseresse hésiteraient à fouler, même à la poursuite du plus beau des daims tachetés, la marjolaine en bouton, dont un seul baiser suffirait à embaumer les lèvres de la déesse de Cythère, et rendre jaloux Adonis, — cela, c’est pour ton front, — et pour te faire une ceinture, — voici ce flexible rameau de clématite pourpre, dont la couleur somptueuse efface de son éclat le roi de Tyr, — et ces digitales aux corolles retombantes, — mais pour cet unique narcisse, que laissa tomber de sa robe la saison printanière, lorsqu’elle entendit avec effarement, dans les bois où elle régnait, résonner le chant ardent, orageux de l’oiseau d’été.
Ah ! Qu’il te soit un souvenir subtil de ces jours charmants de pluie et de soleil, alors qu’avril riait à travers ses larmes, en voyant la précoce primevère quitter d’un pied furtif les racines tortueuses des chênes, et envahir la forêt, au point que malgré ses feuilles jaunies et froissées, elle se couvrait d’un or étincelant.
Non, lu peux le cueillir aussi. Il n’a pas même la moitié de ton charme, ô toi l’idole de mon âme, et quand tes pieds seront las, les anchuses tisseront leurs tapis les plus brillants ; pour toi, les chèvrefeuilles oublieront leur orgueil et voileront leur lacis confus, et tu marcheras sur les pensées bariolées.
Et je couperai un roseau dans le ruisseau de là-bas, et je rendrai jaloux les dieux des bois ; le vieux Pan se demandera quel est ce jeune intrus qui s’enhardit à chanter dans ces retraites plus creuses où jamais homme ne devrait risquer un pied le soir, par crainte de surprendre Artémis et sa troupe aux corps de marbre.
Et je te coulerai pourquoi la jacinthe se revêt d’une aussi morne parure de gémissements plaintifs ; pourquoi l’infortuné rossignol s’interdit de lancer son chant en plein jour, et préfère pleurer seul, alors que dort la rapide hirondelle et que les riches font la fête ; et pourquoi le laurier tremble en voyant des lueurs d’éclair à l’Orient.
Et je chanterai comment la triste Proserpine fut mariée à un grave, à un sombre maître et seigneur.
Des prairies infernales semées de lotus j’évoquerai Hélène aux seins d’argent, et aussi tu verras cette beauté fatale, pour qui deux puissantes armées se heurtèrent d’un choc terrible, dans l’abîme de la guerre.
Puis je te chanterai ce conte grec où Cynthia s’éprend du jeune Endymion, et s’enveloppant d’un voile gris de brouillards, se bute vers les cimes du Latmos, dès que le soleil quitte son lit de l’Océan, pour s’élancer à la poursuite de ces pieds pâles et légers qui se fondent sous son étreinte.
Et si ma flûte est capable de verser une douce mélodie, nous pourrons voir face à face celle qui, en des temps bien lointains, habita parmi les hommes, près de la mer Égée, et dont la triste demeure au portique ravagé, au mur dépouillé de sa frise, aux colonnes croulées, domine les ruines de cette cité charmante, ceinte de violettes.
Esprit de beauté, reste encore un peu : ils ne sont pas tous morts, tes adorateurs de jadis ; il en vit encore un petit nombre, de ceux pour qui le rayonnement de ton sourire est préférable à des milliers de victoires, dussent les nobles victimes tombées à Waterloo se redresser furieuses contre eux ; reste encore, il en survit quelques-uns, qui pour toi donneraient leur part d’humanité, et te consacreraient leur existence. Moi, du moins, j’ai agi ainsi. J’ai fait de tes lèvres ma nourriture de tous les jours, et dans tes temples j’ai trouvé un festin somptueux, tel que n’eût pu me le donner ce siècle affamé, en dépit de ses doctrines toutes neuves, où tant de scepticisme s’offre sous une forme si dogmatique.
Là, ne coule aucun Cephise, aucun Ilissus ; là ne se retrouvent point les bois du blanc Colonos. Jamais sur nos blêmes collines ne croit l’olivier, jamais un pâtre simple ne fait gravir à son taureau mugissant les hautes marches de marbre ; on ne voit point par la ville les rieuses jeunes filles t’apporter la robe brodée de crocus.
Pourtant, reste encore. Car l’enfant qui t’aima le mieux, dont le seul nom devrait être un souvenir capable de te retenir, dort dans un repos silencieux, au pied des murs de Rome, et la mélodie pleure d’avoir perdu sa lyre la plus douce ; nul ne saurait manier le luth d’Adonais, et le chant est mort sur ses lèvres.
Non, à la mort de Keats, il restait encore aux Muses une voix argentine pour chanter sa thrénodie, mais hélas ! nous la perdîmes trop tôt, en cette nuit déchirée par la foudre, en cette mer rageuse, Panthéa vint réclamer comme son bien celui qui l’avait chantée, et fermer la bouche qui l’avait louée ; depuis lors, nous allons dans la solitude, nous n’avons plus que ce cœur ardent, cette étoile matinale de l’Angleterre ressuscitée, dont le clair regard, derrière notre trône croulant, et les ruines de la guerre, vit les grandes formes grecques de la jeune Démocratie surgir dans leur puissance comme Hespérus, et amener la grande République . À lui du moins tu as enseigné le chant.
Et il t’a accompagné en Thessalie, et il a vu la blanche Atalante, aux pieds légers, à la virginité impassible et sauvage, chasser le sanglier armé de défenses. Son luth, aussi doux que le miel, a ouvert la caverne dans la colline creuse, et Vénus rit de savoir qu’un genou fléchira encore devant elle.
Et il a baisé les lèvres de Proserpine et chanté le requiem du Galiléen. Ce front meurtri, taché de sang et de vin, il l’a découronné. Les Dieux de jadis ont trouvé en lui leur dernier, leur plus ardent adorateur, et le signe nouveau s’efface et pâlit devant son vainqueur.
Esprit de Beauté, reste encore avec nous. Elle n’est point encore éteinte, la torche de la poésie.
L’étoile qui surgit par-dessus les hauteurs de l’Orient défend invinciblement ses armoiries argentées, contre les ténèbres qui s’épaississent, contre la fureur des ennemis. Oh ! Reste encore avec nous, car, au cours de la nuit longue et monotone,
Morris, le doux et simple enfant de Chaucer, l’aimable héritier des pipeaux mélodieux de Spencer, a souvent charmé par ses tendres airs champêtres l’âme humaine en ses besoins et ses détresses, et des champs de glace, lointains et dénudés, a rapporté assez de belles fleurs pour faire ensemble un paradis terrestre.