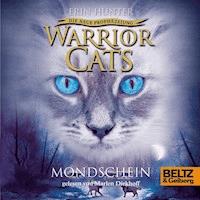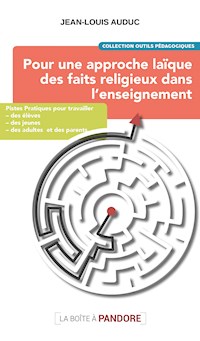
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Comment enseigner les Faits religieux ? Jean-Louis Auduc propose un outil pédagogique directement mobilisable en classe. L’enseignant.e y trouvera 7 fiches de leçons ainsi qu’une annexe reprenant des documents photos.
Comme le dit si bien le site ToutEduc : « Jean-Louis Auduc nous rappelle que "l’enseignement laïque des faits religieux est inscrit dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture" car ce sont des "éléments de compréhension de notre patrimoine culturel et du monde contemporain : rites, textes fondateurs, coutumes, symboles, traces matérielles ou immatérielles, manifestations sociales, oeuvres...". Il ajoute que cet enseignement "ne doit en rien signifier mépriser le sacré, mais plutôt l’approcher comme un élément culturel important permettant la compréhension de la religion. C’est une approche scientifique qui permet de séparer l’approche culturelle d’une approche rituelle ou cultuelle."
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Louis Auduc , enseignant, pédagogue, auteur a été de nombreuses années directeur-adjoint de l'INSPÉ de Créteil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
1) Enseigner les faits religieux à l’école : Un enjeu, une nécessité dans une école laïque
2) Les 5 P guidant le professeur pour éviter le 6e : la PEUR
2A : Les Programmes existant
2B : Les Patrimoines artistiques, architecturaux, littéraires, au cœur de la réflexion
2C : Pluralité des religions, pluralité des approches dans les diverses religions
2D : Des Projets avant tout interdisciplinaires
2E : Le souci permanent de la Personne de l’élève
3) 7 fiches de leçons basées sur des approches transversales
3A : La mesure du temps
3B : L’eau
3C : La montagne
3D : Le soleil et les astres
3E : L’arbre et les plantes ( Sapin, gui, acacia , …)
3F : Les interdits ou recommandations alimentaires
3G : Humour, plaisanterie, caricature et religion
Annexes
édifices servant au culte de différentes religions classés monuments historiques en FranceBibliographieIntroduction : L’école publique est un espace laïque de savoir et de citoyenneté
« La loi doit protéger la foi pour autant que la foi ne prétendre pas dicter la loi… »
Aristide BRIAND - 1905
Espace spécifique parce qu’elle est un service public, un espace d’intérêt général. L’intérêt général n’étant pas la somme des intérêts particuliers ; des limites au prosélytisme politique, religieux et commercial y sont mis. L’école publique est au service de tous les élèves, elle n’a pas à prendre en compte, quelle qu’elle soit, l’idéologie de chaque famille.Laïque, parce qu’elle accueille tous les élèves d’où qu’ils viennent, quelles que soient leurs situations, parce qu’elle est indépendante du politique, du religieux, du commercial.De savoirs, parce qu’on y enseigne des savoirs légitimés, bases des programmes nationaux et non des croyances ou des opinions personnelles.Et de citoyenneté, parce qu’en développant la personnalité de chacun, en aidant chacune et chacun à s’approprier les valeurs de la République, elle œuvre à construire la citoyenne, le citoyen de demain.1. Enseigner les faits religieux à l’école : Un enjeu, une nécessité dans une école laïque
L’enseignement laïque des faits religieux est inscrit dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Il décrit et analyse ces faits comme éléments de compréhension de notre patrimoine culturel et du monde contemporain : rites, textes fondateurs, coutumes, symboles, traces matérielles ou immatérielles, manifestations sociales, œuvres...
Ces faits religieux ont eu, et ont encore, une influence sur les sociétés antiques, médiévales, modernes et contemporaines.
Leur enseignement n’est pas une discipline à part entière, mais un enseignement transversal qui encourage le décloisonnement disciplinaire, associant l’histoire, les lettres, l’histoire des arts, l’éducation musicale, les arts plastiques ou la philosophie.
Un tel enseignement se déroule sur la base de savoirs légitimés et non de croyances ou d’opinions personnelles.
Le fait religieux fait partie du patrimoine, de l’héritage culturel d’une nation.
Un enseignement laïque digne de ce nom doit attacher de l’importance à ce que la dimension culturelle des religions qui ont exercé le plus d’influence sur l’histoire de notre nation soit présente dans les programmes scolaires. Il est donc essentiel que l’école sensibilise tous les jeunes à toutes les dimensions de leur héritage, y compris religieuses... Elle ne peut laisser à d’autres la formation à la connaissance de l’art religieux, l’approche historique et culturelle de la Bible, du Coran, des textes. Ce serait, d’une certaine manière, favoriser les intégrismes et les sectes de tout bord.
Bien séparer le culturel du cultuel, l’historique du sacré
Toutes les religions ont leurs livres, leurs espaces, un lieu, un monument, un arbre, voire un fleuve considérés comme sacré.
Ce sacré reste plus ou moins vivant selon les religions, voire a disparu pour certaines.
Enseigner dans une approche laïque les faits religieux ne doit en rien signifier mépriser le sacré, mais plutôt l’approcher comme un élément culturel important permettant la compréhension de la religion.
C’est une approche scientifique qui permet de séparer l’approche culturelle d’une approche rituelle ou cultuelle.
C’est cette démarche qui a été suivie pour le Coran dans l’ouvrage « Le Coran des historiens ». Cet ouvrage, qui réunit trente spécialistes internationaux, offre, en trois mille pages, une synthèse complète et critique des travaux passés et des recherches présentes sur les origines du Coran, sa formation et son apparition, sa composition et sa canonisation : vingt études exhaustives sur le contexte introduisent ici à l’analyse circonstanciée du texte, les éléments archéologiques et épigraphiques, les environnements géographiques et linguistiques, les faits ethnologiques et politiques, les parallèles religieux éclairant, verset après verset, en un commentaire total les cent quatorze sourates du livre fondateur de l’islam.
C’est ce même type de démarches que suivent les historiens travaillant sur les Evangiles, la Bible, la Torah, la Bhagavad-Gita ou le Mahabharata ou tout texte important d’une religion.
La laïcité française, garant de la liberté de culte, comme de la possibilité de n’avoir aucun culte
La laïcité française issue de la loi de séparation de l’église et de l’état garantit pleinement la liberté de culte et permet à chacun de croire ou de ne pas croire.
Dans le droit fil de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. », la liberté d’expression en France implique le droit à la critique, même des religions et des politiques.
Qui dit droit à la critique, implique que si l’on juge que la critique, la caricature est blessante, fait appel à la haine, au meurtre, les tribunaux peuvent être saisis. Ceux-ci sont juges pour savoir si celle-ci « trouble l’ordre public ».
Dans le cas des caricatures de Charlie Hebdo, le tribunal a jugé que ce n’était pas le cas. Par contre, pour une caricature représentant un immigré africain sous les traits d’un singe menaçant, ses deux auteurs ont été condamnés à des amendes
2. Les 5 P guidant le professeur pour éviter le 6e : La PEUR
L’enseignement des faits religieux repose sur cinq principes, les « cinq P » pour bien gérer le sixième P de « Peur ».
– Les programmes : partir de toutes les parties des programmes évoquant les faits religieux pour bien développer les connaissances des élèves sur ces questions en les contextualisant.
– Le patrimoine : découvrir les monuments, les œuvres artistiques, musicales, picturales, etc…, les textes historiques... qui font l’héritage d’une nation.
– La pluralité : comprendre que les interprétations et les courants religieux sont pluriels.
– La personne de l’élève : avoir conscience qu’elle doit toujours être respectée
– Un projet interdisciplinaire : privilégier un travail interdisciplinaire qui facilite l’approche dans l’enseignement des faits religieux.
2 a. Les programmes existants
L’enseignement du fait religieux est, par excellence, l’enseignement sur lequel peut prendre appui un travail interdisciplinaire car la dimension religieuse interfère souvent dans plusieurs matières.
Nous prendrons ici quelques exemples, sans qu’on puisse considérer que ceux-ci ont un caractère exhaustif.
Dans les collègesPar exemple :
– En français : la Bible figure dans la liste des ouvrages qu’il est recommandé d’étudier avec les élèves de Sixième et de Cinquième ;
– En histoire-géographie figurent aux programmes : l’étude de l’Antiquité gréco-latine, les Hébreux et l’apport spirituel de la Bible (Sixième), la croissance et le développement du christianisme (Sixième), la civilisation de l’Inde (Sixième), Byzance (Cinquième), la civilisation arabo-islamique et son expansion (Cinquième), l’évolution de la civilisation chrétienne en Europe occidentale (Cinquième), la Réforme et la Contre-Réforme (Cinquième), l’Ancien Régime en France, y compris ses aspects religieux (Quatrième).
– En histoire de l’art , comme en Arts Plastiques : L’influence religieuse dans le patrimoine artistique est un incontournable, comme elle l’est pour l’histoire de la musique
Dans les lycées :– En français : l’étude de certains auteurs figurant dans les programmes implique la rencontre de la pensée religieuse : Pascal, Bossuet, Claudel, Bernanos, Hugo, etc.
– En histoire-géographie : en Seconde, les trois religions du livre (judaïsme, catholicisme, islam) sont étudiées au travers de leur doctrine, de leur histoire et de leurs rapports au cours des siècles ; en Première, le mouvement intellectuel, religieux et artistique dans l’entre-deux guerres ; en Terminale la religion, l’évolution des phénomènes religieux, l’Église et le fait religieux dans le monde d’aujourd’hui ;
– En philosophie : l’étude de la pensée religieuse est explicitement au programme.
– En langues, en collège et en lycée, la dimension culturelle d’une langue ne peut faire l’impasse sur la dimension « faits religieux ».
Il est donc important aux yeux des élèves de bien relier l’enseignement des faits religieux avec les programmes scolaires en vigueur, pour lui montrer, ainsi qu’aux yeux de sa familles qu’il ne s’agit pas d’une « lubie » de l’enseignant, mais de l’application pure et simple des programmes, notamment dans une vision interdisciplinaire transversale.
2 b. Les patrimoines artistiques, architectureux, littéraires au coeur de la réflexion
Aborder les faits religieux, c’est aussi aborder la question des divers patrimoines qu’ils ont pu léguer.
Il faut rappeler que la loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905 a profondément transformé le service des monuments historiques né un siècle auparavant.
Le rôle de l’État est en effet essentiel et fait l’originalité du système de protection français. Il définit le monument historique, le nomme, en fait la liste, le conserve, le répare, participant ainsi à la construction d’une mémoire nationale, d’un héritage architectural, puis il en contrôle le devenir. Cette administration se heurte, dès l’origine, à celle des cultes.
Cette conception, uniquement « archéologique », qui ne prend en compte que l’intérêt culturel et historique des édifices est appliquée avec rigueur par les architectes des monuments historiques.
Cette volonté unificatrice dans la restauration se heurte aux pratiques du service des édifices diocésains qui doit d’abord tenir compte des nécessités du culte et donc réaménager, transformer, agrandir églises et cathédrales en fonction des besoins.
Jusqu’en 1905, les deux services restent séparés et, malgré la loi, les projets concernant les cathédrales classées continuent à ne pas être systématiquement soumis à la Commission des monuments historiques.
La loi de séparation des Églises et de l’État « eut pour effet de bouleverser l’équilibre séculaire auquel on était parvenu pour ce qui concernait les édifices du culte ». L’administration des cultes est supprimée ; la loi de finances du 17 avril 1906 transfère aux Beaux-Arts le service des édifices diocésains avec ses crédits et son personnel administratif et technique.
Cette réforme administrative est éminemment politique : «le ministre des Beaux-Arts [...], en groupant dans un même bureau tous les édifices classés qui n’appartiennent pas à l’État, édifices religieux, civils et militaires, indique bien qu’il les comprend tous dans un même intérêt, en se plaçant uniquement au point de vue de la valeur artistique qu’ils pré¬ sentent, abstraction faite de leur origine ou de leur affectation actuelle.» La laïcité appliquée aux monuments historiques en quelque sorte.
La loi de séparation des Églises et de l’État du 31 décembre 1905 est un moment essentiel de l’histoire culturelle de la France.
Dans l’évolution du service des monuments historiques, elle marque une véritable coupure et provoque une réorganisation administrative et financière. Pour ce qui nous concerne ici, elle entraîne une augmentation considérable du nombre des monuments historiques et un changement non moins essentiel dans la conception que l’on pouvait en avoir.
Dans ce nouveau cadre, le problème des objets mobiliers prend une acuité nouvelle. Alors que le classement prévu par la loi de 1887 n’était pas terminé, la nouvelle loi prévoit le classement complet et définitif des objets mobiliers dans un délai de trois ans. La tâche est immense et le danger pressant. Pour éviter les vols et le vandalisme dans les églises, qui ne sont désormais plus protégées par le personnel des fabriques, on décide de protéger momentanément l’ensemble des objets mobiliers contenus dans les lieux de culte et de mettre progressivement en place dans les départements des équipes qui assureront l’inventaire et l’étude de ces objets et proposeront le classement définitif des plus remarquables.
Ainsi, au bout de trois ans, fin 1908, plus de 7 000 objets supplémentaires sont classés, ce qui porte leur nombre à 11000. La tâche n’étant pas terminée, le délai initial de trois ans sera prorogé à trois reprises. Fin 1911, on compte 14 000 objets classés.
En ce qui concerne les immeubles proprement dits, la loi de 1905 est aussi lourde de conséquences. Du 1er janvier 1906 au 1er juillet 1910, 1 200 classements environ ont été prononcés (dont plus de 700 édifices religieux), auxquels il faut ajouter 250 nouveaux classements (dont la moitié d’édifices religieux) du 1er juillet 1910 au 1er juillet 1911(7), ce qui donne plus de 4 000 édifices classés au début de 1912. Au total, de 1906 à 1914, 2 080 édifices supplémentaires, essentiellement religieux, sont classés dont 349 en 1913, année record. Le nombre des églises et chapelles classées, qui était à peine supérieur à 900 en 1905, atteint 2 100 en 1914.
Le 31 décembre 1913, une nouvelle loi prend acte de cette évolution et accroît les pouvoirs juridiques de l’État. Quelques mois plus tard, en juillet 1914, une Caisse nationale des monuments historiques et des sites permettra de drainer des ressources supplémentaires pour ce service au champ d’intervention accru.
La loi de séparation des Églises et de l’État a donc profondément transformé le service des monuments historiques. Il a consacré une attitude nouvelle à l’égard des édifices du culte les plus éminents. Désormais placés sous surveillance des Beaux-Arts qui en assure également l’entretien, ils rejoignent le lot commun du patrimoine culturel, à défendre pour son intérêt artistique et historique et à restaurer en fonction de critères strictement «archéologiques».
De patrimoine des seuls croyants, ils deviennent l’héritage de l’ensemble de la population dont ils constituent une part de l’histoire et de la culture, comme le défendait le service des monuments historiques depuis sa création.
Faire visiter une église, un temple, une mosquée, une synagogue, une pagode, etc… est une démarche culturelle qui ne revêt aucun aspect cultuel. Elle est donc pleinement laïque comme l’est l’étude d’une sculpture, d’un tableau, d’un texte, l’audition d’un morceau de musique à connotation religieuse…..
2 c. Pluralité des religions existantes - pluralité des approches dans les diverses religions
Les religions sont diverses aujourd’hui, mais ce qu’il est important de faire comprendre à des élèves, c’est que chacune des grandes religions monothéistes comprend une diversité d’approches qui se sont peu à peu construites, ont pu disparaître, se reconstituer, mais montrer que par rapport à un texte, une tradition, il y a toujours eu diversité d’interprétations .
Il n’y a donc pas le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, l’orthodoxie, le judaïsme, l’Islam, le Bouddhisme, mais par exemple, les christianismes, les catholicismes, les protestantismes, les orthodoxes, les judaïsmes, les Islams, les Bouddhismes... Donner à penser à des élèves qu’il n’y a qu’une seule interprétation d’un texte, d’une tradition, c’est d’une certaine manière favoriser une lecture «intégriste» des textes et ne pas leur montrer que chaque interprétation peut relever du libre arbitre de chacun.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)