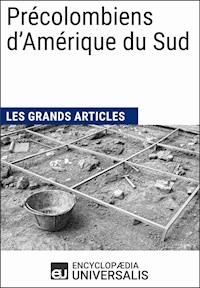
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
L'Amérique du Sud précolombienne recouvre une vaste aire géographique composée de l'aire andine centrale (le Pérou et la Bolivie), l'aire intermédiaire (le Venezuela, la Colombie et l'Équateur) et l'aire périphérique, qui comprend notamment les îles des Caraïbes. Malgré leur extrême diversité, les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852297586
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Marques/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Précolombiens d’Amérique du Sud
L’Amérique du Sud précolombienne recouvre une vaste aire géographique composée de l’aire andine centrale (le Pérou et la Bolivie), l’aire intermédiaire (le Venezuela, la Colombie et l’Équateur) et l’aire périphérique, qui comprend notamment les îles des Caraïbes. Malgré leur extrême diversité, les civilisations précolombiennes d’Amérique du Sud présentent un grand nombre de caractéristiques communes, comme une économie fondée sur l’agriculture et des rituels en grande partie liés à la fertilité des cultures, parmi lesquels un fort intérêt pour l’astronomie qui permit l’élaboration du calendrier des semailles et des récoltes.
E.U.
1. L’Amérique du Sud préhistorique
Si l’on conserve au mot « préhistoire » son sens le plus courant : « histoire de l’humanité depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’apparition des premiers témoignages écrits » (M. Brézillon, 1969), la préhistoire sud-américaine ne prend fin qu’au début du XVIe siècle avec l’arrivée des premiers navigateurs et des conquistadores européens ; en effet, aucun témoignage indubitable d’un système d’écriture quelconque n’a jusqu’ici été retrouvé en Amérique du Sud, et notre connaissance des civilisations précolombiennes se fonde essentiellement sur l’interprétation des vestiges matériels. Il est donc nécessaire de choisir ici un autre critère, qui sera l’apparition des premières sociétés dites complexes, sédentaires, à l’organisation sociale élaborée et hiérarchisée, à l’économie fondée sur l’agriculture et/ou l’élevage et utilisant, pour la plupart d’entre elles, la poterie.
• Des origines aux sociétés complexes
La préhistoire du continent sud-américain constitue par ailleurs un champ d’étude très différent de celui qui est offert par l’Ancien Monde. Il s’agit, en effet, d’une expérience qui eut lieu en vase clos, au contraire de ce qui s’est passé en Europe et en Asie, où actions et réactions des groupes préhistoriques aux mêmes époques ont été multiples et souvent difficiles à démêler. En Amérique, les premiers occupants ont vu s’ouvrir devant eux un continent vide, aux paysages et à la faune non encore modifiés par l’homme, non soumis à des influences culturelles extérieures. Cet univers intact présentait des milieux naturels fortement tranchés auxquels l’homme dut s’adapter relativement vite mais sans avoir à subir, du moins au début, la concurrence d’autres groupes. Par ailleurs, le peuplement de l’Amérique est un phénomène très récent, comparé à celui de l’Ancien Monde. S’il semble désormais difficile de refuser à l’homme américain une ancienneté d’au moins 30 000 ans, nous sommes loin des 3 millions d’années de l’Homo habilis est-africain, et les premiers hommes américains étaient déjà des Homo sapiens sapiens. Troisième différence enfin avec l’Ancien Monde, la science préhistorique est en Amérique une science très jeune. Certes, des trouvailles d’« homme fossile » et d’espèces animales disparues avaient eu lieu dès le milieu du XIXe siècle (travaux de W. P. Lund au Brésil), au moment même où, en France, J. Boucher de Perthes publiait ses Antiquités celtiques et antédiluviennes. Les découvertes de Lund venaient trop tôt, les esprits n’étaient pas encore mûrs pour admettre l’idée d’un homme préhistorique américain alors que la notion commençait à peine à être acceptée en Europe. Quant aux travaux de l’Argentin F. Ameghino, qui prétendit, vers 1870, avoir découvert dans la pampa un « homme tertiaire », ils eurent pour résultat, et pour plusieurs années, de jeter le discrédit sur l’antiquité de l’homme dans le Nouveau Monde. L’anthropologue A. Hrdlicka (1869-1943) et ses disciples refusèrent toujours (et certains continuent à le faire) d’attribuer à l’homme américain une antiquité supérieure à une dizaine de milliers d’années. Il fallut attendre la découverte du site de Folsom, au Nouveau-Mexique en 1926, pour que soit enfin acceptée la contemporanéité de l’homme et d’espèces animales fossiles. C’est seulement depuis quelques décennies que la multiplication des découvertes et le progrès des techniques scientifiques ont permis la naissance de la préhistoire américaine (voir Le peuplement initial de l’Amérique).
Amérique du Sud : préhistoire jusqu'en 8000 B.P.. Gisements de l'époque précéramique occupés avant 12 000 B.P. et jusqu'en 8000 B.P.
Depuis les années 1970, les recherches se sont intensifiées et on peut avancer maintenant que la présence de l’homme Amérique du Sud est très probable depuis 25 000, voire 30 000 ans. Si, au début, l’extrême dispersion géographique des découvertes et l’insuffisance des données publiées avaient conduit une bonne partie des spécialistes à écarter l’hypothèse d’un très ancien peuplement sud-américain, il semble aujourd’hui difficile de rejeter ces données. Les sites très anciens restent cependant très rares, les restes humains inconnus et l’éparpillement des découvertes dans des zones immenses rend impossible non seulement la distinction d’aires culturelles différentes, mais toute connaissance précise des modalités de cette première occupation humaine.
Les premiers occupants de l’Amérique du Sud sont très probablement arrivés du nord, par l’Amérique centrale, c’est-à-dire par l’isthme de Panamá, qui fut, semble-t-il, toujours émergé et praticable. Il est même possible que durant les périodes glaciaires il ait été plus large qu’actuellement et couvert d’une végétation de savane arbustive plus aisément pénétrable que l’actuelle forêt tropicale. Le problème majeur est en fait non pas celui des sites, mais celui de leur conservation, de leur visibilité et de leur recherche. On ne doit pas oublier que la densité des découvertes archéologiques dans une région du monde ne fait généralement que refléter la densité des recherches qui y sont effectuées, ni confondre « carte de peuplement préhistorique » et « carte des gisements découverts ». Dans les régions tempérées de l’Amérique du Sud, les recherches ne sont pas plus difficiles à mener qu’en Europe, mais il n’en va pas de même dans les zones tropicales et équatoriales ou dans les archipels inhospitaliers de la Patagonie. Là, l’extrême humidité, l’épaisseur de la couverture végétale ont pu faire disparaître toute trace d’occupation ancienne, en même temps qu’elles découragent la prospection archéologique ; ici, les variations du niveau des mers, la présence de la forêt magellanique et la difficulté d’accès empêchent le repérage des sites. Et ce n’est pas par hasard que les découvertes ont eu lieu en général dans des régions de prime abord favorables : tout d’abord la région andine, c’est-à-dire les plateaux, les chaînons montagneux et leurs piémonts, les bassins interandins, qui, du 2e au 20e degré de latitude sud approximativement, forment l’épine dorsale du continent ; de l’autre côté, les régions relativement sèches du rebord atlantique, d’altitude faible ou modérée. Plusieurs spécialistes pensent d’ailleurs que ces régions furent celles-là mêmes que choisirent les premiers groupes humains arrivés en Amérique du Sud à partir de Panamá, car elles constituaient déjà à cette époque les voies de cheminement les plus faciles, autant que les lieux d’installation les plus propices.
• Les occupations pléistocènes (ca. 30 000 à 12 000 B.P.)
Les plus anciens indices de présence humaine proviennent du Brésil, où les niveaux inférieurs (datés d’entre 40 000 et 15 000 B.P. (Before Present), les dates les plus anciennes restant très contestées) de la Toca do Boqueirão da Pedra Furada (État du Piaui) ont livré une industrie lithique de galets aménagés et d’éclats grossièrement retouchés, retrouvés autour de foyers. Ces dates, qui en font pour l’instant le gisement le plus ancien d’Amérique, et la nature anthropique des objets de pierre taillée, sont encore loin d’être acceptées par tous les spécialistes. En dépit d’innombrables expertises et contre-expertises Pedra Furada reste le site le plus controversé de la préhistoire américaine. Dans l’État du Mato Grosso, l’abri de Santa Elina a fourni lui aussi des dates autour de 25 000 B.P., pour un niveau contenant des restes osseux d’un grand édenté fossile (Glossotherium) et des éclats ou plaquettes de calcaire apparemment retouchés.
Les sites ou les niveaux datés entre 15 000 et 12 000 B.P. sont en revanche un peu plus nombreux et, bien que toujours rejetés par certains, acceptés par de nombreux archéologues. Au Venezuela, à Taima-Taima (Falcón) où les premières fouilles avaient donné des résultats confus, des restes de faune pléistocène (mastodonte, cheval, édenté géant), associés à des objets de pierre grossièrement travaillés mais aussi à un fragment de pointe de jet bifaciale, ont été datés de 14 000 B.P. environ. Au Brésil, l’occupation des abris du Piaui se poursuit et des occupations d’ancienneté comparable ont été détectées à Sítio do Meio, Baixão da Perna, toujours caractérisées par une industrie sans pièces bifaciales. Au Pérou, dans la grotte de Pikimachay (Ayacucho), à une première phase « Paccaicasa » plus que douteuse succède une occupation « Ayacucho » mieux attestée (14 000-13 000 B.P.) où sont associés des restes de faune pléistocène (cheval, camélidé, édenté géant) et des outils lithiques encore frustes, chopping-tools grossiers et éclats peu ou pas retouchés mais dont l’origine anthropique est cette fois indéniable car, contrairement à ceux de l’hypothétique phase précédente, ils sont taillés dans des matériaux différents de ceux qui constituent les parois de la grotte. Au Chili, la station de plein air de Monte Verde (Llanquihué), datée de 12 500 B.P. constitue l’exemple, pour le moment unique en Amérique, d’un habitat où ont été exceptionnellement préservés, par une tourbière, les restes d’une douzaine d’habitations à l’armature de troncs minces recouverte de peaux de mastodonte, plusieurs foyers aménagés, des mortiers et de nombreux instruments de bois et, plus rares, quelques outils lithiques rudimentaires (galets utilisés, chopping-tools grossiers, sphéroïdes), mais également quatre pièces bifaciales, dont l’une, de forme lancéolée, ressemble étrangement à celle découverte à Taima-Taima. Plus spectaculaires encore, les restes de sept ou huit mastodontes, dispersés aux alentours du campement, portaient des traces de fracture et de décarnisation. Ces découvertes, pour le moment uniques, enrichissent de manière singulière l’image quelque peu simpliste que l’on se fait généralement de la vie des chasseurs « primitifs » d’Amérique du Sud. En Patagonie argentine enfin, seuls deux sites présenteraient des niveaux d’occupation antérieurs à 12 000 B.P., tous deux caractérisés par l’absence d’industrie bifaciale : la grotte de Los Toldos, dont le niveau 11, daté de 12 600 B.P., pourrait en réalité correspondre à un niveau « Toldense » plus récent ; et l’abri Piedra Museo AEP-1 (niveau VI) où un charbon a fourni une datation de 12 890 B.P., toutefois infirmée par d’autres analyses (sur os) qui ramèneraient cette occupation à une date non antérieure à 11 000 B.P. Dans les deux cas, les occupations, de courte durée, seraient le fait d’un groupe de chasseurs de mégafaune (cheval fossile Hippidion) et de guanaco, utilisant un bel outillage d’éclats retouchés en bois silicifié et calcédoine, mais dépourvu de pointes bifaciales.
Si l’on en croit ce que suggèrent l’observation des quelques structures conservées – traces d’habitations, foyers, accumulations de restes fauniques – et celle des outillages recueillis, cette première période antérieure à 12 000 B.P., serait caractérisée par l’absence dans l’industrie (sauf à Taima-Taima et à Monte Verde), des pointes de jet travaillées bifacialement qui deviendront, de manière relativement soudaine, si fréquentes ensuite.
L’outillage fruste qui caractérise la majorité d’entre eux, constitué d’objets de grande taille obtenus à partir de galets ou de plaquettes rarement retouchés, pourrait cependant avoir été complété par un outillage de bois et d’os, correspondant à un mode de vie nomade ou semi-nomade fondé sur une chasse non spécialisée ou plutôt une traque au gros gibier pléistocène, édentés géants, cheval, mastodonte, grands cervidés fossiles, toutes espèces qui disparaissent vers la fin de la période pour laisser place, dans les gisements, à des espèces actuelles de plus petite taille. Quant à l’extrême rareté des sites au regard de l’immensité du sous-continent, elle s’expliquerait à la fois par la faiblesse numérique des populations et par les bouleversements géologiques et les contaminations de toutes sortes auxquels furent soumis au cours des millénaires les vestiges de leur passage.





























