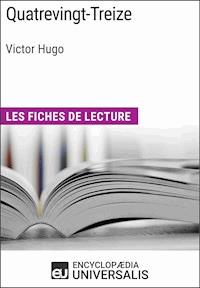
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Rédigé de décembre 1872 à juin 1873, publié en 1874,
Quatrevingt-Treize est le dernier roman de Victor Hugo (1802-1885). L’écrivain en forma le projet dès après la parution des
Misérables, en 1862.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Quatrevingt-Treize de Victor Hugo
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852296435
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Quatrevingt-Treize, Victor Hugo (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
QUATREVINGT-TREIZE, Victor Hugo (Fiche de lecture)
Rédigé de décembre 1872 à juin 1873, publié en 1874, Quatrevingt-Treize est le dernier roman de Victor Hugo (1802-1885). L’écrivain en forma le projet dès après la parution des Misérables, en 1862. À l’origine, l’ouvrage devait conclure une trilogie romanesque qui aurait peint au préalable l’ancienne Angleterre, puis l’ancienne France. Pour Hugo, il s’agissait de montrer comment les injustices de l’aristocratie et les oppressions de l’Ancien Régime avaient inéluctablement conduit à la Révolution. Dans L’homme qui rit, premier volet de cette trilogie, Gwynplaine prophétise devant la Chambre des lords les lendemains terribles où le peuple se soulèvera. Le second volet, qui aurait dû traiter de la royauté française, ne vit pas le jour. Au moment où Hugo y travaillait survint la guerre de 1870, puis la chute de l’Empire. L’auteur pouvait enfin rentrer d’exil, mais pour assister au spectacle d’une France déchirée. 1793, autre « année terrible », se répétait. De nouveau l’envahisseur prussien était aux portes de Paris, de nouveau la guerre civile faisait rage. Au lendemain de la Commune, Hugo éprouva la nécessité de délivrer un grand message de paix : ce fut Quatrevingt-Treize.
• Deux mondes s’affrontent
Le roman retrace la guerre de Vendée qui, au lendemain de l’exécution de Louis XVI, opposa les insurgés royalistes de l’Ouest, les blancs, aux troupes républicaines, les bleus, faisant près de 500 000 morts. Écrit dans l’urgence, il privilégie l’action dramatique, et une esthétique qui évoque souvent celle du théâtre, au détriment des longs commentaires que l’auteur affectionne d’ordinaire. Il repose sur une architecture simple, fortement rythmée : trois actes, trois lieux, trois personnages principaux.
La première partie se situe en mer. Une corvette anglaise emmène vers la Bretagne le marquis de Lantenac qui, appelé à prendre la tête des troupes royalistes, y voyage incognito. Au cours de la traversée, un canon, libéré de ses amarres, endommage la coque du navire. Celui-ci ne peut soutenir le combat devant l’escadre française qui l’intercepte et le coule. Fuyant dans une barque, Lantenac accoste en France, où sa tête est mise à prix. Reconnu et ovationné par les siens, il les exhorte à mener une guerre sans merci : « L’Armée républicaine est mon gibier... Pas de quartier. » Un bataillon de bleus est exterminé. Trois enfants qui en étaient les mascottes sont capturés.
La deuxième partie se passe dans le Paris révolutionnaire, dont Hugo retrace avec réalisme l’agitation. Les responsables du Comité de salut public, Danton, Marat et Robespierre, ont résolu de réprimer dans le sang l’insurrection vendéenne. Mais ils se méfient du commandant de l’armée républicaine, Gauvain, un aristocrate, et neveu de Lantenac qu’il soupçonnent d’être trop clément. Ils nomment auprès de lui un homme inflexible : Cimourdain, « une conscience pure... ayant en lui l’absolu ». Or, celui-ci a jadis été le précepteur de Gauvain, qu’il considère comme son fils.
La fin du roman a pour cadre la Vendée, où Gauvain triomphe de l’insurrection. Lantenac et ses fidèles se réfugient dans le château de la Tourque. Assiégés, ils fuient par une issue secrète, après avoir mis le feu au donjon. Les enfants qui y sont enfermés vont périr. Entendant les cris de leur mère, qui les a retrouvés, le marquis retourne les sauver et est fait prisonnier. Ému par son geste, Gauvain le fait évader et se condamne ainsi à la guillotine. Au moment où tombe le couperet, Cimourdain se tue.
• Vers la concorde nationale
Toute sa vie, Hugo eut présente à l’esprit la Révolution française. S’il acceptait aisément 1789 qui libérait le peuple de son joug, il refusa longtemps 1793, la Terreur et ses luttes fratricides. N’était-il pas le fils d’une vendéenne et d’un officier républicain ? Pourtant, à mesure qu’évoluaient ses idées politiques, il finit par admettre que les bienfaits de la Révolution étaient plus importants que ses crimes, et que 1793 avait constitué le mal nécessaire pour effectuer « cette rude besogne de liquider, en trois ou quatre années, huit siècles d’oppression et de malaise ». C’est ainsi que la partie centrale du roman, nourrie par de vastes lectures documentaires, fait l’apologie de l’œuvre accomplie par la Convention : « En même temps qu’elle dégageait de la révolution, cette assemblée produisait de la civilisation. Fournaise, mais forge. Dans cette cuve où bouillonnait la terreur, le progrès fermentait. »
Quatrevingt-Treize, toutefois, n’est pas seulement un roman historique. Si l’objectif de Hugo est de faire comprendre la Terreur, il est aussi de répondre à la Commune, de faire entendre à une France meurtrie et divisée un hymne de paix et d’espoir. C’est pourquoi il entend dépasser l’affrontement manichéen entre les bleus et les blancs, Cimourdain et Lantenac, le progrès et la réaction. Il invente une autre voie, celle de la réconciliation, à travers le personnage de Gauvain. Héros quasi chimérique, qui a un physique d’Hercule, un regard de prophète, un rire d’enfant et un nom de chevalier, celui-ci est vraiment le porte-parole de Hugo. Avant de monter sur l’échafaud, il dit sa foi en une république idéale qui concilie la nécessaire évolution de la société et le respect de l’homme : « Vous rêvez l’homme soldat, je rêve l’homme citoyen. Vous le voulez terrible, je le veux pensif. Vous fondez une république de glaives, je [...] fonderais une république d’esprits. »
Affirmer la prépondérance de la personne sur l’idéologie, tel est l’enjeu d’un roman qui met en scène le peuple lui-même. Peuple bouillonnant de Paris, libérant sa parole dans la rue, les journaux et les clubs. Peuple archaïque et taciturne de l’Ouest, tapi dans les caches souterraines et le tronc des arbres (Balzac l’avait déjà puissamment évoqué dans Les Chouans, en 1829. Au milieu d’eux, quelques figures mémorables, qui font entendre la voix des humbles : Tellmarch, le mendiant qui a connu toutes les injustices de l’Ancien Régime ; Radoub, le bleu au grand cœur ; Mireille Fléchard, la mère, qui a les traits des héroïnes communardes, et dont le désespoir fait dévier le cours de l’histoire ; les enfants, enfin, qui, enfermés dans le château, se mettent à déchirer les pages d’un livre magnifique consacré à la Saint-Barthélemy : image symbolique de cette espérance en la fin des haines et des guerres civiles, qui traverse le roman.
Philippe DULAC
Études
C. BERNARD, Le Chouan romanesque. Balzac, Barbey d’Aurevilly, Hugo, P.U.F, Paris, 1989Collectif, Analyses et réflexions sur « Quatrevingt-Treize » de Victor Hugo, Ellipses, Paris, 2002.HUGO VICTOR (1802-1885)
Roman, critique, voyages, histoire dialoguent dans l’œuvre de Victor Hugo avec le lyrisme, l’épopée, le théâtre en un ensemble dont le « poète » a souvent proposé des articulations historiques, géographiques ou idéologiques plutôt qu’une périodisation. En règle générale, l’œuvre en prose a pour fonction de recueillir les éléments les plus secrets de l’œuvre poétique, de les composer en architectures prospectives ; plus neuve et plus audacieuse ainsi, elle peut servir de préface à toute la création hugolienne. Elle se distribue pourtant en trois masses : la mort de Léopoldine, en 1843, entre l’Académie (1841) et la Chambre des pairs (1845), marque une première rupture ; vers 1866-1868, c’est le tournant proprement historique et politique. Chacune de ces masses est caractérisée par la présence de romans ou quasi-romans (Han d’Islande, Bug-Jargal, Le Dernier Jour d’un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, pour la première ; Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, pour la deuxième ; L’Homme qui rit et Quatrevingt-Treize, pour la troisième), de textes mêlés d’histoire, de politique et de voyages (pour l’essentiel, respectivement : Le Rhin ; Choses vues et Paris ; Actes et Paroles et Histoire d’un crime) et enfin d’essais critiques, qui se fondent avec l’histoire militante dans la troisième période, en une vue rétrospective qu’annonçaient déjà Littérature et philosophie mêlées





























