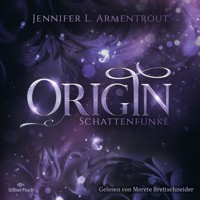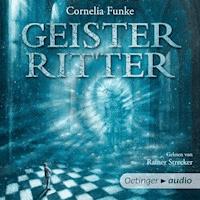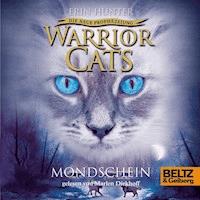Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Résistances au village de La Beuverie décrit, sous forme romancée et avec quelques références à la langue normande, la vie rurale dans une petite ferme du village de La Beuverie. Les différents protagonistes vivent pleinement leur époque tout en restant fortement enracinés dans la tradition. Par le biais de l’exposé de leurs convictions, ce récit s’apparente plus à un essai sur toutes les formes de résistance, de désobéissance civique et d’opposition allant de pair avec celles de violation des droits, d’oppression et de violence.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Auteur de plusieurs ouvrages professionnels, passionné des mots (y compris ceux de la langue normande),
Joël Maline-Debroise décide de franchir le pas d’un nouveau genre. Pour lui, le roman est un prétexte qui permet de sonder les émotions de ses personnages et de décortiquer avec lucidité les paradoxes de la vie collective en société. De ce point de vue, il explore les notions de résistance et de résilience, mettant en situation tous les membres d’une famille au sein d’un village du Cotentin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joël Maline-Debroise
Résistances
au village de La Beuverie
Roman
© Lys Bleu Éditions – Joël Maline-Debroise
ISBN : 979-10-377-5647-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mes grands-parents,
À mes parents,
Sans qui l’ouvrage n’aurait jamais existé.
À Jacqueline,
À Pierre-Alain,
Remerciements sincères.
Un village, une famille
D’un commun accord, mes parents m’ont appelé Antonin. Ma mère, Marie, m’a mis au monde un 28 novembre de l’année 1888 à 17 heures et mon père Victor, a déclaré, en Mairie, la naissance de son premier enfant le lendemain à 13 heures, en compagnie de Abel Guivard, employé au Chemin de fer de l’Ouest et de Silvain Larchais, tonnelier, les deux individus avec qui mon père avait trinqué au café-épicerie de La Beuverie, histoire de fêter cela avant de se consacrer sérieusement aux tâches administratives. C’est après plusieurs libations qu’ils avaient accepté la lourde responsabilité d’être désignés témoins signataires de mon acte de naissance.
Comme on ne choisit pas ses parents, on choisit encore moins son prénom. Si bien que pour certains, porter leur prénom est un pensum, les amenant quelquefois à préférer des diminutifs ; voire à en changer. Pour ma part, j’aime quand les gens m’interpellent en usant de ce prénom dans son intégralité. Sa douceur et sa musicalité me conviennent parfaitement.
La nature m’a donné gentiment des caractéristiques physiques les plus ordinaires en me gratifiant, du haut de mes 1,72 mètre, de cheveux bruns, d’yeux roux, d’un visage ovale, d’un front ordinaire et d’un nez moyen.
Je suis l’aîné d’une fratrie de quatre garçons qui n’ont pas manqué de donner du fil à retordre à leurs parents. Pauvre mère !
Après une scolarité, elle aussi fort ordinaire, à la communale, je devins, par je ne sais quel imbroglio de circonstances faites de connaissances et de relations, employé marchand d’oreiller dans un grand magasin de literie à Coutances. L’emploi n’était pas des plus folichons ni d’un intérêt permettant d’assouvir ma soif de curiosité d’adolescent. Mais le contact avec la clientèle, l’écoute permettant d’analyser ses besoins et ses envies (voire son désintérêt complet !) me plaisait et m’incitait à continuer quelque temps ; ne serait-ce que pour soulager mes parents qui, à partir des maigres revenus de la ferme familiale située dans le village de La Beuverie, avaient fort à faire pour nourrir les bouches affamées de mes frères en pleine croissance.
Je ne m’endormis pas plus longtemps sur mes oreillers et, au bout de deux ans, proposais à mon père de le rejoindre pour participer aux travaux des champs et ainsi développer, moderniser et augmenter les revenus de cette petite exploitation d’une superficie de cinq hectares.
J’appréciais l’activité de paysan. Bien que physiquement éprouvante et quelquefois déroutante, vu les aléas climatiques qui pouvaient venir contrecarrer ou anéantir des espoirs mis dans une récolte ou dans la naissance d’un veau, elle laissait place à beaucoup de liberté et d’initiative. Travailler avec mon père et ma mère, avec qui je m’entendais bien, était un plus lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions relatives à l’élevage, à la fenaison, aux semailles ou au battage de céréales, dont on savait que leur justesse donnerait ses fruits une ou plusieurs années après.
À vingt ans, le conseil de révision me déclara apte au service militaire et me confia aux ordres des gradés du 136e régiment d’infanterie, basé à la caserne Bellevue de Saint-Lô, comme unité militaire de rattachement en cas de conflit.
La vie à la ferme ne m’empêchait pas de participer activement à la vie associative de Blainville sur mer, commune dans laquelle la famille allait à la messe et achetait son pain.
À de nombreuses reprises, j’y fis la rencontre de Julia. Originaire de Savigny-sur-Orge dans la banlieue parisienne, Julia venait fréquemment à Blainville et particulièrement durant l’été qu’elle passait chez une connaissance de ses parents, qui tenait librairie dans le 13e arrondissement de Paris, spécialisée dans les vieilles éditions et vieux manuscrits. Durant ces séjours, elle résidait rue de Bas, encore appelée rue des Libraires, car de nombreux libraires et bouquinistes parisiens s’étaient donné le mot pour y habiter de somptueuses villas. D’une année ma cadette, nous ne nous perdions pas de vue et à chaque séjour qu’elle passait à Blainville nous avions plaisir à nous revoir et à discuter du chemin que chacun avait parcouru. Lors de l’un d’eux, elle m’annonça qu’elle allait travailler comme employée au service traction du Chemin de fer du Paris-Orléans, dans les bureaux de l’administration, place Valhubert, dans le 13e arrondissement de Paris. Je comprenais que ses villégiatures blainvillaises seraient plus rares, voire que nous ne nous reverrions plus.
C’était sans compter sur cette forte amitié qui nous liait et qui s’était forgée au fil des années. Si bien qu’un 4 juillet 1915, mes parents, accompagnés de mes trois frères, me rejoignirent à Savigny-sur-Orge pour assister à mon mariage.
Entre-temps, j’avais appris que le Conseil général de la Manche avait déclaré d’utilité publique la construction de plusieurs lignes de chemin de fer et, après en avoir adopté le tracé définitif en 1906, avait confié à la Compagnie des Chemins de fer de la Manche, le chantier de l’ouverture de la ligne Coutances-Lessay. Je me portais candidat pour participer à cette belle aventure ferroviaire. En plus de mes activités à la ferme, je participais donc à la construction du viaduc sur la Soulles d’une portée de quarante mètres, construit en sidérociment par l’ingénieur Considere.
Je rejoignais également les nombreuses équipes de terrassement qui, sans engins mécanisés mais à renfort de pelles et de pioches, arasaient les buttes et préparaient le lit de la future voie et de son ballast.
Ouvrier polyvalent et à l’affût de toute expérience nouvelle possible, je m’arrangeais pour faire partie des équipes spécialisées dans la pose des rails. D’un poids de 18 kg au mètre, leur pose sur des traverses de pins ou de chênes créosotés, me demandait une résistance physique importante et m’aidait à m’endormir le soir. Ainsi, locomotives et wagonnets pouvaient s’approcher au plus près des terrassiers qui les remplissaient afin d’évacuer les gravats.
Julia, de son côté, avait préparé sa venue à La Beuverie. Amoureuse de la côte et de son air particulièrement iodé, elle avait décidé que nous vivrions ensemble à Blainville sur mer. La configuration des bâtiments de la ferme nous permettait d’avoir notre autonomie par rapport à mes parents, tout en les côtoyant chaque jour. N’étant pas attirée par les activités agricoles et souhaitant garder son indépendance, Julia avait réussi à passer de la Compagnie du Chemin de fer du Paris-Orléans à celle du Chemin de fer de l’Ouest en trouvant un emploi similaire dans l’administration de la ligne Lison-Pontorson, en gare de Coutances. La Vie s’organisait ainsi pour le mieux.
Ce, d’autant plus que, voyant la fin des travaux de génie civil de la voie ferroviaire métrique arriver, j’anticipais en candidatant au poste de mécanicien de locomotive et acceptais de retourner sur les bancs de l’école du soir pour parfaire mes connaissances mécaniques et hydrauliques et ainsi conduire un tue-vaques.1
En effet, dès 1907, la Compagnie venait de commander la fabrication de quatre locomotives mi-lourdes de type 030 avec un T pour tender, auprès des ateliers de Construction du Pont-de-Flandre dirigés par le constructeur parisien Weidknecht Frères et Cie. Bien que jugées d’une puissance insuffisante pour l’usage prévu par le nouveau sénateur Gaudin de Villaine, elles furent mises en circulation en 1908 sur notre ligne littorale Coutances-Lessay en ayant respectivement les numéros 8, 9, 12 et 13 pour immatriculation.
Lors de ma période d’exercice militaire, les gradés s’aperçurent que ma situation n’avait plus rien à voir avec l’infanterie ! Je fus donc affecté comme réserve à la 10e section des chemins de fer de campagne, celle des chemins de fer secondaires qui exploitait les réseaux de voie métrique.
La qualité de chef d’exploitation agricole depuis le décès de mes parents en 1914 et mon emploi de mécanicien d’une ligne de chemin de fer secondaire jugée stratégique par l’État-Major me valurent d’éviter la mobilisation au front de la Grande Guerre, tout en étant réserviste mobilisable à tout moment.
Avec Julia, nous formions donc un couple dont la voie était toute tracée ; était sur les rails, si je puis dire.
Je m’aperçois que j’ai plusieurs fois mentionné le mot de La Beuverie. Il serait peut-être temps de vous dire ce qu’il en est ! La Beuverie est un village dont la superficie est à cheval sur les communes d’Agon et de Blainville sur mer, situées sur la côte ouest du département de la Manche, à douze kilomètres à l’ouest de Coutances, grande ville épiscopale. Détrompez-vous, ce n’est pas un village qui, comme une des significations de son nom pourrait le laisser penser, est un lieu de perdition, de dépravation, ou de débauche comme Rabelais le décrivait si bien.
Non ! Il est fréquent dans notre région que les noms de village portent le nom de familles qui y ont habité, voire qui ont contribué à sa naissance. Ainsi, retrouve-t-on alentour, la Maugerie où habitait la famille Mauger, la Boivinerie où résidait la famille Boivin, la Jeannerie, la Chardoterie, la Rogerie, etc. D’autres ont des terminaisons différentes mais avec la même signification : la Martinière, la Robinière, etc. Avec Julia, nous vivons donc dans le lieu historique d’habitation des Beuve.
Avec des vents marins d’ouest prédominants, notre environnement est celui d’un paysage de bocage. Les pièces2 et les plants de pommiers sont séparés par des talus surmontés de haies principalement constituées de peupliers et de frênes.
Forte d’environ mille âmes, composées principalement d’artisans, de pêcheurs côtiers, d’ouvriers, d’agriculteurs…, la commune de Blainville s’étend de la Martinière à la plage de Gonneville et, dans sa plus grande largeur, de La Beuverie à la Vicomterie. Notre trait de côte s’étend sur 2,5 km entre Linverville et Agon.
Entre le bourg et la mer, un havre que la mer recouvre en grande marée, fait la transition et permet aux moutons de paître parmi les plantes halophiles comme la salicorne ou la glinette3 qui profitent ou s’accommodent du milieu salé, qu’ils affectionnent particulièrement.
Au sud, Agon, commune plus importante, est forte de trois mille cinq cents âmes, composée d’artisans, d’agriculteurs, d’ouvriers. Agon est le bourg qui se trouve reculé dans les terres. Dès l’hiver 1888-1889, une digue sur le bord de mer a été construite, avec des pierres de la carrière du Martinet, gérée par la famille de Saint-Denis, pour préserver les quelque cent soixante-dix cabanes et habitations que les particuliers se sont fait construire sur la dune. De ce fait, au lieudit Coutainville, une station balnéaire était née.
Agon se termine au sud par le havre de Regnéville dans lequel débouche le fleuve La Sienne et la rivière La Soulles. À bicyclette, nous poussons, avec Julia, quelquefois jusqu’à cette Pointe d’Agon, balayée la nuit par un phare du même nom. Nous aimons y marcher dans les dunes ou les mielles4 recouvertes d’un tapis végétal composé de milgrai5, de panicaut6, de liseron des dunes, d’élyme des sables ou de sodanelle. Nous empruntons les chemins tangoos7 sur lesquels nous rencontrons des cultivateurs avec leurs banneaux attelés de deux ou trois chevaux et chargés de tangue8 prélevée dans le marais et étalée ensuite sur les champs ou enfouie dans les jardins, pour amender la terre. Bordés de saules que l’on étête pour récupérer les branches servant à la fabrication des pêcheries, ils nous procurent des voyages fantasmagoriques en formant, par contraste dans la pénombre, des ombres de sentinelles animées qui gardent le chemin et veillent sur les promeneurs.
Que l’on soit à Agon ou à Blainville, sur la côte ou plus haut dans les terres, on dispose d’une vue magnifique sur l’archipel des îles Chausey au sud et sur l’île de Jersey au nord. Observée de nombreuses fois dans la journée, celle-ci nous sert de baromètre pour nos prévisions météorologiques. En effet, un dicton local affirme qu’une mer bleue et un Jersey blanc sont signe de beau temps mais qu’une mer blanche et un Jersey bleu sont signe de pluie sous peu. La réalité, au bout du compte, c’est qu’il pleut déjà !
Plus près de la côte, le phare du Senéquet garde les rochers du Long Héquet. Construit en 1857 sous forme d’une tourelle sans feu, il a été surélevé et équipé d’un feu pour devenir un phare, suite au naufrage de l’aviso L’Antilope, le 14 décembre 1858. Il faut dire que sur notre côte, la mer recule de 6 km à marée basse. Avec la baie de Fundy au Canada, nous partageons le record mondial du marnage de 14 mètres. En plus d’en être fiers, les Agonais et les Blainvillais sont des adeptes et des experts de la pêche à pied.
Le village de La Beuverie est un village où il fait bon vivre. Chaque famille, chaque génération se connaît. Portant attention à la situation de chacun, tout le monde est prêt à aider à la résolution des difficultés engendrées par les déboires de la vie quotidienne.
Les habitations sont au nombre d’une vingtaine environ et se situent de chaque côté d’une rue longue d’un kilomètre environ. Les jardins ou les champs des exploitations agricoles se situent derrière les maisons et sont invisibles de la rue. Quatre-vingts habitants environ, que l’on nomme Beuvrions, bordent cette rue. Leurs portes sont généralement ouvertes ou entrebâillées. Pas besoin de frapper, ni de demander quelconque permission de monter à bord, il suffit de crier fort qu’on est là et que nous sommes en train d’entrer dans la cuisine. En revanche, pas question de pénétrer sans s’asseoir à la table, sans échanger quelques mots de politesse, s’inquiéter de la santé des uns et des autres, donner quelques informations glanées auprès d’autres voisins, sans boire café, cidre ou calva selon l’heure de la journée, avant enfin, d’exprimer la raison de sa visite, s’il y en avait une ! Si d’aventure les habitants de la maison sont absents, il suffit de mettre un bâton en travers de la porte ou un objet sur son seuil pour signifier que quelqu’un est passé vous voir et qu’il reviendra.
Véritable point névralgique du village, un unique lieu multifonctionnel, tout à la fois débit de boisson, de tabac et épicerie, sert de point de rencontre aux habitants. L’arrivée d’un client est annoncée par le son d’une petite cloche actionnée lors de l’ouverture de la porte. À la lueur d’une ampoule pendant à son fil, allumée toute la journée car la pièce est sombre, Mme Guillemin, plantée derrière le comptoir en chêne au-dessus usé par des années de service et aux moulures bien travaillées, sert ses clients des quelques produits frais ou en conserve qu’elle peut encore avoir à la vente. À l’extrémité du comptoir trônent la balance et le tiroir-caisse qui sonne lorsqu’on l’ouvre et le ferme. Une petite étagère, peu remplie est réservée aux bonbons pour les gamins.
Derrière elle, une grande vitrine avec des portes coulissantes ajourées de carreaux vitrés, renferme les quelques paquets de tabac les plus demandés par les poumons des hommes de La Beuverie : Scaferlati gris ou bleu à rouler, Gauloises de la Seita, tabac à rouler de la Régie française des Tabacs.
Dans une autre pièce sont disposées cinq tables, habillées de toiles cirées aux décors passés, à force de les nettoyer à l’éponge après chaque passage de clients. Les habitués se retrouvent toujours à la même place pour consommer principalement du cidre et du café que Mme Guillemin prépare dans sa cuisine et met à réchauffer dans la cafetière, à longueur de journée.
Une autre table est réservée aux irréductibles de jeux de cartes et particulièrement celui de l’Aluette que nous appelons par t’cheu nous, la Vache. Les côtais ont conservé la pratique de ce jeu de quarante-huit cartes, d’origine espagnole, arrivé sur nos côtes certainement lors d’échanges du commerce maritime. Quatre joueurs par équipe de deux jouent à chaque levée en échangeant des grimaces codées qui permettent de renseigner son co-équipier sur la valeur des cartes qu’il détient. Il faut les voir s’appliquer à mobiliser leur musculature zygomatique pour lever les yeux au ciel, lever le coin des lèvres d’un seul côté de la bouche, pencher la tête, faire un clin d’œil, faire la moue, hausser les épaules, tirer la langue… Chaque joueur a sa façon de réaliser ses grimaces et ses gestes, avec plus ou moins de discrétion et de dissimulation ou au contraire d’outrance et d’extravagance.
Lorsque je vais acheter mon tabac, j’ai plaisir à rester à leur côté pour les observer, mais il n’est surtout pas autorisé d’intervenir et de rire de leurs mimiques. La chose est suffisamment sérieuse et l’enjeu tellement important à leurs yeux que vous pourriez être remerciés et invités à prendre la porte du café.
Je suis un fidèle client du café particulièrement pour son rayon tabac, mais paradoxalement je ne fume pas. J’aime avoir toujours dans mes poches un paquet de réserve de façon à pouvoir l’offrir aux personnes avec qui je discute. C’est ma façon à moi de contribuer au bonheur des autres ! Dans chacune des pièces, des boudins autocollants de couleur jaune, pendent en spirale du plafond. Certains sont là depuis des années et offrent à la vue des clients des cadavres de mouches et de guêpes, figés dans la glu dans des postures que même les entomologistes chevronnés n’arriveraient pas à reconstituer dans leurs boîtes de conservation.
Quatre fermes ont une superficie nécessitant l’emploi de journaliers agricoles. L’une d’entre elles bénéficie d’un abattoir qui permet de fournir de la viande fraîche.
D’une superficie de cinq hectares, la nôtre figure parmi les plus petites. Chaque pièce de terre a un nom, ce qui permet de bien situer les choses lorsque nous parlons du travail à faire et de sa programmation : les Foules, les Croûtes, les Pointes, la Valloterie, le Pré-cornière, le Plant de la Route, le Plant-Neuf, la Lande-Jourdan, le Modélion… etc.
Elle s’étend, à cheval, sur les deux communes d’Agon et de Blainville. La limite, matérialisée par le Ruet Ganne, ruisseau qui coule à l’ouest pour rejoindre le havre de Blainville, passe au pas de la porte de notre maison principale, laissant le Jardin de la route et le Plant de la Route sur Agon et le reste des bâtiments et des terres sur Blainville. Cette caractéristique géoadministrative présente un avantage non négligeable car elle nous permet de bénéficier de deux droits de récolte de vray, de plise 9 et de tangue sur les deux communes.
Notre ferme est en elle-même, un village dans le village de La Beuverie. À la fin du 19e siècle, pas moins de sept feux, c’est-à-dire sept familles, vivaient là, dans de petites maisons adossées à la maison principale. Deux puits, deux jardins, un poulailler, une étable, une écurie, des granges et des quertries,10 entourent le corps de ferme principal constitué de trois bâtiments que nous habitons. C’est une maison qui a appartenu à de nombreux capitaines de frégate ou capitaines au long cours naviguant pour le commerce ou la pêche à la morue.
Les familles qui vivaient dans les petites maisons de la cour étaient des matelots Terre-neuvas qui partaient banquer sur les côtes de Terre-Neuve, à partir du port de Granville, pour pêcher la morue.
Deux familles seulement occupent actuellement deux maisons et vivent avec nous dans la cour. Louis Calenge et Jacques Chardot, les chefs de famille, espèrent un embarquement pour cette année. Au début du mois de janvier de l’année dernière, deux capitaines de navires ; l’un, de la Société des pêcheries de France, l’autre de l’armement Chuinard étaient venus leur rendre visite à domicile pour les recruter et convenir d’un salaire. Ils avaient réussi à appareiller le 20 février pour arriver sur les zones poissonneuses huit jours après. Une fois sur les lieux, ils avaient mis à l’eau les doris entassés sur le pont du trois-mâts. Inséparables, ils avaient posé ensemble, à la rame à partir du même doris, des lignes dérivantes après en avoir boetté11 les hameçons avec des bulots. De retour au navire en fin de journée, leur travail n’était pas fini. À deux, il leur fallait lancer les morues à bord, les ébreuiller pour enlever à l’aide d’un couteau les entrailles, leur couper la tête et enlever l’arête dorsale. C’est une autre équipe qui les salait et les empilait en cale, pendant que le bosco comptait le nombre de langues de morues dégagées pour calculer leur salaire.
Durant cette absence qui peut durer six mois, ce sont leurs femmes qui veillent à l’organisation de la vie de la famille, élèvent les enfants et assurent les tâches agricoles, sur leur lopin de terre et auprès de leur unique vache. Nous formons alors une petite communauté, bien soudée, vivant en bonne intelligence, malgré la proximité de nos lieux de Vie. Julia et les femmes s’entraident. Pour l’agriculture, nous mettons en commun nos moyens.
Lorsqu’ils sont à terre, ils nous aident dans nos corvées agricoles en plus de leur labeur. Ils nous arrivent de discuter avec eux dans la cour à l’asseiraunt,12 autour d’un verre de bon beire bouchyi13. C’est à ce moment qu’ils se confient et nous font part de leurs conditions de vie une fois à bord : les doris qui peuvent ne pas rentrer au bateau maître pour cause de brouillard ou de chargement de morues trop lourd, les marins qui tombent dans les eaux glacées, empêtrés dans leur équipement et qui n’ont pas de chance de survie, la longueur des journées de travail qui pousse les hommes jusqu’à l’épuisement, les occasions de blessures qui ne manquent pas avec les chutes, les fractures, les coupures, les hameçons plantés dans la main et les conditions d’hygiène qui favorisent l’infection pour laquelle les remèdes à bord ne sont pas forcément adaptés et efficaces. Je suis, à chaque fois, impressionné, par la résistance physique et morale dont font preuve nos gaillards de voisins. Une fois rentrés sur leur lopin de terre, ils n’en parlent pas souvent, ne se plaignent pas et d’ailleurs, considèrent que les conditions de l’occupation allemande sont loin d’être aussi intolérables que celles qu’ils peuvent vivre à bord sur les bancs de Terre-Neuve.
C’est donc dans ce village qu’avec Julia, nous avons fondé famille. Sa description serait incomplète si j’omettais de vous présenter nos deux enfants.
Madeleine est née un 31 décembre. Je n’étais pas préparé à devenir père d’une petite fille. La vie turbulente avec mes frères ne m’avait pas sensibilisé à la psychologie féminine. Julia, à force de conseils, d’explications et de patience, m’a beaucoup aidé à comprendre le caractère, le comportement et les attentes de ce beau brin de fille, tant durant sa prime jeunesse que pendant sa période d’adolescente.
Madeleine manifestait beaucoup d’intérêt pour la vie animale et les travaux agricoles qui rythmaient la vie de la ferme. Tombée en amour avec son lapin, elle le promenait dans un landau et allait le présenter de ferme en ferme, de cuisine en cuisine, convaincue que ses hôtes seraient ravis de le voir même si, avant de partir, il avait gratifié le tapis du salon de ses déjections les plus fournies.
Enjouée et curieuse, elle s’était fait un tissu de relations dans le village. Les garçons et les filles de son âge la considéraient comme leur meneuse, toujours prête à inventer des histoires, des jeux et des activités adaptés à la vie de la campagne.
Brillante dans ses études primaires, où elle avait reçu le prix de « Courses folles et de franches camaraderies », elle les continua au lycée de Coutances, utilisant comme sa mère, plusieurs moyens de transport pour s’y rendre, dont le tue-vaques que je conduisais. Lorsqu’elle était de corvée de pain, elle choisissait la boulangerie en fonction de la gare où je terminais mon service (Agon ou Coutainville). Nous rentrions ainsi à pied tous les deux par les petits chemins en discutant des faits marquants de sa journée, elle, portant son pain de quatre livres au levain, moi, ma musette en bandoulière renfermant des documents administratifs de la compagnie et ma gamelle en aluminium.
Adolescente, elle était très proche de Julia. Les deux faisaient preuve de complicité avancée qui se manifestait quelquefois jusque dans leur façon de s’habiller. Baccalauréat en poche, Madeleine ne réfléchit pas longtemps pour orienter sa destinée professionnelle. Elle voulait faire « comme maman. »
Elle entrait donc, comme apprentie à la Compagnie du Chemin de fer de l’Ouest, en gare de Coutances, sur la ligne qui maintenant reliait complètement Caen à Rennes. Madeleine était assidue dans les tâches qui lui étaient confiées et elle n’hésitait pas à passer les concours internes nécessaires pour gravir progressivement les échelons.
Pendant neuf années, les deux femmes se sont côtoyées dans des fonctions différentes à la gare. Elles ont usé du même train que je conduisais fièrement pour aller au travail ou rentrer chez nous à La Beuverie. Après, elles ont utilisé les services des autobus de la STN.14 Lorsque Julia a fait valoir ses droits à la retraite, ce ne fut pas une rupture brutale de changement de vie pour elle ni pour moi ! Bien au contraire, elle avait déjà participé pleinement et pris goût aux travaux de la ferme.
Trois années après sa naissance, Madeleine accueillit avec bienveillance et enthousiasme la venue au monde de son frère Jean, un 26 août 1919. L’arrivée d’un garçon dans le cercle familial satisfaisait tout le monde ; Julia qui attendait l’évènement depuis longtemps, Madeleine qui allait pouvoir jouer à la grande sœur et à la poupée et moi qui me sentais a priori plus à l’aise dans mes futures relations avec un garçon.
Attentif aux autres, réfléchi, Jean était d’une nature plus réservée et moins expansive que sa sœur. Lui aussi participait très tôt aux activités agricoles de la ferme ; avec toutefois, une préférence pour les mécanismes.
Après la communale et le baccalauréat au lycée de Coutances, il effectue le recrutement militaire en 1939 à la circonscription de Saint-Lô, caserne Bellevue. Là même où le conseil de révision m’avait déclaré apte au service militaire.
Appartenant à la classe 39, Jean fait partie de ces jeunes dont les années de leurs vingt ans n’avaient d’autres horizons que ceux d’un enrôlement militaire pour participer à une guerre dont les résultats, dans un premier temps, furent peu brillants. C’est le moins qu’on puisse dire ! Le 15 avril 1940, Jean est appelé au service de l’armée au dépôt de guerre du 5e régiment du génie chemin de fer à Satory-Versailles. Décidément, le chemin de fer commençait à prendre une place plus qu’importante dans la famille ! Lorsque Julia, Madeleine et moi l’accompagnons à la gare de Coutances en direction de Caen pour Paris, nous ne savions pas encore que nous allions être longtemps sans avoir de ses nouvelles et sans le revoir.
Car c’est le 20 juin 1940, il y a maintenant plus de deux années, que les Allemands nous imposent leur présence dans nos deux communes. Comparativement à d’autres zones du département, ils n’étaient pas nombreux à nous envahir. L’intérêt stratégique de notre côte n’était pas important aux yeux de leurs supérieurs. Une garnison occupe Blainville. Les hommes de troupe ont investi le village de Gruchy, l’Orst-Kommandantur s’est installée à la villa Alice, l’état-major au Clos des pommiers et une partie de la Kommandantur au Château des Ruettes dans la rue des libraires.
Rivage oblige, nous avons surtout à côtoyer des douaniers. À Coutainville, ils ont pris résidence à la villa les Roches dont le jardin donne directement sur le bord de mer. Il y a pire pour faire la guerre !
Décidés à étendre leur hégémonie, les douaniers allemands ont remplacé en avril 1941 les douaniers français et se sont installés à la villa Le Tertre à Coutainville. De plus, ils ont monté un corps de garde au pont de Blainville pour surveiller les allées et venues sur le rivage.
Fin 1941, toute cette petite troupe en uniformes verts a été remplacée par une trentaine de Géorgiens, un matin sans que l’on s’en aperçoive.
Notre village bénéficie également de la présence de bottés casqués. Trois hommes de troupe, sous la responsabilité d’un sous-officier allemand, tous télégraphistes, occupent la maison de Mme Hersent dans laquelle, ils ont installé leurs postes de T.S.F., émetteurs-récepteurs, à renfort de fils tendus dans les branches des arbres. Discrets, ils ne font pas de bruit dans le village, sauf quand l’alcool leur a échauffé les oreilles au cours d’une soirée bien arrosée.
C’est depuis cette date que la vie au village s’est trouvée modifiée. Chacun s’est recroquevillé chez lui. Les portes de maison se sont refermées. Au café, l’enthousiasme est plus mesuré. On baisse la voix dès qu’un allemand entre et on joue avec moins de ferveur à la Vache. Bien que n’engageant que très peu la conversation avec l’occupant de toute façon, la barrière de la langue devenait encore plus lourde à surmonter depuis que nos occupants étaient géorgiens.
Nos relations entre nous ne sont plus aussi naturelles et deviennent ambigües. Tout en ayant moins confiance en l’autre, par exemple sur son attitude qu’il pourrait avoir avec l’occupant, nous pensons que justement, face à l’occupant, il est important de se retrouver entre Blainvillais ou Agonais pour parler d’autre chose que de la guerre et de ses évènements.
Nos habitudes de déplacements ne sont plus les mêmes. Quiconque voulant admirer le montant de la mé15, le couchant du solé16 ou respirer le bon air iodé le long du littoral, est suspecté d’agissements belliqueux et contraires à leur loi allemande.
Néanmoins, des manifestations de solidarité entre nous se sont fait jour. À l’abattoir de la ferme, des ruses et astuces sont développées entre les habitants pour éviter la surveillance allemande et faire en sorte que toute la viande aille aux habitants du village.
En ces temps d’occupation et de pénurie, pouvoir déguster des praires, des palourdes, du bouquet, des étrilles ou des araignées, pêchés dans les rochers ou sur les platis17, permet d’agrémenter le quotidien. Malgré l’occupation, les Allemands autorisent, de façon réglementée, la pêche au large au thon et à la morue, se rendant compte que nourrir la population peut éviter bien des réactions néfastes à leur égard. Une organisation collective, pour laquelle Louis et Jacques, nos Terre-neuvas sont des chevilles ouvrières, s’est mise en place pour distribuer les prises à ceux qui en ont le plus besoin. J’ai l’impression que chaque habitant courbe l’échine comme si c’était la forme de résistance la plus efficace à adopter face à l’occupant.
C’est dans ce contexte que Jean revient à La Beuverie une fois démobilisé le 27 novembre 1942. C’est avec liesse que nous allons tous les trois l’accueillir à la descente du train en gare de Coutances. Il n’est pas moment plus exaltant que de retrouver son fils après une longue période d’absence, d’être attentif à ce qui a changé en lui et à ce qui a pu l’affecter particulièrement.
Pour nous l’avoir raconté par le menu quelques mois plus tard lors de veillées au coin du feu, moments durant lesquels l’âme et le cœur se confient, ces deux années et demie passées loin de La Beuverie, furent pleines de rebondissements.
Alors que les troupes allemandes ont envahi le nord de la France et se dirigent vers Paris, il participe, comme vaincu, à la retraite de France le 14 juin 1940. Affecté dans l’armée d’armistice, sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, aux troupes spéciales du Génie, il rétablit, en zone non occupée, les voies de communication et les ponts de chemin de fer.
Pour en avoir longuement discuté avec lui, cette période l’a beaucoup marqué et lui a laissé par la suite un certain nombre de convictions et de certitudes sur ce que devait être la France et les Français.
Tout est mis en œuvre familialement pour qu’il retrouve ses repères, qu’il oublie cette période et qu’il se reconstruise. Madeleine est pleine d’attention pour lui, en lui montrant tout ce qui a changé dans la maison. Julia s’empresse de lui préparer les plats qu’il affectionnait particulièrement et dont il a été privé depuis deux années et demie. Quant à moi, j’essaye de lui transmettre toutes les informations relatives aux évènements qui se sont passés dans la commune depuis son départ. Parmi toute la liste, je remarque que Jean est très sensible à l’exploit, véritable défi lancé à l’occupation allemande, de André Adde qui fit flotter le drapeau tricolore sur le clocher de l’église Saint-Pierre de Blainville, à la date symbolique du 14 juillet 1942 et dont nous n’avons pas de nouvelles depuis son arrestation.
Chacun et chacune s’abstient, dans un premier temps, de poser des questions au fils prodigue, évitant d’être trop envahissant. Pour ma part, je me dis intérieurement que la meilleure intention que je puisse avoir pour faciliter sa réinsertion serait de lui laisser les rênes dans la conduite des affaires à la ferme.
Mais de nombreuses interrogations encombrent nos pensées, se bousculant pêle-mêle sans aucune logique : ses conditions de vie dans les wagons ateliers étaient-elles supportables, comment avait-il vécu la débâcle de l’armée française, l’armistice avait-il été une humiliation ou au contraire était-il pétainiste, comment avait-il pu travailler sous les ordres de l’envahisseur allemand, quelle position avait-il tenu vis-à-vis de l’occupant, était-il soumis ou avait-il résisté, parti jeune à la guerre sa jeunesse était-elle gâchée, quels impacts cette période allait-elle avoir sur son comportement… ?
Madeleine remarque que son frère va devoir s’habituer à la nouvelle vie de La Beuverie, alors qu’il a bien fallu qu’il s’adapte déjà à sa vie de militaire si particulière. Cela lui fait deux changements radicaux de milieu à assurer. Va-t-il faire preuve de suffisamment de résilience, se demande-t-elle ? Elle espère que ce ne sera pas la fin mais le commencement d’une nouvelle vie pour lui.







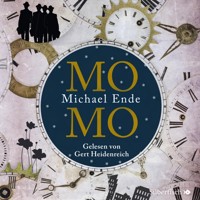



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)