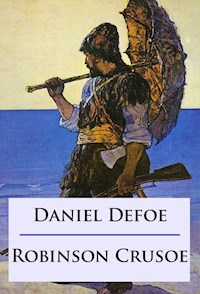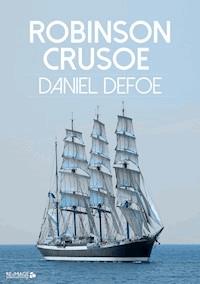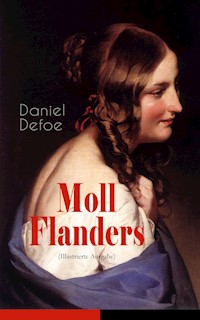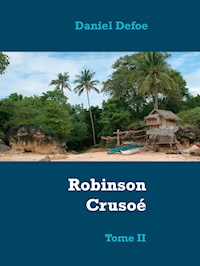
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Daniel Defoe, de son vrai nom Daniel Foe, est un aventurier, commerçant, agent politique et écrivain anglais, né vers 1660 à Londres et mort en avril 1731 dans la Cité de Londres. Il est notamment connu pour être l'auteur de Robinson Crusoé et de Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robinson Crusoé
Pages de titreDeuxième volumeDéfaillanceCombat avec les loupsLes deux neveuxProposition du neveuLe vaisseau incendiéRequête des incendiésLa cabineRetour dans l’îleBatterie des insulairesBrigandage des trois vauriensSoumission des trois vauriensPrise des trois fuyardsCaptifs offerts en présentLoterieFuite à la grotteDéfense des deux AnglaisMort de faim !…Habitation de William AtkinsDistribution des outilsConférenceSuite de la conférenceArrivée chez les AnglaisConversion de William AtkinsMariagesDialoguela femme d’AtkinsBaptême de la femme d’AtkinsLa BibleÉpisode de la cabineMort de VendrediThomas JeffrysThomas Jeffrys penduSaccagement du village indienMutinerieRencontre du canonnierAffaire des cinq chaloupesCombat à la poixLe vieux pilote portugaisArrivée à QuinchangLe négociant japonaisVoyage à NankingLe Don Quichotte chinoisLa grande murailleChameau voléLes Tartares-MongolsCham-Chi-ThaunguLes TongousesLe prince moscoviteLe fils du prince moscoviteDernière affairePage de copyrightRobinson Crusoé II
Daniel Defoe
Deuxième volume
Le vieux capitaine portugais
Quand j’arrivai en Angleterre, j’étais parfaitement étranger à tout
le monde, comme si je n’y eusse jamais été connu. Ma bienfaitrice,
ma fidèle intendante à qui j’avais laissé en dépôt mon argent, vivait
encore, mais elle avait essuyé de grandes infortunes dans le monde ;
et, devenue veuve pour la seconde fois, elle vivait chétivement. Je la
mis à l’aise quant à ce qu’elle me devait, en lui donnant l’assurance
que je ne la chagrinerais point. Bien au contraire, en reconnaissance
de ses premiers soins et de sa fidélité envers moi, je l’assistai autant
que le comportait mon petit avoir, qui pour lors, il est vrai, ne me
permit pas de faire beaucoup pour elle. Mais je lui jurai que je
garderais toujours souvenance de son ancienne amitié pour moi. Et
vraiment je ne l’oubliai pas lorsque je fus en position de la secourir,
comme on pourra le voir en son lieu.
Je m’en allai ensuite dans le Yorkshire. Mon père et ma mère
étaient morts et toute ma famille éteinte, hormis deux sœurs et deux
enfants de l’un de mes frères. Comme depuis longtemps je passais
pour mort, on ne m’avait rien réservé dans le partage. Bref je ne
trouvai ni appui ni secours, et le petit capital que j’avais n’était pas
suffisant pour fonder mon établissement dans le monde.
À la vérité je reçus une marque de gratitude à laquelle je ne
m’attendais pas : le capitaine que j’avais si heureusement délivré
avec son navire et sa cargaison, ayant fait à ses armateurs un beau
récit de la manière dont j’avais sauvé le bâtiment et l’équipage, ils
m’invitèrent avec quelques autres marchands intéressés à les venir
voir, et tous ensemble ils m’honorèrent d’un fort gracieux
compliment à ce sujet et d’un présent d’environ deux cents livres
sterling.
Après beaucoup de réflexions, sur ma position, et sur le peu de
moyens que j’avais de m’établir dans le monde, je résolus de m’en
aller à Lisbonne, pour voir si je ne pourrais pas obtenir quelques
informations sur l’état de ma plantation au Brésil, et sur ce qu’était
devenu mon partner, qui, j’avais tout lieu de le supposer, avait dû
depuis bien des années me mettre au rang des morts.
Dans cette vue, je m’embarquai pour Lisbonne, où j’arrivai au
mois d’avril suivant. Mon serviteur Vendredi m’accompagna avec
beaucoup de dévouement dans toutes ces courses, et se montra le
garçon le plus fidèle en toute occasion.
Quand j’eus mis pied à terre à Lisbonne, je trouvai après quelques
recherches, et à ma toute particulière satisfaction, mon ancien ami le
capitaine qui jadis m’avait accueilli en mer à la côte d’Afrique. Vieux
alors, il avait abandonné la mer, après avoir laissé son navire à son
fils, qui n’était plus un jeune homme, et qui continuait de commercer
avec le Brésil. Le vieillard ne me reconnut pas, et au fait je le
reconnaissais à peine ; mais je me rétablis dans son souvenir aussitôt
que je lui eus dit qui j’étais.
Après avoir échangé quelques expressions affectueuses de notre
ancienne connaissance, je m’informai, comme on peut le croire, de
ma plantation et de mon partner. Le vieillard me dit : — « Je ne suis
pas allé au Brésil depuis environ neuf ans ; je puis néanmoins vous
assurer que lors de mon dernier voyage votre partner vivait encore,
mais les curateurs que vous lui aviez adjoints pour avoir l’œil sur
votre portion étaient morts tous les deux.
Je crois cependant que vous pourriez avoir un compte très exact
du rapport de votre plantation ; parce que, sur la croyance générale
qu’ayant fait naufrage vous aviez été noyé, vos curateurs ont versé le
produit de votre part de la plantation dans les mains du Procureur-
Fiscal, qui en a assigné, — en cas que vous ne revinssiez jamais le
réclamer, — un tiers au roi et deux tiers au monastère de Saint-
Augustin, pour être employés au soulagement des pauvres, et à la
conversion des Indiens à la foi catholique. — Nonobstant, si vous
vous présentiez, ou quelqu’un fondé de pouvoir, pour réclamer cet
héritage, il serait restitué, excepté le revenu ou produit annuel, qui,
ayant été affecté à des œuvres charitables, ne peut être réversible. Je
vous assure que l’intendant du roi et le proveedor, ou majordome du
monastère, ont toujours eu grand soin que le bénéficier, c’est-à-dire
votre partner, leur rendît chaque année un compte fidèle du revenu
total, dont ils ont dûment perçu votre moitié. »
Je lui demandai s’il savait quel accroissement avait pris ma
plantation ; s’il pensait qu’elle valût la peine de s’en occuper, ou si,
allant sur les lieux, je ne rencontrerais pas d’obstacle pour rentrer
dans mes droits à la moitié.
Il me répondit : — « Je ne puis vous dire exactement à quel point
votre plantation s’est améliorée, mais je sais que votre partner est
devenu excessivement riche par la seule jouissance de sa portion. Ce
dont j’ai meilleure souvenance, c’est d’avoir ouï dire que le tiers de
votre portion, dévolu au roi, et qui, ce me semble, a été octroyé à
quelque monastère ou maison religieuse, montait à plus 200
moidores par an. Quant à être rétabli en paisible possession de votre
bien, cela ne fait pas de doute, votre partner vivant encore pour
témoigner de vos droits, et votre nom étant enregistré sur le cadastre
du pays. » — Il me dit aussi : — « Les survivants de vos deux
curateurs sont de très probes et de très honnêtes gens, fort riches, et
je pense que non seulement vous aurez leur assistance pour rentrer en
possession, mais que vous trouverez entre leurs mains pour votre
compte une somme très considérable.
C’est le produit de la plantation pendant que leurs pères en avaient
la curatelle, et avant qu’ils s’en fussent dessaisis comme je vous le
disais tout à l’heure, ce qui eut lieu, autant que je me le rappelle, il y
a environ douze ans. »
À ce récit je montrai un peu de tristesse et d’inquiétude, et je
demandai au vieux capitaine comment il était advenu que mes
curateurs eussent ainsi disposé de mes biens, quand il n’ignorait pas
que j’avais fait mon testament, et que je l’avais institué, lui, le
capitaine portugais, mon légataire universel.
— « Cela est vrai, me répondit-il ; mais, comme il n’y avait point
de preuves de votre mort, je ne pouvais agir comme exécuteur
testamentaire jusqu’à ce que j’en eusse acquis quelque certitude. En
outre, je ne me sentais pas porté à m’entremettre dans une affaire si
lointaine. Toutefois j’ai fait enregistrer votre testament, et je l’ai
revendiqué ; et, si j’eusse pu constater que vous étiez mort ou vivant,
j’aurais agi par procuration, et pris possession de l’engenho, — c’est
ainsi que les Portugais nomment une sucrerie — et j’aurais donné
ordre de le faire à mon fils, qui était alors au Brésil.
— » Mais, poursuivit le vieillard, j’ai une autre nouvelle à vous
donner, qui peut-être ne vous sera pas si agréable que les autres :
c’est que, vous croyant perdu, et tout le monde le croyant aussi, votre
partner et vos curateurs m’ont offert de s’accommoder avec moi, en
votre nom, pour le revenu des six ou huit premières années, lequel
j’ai reçu. Cependant de grandes dépenses ayant été faites alors pour
augmenter la plantation, pour bâtir un engenho et acheter des
esclaves, ce produit ne s’est pas élevé à beaucoup près aussi haut que
par la suite.
Néanmoins je vous rendrai un compte exact de tout ce que j’ai
reçu et de la manière dont j’en ai disposé. »
Après quelques jours de nouvelles conférences avec ce vieil ami,
il me remit un compte du revenu des six premières années de ma
plantation, signé par mon partner et mes deux curateurs, et qui lui
avait toujours été livré en marchandises : telles que du tabac en
rouleau, et du sucre en caisse, sans parler du rhum, de la
mélasphærule, produit obligé d’une sucrerie. Je reconnus par ce
compte que le revenu s’accroissait considérablement chaque année :
mais, comme il a été dit précédemment, les dépenses ayant été
grandes, le boni fut petit d’abord. Cependant, le vieillard me fit voir
qu’il était mon débiteur pour 470 moidores ; outre, 60 caisses de
sucre et 15 doubles rouleaux de tabac, qui s’étaient perdus dans son
navire, ayant fait naufrage en revenant à Lisbonne, environ onze ans
après mon départ du Brésil.
Cet homme de bien se prit alors à se plaindre de ses malheurs, qui
l’avaient contraint à faire usage de mon argent pour recouvrer ses
pertes et acheter une part dans un autre navire. — « Quoi qu’il en
soit, mon vieil ami, ajouta-t-il, vous ne manquerez pas de secours
dans votre nécessité, et aussitôt que mon fils sera de retour, vous
serez pleinement satisfait. »
Là-dessus il tira une vieille escarcelle, et me donna 160 moidores
portugais en or. Ensuite, me présentant les actes de ses droits sur le
bâtiment avec lequel son fils était allé au Brésil, et dans lequel il était
intéressé pour un quart et son fils pour un autre, il me les remit tous
entre les mains en nantissement du reste.
J’étais beaucoup trop touché de la probité et de la candeur de ce
pauvre homme pour accepter cela ; et, me remémorant tout ce qu’il
avait fait pour moi, comment il m’avait accueilli en mer, combien il
en avait usé généreusement à mon égard en toute occasion, et
combien surtout il se montrait en ce moment ami sincère, je fus sur le
point de pleurer quand il m’adressait ces paroles. Aussi lui demandai-
je d’abord si sa situation lui permettait de se dépouiller de tant
d’argent à la fois, et si cela ne le gênerait point. Il me répondit qu’à la
vérité cela pourrait le gêner un peu, mais que ce n’en était pas moins
mon argent, et que j’en avais peut-être plus besoin que lui.
Tout ce que me disait ce galant homme était si affectueux que je
pouvais à peine retenir mes larmes. Bref, je pris une centaine de
moidores, et lui demandai une plume et de l’encre pour lui en faire
un reçu ; puis je lui rendis le reste, et lui dis : — « Si jamais je rentre
en possession de ma plantation, je vous remettrai toute la somme, —
comme effectivement je fis plus tard ; — et quant au titre de
propriété de votre part sur le navire de votre fils, je ne veux en
aucune façon l’accepter ; si je venais à avoir besoin d’argent, je vous
tiens assez honnête pour me payer ; si au contraire je viens à palper
celui que vous me faites espérer, je ne recevrai plus jamais un penny
de vous. »
Quand ceci fut entendu, le vieillard me demanda s’il ne pourrait
pas me servir en quelque chose dans la réclamation de ma plantation.
Je lui dis que je pensais aller moi-même sur les lieux. — « Vous
pouvez faire ainsi, reprit-il, si cela vous plaît ; mais, dans le cas
contraire, il y a bien des moyens d’assurer vos droits et de recouvrer
immédiatement la jouissance de vos revenus. »
— Et, comme il se trouvait dans la rivière de Lisbonne des
vaisseaux prêts à partir pour le Brésil, il me fit inscrire mon nom
dans un registre public, avec une attestation de sa part, affirmant,
sous serment, que j’étais en vie, et que j’étais bien la même personne
qui avait entrepris autrefois le défrichement et la culture de ladite
plantation.
À cette déposition régulièrement légalisée par un notaire, il me
conseilla d’annexer une procuration, et de l’envoyer avec une lettre
de sa main à un marchand de sa connaissance qui était sur les lieux.
Puis il me proposa de demeurer avec lui jusqu’à ce que j’eusse reçu
réponse.
Défaillance
Il ne fut jamais rien de plus honorable que les procédés dont ma
procuration fut suivie : car en moins de sept mois il m’arriva de la
part des survivants de mes curateurs, les marchands pour le compte
desquels je m’étais embarqué, un gros paquet contenant les lettres et
papiers suivants :
1°. Il y avait un compte courant du produit de ma ferme en
plantation durant dix années, depuis que leurs pères avaient réglé
avec mon vieux capitaine du Portugal ; la balance semblait être en
ma faveur de 1174 moidores.
2°. Il y avait un compte de quatre années en sus, où les immeubles
étaient restés entre leurs mains avant que le gouvernement en eût
réclamé l’administration comme étant les biens d’une personne ne se
retrouvant point, ce qui constitue Mort Civile. La balance de celui-ci,
vu l’accroissement de la plantation, montait en cruzades à la valeur
de 3241 moidores.
3° Il y avait le compte du prieur des Augustins, qui, ayant perçu
mes revenus pendant plus de quatorze ans, et ne devant pas me
rembourser ce dont il avait disposé en faveur de l’hôpital, déclarait
très honnêtement qu’il avait encore entre les mains 873 moidores et
reconnaissait me les devoir. — Quant à la part du roi, je n’en tirai
rien.
Il y avait aussi une lettre de mon partner me félicitant très
affectueusement de ce que j’étais encore de ce monde, et me donnant
des détails sur l’amélioration de ma plantation, sur ce qu’elle
produisait par an, sur la quantité d’acres qu’elle contenait, sur sa
culture et sur le nombre d’esclaves qui l’exploitaient.
Puis, faisant vingt-deux croix en signe de bénédiction, il
m’assurait qu’il avait dit autant d’Ave Maria pour remercier la très
Sainte-Vierge de ce que je jouissais encore de la vie ; et m’engageait
fortement à venir moi-même prendre possession de ma propriété, ou
à lui faire savoir en quelles mains il devait remettre mes biens, si je
ne venais pas moi-même. Il finissait par de tendres et cordiales
protestations de son amitié et de celle de sa famille, et m’adressait en
présent sept belles peaux de léopards, qu’il avait sans doute reçues
d’Afrique par quelque autre navire qu’il y avait envoyé, et qui
apparemment avaient fait un plus heureux voyage que moi. Il
m’adressait aussi cinq caisses d’excellentes confitures, et une
centaine de pièces d’or non monnayées, pas tout à fait si grandes que
des moidores.
Par la même flotte mes curateurs m’expédièrent 1200 caisses de
sucre, 800 rouleaux du tabac, et le solde de leur compte en or.
Je pouvais bien dire alors avec vérité que la fin de Job était
meilleure que le commencement. Il serait impossible d’exprimer les
agitations de mon cœur à la lecture de ces lettres, et surtout quand je
me vis entouré de tous mes biens ; car les navires du Brésil venant
toujours en flotte, les mêmes vaisseaux qui avaient apporté mes
lettres avaient aussi apporté mes richesses, et mes marchandises
étaient en sûreté dans le Tage avant que j’eusse la missive entre les
mains. Bref, je devins pâle ; le cœur me tourna, et si le bon vieillard
n’était accouru et ne m’avait apporté un cordial, je crois que ma joie
soudaine aurait excédé ma nature, et que je serais mort sur la place.
Malgré cela, je continuai à aller fort mal pendant quelques heures,
jusqu’à ce qu’on eût appelé un médecin, qui, apprenant la cause
réelle de mon indisposition, ordonna de me faire saigner, après quoi
je me sentis mieux et je me remis. Mais je crois véritablement que, si
je n’avais été soulagé par l’air que de cette manière on donna pour
ainsi dire à mes esprits, j’aurais succombé.
J’étais alors tout d’un coup maître de plus de 50 000 livres sterling
en espèces, et au Brésil d’un domaine, je peux bien l’appeler ainsi,
d’environ mille livres sterling de revenu annuel, et aussi sûr que peut
l’être une propriété en Angleterre. En un mot, j’étais dans une
situation que je pouvais à peine concevoir, et je ne savais quelles
dispositions prendre pour en jouir.
Avant toutes choses, ce que je fis, ce fut de récompenser mon
premier bienfaiteur, mon bon vieux capitaine, qui tout d’abord avait
eu pour moi de la charité dans ma détresse, de la bonté au
commencement de notre liaison et de la probité sur la fin. Je lui
montrai ce qu’on m’envoyait, et lui dis qu’après la Providence
céleste, qui dispose de toutes choses, c’était à lui que j’en étais
redevable, et qu’il me restait à le récompenser, ce que je ferais au
centuple. Je lui rendis donc premièrement les 100 moidores que
j’avais reçus de lui ; puis j’envoyai chercher un tabellion et je le priai
de dresser en bonne et due forme une quittance générale ou décharge
des 470 moidores qu’il avait reconnu me devoir. Ensuite je lui
demandai de me rédiger une procuration, l’investissant receveur des
revenus annuels de ma plantation, et prescrivant à mon partner de
compter avec lui, et de lui faire en mon nom ses remises par les
flottes ordinaires.
Une clause finale lui assurait un don annuel de 100 moidores sa
vie durant, et à son fils, après sa mort, une rente viagère de 50
moidores. C’est ainsi que je m’acquittai envers mon bon vieillard.
Je me pris alors à considérer de quel côté je gouvernerais ma
course, et ce que je ferais du domaine que la Providence avait ainsi
replacé entre mes mains. En vérité j’avais plus de soucis en tête que
je n’en avais eus pendant ma vie silencieuse dans l’île, où je n’avais
besoin que de ce que j’avais, où je n’avais que ce dont j’avais
besoin ; tandis qu’à cette heure j’étais sous le poids d’un grand
fardeau que je ne savais comment mettre à couvert. Je n’avais plus de
caverne pour y cacher mon trésor, ni de lieu où il pût loger sans
serrure et sans clef, et se ternir et se moisir avant que personne mît la
main dessus. Bien au contraire, je ne savais où l’héberger, ni à qui le
confier. Mon vieux patron, le capitaine, était, il est vrai, un homme
intègre : ce fut lui mon seul refuge.
Secondement, mon intérêt semblait m’appeler au Brésil ; mais je
ne pouvais songer à y aller avant d’avoir arrangé mes affaires, et
laissé derrière moi ma fortune en mains sûres. Je pensai d’abord à ma
vieille amie la veuve, que je savais honnête et ne pouvoir qu’être
loyale envers moi ; mais alors elle était âgée, pauvre, et, selon toute
apparence, peut-être endettée. Bref, je n’avais ainsi d’autre parti à
prendre que de m’en retourner en Angleterre et d’emporter mes
richesses avec moi.
Quelques mois pourtant s’écoulèrent avant que je me
déterminasse à cela ; et c’est pourquoi, lorsque je me fus
parfaitement acquitté envers mon vieux capitaine, mon premier
bienfaiteur, je pensai aussi à ma pauvre veuve, dont le mari avait été
mon plus ancien patron, et elle-même, tant qu’elle l’avait pu, ma
fidèle intendante et ma directrice. Mon premier soin fut de charger un
marchand de Lisbonne d’écrire à son correspondant à Londres, non
pas seulement de lui payer un billet, mais d’aller la trouver et de lui
remettre de ma part 100 livres sterling en espèces, de jaser avec elle,
de la consoler dans sa pauvreté, en lui donnant l’assurance que, si
Dieu me prêtait vie, elle aurait de nouveaux secours. En même temps
j’envoyai dans leur province 100 livres sterling à chacune de mes
sœurs, qui, bien qu’elles ne fussent pas dans le besoin, ne se
trouvaient pas dans de très heureuses circonstances, l’une étant
veuve, et l’autre ayant un mari qui n’était pas aussi bon pour elle
qu’il l’aurait dû.
Mais parmi tous mes parents en connaissances, je ne pouvais faire
choix de personne à qui j’osasse confier le gros de mon capital, afin
que je pusse aller au Brésil et le laisser en sûreté derrière moi. Cela
me jeta dans une grande perplexité.
J’eus une fois l’envie d’aller au Brésil et de m’y établir, car j’étais
pour ainsi dire naturalisé dans cette contrée ; mais il s’éveilla en mon
esprit quelques petits scrupules religieux qui insensiblement me
détachèrent de ce dessein, dont il sera reparlé tout à l’heure.
Toutefois ce n’était pas la dévotion qui pour lors me retenait ; comme
je ne m’étais fait aucun scrupule de professer publiquement la
religion du pays tout le temps que j’y avais séjourné, pourquoi ne
1
l’eussé-je pas fait encore .
Non, comme je l’ai dit, ce n’était point là la principale cause qui
s’opposât à mon départ pour le Brésil, c’était réellement parce que je
ne savais à qui laisser mon avoir. Je me déterminai donc enfin à me
rendre avec ma fortune en Angleterre, où, si j’y parvenais, je me
1 Voir à la Dissertation religieuse.
promettais de faire quelque connaissance ou de trouver quelque
parent qui ne serait point infidèle envers moi. En conséquence je me
préparai à partir pour l’Angleterre avec toutes mes richesses.
À dessein de tout disposer pour mon retour dans ma patrie, — la
flotte du Brésil étant sur le point de faire voile, — je résolus d’abord
de répondre convenablement aux comptes justes et fidèles que j’avais
reçus. J’écrivis premièrement au prieur de Saint-Augustin une lettre
de remerciement pour ses procédés sincères, et je le priai de vouloir
bien accepter les 872 moidores dont il n’avait point disposé ; d’en
affecter 500 au monastère et 372 aux pauvres, comme bon lui
semblerait. Enfin je me recommandai aux prières du révérend Père,
et autres choses semblables.
J’écrivis ensuite une lettre d’action de grâces à mes deux
curateurs, avec toute la reconnaissance que tant de droiture et de
probité requérait. Quant à leur adresser un présent, ils étaient pour
cela trop au-dessus de toutes nécessités.
Finalement j’écrivis à mon partner, pour le féliciter de son
industrie dans l’amélioration de la plantation et de son intégrité dans
l’accroissement de la somme des productions. Je lui donnai mes
instructions sur le gouvernement futur de ma part, conformément aux
pouvoirs que j’avais laissés à mon vieux patron, à qui je le priai
d’envoyer ce qui me reviendrait, jusqu’à ce qu’il eût plus
particulièrement de mes nouvelles ; l’assurant que mon intention était
non seulement d’aller le visiter, mais encore de m’établir au Brésil
pour le reste de ma vie.
À cela j’ajoutai pour sa femme et ses filles, — le fils du capitaine
m’en avait parlé, — le fort galant cadeau de quelques soieries
d’Italie, de deux pièces de drap fin anglais, le meilleur que je pus
trouver dans Lisbonne, de cinq pièces de frise noire et de quelques
dentelles de Flandres de grand prix.
Ayant ainsi mis ordre à mes affaires, vendu ma cargaison et
converti tout mon avoir en bonnes lettres de change, mon nouvel
embarras fut le choix de la route à prendre pour passer en Angleterre.
J’étais assez accoutumé à la mer, et pourtant je me sentais alors une
étrange aversion pour ce trajet ; et, quoique je n’en eusse pu donner
la raison, cette répugnance s’accrut tellement, que je changeai d’avis,
et fis rapporter mon bagage, embarqué pour le départ, non seulement
une fois, mais deux ou trois fois.
Il est vrai que mes malheurs sur mer pouvaient bien être une des
raisons de ces appréhensions ; mais qu’en pareille circonstance nul
homme ne méprise les fortes impulsions de ses pensées intimes.
Deux des vaisseaux que j’avais choisis pour mon embarquement,
j’entends plus particulièrement choisis qu’aucun autre ; car dans l’un
j’avais fait porter toutes mes valises, et quant à l’autre j’avais fait
marché avec le capitaine ; deux de ces vaisseaux, dis-je, furent
perdus : le premier fut pris par les Algériens, le second fit naufrage
vers le Start, près de Torbay, et, trois hommes exceptés, tout
l’équipage se noya. Ainsi dans l’un ou l’autre de ces vaisseaux
j’eusse trouvé le malheur. Et dans lequel le plus grand ? Il est
difficile de le dire.
Le guide attaqué par des loups
Mon esprit étant ainsi harassé par ces perplexités, mon vieux
pilote, à qui je ne celais rien, me pria instamment de ne point aller sur
mer, mais de me rendre par terre jusqu’à La Corogne, de traverser le
golfe de Biscaye pour atteindre La Rochelle, d’où il était aisé de
voyager sûrement par terre jusqu’à Paris, et de là de gagner Calais et
Douvres, ou bien d’aller à Madrid et de traverser toute la France.
Bref, j’avais une telle appréhension de la mer, que, sauf de Calais
à Douvres, je résolus de faire toute la route par terre ; comme je
n’étais point pressé et que peu m’importait la dépense, c’était bien le
plus agréable chemin. Pour qu’il le fût plus encore, mon vieux
capitaine m’amena un Anglais, un gentleman, fils d’un négociant de
Lisbonne, qui était désireux d’entreprendre ce voyage avec moi.
Nous recueillîmes en outre deux marchands anglais et deux jeunes
gentilshommes portugais : ces derniers n’allaient que jusqu’à Paris
seulement. Nous étions en tout six maîtres et cinq serviteurs, les deux
marchands et les deux Portugais se contentant d’un valet pour deux,
afin de sauver la dépense. Quant à moi, pour le voyage je m’étais
attaché un matelot anglais comme domestique, outre Vendredi, qui
était trop étranger pour m’en tenir lieu durant la route.
Nous partîmes ainsi de Lisbonne. Notre compagnie étant toute
bien montée et bien armée, nous formions une petite troupe dont on
me fit l’honneur de me nommer capitaine, parce que j’étais le plus
âgé, que j’avais deux serviteurs, et qu’au fait j’étais la cause première
du voyage.
Comme je ne vous ai point ennuyé de mes journaux de mer, je ne
vous fatiguerai point de mes journaux de terre ; toutefois durant ce
long et difficile voyage quelques aventures nous advinrent que je ne
puis omettre.
Quand nous arrivâmes à Madrid, étant tous étrangers à l’Espagne,
la fantaisie nous vint de nous y arrêter quelque temps pour voir la
cour et tout ce qui était digne d’observation ; mais, comme nous
étions sur la fin de l’été, nous nous hâtâmes, et quittâmes Madrid
environ au milieu d’octobre. En atteignant les frontières de la
Navarre, nous fûmes alarmés en apprenant dans quelques villes le
long du chemin que tant de neige était tombée sur le côté français des
montagnes, que plusieurs voyageurs avaient été obligés de retourner
à Pampelune, après avoir à grands risques tenté passage.
Arrivés à Pampelune, nous trouvâmes qu’on avait dit vrai ; et pour
moi, qui avais toujours vécu sous un climat chaud, dans des contrées
où je pouvais à peine endurer des vêtements, le froid fut
insupportable. Au fait, il n’était pas moins surprenant que pénible
d’avoir quitté dix jours auparavant la Vieille-Castille, où le temps
était non seulement chaud mais brûlant, et de sentir immédiatement
le vent des Pyrénées si vif et si rude qu’il était insoutenable, et
mettait nos doigts et nos orteils en danger d’être engourdis et gelés.
C’était vraiment étrange.
Le pauvre Vendredi fut réellement effrayé quand il vit ces
montagnes toutes couvertes de neige et qu’il sentit le froid de l’air,
choses qu’il n’avait jamais ni vues ni ressenties de sa vie.
Pour couper court, après que nous eûmes atteint Pampelune, il
continua à neiger avec tant de violence et si longtemps, qu’on disait
que l’hiver était venu avant son temps. Les routes, qui étaient déjà
difficiles, furent alors tout à fait impraticables. En un mot, la neige se
trouva en quelques endroits trop épaisse pour qu’on pût voyager, et,
n’étant point durcie par la gelée, comme dans les pays
septentrionaux, on courait risque d’être enseveli vivant à chaque pas.
Nous ne nous arrêtâmes pas moins de vingt jours à Pampelune ;
mais, voyant que l’hiver s’approchait sans apparence
d’adoucissement, — ce fut par toute l’Europe l’hiver le plus
rigoureux qu’il y eût eu depuis nombre d’années, — je proposai
d’aller à Fontarabie, et là de nous embarquer pour Bordeaux, ce qui
n’était qu’un très petit voyage.
Tandis que nous étions à délibérer là-dessus, il arriva quatre
gentilshommes français, qui, ayant été arrêtés sur le côté français des
passages comme nous sur le côté espagnol, avaient trouvé un guide
qui, traversant le pays près la pointe du Languedoc, leur avait fait
passer les montagnes par de tels chemins, que la neige les avait peu
incommodés, et où, quand il y en avait en quantité, nous dirent-ils,
elle était assez durcie par la gelée pour les porter eux et leurs
chevaux.
Nous envoyâmes quérir ce guide. — « J’entreprendrai de vous
mener par le même chemin, sans danger quant à la neige, nous dit-il,
pourvu que vous soyez assez bien armés pour vous défendre des
bêtes sauvages ; car durant ces grandes neiges il n’est pas rare que
des loups, devenus enragés par le manque de nourriture, se fassent
voir aux pieds des montagnes. »
— Nous lui dîmes que nous étions suffisamment prémunis contre
de pareilles créatures, s’il nous préservait d’une espèce de loups à
deux jambes, que nous avions beaucoup à redouter, nous disait-on,
particulièrement sur le côté français des montagnes.
Il nous affirma qu’il n’y avait point de danger de cette sorte par la
route que nous devions prendre. Nous consentîmes donc sur-le-
champ à le suivre. Le même parti fut pris par douze autres
gentilshommes avec leurs domestiques, quelques-uns français,
quelques-uns espagnols, qui, comme je l’ai dit avaient tenté le
voyage et s’étaient vus forcés de revenir sur leurs pas.
Conséquemment nous partîmes de Pampelune avec notre guide
vers le 15 novembre, et je fus vraiment surpris quand, au lieu de nous
mener en avant, je le vis nous faire rebrousser de plus de vingt
milles, par la même route que nous avions suivie en venant de
Madrid. Ayant passé deux rivières et gagné le pays plat, nous nous
retrouvâmes dans un climat chaud, où le pays était agréable, et où
l’on ne voyait aucune trace de neige ; mais tout à coup, tournant à
gauche, il nous ramena vers les montagnes par un autre chemin. Les
rochers et les précipices étaient vraiment effrayants à voir ;
cependant il fit tant de tours et de détours, et nous conduisit par des
chemins si tortueux, qu’insensiblement nous passâmes le sommet des
montagnes sans être trop incommodés par la neige. Et soudain il
nous montra les agréables et fertiles provinces de Languedoc et de
Gascogne, toutes vertes et fleurissantes, quoique, au fait, elles fussent
à une grande distance et que nous eussions encore bien du mauvais
chemin.
Nous eûmes pourtant un peu à décompter, quand tout un jour et
une nuit nous vîmes neiger si fort que nous ne pouvions avancer.
Mais notre guide nous dit de nous tranquilliser, que bientôt tout serait
franchi. Nous nous aperçûmes en effet que nous descendions chaque
jour, et que nous nous avancions plus au nord qu’auparavant ; nous
reposant donc sur notre guide, nous poursuivîmes.
Deux heures environ avant la nuit, notre guide était devant nous à
quelque distance et hors de notre vue, quand soudain trois loups
monstrueux, suivis d’un ours, s’élancèrent d’un chemin creux
joignant un bois épais. Deux des loups se jetèrent sur le guide ; et,
s’il s’était trouvé seulement éloigné d’un demi-mille, il aurait été à
coup sûr dévoré avant que nous eussions pu le secourir. L’un de ces
animaux s’agrippa au cheval, et l’autre attaqua l’homme avec tant de
violence, qu’il n’eut pas le temps ou la présence d’esprit de s’armer
de son pistolet, mais il se prit à crier et à nous appeler de toute sa
force. J’ordonnai à mon serviteur Vendredi, qui était près de moi,
d’aller à toute bride voir ce qui se passait. Dès qu’il fut à portée de
vue du guide il se mit à crier aussi fort que lui : — « Ô maître ! Ô
maître ! » — Mais, comme un hardi compagnon, il galopa droit au
pauvre homme, et déchargea son pistolet dans la tête du loup qui
l’attaquait.
Par bonheur pour le pauvre guide, ce fut mon serviteur Vendredi
qui vint à son aide ; car celui-ci, dans son pays, ayant été familiarisé
avec cette espèce d’animal, fondit sur lui sans peur et tira son coup à
bout portant ; au lieu que tout autre de nous aurait tiré de plus loin, et
peut-être manqué le loup, ou couru le danger de frapper l’homme.
Il y avait là de quoi épouvanter un plus vaillant que moi ; et de fait
toute la compagnie s’alarma quand, avec la détonation du pistolet de
Vendredi, nous entendîmes des deux côtés les affreux hurlements des
loups, et ces cris tellement redoublés par l’écho des montagnes,
qu’on eût dit qu’il y en avait une multitude prodigieuse ; et peut-être
en effet leur nombre légitimait-il nos appréhensions.
Quoi qu’il en fût, lorsque Vendredi eut tué ce loup, l’autre, qui
s’était cramponné au cheval, l’abandonna sur-le-champ et s’enfuit.
Fort heureusement, comme il l’avait attaqué à la tête, ses dents
s’étaient fichées dans les bossettes de la bride, de sorte qu’il lui avait
fait peu de mal. Mais l’homme était grièvement blessé : l’animal
furieux lui avait fait deux morsures, l’une au bras et l’autre un peu
au-dessus du genou, et il était juste sur le point d’être renversé par
son cheval effrayé quand Vendredi accourut et tua le loup.
On imaginera facilement qu’au bruit du pistolet de Vendredi nous
forçâmes tous notre pas et galopâmes aussi vite que nous le
permettait un chemin ardu, pour voir ce que cela voulait dire. Sitôt
que nous eûmes passé les arbres qui nous offusquaient, nous vîmes
clairement de quoi il s’agissait, et de quel mauvais pas Vendredi avait
tiré le pauvre guide, quoique nous ne pussions distinguer d’abord
l’espèce d’animal qu’il avait tuée.
Mais jamais combat ne fut présenté plus hardiment et plus
étrangement que celui qui suivit entre Vendredi et l’ours, et qui, bien
que nous eussions été premièrement surpris et effrayés, nous donna à
tous le plus grand divertissement imaginable.
— L’ours est un gros et pesant animal ; il ne galope point comme
le loup, alerte et léger ; mais il possède deux qualités particulières,
sur lesquelles généralement il base ses actions. Premièrement, il ne
fait point sa proie de l’homme, non pas que je veuille dire que la faim
extrême ne l’y puisse forcer, — comme dans le cas présent, la terre
étant couverte de neige, — et d’ordinaire il ne l’attaque que lorsqu’il
en est attaqué. Si vous le rencontrez dans les bois, et que vous ne
vous mêliez pas de ses affaires, il ne se mêlera pas des vôtres. Mais
ayez soin d’être très galant avec lui et de lui céder la route ; car c’est
un gentleman fort chatouilleux, qui ne voudrait point faire un pas
hors de son chemin, fût-ce pour un roi. Si réellement vous en êtes
effrayé, votre meilleur parti est de détourner les yeux et de
poursuivre ; car par hasard si vous vous arrêtez, vous demeurez coi et
le regardez fixement, il prendra cela pour un affront, et si vous lui
jetiez ou lui lanciez quelque chose qui l’atteignit, ne serait-ce qu’un
bout de bâton gros comme votre doigt, il le considérerait comme un
outrage, et mettrait de côté tout autre affaire pour en tirer vengeance ;
car il veut avoir satisfaction sur le point d’honneur : c’est là sa
première qualité. La seconde, c’est qu’une fois offensé, il ne vous
laissera ni jour ni nuit, jusqu’à ce qu’il ait sa revanche, et vous
suivra, avec sa bonne grosse dégaine, jusqu’à ce qu’il vous ait atteint.
Mon serviteur Vendredi, lorsque nous le joignîmes, avait délivré
notre guide, et l’aidait à descendre de son cheval, car le pauvre
homme était blessé et effrayé plus encore, quand soudain nous
aperçûmes l’ours sortir du bois ; il était monstrueux, et de beaucoup
le plus gros que j’eusse jamais vu.
À son aspect nous fûmes tous un peu surpris ; mais nous
démêlâmes aisément du courage et de la joie dans la contenance de
Vendredi. — « Ô ! Ô ! Ô ! s’écria-t-il trois fois, en le montrant du
doigt, Ô maître ! vous me donner congé, moi donner une poignée de
main à lui, moi vous faire vous bon rire. »
Vendredi montre à danser à l’ours
Je fus étonné de voir ce garçon si transporté. — « Tu es fou, lui
dis-je, il te dévorera ! » — « Dévorer moi ! dévorer moi ? répéta
Vendredi. Moi dévorer lui, moi faire vous bon rire ; vous tous rester
là, moi montrer vous bon rire. » — Aussitôt il s’assied à terre, en un
tour de main ôte ses bottes, chausse une paire d’escarpins qu’il avait
dans sa poche, donne son cheval à mon autre serviteur, et, armé de
son fusil, se met à courir comme le vent.
L’ours se promenait tout doucement, sans songer à troubler
personne, jusqu’à ce que Vendredi, arrivé assez près, se mit à
l’appeler comme s’il pouvait le comprendre : — « Écoute ! écoute !
moi parler avec toi. » — Nous suivions à distance ; car, ayant alors
descendu le côté des montagnes qui regardent la Gascogne, nous
étions entrés dans une immense forêt dont le sol plat était rempli de
clairières parsemées d’arbres çà et là.
Vendredi, qui était comme nous l’avons dit sur les talons de l’ours,
le joignit promptement, ramassa une grosse pierre, la lui jeta et
l’atteignit à la tête ; mais il ne lui fit pas plus de mal que s’il l’avait
lancée contre un mur ; elle répondait cependant à ses fins, car le drôle
était si exempt de peur, qu’il ne faisait cela que pour obliger l’ours à
le poursuivre, et nous montrer bon rire, comme il disait.
Sitôt que l’ours sentit la pierre, et aperçut Vendredi, il se retourna,
et s’avança vers lui en faisant de longues et diaboliques enjambées,
marchant tout de guingois et d’une si étrange allure, qu’il aurait fait
prendre à un cheval le petit galop. Vendredi s’enfuit et porta sa
course de notre côté comme pour demander du secours.
Nous résolûmes donc aussi de faire feu tous ensemble sur l’ours,
afin de délivrer mon serviteur. J’étais cependant fâché de tout cœur
contre lui, pour avoir ainsi attiré la bête sur nous lorsqu’elle allait à
ses affaires par un autre chemin. J’étais surtout en colère de ce qu’il
l’avait détournée et puis avait pris la fuite. Je l’appelai : — « Chien,
lui dis-je, est-ce là nous faire rire ? Arrive ici et reprends ton bidet,
afin que nous puisions faire feu sur l’animal. » — Il m’entendit et
cria : — « Pas tirer ! pas tirer ! rester tranquille : vous avoir beaucoup
rire. » — Comme l’agile garçon faisait deux enjambées contre l’autre
une, il tourna tout à coup de côté, et, apercevant un grand chêne
propre pour son dessein, il nous fit signe de le suivre ; puis,
redoublant de prestesse, il monta lestement sur l’arbre, ayant laissé
son fusil sur la terre, à environ cinq ou six verges plus loin.
L’ours arriva bientôt vers l’arbre. Nous le suivions à distance. Son
premier soin fut de s’arrêter au fusil et de le flairer ; puis, le laissant
là, il s’agrippa à l’arbre et grimpa comme un chat, malgré sa
monstrueuse pesanteur. J’étais étonné de la folie de mon serviteur,
car j’envisageais cela comme tel ; et, sur ma vie, je ne trouvais là-
dedans rien encore de risible, jusqu’à ce que, voyant l’ours monter à
l’arbre, nous nous rapprochâmes de lui.
Quand nous arrivâmes, Vendredi avait déjà gagné l’extrémité
d’une grosse branche, et l’ours avait fait la moitié du chemin pour
l’atteindre. Aussitôt que l’animal parvint à l’endroit où la branche
était plus faible, — « Ah ! nous cria Vendredi, maintenant vous voir
moi apprendre l’ours à danser. »
— Et il se mit à sauter et à secouer la branche. L’ours,
commençant alors à chanceler, s’arrêta court et se prit à regarder
derrière lui pour voir comment il s’en retournerait, ce qui
effectivement nous fit rire de tout cœur. Mais il s’en fallait de
beaucoup que Vendredi eût fini avec lui. Quand il le vit se tenir coi, il
l’appela de nouveau, comme s’il eût supposé que l’ours parlait
anglais : — « Comment ! toi pas venir plus loin ? Moi prie toi venir
plus loin. » — Il cessa donc de sauter et de remuer la branche ; et
l’ours, juste comme s’il comprenait ce qu’il disait, s’avança un peu.
Alors Vendredi se reprit à sauter, et l’ours s’arrêta encore.
Nous pensâmes alors que c’était un bon moment pour le frapper à
la tête, et je criai à Vendredi de rester tranquille, que nous voulions
tirer sur l’ours ; mais il répliqua vivement : — « Ô prie ! Ô prie ! pas
tirer ; moi tirer près et alors. » — Il voulait dire tout à l’heure.
Cependant, pour abréger l’histoire, Vendredi dansait tellement et
l’ours se posait d’une façon si grotesque, que vraiment nous pâmions
de rire. Mais nous ne pouvions encore concevoir ce que le camarade
voulait faire. D’abord nous avions pensé qu’il comptait renverser
l’ours ; mais nous vîmes que la bête était trop rusée pour cela : elle
ne voulait pas avancer, de peur d’être jetée à bas, et s’accrochait si
bien avec ses grandes griffes et ses grosses pattes, que nous ne
pouvions imaginer quelle serait l’issue de ceci et où s’arrêterait la
bouffonnerie.
Mais Vendredi nous tira bientôt d’incertitude. Voyant que l’ours se
cramponnait à la branche et ne voulait point se laisser persuader
d’approcher davantage : — « Bien, bien ! dit-il, toi pas venir plus
loin, moi aller, moi aller ; toi pas venir à moi, moi aller à toi. » — Sur
ce, il se retire jusqu’au bout de la branche, et, la faisant fléchir sous
son poids, il s’y suspend et la courbe doucement jusqu’à ce qu’il soit
assez près de terre pour tomber sur ses pieds ; puis il court à son
fusil, le ramasse et se plante là.
— « Eh bien, lui dis-je, Vendredi, que voulez-vous faire
maintenant ? Pourquoi ne tirez-vous pas ? » — « Pas tirer, répliqua-t-
il, pas encore ; moi tirer maintenant, moi non tuer ; moi rester, moi
donner vous encore un rire. » — Ce qu’il fit en effet, comme on le
verra tout à l’heure. Quand l’ours vit son ennemi délogé, il déserta de
la branche où il se tenait, mais excessivement lentement, regardant
derrière lui à chaque pas et marchant à reculons, jusqu’à ce qu’il eût
gagné le corps de l’arbre. Alors, toujours l’arrière-train en avant, il
descendit, s’agrippant au tronc avec ses griffes et ne remuant qu’une
patte à la fois, très posément. Juste à l’instant où il allait appuyer sa
patte de derrière sur le sol, Vendredi s’avança sur lui, et, lui
appliquant le canon de son fusil dans l’oreille, il le fit tomber roide
mort comme une pierre.
Alors le maraud se retourna pour voir si nous n’étions pas à rire ;
et quand il lut sur nos visages que nous étions fort satisfaits, il poussa
lui-même un grand ricanement, et nous dit : « Ainsi nous tue ours
dans ma contrée. » — « Vous les tuez ainsi ? repris-je, comment !
vous n’avez pas de fusils ? » — « Non, dit-il, pas fusils ; mais tirer
grand beaucoup longues flèches. »
Ceci fut vraiment un bon divertissement pour nous ; mais nous
nous trouvions encore dans un lieu sauvage, notre guide était
grièvement blessé, et nous savions à peine que faire. Les hurlements
des loups retentissaient toujours dans ma tête ; et, dans le fait,
excepté le bruit que j’avais jadis entendu sur le rivage d’Afrique, et
dont j’ai dit quelque chose déjà, je n’ai jamais rien ouï qui m’ait
rempli d’une si grande horreur.
Ces raisons, et l’approche de la nuit, nous faisaient une loi de
partir ; autrement, comme l’eût souhaité Vendredi, nous aurions
certainement dépouillé cette bête monstrueuse de sa robe, qui valait
bien la peine d’être conservée ; mais nous avions trois lieues à faire,
et notre guide nous pressait. Nous abandonnâmes donc ce butin et
poursuivîmes notre voyage.
La terre était toujours couverte de neige, bien que moins épaisse et
moins dangereuse que sur les montagnes. Des bêtes dévorantes,
comme nous l’apprîmes plus tard, étaient descendues dans la forêt et
dans le pays plat, pressées par la faim, pour chercher leur pâture, et
avaient fait de grands ravages dans les hameaux, où elles avaient
surpris les habitants, tué un grand nombre de leurs moutons et de
leurs chevaux, et même quelques personnes.
Nous avions à passer un lieu dangereux dont nous parlait notre
guide ; s’il y avait encore des loups dans le pays, nous devions à
coup sûr les rencontrer là. C’était une petite plaine, environnée de
bois de tous les côtés, et un long et étroit défilé où il fallait nous
engager pour traverser le bois et gagner le village, notre gîte.
Une demi-heure avant le coucher du soleil nous entrâmes dans le
premier bois, et à soleil couché nous arrivâmes dans la plaine. Nous
ne rencontrâmes rien dans ce premier bois, si ce n’est que dans une
petite clairière, qui n’avait pas plus d’un quart de mille, nous vîmes
cinq grands loups traverser la route en toute hâte, l’un après l’autre,
comme s’ils étaient en chasse de quelque proie qu’ils avaient en vue.
Ils ne firent pas attention à nous, et disparurent en peu d’instants.
Là-dessus notre guide, qui, soit dit en passant, était un misérable
poltron, nous recommanda de nous mettre en défense ; il croyait que
beaucoup d’autres allaient venir.
Nous tînmes nos armes prêtes et l’œil au guet ; mais nous ne
vîmes plus de loups jusqu’à ce que nous eûmes pénétré dans la plaine
après avoir traversé ce bois, qui avait près d’une demi-lieue. Aussitôt
que nous y fûmes arrivés, nous ne chômâmes pas d’occasion de
regarder autour de nous. Le premier objet qui nous frappa ce fut un
cheval mort, c’est-à-dire un pauvre cheval que les loups avaient tué.
Au moins une douzaine d’entre eux étaient à la besogne, on ne peut
pas dire en train de le manger, mais plutôt de ronger les os, car ils
avaient dévoré toute la chair auparavant.
Nous ne jugeâmes point à propos de troubler leur festin, et ils ne
prirent pas garde à nous. Vendredi aurait bien voulu tirer sur eux,
mais je m’y opposai formellement, prévoyant que nous aurions sur
les bras plus d’affaires semblables que nous ne nous y attendions. —
Nous n’avions pas encore traversé la moitié de la plaine, quand, dans
les bois, à notre gauche, nous commençâmes à entendre les loups
hurler d’une manière effroyable, et aussitôt après nous en vîmes
environ une centaine venir droit à nous, tous en corps, et la plupart
d’entre eux en ligne, aussi régulièrement qu’une armée rangée par
des officiers expérimentés.
Je savais à peine que faire pour les recevoir. Il me sembla
toutefois que le seul moyen était de nous serrer tous de front, ce que
nous exécutâmes sur-le-champ. Mais, pour qu’entre les décharges
nous n’eussions point trop d’intervalle, je résolus que seulement de
deux hommes l’un ferait feu, et que les autres, qui n’auraient pas tiré,
se tiendraient prêts à leur faire essuyer immédiatement une seconde
fusillade s’ils continuaient d’avancer sur nous ; puis que ceux qui
auraient lâché leur coup d’abord ne s’amuseraient pas à recharger
leur fusil, mais s’armeraient chacun d’un pistolet, car nous étions
tous munis d’un fusil et d’une paire de pistolets. Ainsi nous pouvions
par cette tactique faire six salves, la moitié de nous tirant à la fois.
Néanmoins, pour le moment, il n’y eut pas nécessité : à la première
décharge les ennemis firent halte, épouvantés, stupéfiés du bruit
autant que du feu. Quatre d’entre eux, frappés à la tête, tombèrent
morts ; plusieurs autres furent blessés et se retirèrent tout sanglants,
comme nous pûmes le voir par la neige. Ils s’étaient arrêtés, mais ils
ne battaient point en retraite. Me ressouvenant alors d’avoir entendu
dire que les plus farouches animaux étaient jetés dans l’épouvante à
la voix de l’homme, j’enjoignis à tous nos compagnons de crier aussi
haut qu’ils le pourraient, et je vis que le dicton n’était pas absolument
faux ; car, à ce cri, les loups commencèrent à reculer et à faire volte-
face. Sur le coup j’ordonnai de saluer leur arrière-garde d’une
seconde décharge, qui leur fit prendre le galop, et ils s’enfuirent dans
les bois.
Ceci nous donna le loisir de recharger nos armes, et, pour ne pas
perdre de temps, nous le fîmes en marchant. Mais à peine eûmes-
nous bourré nos fusils et repris la défensive, que nous entendîmes un
bruit terrible dans le même bois, à notre gauche ; seulement c’était
plus loin, en avant, sur la route que nous devions suivre.
Combat avec les loups
La nuit approchait et commençait à se faire noire, ce qui empirait
notre situation ; et, comme le bruit croissait, nous pouvions aisément
reconnaître les cris et les hurlements de ces bêtes infernales. Soudain
nous aperçûmes deux ou trois troupes de loups sur notre gauche, une
derrière nous et une à notre front, de sorte que nous en semblions
environnés. Néanmoins, comme elles ne nous assaillaient point, nous
poussâmes en avant aussi vite que pouvaient aller nos chevaux, ce
qui, à cause de l’âpreté du chemin, n’était tout bonnement qu’un
grand trot. De cette manière nous vînmes au-delà de la plaine, en vue
de l’entrée du bois à travers lequel nous devions passer ; mais notre
surprise fut grande quand, arrivés au défilé, nous aperçûmes, juste à
l’entrée, un nombre énorme de loups à l’affût.
Tout à coup, vers une autre percée du bois, nous entendîmes la
détonation d’un fusil ; et comme nous regardions de ce côté, sortit un
cheval, sellé et bridé, fuyant comme le vent, et ayant à ses trousses
seize ou dix-sept loups haletants : en vérité il les avait sur ses talons.
Comme nous ne pouvions supposer qu’il tiendrait à cette vitesse,
nous ne mîmes pas en doute qu’ils finiraient par le joindre ;
infailliblement il en a dû être ainsi.
Un spectacle plus horrible encore vint alors frapper nos regards :
ayant gagné la percée d’où le cheval était sorti, nous trouvâmes les
cadavres d’un autre cheval et de deux hommes dévorés par ces bêtes
cruelles. L’un de ces hommes était sans doute le même que nous
avions entendu tirer une arme à feu, car il avait près de lui un fusil
déchargé. Sa tête et la partie supérieure de son corps étaient rongées.
Cette vue nous remplit d’horreur, et nous ne savions où porter nos
pas ; mais ces animaux, alléchés par la proie, tranchèrent bientôt la
question en se rassemblant autour de nous. Sur l’honneur, il y en
avait bien trois cents ! — Il se trouvait, fort heureusement pour nous,
à l’entrée du bois, mais à une petite distance, quelques gros arbres
propres à la charpente, abattus l’été d’auparavant, et qui, je le
suppose, gisaient là en attendant qu’on les charriât. Je menai ma
petite troupe au milieu de ces arbres, nous nous rangeâmes en ligne
derrière le plus long, j’engageai tout le monde à mettre pied à terre,
et, gardant ce tronc devant nous comme un parapet, à former un
triangle ou trois fronts, renfermant nos chevaux dans le centre.
Nous fîmes ainsi et nous fîmes bien, car jamais il ne fut plus
furieuse charge que celle qu’exécutèrent sur nous ces animaux quand
nous fûmes en ce lieu : ils se précipitèrent en grondant, montèrent sur
la pièce de charpente qui nous servait de parapet, comme s’ils se
jetaient sur leur proie. Cette fureur, à ce qu’il paraît, était surtout
excitée par la vue des chevaux placés derrière nous : c’était là la
curée qu’ils convoitaient. J’ordonnai à nos hommes de faire feu
comme auparavant, de deux hommes l’un, et ils ajustèrent si bien
qu’ils tuèrent plusieurs loups à la première décharge ; mais il fut
nécessaire de faire un feu roulant, car ils avançaient sur nous comme
des diables, ceux de derrière poussant ceux de devant.
Après notre seconde fusillade, nous pensâmes qu’ils s’arrêteraient
un peu, et j’espérais qu’ils allaient battre en retraite ; mais ce ne fût
qu’une lueur, car d’autres s’élancèrent de nouveau.
Nous fîmes donc nos salves de pistolets. Je crois que dans ces
quatre décharges nous en tuâmes bien dix-sept ou dix-huit et que
nous en estropiâmes le double. Néanmoins ils ne désemparaient pas.
Je ne me souciais pas de tirer notre dernier coup trop à la hâte.
J’appelai donc mon domestique, non pas mon serviteur Vendredi, il
était mieux employé : durant l’engagement il avait, avec la plus
grande dextérité imaginable chargé mon fusil et le sien ; mais,
comme je disais, j’appelai mon autre homme, et, lui donnant une
corne à poudre, je lui ordonnai de faire une grande traînée le long de
la pièce de charpente. Il obéit et n’avait eu que le temps de s’en aller,
quand les loups y revinrent, et quelques-uns étaient montés dessus,
lorsque moi, lâchant près de la poudre le chien d’un pistolet
déchargé, j’y mis le feu. Ceux qui se trouvaient sur la charpente
furent grillés, et six ou sept d’entre eux tombèrent ou plutôt sautèrent
parmi nous, soit par la force ou par la peur du feu. Nous les
dépêchâmes en un clin d’œil ; et les autres furent si effrayés de cette
explosion, que la nuit fort près alors d’être close rendit encore plus
terrible, qu’ils se reculèrent un peu.
Là-dessus je commandai de faire une décharge générale de nos
derniers pistolets, après quoi nous jetâmes un cri. Les loups alors
nous montrèrent les talons, et aussitôt nous fîmes une sortie sur une
vingtaine d’estropiés que nous trouvâmes se débattant par terre, et
que nous taillâmes à coups de sabre, ce qui répondit à notre attente ;
car les cris et les hurlements qu’ils poussèrent furent entendus par
leurs camarades, si bien qu’ils prirent congé de nous et s’enfuirent.
Nous en avions en tout expédié une soixantaine, et si c’eût été en
plein jour nous en aurions tué bien davantage. Le champ de bataille
étant ainsi balayé, nous nous remîmes en route, car nous avions
encore près d’une lieue à faire. Plusieurs fois chemin faisant nous
entendîmes ces bêtes dévorantes hurler et crier dans les bois, et
plusieurs fois nous nous imaginâmes en voir quelques-unes ; mais,
nos yeux étant éblouis par la neige, nous n’en étions pas certains.
Une heure après nous arrivâmes à l’endroit où nous devions loger.
Nous y trouvâmes la population glacée d’effroi et sous les armes, car
la nuit d’auparavant les loups et quelques ours s’étaient jetés dans le
village et y avaient porté l’épouvante. Les habitants étaient forcés de
faire le guet nuit et jour, mais surtout la nuit, pour défendre leur
bétail et se défendre eux-mêmes.
Le lendemain notre guide était si mal et ses membres si enflés par
l’apostème de ses deux blessures, qu’il ne put aller plus loin. Là nous
fûmes donc obligés d’en prendre un nouveau pour nous conduire à
Toulouse, où nous ne trouvâmes ni neige, ni loups, ni rien de
semblable, mais un climat chaud et un pays agréable et fertile.
Lorsque nous racontâmes notre aventure à Toulouse, on nous dit que
rien n’était plus ordinaire dans ces grandes forêts au pied des
montagnes, surtout quand la terre était couverte de neige. On nous
demanda beaucoup quelle espèce de guide nous avions trouvé pour
oser nous mener par cette route dans une saison si rigoureuse, et on
nous dit qu’il était fort heureux que nous n’eussions pas été tous
dévorés.
Au récit que nous fîmes de la manière dont nous nous étions
placés avec les chevaux au milieu de nous, on nous blâma
excessivement, et on nous affirma qu’il y aurait eu cinquante à gager
contre un que nous eussions dû périr ; car c’était la vue des chevaux
qui avait rendu les loups si furieux : ils les considéraient comme leur
proie ; qu’en toute autre occasion ils auraient été assurément effrayés
de nos fusils ; mais, qu’enrageant de faim, leur violente envie
d’arriver jusqu’aux chevaux les avait rendus insensibles au danger, et
si, par un feu roulant et à la fin par le stratagème de la traînée de
poudre, nous n’en étions venus à bout, qu’il y avait gros à parier que
nous aurions été mis en pièces ; tandis que, si nous fussions
demeurés tranquillement à cheval et eussions fait feu comme des
cavaliers, ils n’auraient pas autant regardé les chevaux comme leur
proie, voyant des hommes sur leur dos. Enfin on ajoutait que si nous
avions mis pied à terre et avions abandonné nos chevaux, ils se
seraient jetés dessus avec tant d’acharnement que nous aurions pu
nous éloigner sains et saufs, surtout ayant en main des armes à feu et
nous trouvant en si grand nombre.
Pour ma part, je n’eus jamais de ma vie un sentiment plus profond
du danger ; car, lorsque je vis plus de trois cents de ces bêtes
infernales, poussant des rugissements et la gueule béante, s’avancer
pour nous dévorer, sans que nous eussions rien pour nous réfugier ou
nous donner retraite, j’avais cru que c’en était fait de moi.
N’importe ! je ne pense pas que je me soucie jamais de traverser les
montagnes ; j’aimerais mieux faire mille lieues en mer, fussé-je sûr
d’essuyer une tempête par semaine.
Rien qui mérite mention ne signala mon passage à travers la
France, rien du moins dont d’autres voyageurs n’aient donné le récit
infiniment mieux que je ne le saurais. Je me rendis de Toulouse à
Paris ; puis, sans faire nulle part un long séjour, je gagnai Calais, et
débarquai en bonne santé à Douvres, le 14 janvier, après avoir eu une
âpre et froide saison pour voyager.
J’étais parvenu alors au terme de mon voyage, et en peu de temps
j’eus autour de moi toutes mes richesses nouvellement recouvrées,
les lettres de change dont j’étais porteur ayant été payées
couramment.
Mon principal guide et conseiller privé ce fut ma bonne vieille
veuve, qui, en reconnaissance de l’argent que je lui avais envoyé, ne
trouvait ni peines trop grandes ni soins trop onéreux quand il
s’agissait de moi. Je mis pour toutes choses ma confiance en elle si
complètement, que je fus parfaitement tranquille quant à la sûreté de
mon avoir ; et, par le fait, depuis, le commencement jusqu’à la fin, je
n’eus qu’à me féliciter de l’inviolable intégrité de cette bonne
gentlewoman.
J’eus alors la pensée de laisser mon avoir à cette femme, et de
passer à Lisbonne, puis de là au Brésil ; mais de nouveaux scrupules
2
religieux vinrent m’en détourner . — Je pris donc le parti de
demeurer dans ma patrie, et, si j’en pouvais trouver le moyen, de me
3
défaire de ma plantation .
Dans ce dessein j’écrivis à mon vieil ami de Lisbonne. Il me
répondit qu’il trouverait aisément à vendre ma plantation dans le
pays ; mais que, si je consentais à ce qu’au Brésil il l’offrit en mon
nom aux deux marchands, les survivants de mes curateurs, que je
savais fort riches, et qui, se trouvant sur les lieux, en connaissaient
parfaitement la valeur, il était sûr qu’ils seraient enchantés d’en faire
l’acquisition, et ne mettait pas en doute que je ne pusse en tirer au
moins 4 ou 5000 pièces de huit.
J’y consentis donc et lui donnai pour cette offre mes instructions,
qu’il suivit. Au bout de huit mois, le bâtiment étant de retour, il me fit
savoir que la proposition avait été acceptée, et qu’ils avaient adressé
33 000 pièces de huit à l’un de leurs correspondants à Lisbonne pour
effectuer le paiement.
De mon côté je signai l’acte de vente en forme qu’on m’avait
expédié de Lisbonne, et je le fis passer à mon vieil ami, qui
4
m’envoya des lettres de change pour 32 800 pièces de huit , prix de
2 Voir à la Dissertation religieuse.
3 Ce paragraphe et le fragment que nous renvoyons à la Dissertation ont été
supprimés dans une édition contemporaine où l’on se borne au rôle de
traducteur fidèle.
4 La pièce de huit ou de huit testons, dont il a souvent été parlé dans le cours de
cet ouvrage, est une pièce d’or portugaise valant environ 5 Fr. 66 cent.
ma propriété, se réservant le paiement annuel de 100 moidores pour
5
lui, et plus tard pour son fils celui viager de 50 moidores , que je leur
avais promis et dont la plantation répondait comme d’une rente
inféodée. — Voici que j’ai donné la première partie de ma vie de
fortune et d’aventures, vie qu’on pourrait appeler une marqueterie de
la Providence, vie d’une bigarrure telle que le monde en pourra
rarement offrir de semblable. Elle commença follement, mais elle
finit plus heureusement qu’aucune de ses circonstances ne m’avait
donné lieu de l’espérer.
5 Le moidores que les Français nomment noror et les Portugais nordadouro, est
aussi une pièce d’or qui vaut environ 33 fr. 96 cent. P. B.
Les deux neveux
On pensera que, dans cet état complet de bonheur, je renonçai à
courir de nouveaux hasards, et il en eût été ainsi par le fait si mes
alentours m’y eussent aidé ; mais j’étais accoutumé à une vie
vagabonde : je n’avais point de famille, point de parents ; et, quoique
je fusse riche, je n’avais pas fait beaucoup de connaissances. — Je
m’étais défait de ma plantation au Brésil : cependant ce pays ne
pouvait me sortir de la tête, et j’avais une grande envie de reprendre
ma volée ; je ne pouvais surtout résister au violent désir que j’avais
de revoir mon île, de savoir si les pauvres Espagnols l’habitaient, et
6
comment les scélérats que j’y avais laissés en avaient usé avec eux .
Ma fidèle amie la veuve me déconseilla de cela, et m’influença si
bien que pendant environ sept ans elle prévint mes courses lointaines.
Durant ce temps je pris sous ma tutelle mes deux neveux, fils d’un de
mes frères. L’aîné ayant quelque bien, je l’élevai comme un
gentleman, et pour ajouter à son aisance je lui constituai un legs
après ma mort. Le cadet, je le confiai à un capitaine de navire, et au
bout de cinq ans, trouvant en lui un garçon judicieux, brave et
entreprenant, je lui confiai un bon vaisseau et je l’envoyai en mer. Ce
jeune homme m’entraîna moi-même plus tard, tout vieux que j’étais,
dans de nouvelles aventures.
Cependant je m’établis ici en partie, car premièrement je me
mariai, et cela non à mon désavantage ou à mon déplaisir. J’eus trois
enfants, deux fils et une fille ; mais ma femme étant morte et mon
6 Dans l’édition où l’on se borne au rôle de traducteur fidèle, les cinq
paragraphes, à partir de : J’eus alors la pensée…, jusqu’à : ma fidèle amie la
veuve…, ont été supprimés. P. B.
neveu revenant à la maison après un fort heureux voyage en Espagne,
mes inclinations à courir le monde et ses importunités prévalurent, et
m’engagèrent à m’embarquer dans son navire comme simple
négociant pour les Indes-Orientales. Ce fut en l’année 1694.
Dans ce voyage je visitai ma nouvelle colonie dans l’île, je vis
mes successeurs les Espagnols, j’appris toute l’histoire de leur vie et
celle des vauriens que j’y avais laissés ; comment d’abord ils
insultèrent les pauvres Espagnols, comment plus tard ils
s’accordèrent, se brouillèrent, s’unirent et se séparèrent, et comment
à la fin les Espagnols furent obligés d’user de violence ; comment ils
furent soumis par les Espagnols, combien les Espagnols en usèrent
honnêtement avec eux. C’est une histoire, si elle était écrite, aussi
pleine de variété et d’événements merveilleux que la mienne, surtout
aussi quant à leurs batailles avec les Caribes qui débarquèrent dans
l’île, et quant aux améliorations qu’ils apportèrent à l’île elle-même.
Enfin, j’appris encore comment trois d’entre eux firent une tentative
sur la terre ferme et ramenèrent cinq femmes et onze hommes
prisonniers, ce qui fit qu’à mon arrivée je trouvai une vingtaine
d’enfants dans l’île.
J’y séjournai vingt jours environ et j’y laissai de bonnes