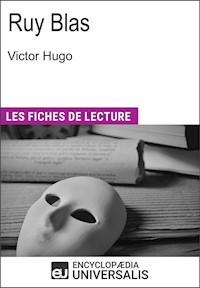
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis !
Ruy Blas est une pièce en cinq actes et en alexandrins de Victor Hugo (1802-1885), créée à Paris, au théâtre de la Renaissance – inauguré pour l'occasion – le 8 novembre 1838, soit huit ans après la « bataille d'Hernani ». Huit années durant lesquelles le drame romantique s'est peu à peu imposé, bénéficiant notamment de l'engouement populaire pour le mélodrame, dont l'acteur fétiche, Frédérick Lemaître, se voit confier ici le rôle-titre. Au succès public répondent, comme pour les pièces précédentes de l'auteur, les réserves voire les attaques de la critique, que résume cette formule de Gustave Planche dans La Revue des Deux Mondes : « Si Ruy Blas était applaudi, il faudrait proclamer la ruine de la poésie dramatique »... Jouée régulièrement jusqu'en 1851, la pièce sera interdite, comme toute l'œuvre théâtrale de Hugo, durant le second Empire et l'exil de l'auteur.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Ruy Blas de Victor Hugo.
À PROPOS DE L'ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341012102
© Encyclopædia Universalis France, 2022. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/ Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Ruy Blas, Victor Hugo (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
RUY BLAS, Victor Hugo (Fiche de lecture)
Ruy Blasest une pièce en cinq actes et en alexandrins de Victor Hugo (1802-1885), créée à Paris, au théâtre de la Renaissance – inauguré pour l’occasion – le 8 novembre 1838, soit huit ans après la « bataille d’Hernani ». Huit années durant lesquelles le drame romantique s’est peu à peu imposé, bénéficiant notamment de l’engouement populaire pour le mélodrame, dont l’acteur fétiche, Frédérick Lemaître, se voit confier ici le rôle-titre. Au succès public répondent, comme pour les pièces précédentes de l’auteur, les réserves voire les attaques de la critique, que résume cette formule de Gustave Planche dans La Revue des Deux Mondes : « Si Ruy Blas était applaudi, il faudrait proclamer la ruine de la poésie dramatique »... Jouée régulièrement jusqu’en 1851, la pièce sera interdite, comme toute l’œuvre théâtrale de Hugo, durant le second Empire et l’exil de l’auteur. Elle ne sera reprise qu’en 1872, entrera à la Comédie-Française en 1879, avec, pour la première représentation, les deux comédiens les plus fameux de l’époque – Mounet-Sully et Sarah Bernhardt. Depuis, elle n’a plus guère cessé d’être montée. Elle a notamment fait l’objet de deux adaptations, assez libres parmi lesquelles une version télévisée, très picturale, de Jacques Weber, avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet et Weber lui-même (Ruy Blas) et celle, franchement comique, de Gérard Oury, avec Yves Montand et Louis de Funès pour le cinéma en 1971 (La Folie des grandeurs).
1. Le « ver de terre amoureux d’une étoile »
Acte I. À la cour d’Espagne, sous le règne de Charles II (1665-1700), Don Salluste de Bazan, ministre tout-puissant, cherche à se venger de la Reine qui vient de le condamner à l’exil pour avoir séduit, engrossé et refusé d’épouser l’une de ses suivantes. Il compte pour cela monnayer les services de son propre cousin, Don César de Bazan, aristocrate devenu vagabond et bandit sous le nom de Zafari. En homme d’honneur malgré sa déchéance, celui-ci refuse le marché. Le laquais de Don Salluste, Ruy Blas, que Don César a connu autrefois et que la pauvreté a contraint à cette dégradante fonction, lui avoue qu’il est secrètement amoureux de la Reine. Don Salluste, qui a tout entendu, monte alors une machination. Il contraint Ruy Blas à s’engager à le servir en toute occasion et lui fait écrire une lettre, adressée de sa part à une femme qu’il nomme sa « reine », et signée du nom de César. Puis il fait enlever Don César, et lui substitue Ruy Blas, qu’il présente à la Cour comme son cousin revenu du Pérou, avec l’ordre de devenir l’amant de la Reine.
Acte II. Allemande isolée à la Cour d’Espagne, épouse délaissée par le Roi, jeune femme poursuivie par les assiduités du vieux Don Guritan, la Reine songe à l’inconnu qui dépose chaque jour sur un banc ses fleurs préférées, ce « César » qui lui a fait parvenir une lettre d’amour. Lorsque Ruy Blas se présente à elle sous ce nom comme nouvel écuyer du Roi, elle ne peut cacher son trouble. Don Guritan s’en aperçoit et, jaloux, provoque Ruy Blas en duel. Mise au courant, la Reine trouve le moyen d’éloigner le danger.
Acte III. Six mois plus tard, Ruy Blas alias Don César est devenu Premier ministre. Dans une longue tirade, il accable de reproches les autres ministres, coupables à ses yeux de sacrifier le destin de l’Espagne à leurs intérêts personnels. La Reine, pleine d’admiration, lui déclare son amour et souhaite lui confier le pouvoir. Mais le bonheur de Ruy Blas est de courte durée : survient Don Salluste, déguisé en valet, qui lui rappelle son serment de soumission et le menace, s’il refuse de lui obéir, de révéler à la Reine sa véritable identité.
Acte IV. Tout l’acte constitue une parenthèse burlesque avec le retour inopiné du véritable Don César, qui a échappé à ses ravisseurs. Plongé dans une situation qu’il ne comprend pas mais à laquelle il s’adapte avec désinvolture, il reçoit successivement un laquais qui lui remet une somme d’argent, qu’il s’empresse de faire distribuer aux pauvres, une entremetteuse chargée d’organiser une entrevue avec une belle inconnue (il s’agit de la Reine), Don Guritan qui le provoque en duel et qu’il tue, Don Salluste enfin, qu’il croit pouvoir démasquer mais qui parvient à le faire emprisonner...
Acte V. La Reine vient rejoindre Ruy Blas, répondant au billet que Don Salluste lui avait fait rédiger au début de la pièce. Celui-ci apparaît alors pour accomplir sa vengeance : soit la Reine renonce au trône pour suivre le faux Don César, soit il révèle qu’elle trompe le Roi. Ruy Blas avoue alors sa véritable identité, tue Don Salluste, puis s’empoisonne. Désespérée, la Reine lui pardonne, l’appelant enfin par son vrai nom : Ruy Blas.
2. « Une monarchie va s’écrouler »
On tient généralement Ruy Blas pour le dernier grand drame romantique, et il se pourrait bien qu’il en soit aussi comme un condensé. La pièce semble en effet reprendre en les accentuant les grands principes énoncés dans la célèbre préface que Victor Hugo a donnée à son Cromwell (1827) : affranchissement des règles classiques, mélange des genres et des registres, ancrage historique et géographique, libération prosodique enfin. Tout cela dans un souci de naturel et de réalisme.
Le premier point paraît acquis en 1838 et il n’en est, significativement, plus question dans la préface, qui s’abstient de justifier l’allongement et les ellipses temporelles (un mois entre les actes I et II, six entre les actes II et III), ou la multiplication des lieux. Les bienséances elles-mêmes ont été allègrement bousculées par le mélodrame et le vaudeville, et c’est plutôt, ironiquement, au nom même de la vraisemblance que les critiques viseront l’histoire d’amour entre un laquais et une reine.
Le deuxième principe est au cœur de la dramaturgie et de la poétique de Ruy Blas. Déclinant une trinité certes rhétorique – il existe « trois espèces de spectateurs » : les femmes, les penseurs, la foule ; d’où trois demandes : les émotions, les méditations, les sensations ; et trois « réponses » : la passion, les caractères, l’action –, Hugo rappelle sa définition du drame comme art théâtral « total », englobant Molière et Racine et se réclamant de Shakespeare, autrement dit tenant « de la tragédie par la peinture des passions et de la comédie par la peinture des caractères ».
La structure de la pièce, qui assigne à chacun des quatre premiers actes un personnage particulier (successivement Don Salluste, la reine d’Espagne, Ruy Blas et Don César), avant la synthèse du cinquième (« le tigre et le lion »), repose sur une alternance de tragique et de comique ou, pour mieux dire, de sublime et de grotesque. Ce dernier registre, incarné par le truculent Don César, peut même occuper tout un acte : le quatrième. Et, comme pour varier encore les tons et les niveaux, Hugo n’hésite pas à faire appel aux ressorts du mélodrame : vengeance, machination, enlèvement, déguisements, cachettes, duels...
La libération de « ce grand niais d’alexandrin », déstructuré jusqu’aux limites de la prose, comme l’appel à des ressources lexicales puisées tout autant dans le vocabulaire solennel et hiératique de la tragédie classique que dans celui, trivial, de la langue commune voire populaire, participent à cette révolution esthétique.
Enfin, en revisitant la Cour d’Espagne huit ans après Hernani, l’auteur ancre sa pièce, au-delà du pittoresque et de la couleur locale, dans un contexte historique et politique : celui d’une crise de la monarchie, en écho à celle que connaît la France de 1838, dix ans avant son effondrement définitif. Faiblesse et effacement du Roi, cupidité et égoïsme des ministres, bassesse et cruauté des Grands... Hugo, qui n’a pas encore opéré sa mue républicaine, en appelle moins ici à une remise en cause de la royauté qu’il n’exprime la nostalgie d’une supposée « vraie » noblesse, indépendante du sang, incarnée ici par Ruy Blas. Et lorsqu’il écrit dans la Préface : « Le sujet philosophique de Ruy Blas c’est le peuple aspirant aux régions élevées », il a sans doute davantage en tête le souvenir idéalisé de Napoléon Bonaparte que celui des sans-culottes de 1789 ! Sur la réussite ou l’échec de cette aspiration, le dénouement maintient l’ambiguïté : Ruy Blas meurt, mais son nom est prononcé et il est reconnu pour ce qu’il est. Son « assomption », amorcée mais interrompue, s’accomplira avec Jean Valjean et la révolution de 1848 !
Le système des personnages s’articule en grande partie autour de cette opposition entre vraie et fausse aristocratie, sous la forme de couples antithétiques : Don Salluste vs Don César (noblesse de rang vs noblesse de l’âme), Ruy Blas vs Don Salluste (fragilité et pureté vs





























