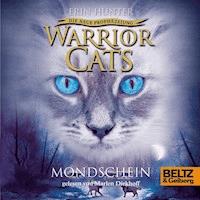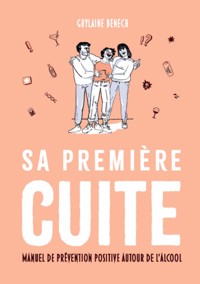
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
En France, nous produisons de bons vins, mais lorsqu’il s’agit de faire de la prévention, nous ne sommes pas des champions.
Résultat : nos ados prennent leur première cuite en moyenne à 15 ans, ce qui est bien trop tôt. À cet âge, leur cerveau est en pleine maturation, et l’alcool est particulièrement nocif. Ce livre invite les parents, les grands-parents et tous les adultes ayant la responsabilité d’éduquer un enfant ou un adolescent, à adopter une nouvelle posture éducative, plus soucieuse de prévention.
Dans un langage accessible et souvent drôle,
Guylaine Benech expose les méthodes les plus efficaces pour accompagner nos jeunes et leur parler sans tabou d’alcool. Elle présente les données issues de la recherche scientifique internationale, pour nous aider à préparer au mieux nos enfants à leur future vie d’adulte.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Titulaire d’un DEA en sociologie et d'un master en conseil et gestion publique,
Guylaine Benech est consultante formatrice. Elle a vécu au Québec, où elle s’est initiée aux approches nord-américaines en santé publique. Aujourd’hui, elle vit et travaille en Bretagne.
Spécialiste reconnue au niveau national, elle forme et accompagne les professionnels à la mise en oeuvre de programmes de prévention. Elle intervient auprès d’étudiants, anime des ateliers en entreprise et donne des conférences participatives auprès du grand public.
Impliquée dans des associations de soutien à la parentalité, elle est maman de trois enfants. "Sa première cuite" est son troisième livre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sa première cuite
Manuel de prévention positive autour de l’alcool
De la même autrice
Les Ados et l’alcool. Comprendre et agir. Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2019.
Les Jeunes et l’alcool. Dunod, 2013.
© 2024 Guylaine Benech
Tous droits réservés pour tous pays
Le photocopillage met en danger l’équilibre économique des circuits du Livre. Toute reproduction, même partielle, à usage collectif de cet ouvrage est strictement interdite sans autorisation de l’autrice (loi du 11 mars 1957, code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992).
Design graphique & illustrations : G. Benech & Mai-liên Nguyen Duy
Édition : Benech G. (EI)
Et dis donc Éditions ≈ ABACom
90 bis rue de Fougères 35700 Rennes
Couverture :
Conception : Brut de pomme.
Photographie : Mélanie Janin.
Illustration : Mai-liên Nguyen Duy
Corrections & mise en page : Maxime Taffin (Le Ciseleur de Prose)
www.sapremierecuite.fr
ISBN : 978-2-38625-360-7
PNB : 978-2-38625-361-4
Guylaine Benech
Sa première cuite
Manuel de prévention positive autour de l’alcool
Préface
L'ouvrage de Guylaine Benech, que vous tenez entre vos mains, est certainement l’un des plus originaux et des plus utiles du genre. Chaque parent peut le consulter pour comprendre, faire face et réagir le mieux possible dans différentes situations du quotidien. Il aide notamment à appréhender ce qui se joue derrière le comportement de transgression d'un ado qui, un jour, consomme de l'alcool jusqu'à l'ivresse alors que jusque-là, enfant, il écoutait les conseils de prudence des adultes.
La rencontre de l'ado, fille ou garçon, avec l'alcool est celle d'une personnalité qui se construit, qui se cherche, parfois dans la douleur, avec un produit, une drogue, hautement disponible et trop souvent banalisé, voire valorisé. Les parents s'inquiètent, à juste titre, soucieux de protéger leur enfant qui prend des risques, une prise de risques tout à fait normale à cet âge, puisque l’ado apprend de ses erreurs. Mais leur inquiétude ravive aussi souvent le souvenir de ce qu’ils ont vécu au même âge. Ce regard en arrière leur fait parfois prendre conscience des risques qu'ils ont pris eux-mêmes et qu'ils ne souhaiteraient pas que leur ado reproduise.
Si la cuite n'est plus le rite initiatique d’antan, le passage obligé de l'adolescence à l'âge adulte, elle n'en est pas moins fréquente et trouve généralement les parents démunis, peu préparés. Elle n'est souvent qu'un symptôme, un révélateur de ce qui se joue pour l'adulte en devenir et ses futures relations, à jamais différentes, entre lui et ses parents.
Guylaine Benech, dans une approche qu'on pourrait qualifier de panoramique, apporte des réponses à toutes (n'hésitons pas à le dire) les questions que les parents se posent dans ces circonstances. Elle le fait avec ses compétences professionnelles en formation et en prévention, mais aussi avec son expérience personnelle de maman. Elle illustre une approche rigoureusement construite, et solidement référencée sur le plan scientifique, avec des expériences, des anecdotes, des situations concrètes, dans lesquelles chaque parent se reconnaîtra. Mais surtout, elle ne nous laisse pas démunis : ses conseils concrets et étayés, ses analyses des comportements nous guident sur ce qu'il est préférable de faire ou pas dans ces situations. Quels conseils donner à votre ado et avec quelle tonalité, comment informer de manière entendable sur les risques, comment gérer la première demande d'organisation d'une soirée par votre ado, que peut-on/doit-on négocier et comment, quelle attitude avoir en cas de transgression ? Autant de situations fréquentes et concrètes auxquelles tout parent sera confronté et pour lesquelles il trouvera des conseils judicieux.
In fine, Guylaine Benech valorise le rôle des parents, alors qu'ils peuvent se sentir impuissants face à l'éclosion de la personnalité de leur ado et à la pression sociale. Car si cet ouvrage a pour thème central « la première cuite », il va bien au-delà. Guylaine Benech nous propose ici un véritable vade-mecum pour les parents souvent désemparés, qui sera utile en bien d'autres circonstances que la prévention des risques liés à l'alcool. Mais l'intérêt indéniable de cet ouvrage est aussi majoré par le style vif, et toujours empathique pour les parents, de l’autrice, par une bonne dose de vécu, par l'autodérision parfois, par le souci de ne rien négliger, et par la complicité qui s'instaure entre l'autrice et son lecteur.
Bref, commencez à lire, et vous ne vous arrêterez pas !
Merci Guylaine Benech.
Dr Bernard BassetPrésident de l’Association Addictions France
Pr Mickael NaassilaPrésident de la Société Française d'Alcoologie
SOMMAIRE
Partie 1.
Une analyse du rapport des Français à l'alcool (les jeunes ne sont pas les seuls à boire, on est d'accord)
Partie 2.
Ce qui se joue autour de l’alcool durant la petite enfance (vous avez bien lu) et à l’adolescence
Partie 3.
Les raisons pour lesquelles les jeunes Français boivent (et pourquoi votre jeune pourrait être tenté)
Partie 4.
Ce que l'on ne vous a jamais dit sur les effets de l’alcool sur l’organisme et le cerveau de votre ado
Partie 5.
Les neuf règles d’or de l'éducation préventive
Partie 6.
Des conseils pour parler d’alcool avec votre enfant aux différentes étapes de sa vie
Partie 7.
Les messages et attitudes à privilégier pour protéger votre jeune s’il ou elle sort et fait la fête
Partie 8.
Des conseils et des ressources pour vous aider si le comportement de votre jeune vous inquiète
Partie 9.
Des idées pour construire ensemble une société plus préventive et respectueuse de la jeunesse
Avant-propos
Bravo, mais alors vraiment bravo pour votre choix ! Lorsque vous refermerez ce livre, vous ne verrez plus la prévention de la même façon. La consommation d’alcool par les jeunes n’aura plus aucun secret pour vous. Vous serez équipé(e) pour agir efficacement dans la plupart des situations de la vie courante nécessitant une attitude éducative autour de ce produit ô combien présent dans la vie de nos jeunes.
L’idée de cet ouvrage m’est venue lors d’une soirée. Je venais de faire la connaissance d’un couple, parents de trois enfants tout comme moi. Nous discutions à bâtons rompus. Comme la plupart des gens lorsqu’ils découvrent mon métier, Valérie et Stéphane me posaient question sur question à propos de l’alcool. Lui finit par glisser : « Ce serait bien que tu rencontres notre fils Quentin. Tu pourrais le sensibiliser. Avec lui, on est en plein dans le sujet », avant d’ajouter : « Il vient de fêter ses 16 ans, et pour l’occasion, il a pris sa première cuite. C’est un homme, maintenant ! » Son épouse était dubitative : « Je n’ai pas aimé le voir rentrer saoul. Il n’a que 16 ans, c’est encore un gamin. Nous ne savions pas trop comment réagir, alors nous n’avons rien dit. Nous serions mal placés pour lui faire la morale. Il nous voit à l’apéro avec les potes, et côté alcool, Stéphane et moi, on n’est pas les derniers... Enfin, ce qui me rassure, c’est qu’il n’a pas fumé de pétard. C’est déjà ça. » Songeuse, elle ajouta : « Nous faisons confiance à Quentin. Il est raisonnable. Mais avec tout ce que l’on entend, on finit par s’inquiéter. N’importe quoi peut arriver en soirée, une bagarre, un accident. Ça fait peur. On devrait peut-être lui parler. »
Nous avons passé le restant de la soirée à échanger sur ce sujet. Nous avons parlé de l’alcool, ce produit pas comme les autres, si présent dans nos familles, et dont on ne peut s’étonner qu’il séduise nos ados. Ils m’ont, l’un et l’autre, raconté leur première cuite, leur enfance, les fêtes de famille avinées, l’accident de voiture d’un cousin de Valérie, mort sur le coup à 24 ans. Nous avons évoqué les difficultés que nous rencontrions, eux comme moi, dans notre rôle éducatif. Nous, parents, sommes parfois désarmés face au comportement de nos ados. Nous avons besoin de repères, de conseils, d’informations. Ceci est valable dans bien des domaines, et en matière de prévention autour de l’alcool particulièrement. Plus tard, sur le chemin du retour, je repensais aux inquiétudes de Valérie et Stéphane. Ces questions qu’ils m’avaient posées, des centaines de parents me les avaient posées avant eux. Les parents avec lesquels je travaille, ceux que je forme ou que je rencontre au sein d’associations, ceux qui viennent à mes conférences, mes amis, les amis d’amis… Peu importe leur niveau d’études ou leur statut social, ils ont en commun de s’inquiéter à l’idée que leur enfant puisse un jour être tenté par l’alcool et l’ivresse. Leurs interrogations sont nombreuses.
Ces questions sont légitimes. Les adolescents français consomment trop d’alcool. À 11 ans, nos enfants sont deux fois plus nombreux que la moyenne des ados européens à avoir déjà bu. Ils prendront leur première cuite, en moyenne, à l’âge de 15 ans. À 17 ans, 44 % d’entre eux s’alcooliseront fortement (5 verres ou plus) au moins une fois par mois. Les alcoolisations adolescentes ne sont jamais anodines. Elles présentent des risques élevés à court, moyen et long termes. Face à cela, les adultes sont démunis. Pourtant, des solutions existent. Nous avons plusieurs décennies de recul. Nous disposons d’un corpus de connaissances scientifiques solides sur lequel nous reposer pour faire de la prévention alcool efficace. Les recherches nous permettent de distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Nous connaissons les attitudes et les discours à privilégier avec les jeunes. Nous savons quels sont les écueils à éviter et les discours contre-productifs. Nous connaissons parfaitement les mesures simples, mais efficaces, que l’État pourrait mettre en place pour protéger la jeunesse. Le grand public, malheureusement, n’a pas accès à ces informations, ou alors partiellement. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’écrire ce livre. Pour partager avec vous ce que nous, professionnels de la prévention, savons.
Plusieurs pays, comme l’Islande, la Suède, la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis, ont réussi à faire baisser sensiblement la consommation d’alcool de leurs ados. De grands programmes de prévention y sont déployés pour informer les familles et aider tous les adultes à améliorer leurs attitudes éducatives et préventives. Nous n’avons rien de tel en France. Et nous sentons bien que quelque chose cloche. Une petite voix nous dit qu’il serait bon, individuellement et collectivement, de faire davantage de prévention sur l’alcool. Nous savons qu’il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique. 41 000 morts par an, ce n’est pas rien. Le problème, c’est que nous avons de mauvais souvenirs des actions de prévention de notre époque. Les leçons de morale, les messages alarmistes et tout le tintouin, très peu pour nous. Si la prévention consiste à faire peur à notre jeune et à l’infantiliser inutilement, alors pas question. Rassurez-vous. J’ai autre chose à vous proposer : une prévention positive, fun, constructive, parfois amusante, toujours galvanisante. Cette discipline a tant à nous apprendre sur nous-mêmes et sur les autres. Les chercheurs du monde entier font chaque semaine des découvertes inouïes, surprenantes, inattendues, révoltantes et parfois cocasses.
Nous verrons que nous intéresser à la prévention alcool, c’est d’abord s’intéresser à ce qui nous rassemble, nous les êtres humains : nos émotions, nos désirs, nos craintes et notre besoin immense d’aimer et d’être aimé. Car l’alcool agit sur les émotions. On dit de lui qu’il est un « lubrifiant social », qu’il rapproche. Mais nous savons aussi qu’il détruit, brise, sépare. Comme l’alcool agit sur le corps, et notamment sur le cerveau, nous devrons nous intéresser à la biologie et aux neurosciences. C’est même essentiel, car le cerveau des adolescents est beaucoup plus vulnérable que celui d’un adulte. Dans cette tranche d’âge, les effets neurotoxiques de l’alcool sont extrêmement dommageables. Une cuite à 15 ans n’a rien de comparable avec une cuite à 45 ans ! Nous serons amenés à interroger plusieurs aspects de notre société, parmi lesquels notre système économique et nos institutions politiques. Notre rôle d’éducateur consiste aussi, malheureusement, à protéger notre enfant de certaines influences sociétales et marchandes délétères, pour faire de lui un citoyen libre, critique et avisé.
Cette approche de la prévention devrait vous plaire. Personnellement, elle me passionne. Pour écrire ce livre, j’ai mobilisé mon expertise professionnelle, mon cœur de maman et ma conscience citoyenne. Il ne sera question ni de leçon de morale, ni de scénario catastrophe, ni d’appel à la prohibition. Ces choses sont inutiles en prévention. Ce qui fonctionne et protège nos enfants, c’est l’amour et le respect, c’est le lien que nous construisons avec eux, les compétences positives que nous les aidons à acquérir, le cadre sécurisant que nous posons et, bien entendu, les informations rigoureuses et honnêtes que nous leur transmettons.
Vous pouvez lire Sa première cuite dans l’ordre, du début à la fin, ou bien aléatoirement, en piochant dedans selon vos préoccupations du moment. Chaque petite idée clé (il y en a 100) peut se lire indépendamment des autres. J’utilise le symbole (→) pour vous signaler que la thématique traitée est développée dans une autre idée. La table des matières détaillée se trouve à la fin du livre. Avec la version ebook du livre vous pourrez accéder, grâce à des hyperliens, à l’ensemble des articles, références et autres ressources.
Pour des raisons de confidentialité, j’ai modifié les contextes dans lesquels se sont déroulés certains des évènements dont je rends compte, ainsi que les prénoms des protagonistes.
Le livre se poursuit sur Internet, à l’adresse sapremierecuite.fr.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Retrouvez tous les exercices du livre, en version enrichie, dans le Cahier de travaux pratiques téléchargeable gratuitement sur sapremierecuite.fr.
Avant de commencer
Tout au long de votre lecture, vous serez invité(e) à réaliser de courts exercices. L’idée est de vous aider à aller plus loin dans votre réflexion personnelle par la pratique. Je vous suggère de vous procurer soit un carnet dans lequel vous noterez vos réponses et vos observations, soit le livret Cahier de travaux pratiques, disponible sur sapremierecuite.fr.
Vous êtes prêt(e) ? Prenez une feuille et un crayon. Notez la date du jour. La consigne est simple : terminez mes phrases. Ne réfléchissez pas trop. Répondez spontanément.
1. Voici ce qui me vient à l’esprit lorsque je pense à la thématique « les jeunes et l’alcool en France »………………………………………………….
2. À mon époque, les jeunes buvaient de l’alcool pour…………………….
3. Aujourd’hui, les jeunes boivent de l’alcool pour………………………….
4. Ce qui a changé en l’espace d’une génération, c’est……………………..
5. La question que je me pose sur les jeunes et l’alcool, c’est……………
6. Si j’imagine mon enfant (ou un jeune de mon entourage) complètement ivre, je me sens……………………………………………………….
7. En prévention, je voudrais savoir comment m’y prendre concrètement pour ………………………………………………………………………
8. Ce que je voudrais que mon enfant sache à propos de l’alcool………
Dessinez, sur une feuille libre ou dans votre cahier de travaux pratiques, l’image qui vous vient à l’esprit suite à l’exercice que vous venez de faire.
Partie 1
La France, l’alcool et nous
1. L’apéro est un sport national français
Je me suis bien intégré en France parce que j’aime bien l’alcool.Guillermo Guiz
L’apéritif est un sport national français, nul ne me contredira. Certaines régions seraient plus sportives que d’autres. Je préfère ne pas entrer dans la polémique. Une chose est certaine : du nord au sud, d’est en ouest, en montagne comme dans les îles, les visages s’illuminent lorsque sonne l’heure de l’apéro.
L’apéritif est une pratique plébiscitée dans l’hexagone. Seuls 8 % des adultes n’en prennent jamais1. Près d’un Français sur deux déclare en prendre au moins une fois par semaine. Le lieu idéal pour prendre l’apéro est à la maison (70 %) ou chez des amis (48 %). Un apéritif sur trois se déroule en famille, réunissant parfois plusieurs générations. Les enfants sont souvent de la fête. En général, ils apprécient ces moments durant lesquels les adultes manifestent le plaisir d’être ensemble. Avez-vous déjà demandé à un enfant d’âge scolaire ce qu’est un apéro ? Faites l’expérience. Demandez-lui ce que font les adultes. Interrogez-le sur les boissons servies. Vous découvrirez sans doute qu’il fait déjà la différence entre les types d’alcools. Il vous expliquera peut-être que les mamans boivent plutôt du rosé, tandis que les papas préfèrent la bière. Certains enfants expliquent que les adultes sont plus joyeux que d’ordinaire lorsqu’ils boivent de l’alcool. D’autres, à l’inverse, diront que l’alcool rend les adultes méchants, voire violents.
Je connais des enfants de 8 ans pour qui la recette du mojito n’a aucun secret. Ils participent à la fête en sirotant le leur, sans alcool bien sûr, et grâce à ce « Virgin mojito » ils s’amusent à imiter les adultes. Jouer à boire de l’alcool pour de faux plaît généralement beaucoup aux enfants.
Jouer à en boire pour de vrai plaît généralement beaucoup aux adultes. Un sondage IFOP révèle que ce qui a le plus manqué aux Français durant le premier confinement de 2020, en deuxième position après les balades de plus d’une heure, c’est « la possibilité de prendre un apéritif physique avec des amis2 ». L’apéro nous aurait davantage manqué que les voyages, le cinéma, le théâtre et même les concerts et les matchs de foot.
Une règle implicite veut que l’on boive de l’alcool à l’apéro. Refuser une boisson alcoolisée est parfois mal vu. On vous demandera si vous êtes malade, enceinte, ancien alcoolique ou bien si votre religion vous interdit de boire. La présence de vos enfants ne changera pas grand-chose. Il y aura toujours quelqu’un pour sous-entendre devant eux que ne pas boire d’alcool est bizarre. Il faut dire que nous sommes presque tous consommateurs. La petite minorité de Français ne buvant pas (13 %) a de quoi se sentir marginalisée.
Vous le savez, l’apéro n’est pas le seul moment où nous buvons de l’alcool. À vrai dire, nous buvons dès que l’occasion se présente. Et les occasions ne manquent pas. Nous buvons aux pots de départ à la retraite, en discothèque, en festival, lors de rendez-vous galants, à la signature de contrats, aux mariages, aux baptêmes et même aux enterrements. En mangeant, nous buvons du vin. Tout cela mis bout à bout, ça fait beaucoup. Nous dépensons chaque année 14 milliards d’euros pour acheter de l’alcool. C’est plus que le trou de la sécu.
À vous de jouer
La prochaine fois que vous prendrez l’apéro ou participerez à une fête de famille, observez la scène avec un regard d’enfant. Mettez-vous dans la peau d’un petit de sept ou huit ans. Que remarquez-vous ?
2. Nous buvons trop (quel scoop)
La bière, la bière, qu'est-ce qu'elle a fait de moi la bière ?Les Garçons bouchers
On me dit souvent : « Vous faites de la prévention alcool à destination des jeunes ! Eh ben, vous en avez du boulot, vous. » Mes interlocuteurs ajoutent immanquablement : « Il faut reconnaître qu’il n’y a pas que les jeunes qui boivent. » Ces personnes ont raison. L’adulte moyen boit trop. La France est le sixième plus gros consommateur d’alcool au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)3. Les Français consomment en moyenne 10,4 litres d’alcool pur par an et par habitant, soit l’équivalent de 2,3 verres standard par jour et par personne. Nous consacrons 10 % de notre budget alimentaire en achat de boissons alcoolisées. S’il vous prenait l’idée saugrenue d’aller au supermarché du coin acheter la consommation annuelle d’un Français, voici ce qu’il vous faudrait inscrire sur votre liste de courses4 :
74 bouteilles de vin
137 bouteilles de bière
9 bouteilles de whisky
Plus d’un Français sur cinq (soit 10 millions de personnes) dépasse les niveaux de consommation d’alcool considérés comme faiblement risqués (→58). Cette moyenne dissimule des disparités. Pami les personnes qui boivent trop, certaines font des excès une ou deux fois par an seulement, lors d’occasions spéciales, tandis que d’autres s’alcoolisent massivement tous les week-ends. Certaines personnes ne boivent qu’un verre ou deux par jour, mais c’est 365 jours par an. Un Français sur dix boit tous les jours. Cette habitude, rarissime chez les jeunes, augmente avec l’âge. 26 % des 65-75 ans ont une consommation quotidienne d’alcool contre 2,3 % des 18-24 ans5. Lorsqu’ils boivent, les jeunes le font plus souvent que nous de manière massive. De là à dire que la cuite est l’apanage de la jeunesse, il y a un pas que je ne franchirai pas : 20 % des 50-64 ans reconnaissent s’être fortement alcoolisés au cours de l’année écoulée. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique que la consommation d’alcool est associée à plus de 60 maladies, sans compter tous les autres dommages (accidents, violences, traumatismes). Les boissons alcoolisées tuent trois millions de personnes par an dans le monde. C’est plus que le sida, le paludisme ou la grippe.
En France, nous payons particulièrement cher notre surconsommation. La mortalité française due à l’alcool dépasse celle des autres pays européens L’alcool tue chaque jour 112 personnes dans notre pays (41 000 morts par an). Si mes calculs sont exacts, entre 1973 et aujourd’hui, l’alcool a tué plus de 2 millions de nos compatriotes. Un Français sur deux a subi au cours des 12 derniers mois des dommages en raison de la consommation d’alcool de tiers, comme par exemple le fait d’avoir été réveillé la nuit, de s’être senti en insécurité dans un lieu public ou d’avoir été agressé physiquement. 40 % des phénomènes de violences intrafamiliales seraient attribuables à l’alcool, incluant des violences faites aux enfants. Pour autant, boire beaucoup n’est pas mal vu. Nous disons de quelqu’un qui lève facilement le coude qu’il est un « bon vivant » ou encore un « boute-en-train ». Les personnes abstinentes, à l’inverse, sont vues comme des « rabats-joies ». Certains considèrent qu’elles « ne savent pas vivre ». Si notre rôle d’éducateur est de présenter à nos enfants un discours cohérent sur ce que signifie « être adulte », alors nous voici bien mal emmanchés. OK, Houston, je crois que nous avons un problème ici.
À vous de jouer
Demandez aux jeunes adultes de votre entourage ce qu’ils pensent de la consommation d’alcool en France. Interrogez-les sur les différences d’usage entre les générations.
3. Avec modération, slogan bidon
C'était un homme si profondément conciliant qu'il ne défendait ses opinions modérées qu'avec une très forte modération. Milan Kundera
Certaines publicités marquent durablement les esprits : « Avant, j’étais moche », « On se lève tous pour Danette », « Gifi, des idées de génies ». Ces messages nous sont familiers. Les entreprises savent qu’une bonne accroche met en confiance le consommateur. Le meilleur slogan de tous les temps est sans contexte « À consommer avec modération ».
Personnellement, j’ai longtemps cru qu’il s’agissait d’un message de prévention imposé par le gouvernement, que les marques devaient faire figurer sur leurs publicités. Que nenni. Le seul avertissement sanitaire obligatoire (d'après la loi Évin de 1991) est « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Si les industriels de l’alcool y ajoutent « à consommer avec modération », c’est par choix, car cela permet d’atténuer la dimension anxiogène du mot « dangereux ». Pour ce qui est du business, c’est une idée de génie. Lorsque nous lisons : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération », le message qui s’ancre, inconsciemment, dans notre cerveau et le rassure, c’est « modération6 ». Il existe un antidote au danger : la modération. Si nous sommes invités à consommer (qui plus est, pensons-nous, par les autorités de santé), c’est que le produit n’est pas si dangereux que cela. Quant à savoir ce que signifie concrètement la modération, impossible. Charge à chacun d’y mettre ce qu’il veut (Coluche disait : « un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qui boit autant que vous »). Une étude belge menée auprès de consommateurs d’alcool7 a montré que ces derniers définissent la modération en fonction de leurs propres habitudes, et non en fonction de critères objectifs. Si nous demandons à une personne qui boit un peu tous les jours ce qu’est la modération, elle vous répondra que c’est le fait de boire un peu tous les jours.Les psychologues ont d’ailleurs donné un nom à ce processus qui consiste à caler ses idées sur ses comportements plutôt que l’inverse : le « biais cognitif ».
Vous le savez maintenant, « À consommer avec modération » est un slogan incitant à l’acte d’achat. Certes, me diriez-vous, mais ce slogan ne préconise pas pour autant de se mettre la tête à l’envers. Je vous l’accorde. Le procédé est néanmoins fallacieux, car il laisse à penser au consommateur que boire de l’alcool en quantité modérée est sans danger aucun. Or, c’est faux8. La science a largement démontré que toute consommation d’alcool présente un risque pour la santé. Les études en ce sens sont si nombreuses qu’il faudrait tout un livre pour les présenter. Voici quelques exemples :
Les experts de santé publique13 demandent au gouvernement d’interdire le slogan « À consommer avec modération ». J’ignore s’ils seront écoutés un jour. En attendant, lorsque nous parlons avec notre enfant, mieux vaut bannir de notre vocabulaire cette expression. Disons-lui plutôt que l’alcool est dangereux et que si les adultes en consomment, ils doivent le faire avec précaution.
À vous de jouer
Et pour vous, c’est quoi la modération ? Pouvez-vous en donner une définition précise (nombre de verres, fréquence de consommation ou autre) ? Pensez-vous que ce soit valable pour tout le monde ?
4. Les marques d’alcool ont des projets pour nos enfants
Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Kofi A. Annan
Les Français, en général, et les parents, en particulier, sont très remontés. Ils reconnaissent certes que boire de l’alcool est un choix individuel, néanmoins ils estiment que l’industrie des boissons alcoolisées est en grande partie responsable de l’alcoolisation des adolescents. Ils déplorent l’inaction du gouvernement en matière de prévention.
Un sondage réalisé en 2018 par l’Ipsos révèle que 79 % du grand public et 81 % des parents identifient les producteurs et les distributeurs de boissons alcoolisées comme responsables de l’alcoolisation des jeunes14. Une autre enquête, réalisée cette fois par la Ligue contre le cancer15, montre que les Français jugent que l’État ne fait pas assez de prévention. La majorité (77 %) pense que les producteurs d’alcool exercent une influence sur les pouvoirs publics et presque tous (92 %) souhaitent une meilleure prévention envers les jeunes. Les parents français ont des projets pour leurs enfants. Comme tous les parents de la planète, ils souhaitent que leurs jeunes grandissent en sécurité et deviennent des adultes épanouis, libres et en bonne santé. Mais ils savent que les marques d’alcool ont leur propre projet, lequel consiste à faire de leurs enfants les consommateurs de demain.
Mettons-nous un instant dans la peau d’un professionnel dont la prospérité économique et financière dépend de la vente d’alcool. Imaginons que les personnes nées après 1998 décident, collectivement, de ne plus jamais boire une goutte d’alcool. Que se passerait-il pour lui ? La réponse est simple. Il mettrait la clé sous la porte. La France est dépendante économiquement du marché de l’alcool, qui pèse environ 50 milliards d'euros par an et qui contribue à l’équilibre de sa balance commerciale16. Si la nouvelle génération cessait de boire, ou même si elle décidait simplement de boire deux fois moins que la nôtre, ce serait une catastrophe nationale. Un tsunami économique. Ce n’est pas près de se produire, je vous l’accorde. Mais les industriels de l’alcool restent sur leur garde. La consommation d’alcool des Français a diminué depuis les années 70. Aujourd’hui, elle ne diminue plus, mais les marques ont tout de même besoin de conquérir de nouvelles parts de marché.
Des travaux révèlent que les nouvelles cibles du marketing des boissons alcoolisées sont les jeunes, les femmes et les personnes alcoolodépendantes17. Ce marketing vise même les enfants, jusqu’aux abords de leurs écoles. Nos filles sont doublement concernées, car elles sont et jeunes et femmes. Investir dans la pub et dans le marketing en général (packaging, réseaux sociaux, prix bas pour faciliter l'accès, etc.) est une stratégie payante pour les marques. Le lien entre l’exposition au marketing et le niveau de consommation des jeunes est en effet démontré18. Vous l’aurez compris, nous sommes en présence de deux projets incompatibles. Nos enfants sont au cœur de cette double tension. Il nous faut donc parler d’alcool, très tôt et très régulièrement, avec eux. Si nous ne le faisons pas, d’autres, moins bien intentionnés, le feront à notre place. Nous pouvons les mettre hors d’état de nuire. Je vous dirai comment.
À vous de jouerJe vous invite à une immersion dans l’univers de la marque Desperados. Cette bière aromatisée à la tequila étant très populaire chez les ados, il est utile pour nous de connaître sa philosophie. Rendez-vous sur le site www.desperados.com. Saisissez votre date de naissance pour prouver que vous êtes majeur(e). Si vous ne lisez pas l’anglais, cliquez sur l’option « traduire cette page en français » de votre moteur de recherche. Naviguez. Observez. Ressentez. Prenez des notes.
5. État complice ? Affirmatif
Dans ce contexte, les acteurs publics sont en position de faiblesse face au secteur des boissons alcoolisées, très présent auprès des institutions européennes et nationales. Cour des comptes
Le Président est grave. Ce soir, il s’adresse aux Français. « Mes chers compatriotes, dit-il, notre pays fait face à un drame sanitaire qui affecte directement ou indirectement des millions de nos compatriotes. Aujourd’hui encore, l’alcool a tué 110 personnes en France. Il a également blessé, mutilé, traumatisé, des centaines de personnes. Notre jeunesse est en danger. Cela requiert notre mobilisation générale. » Vous l’avez compris, ce discours n’existe que dans mes rêves. Aucun président sous la Ve République n’a décrété que la prévention alcool serait une priorité de son mandat.
Si nous allions faire un tour au 13 rue Cambon, à Paris ? C’est là que siège la Cour des comptes. Cette instance, c’est un peu le gendarme de l’État. Son rôle est de vérifier si nos dirigeants font leur travail. En 2016, les magistrats de la Cour des comptes entreprennent de réaliser un grand audit de l’action publique sur le dossier alcool. Ils analysent la littérature scientifique, rencontrent des experts français et étrangers, tiennent des auditions, puis restituent le fruit de leur travail dans un volumineux rapport. Celui-ci est accablant pour l’État. On y apprend que les gouvernements successifs ont refusé d’adopter les mesures que l’on sait efficaces19 et qui auraient permis de faire baisser la consommation d’alcool des adolescents. Dans ce rapport, chaque ministère, ou presque, en prend pour son grade. Regardons, par exemple, ce que les magistrats décrivent concernant l’état de la prévention en milieu scolaire. L’école, rappellent-ils, est dotée d’une mission d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Elle devrait en toute logique s’emparer de la question de l’alcool et mettre en œuvre des programmes de prévention ambitieux. Or, elle ne le fait pas. Des programmes de prévention scientifiquement validés existent. Les pouvoirs publics connaissent ces programmes et, pourtant, aucun n’est déployé à l’échelle nationale. Lorsque des actions sont menées, dans un collège ou un lycée, par exemple, c’est à l’initiative des équipes qui, le plus souvent, font appel à des prestataires externes. Certaines associations font du bon travail, mais elles manquent de moyens. La prévention en milieu scolaire, nous disent les magistrats, est mal organisée, mal coordonnée et sous-financée. Les interventions menées auprès des jeunes ne sont que rarement évaluées, ce qui est très grave. Des recherches prouvent en effet que certaines interventions, de mauvaise qualité, incitent les jeunes à consommer.
La liste des dysfonctionnements recensés par la Cour des comptes est trop longue pour tout énumérer. Sachez toutefois que l’instance dénonce « le caractère ambigu des messages des pouvoirs publics » sur l’alcool ainsi que la présence, à l’intérieur même des instances de la République, de représentants du secteur des boissons alcoolisées (→72). Face à l’inaction des pouvoirs publics, les magistrats se tournent vers les citoyens, c’est-à-dire vers vous et moi, en nous demandant de réagir. Leur rapport se termine en effet par un appel à « une prise de conscience collective de la part des Français ». Depuis 2016, d’autres rapports sont venus confirmer les constats la Cour des comptes20. Les chercheurs et les addictologues publient des tribunes, les associations interpellent les femmes et les hommes politiques. Rien n’y fait. Rien ne bouge. Nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants, dont acte. À nous de nous emparer du dossier. Il s’agit de nos enfants. Nous avons notre mot à dire.
À vous de jouerJe vous propose de visionner la courte vidéo réalisée par la Cour des comptes pour présenter les résultats de son audit. Pour cela, rendez-vous sur la chaîne Dailymotion de la Cour des comptes.
6. Ces campagnes de préventionque vous ne verrez pas
Le lobby de l'alcool a infiltré tout l'appareil d'État de la présidence jusqu'au ministère de la Santé en passant par le Premier ministre. Il influe sur les décisions et en fait, il s'octroie un droit de veto sur les campagnes. On ne peut faire une campagne d'information libre sur l'alcool en France.Dr Bernard Basset21
Je n’aimerais pas travailler au ministère de la Santé, à Santé publique France ou à l’Institut national du cancer. Non que l’ambiance y soit mauvaise. Il m’arrive de croiser, en réunion, des professionnels de ces agences. Ils m’ont tous l’air très sympathiques. Mais je les trouve malmenés. Des journalistes d’investigation se sont en effet intéressés à plusieurs campagnes de prévention, conçues par les spécialistes de ces instances, qui ont mystérieusement disparu des radars. Leur diffusion, révèlent les journalistes, aurait été annulée sur ordre de l’Élysée, sous prétexte qu’elles véhiculaient des messages inadéquats. Adieu affiches, dépliants, spots TV et autre jingles radio. Je plains les concepteurs de ces opérations. Voir le fruit de longs mois de travail partir à la poubelle, ça ne doit pas être agréable. Mais je nous plains encore plus, nous, les citoyens, qui aurions dû voir et entendre ces messages, ainsi que nos enfants, qui auraient dû grandir avec. Allez savoir, l’un des slogans censurés aurait pu devenir culte, qui sait ? Voici des informations sur des campagnes annulées. Si vous avez un ado, discuter de cela avec lui peut être une manière intéressante de le sensibiliser à la fois à la santé et à la vie démocratique (→72).
Ils considèrent que ce visuel « stigmatise le vin ». Ils sont reçus à l’Élysée. La campagne de prévention du cancer disparaît subitement.
Quand la santé publique prend des coups, c’est la démocratie qui prend des coups.
Une campagne a miraculeusement franchi la barrière de la censure. J’aime assez son slogan : « C’est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l’alcool ? La bonne santé n’a rien à voir avec l’alcool28. » De vous à moi : c’est pas un peu absurde de censurer des campagnes de prévention ? Quand la santé publique prend des coups, c’est l’avenir de nos enfants qui prend des coups.
À vous de jouer. Je vous lance un défi.
Si l’occasion se présente, au moment de trinquer, lancez, l’air de rien, la phrase suivante : « C’est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l’alcool ? La bonne santé n’a rien à voir avec l’alcool. » Observez les réactions et profitez-en, pourquoi pas, pour lancer une conversation sur le rapport des Français à l’alcool. Nul doute que le débat sera animé.
Partie 2
Grandir dans une société qui valorise l’alcool
Dans cette partie, nous allons découvrir des choses étonnantes. Vous apprendrez, par exemple, que la Cour de cassation reconnaît officiellement que le célèbre Champomy est un moyen de faire découvrir aux enfants l’univers des vins de Champagne et que ceci profite, à moyen terme, aux viticulteurs de cette région. Dans ces conditions, on pourrait s’attendre à une interdiction de ce qui ressemble fort à une forme de promotion d’une boisson alcoolisée à destination des enfants. Mais non, pensez-vous. La loi française autorise la commercialisation de ce genre de faux alcool pour les petits. Vive la France !
7. Le rapport à l’alcool se construitdès l’enfance
Les enfants commencent à acquérir des connaissances sur l’alcool à l’âge de deux ans. Carmen Voogt et al.
J’étais chez des amis l’autre jour, dans une fête29. Sur une table se trouvaient des coupelles à olives en forme de lettres, posées dans le désordre : A, E, O, P et R. J’observais une fillette qui manipulait ces coupelles. Patiemment, elle tentait de recomposer un mot. Soudain, elle cria victoire en levant les bras : « A-P-E-R-O ! ». Je m’assis à ses côtés : « Regarde, on peut aussi écrire O-P-E-R-A. » Elle me dévisagea, les yeux ronds comme des billes, et me demanda : « Ça veut dire quoi, opéra ? »
Le rapport à l’alcool se construit dès la petite enfance. Une équipe de recherche internationale a procédé à une analyse systématique des travaux publiés dans des revues scientifiques, au niveau mondial, sur ce sujet. Les chercheurs souhaitaient documenter les connaissances des petits sur les boissons alcoolisées et la manière dont les représentations sur l’alcool se construisent dans l’enfance30. Les résultats de l’étude sont édifiants. Ils révèlent qu’un enfant commence à acquérir des connaissances sur l’alcool très tôt, vers l’âge de 2 ans. À 4 ans, il est en mesure de décrire les effets de l’alcool et ce à quoi il faut s’attendre lorsqu’une personne en boit. L’enfant se « fabrique » une image de l’alcool à partir de ce qu’il observe autour de lui. La consommation de ses parents et/ou des autres membres de son entourage contribue, bien entendu, à façonner ses représentations. Les chercheurs ne comprennent cependant pas encore parfaitement comment cela fonctionne, d’autant que des influences extérieures à la famille agissent également sur l’enfant.
Le professeur Laurent Bègue, chercheur en psychologie sociale à l’université de Grenoble, m’a confirmé que les enfants d’âge scolaire savent déjà bien ce qu’est l’alcool. Ils n’ont généralement aucune difficulté à distinguer une boisson qui en contient d’une autre qui n’en contient pas. Ils sont en mesure de décrire les contextes dans lesquels les adultes en consomment, ainsi que les effets de la boisson sur ces derniers. Le psychologue Jean-Pascal Assailly explique pour sa part que les stéréotypes sur l’alcool, c’est-à-dire les représentations qu’un individu se fera de la consommation de ce produit, se construisent très tôt dans l’enfance. Dès l’âge de 7-8 ans, ces stéréotypes sont stables. Plus encore, ils sont prédictifs des consommations à l’âge adulte :« Ces images prototypiques sont construites très précocement dans la vie : les images que les enfants ont des gens qui boivent sont déjà très stables à l’âge de 7 ans, et à partir de 10-11 ans, elles sont prédictives de la consommation d’alcool cinq ans plus tard31. »
Le sujet de l’alcool est un angle mort de notre approche éducative. Au quotidien, nous sommes vigilants lorsqu’il s’agit de violence, de sexualité ou encore de gros mots. Nous essayons de filtrer ce que notre enfant voit et entend. Nous plaçons des « contrôles parentaux » autour de lui. Nous le faisons somme toute assez peu autour de l’alcool, au regard de l’enjeu sanitaire et social qu’il représente pourtant. Si vous ne le faites pas déjà, je vous conseille d’aborder régulièrement le sujet avec votre enfant, même s’il est petit. Je vous propose des manières de faire, concrètement, dans la partie 5.
À vous de jouer
Quand vous étiez petits, les adultes autour de vous buvaient-ils de l’alcool ? Diriez-vous que ce que vous avez vécu et observé durant votre enfance a joué un rôle dans votre rapport à l’alcool, plus tard ?
8. La première gorgée, c’est en famille
Chaque année à Noël c’est la même rengaine. Mes grands-parents m’obligent à boire du champagne. Je déteste ça. Inès, 14 ans
En France, une tradition veut que l’on fasse goûter un peu d’alcool à nos enfants dans les grandes occasions. Il n’est pas rare, dans les mariages par exemple, de voir un petit de moins de 10 ans siroter un fond de champagne dans sa propre flûte, ou bien goûter un peu de vin dans le verre d’un adulte. Voyons ce que la recherche nous apprend à propos de cette pratique.
Les petits Français présentent un niveau d’expérimentation de boissons alcoolisées à 11 ans deux fois plus élevé que dans le reste de l’Europe (32 % contre 15 %)32. À 13 ans, un mineur français sur deux a déjà bu de l’alcool. À 16 ans, presque tous (80 %) l’ont déjà fait33. Nos enfants sont initiés à l’alcool en famille très tôt, parfois même entre 5 et 10 ans. Lorsqu’on les interroge sur les souvenirs qu’ils ont de cette première gorgée d’alcool, les adolescents décrivent une expérience désagréable. Ils expliquent s’être sentis obligés de boire pour faire plaisir aux adultes. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) explique que les petits Français subissent une « injonction familiale de “goûter” […] sous la “pression” des parents, grands-parents, oncles et tantes34. » L’alcool est le seul psychotrope auquel les adultes initient les enfants. Aucun proche ne proposerait à un petit de tirer sur une cigarette (cela se faisait autrefois) ou sur un joint pour « l’intégrer à la fête ». Pourquoi faisons-nous, avec l’alcool, ce qui nous choquerait pour d’autres produits ?
Une équipe de pédiatres américains a interrogé des parents qui servent de l’alcool à leurs enfants pour comprendre leurs motivations. Leurs travaux montrent que leur geste s’explique par une croyance selon laquelle servir de l’alcool à un petit réduirait le risque que celui-ci boive en excès à l’adolescence et à l’âge adulte. Les parents pensent qu’en initiant eux-mêmes leur enfant, celui-ci sera plus apte, le jour venu, à résister à l’influence des copains et à contrôler sa consommation. Les chercheurs font le parallèle avec la vaccination : dans l’imaginaire parental, il serait possible de protéger son enfant en lui « inoculant » une dose d’alcool. Certains adultes, persuadés que l’enfant n’aimera pas le goût de l’alcool, espèrent le « dégoûter » et lui ôter l’envie de tester sans eux ce « fruit défendu ». En France, certains parents font goûter un peu de vin à leur enfant dans l’espoir de lui transmettre une « pratique culturelle » qui serait le gage d’une « consommation responsable » plus tard.
Les adultes qui servent de l’alcool à un enfant pensent donc, en général, le protéger. Malheureusement, c’est une erreur. L’alcool, même à faible dose, est extrêmement toxique pour le cerveau et pour tous les autres organes d’un sujet en phase de croissance. En outre il est démontré que plus un enfant goûte tôt à l’alcool, plus il risque de consommer en excès plus tard. Si l’on en croit le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 41 % des jeunes ayant goûté à une boisson alcoolisée avant l’âge de 15 ans développeront un problème d’alcool plus tard, contre 10 % chez ceux qui ont attendu l’âge de 21 ans pour boire35. Servir de l’alcool à un mineur n’est jamais anodin. En tant que parent, notre rôle est de retarder au maximum le premier contact avec l’alcool (→65). Chaque année gagnée est une petite victoire. Si vous subissez des pressions, lors de fêtes de famille, de la part de personnes qui insistent pour servir de l’alcool à votre enfant contre votre gré, tenez bon. C’est vous le parent. C’est à vous seul d’en décider.
À vous de jouer
Comment ça se passe dans votre famille ? Les adultes font-ils goûter de l’alcool aux enfants, lors des grandes occasions ? Si oui, à partir de quel âge ? Que pensez-vous de cette pratique ? En avez-vous déjà discuté en famille ? Est-ce que tout le monde était d’accord ?
9. Ce que les enfants disent à proposdes boissons alcoolisées
Ils ont entre 7 et 10 ans. Voici ce qu’ils m’ont confié à propos des boissons alcoolisées.
Les adultes, quand ils en boivent, ça leur donne de la joie. Camille, 7 ans.
L’alcool, c’est quelque chose qu’on aime bien quand on est grand. Tom, 8 ans.
Dans ma famille, personne ne boit d’alcool, mais dans les familles de mes copains, les grands boivent de la bière et du vin.Zoé, 9 ans.
Boire de l’alcool ce n’est pas dangereux. C’est juste qu’il ne faut pas être bourré. Les gens bourrés, parfois, ils tombent par terre et ils se font mal. Lilou, 7 ans.
Mon père, c’est celui qui tient le stand avec la tireuse à bière à la fête de l’école. Thomas, 9 ans.
Les bouteilles de vin, ça se collectionne. Mon grand-père, il est collectionneur, il les range dans une armoire spéciale et il note tout dans un carnet. On dirait que pour lui c’est comme un trésor. Noé, 9 ans.
Ma mère, des fois, elle dit qu’elle est pompette. Elle bouge bizarrement et elle parle fort. Ça me gêne pour elle. Suzie, 10 ans.
Mon père, quand il boit avec ses copains, on dirait que ça prend toute la place dans le salon. Je ne sais pas comment expliquer. C’est comme s’il n’y avait plus assez d’air. Et aussi j’ai remarqué qu’il est un peu moins beau quand il boit. Il n’a pas le même regard. Lucia, 7 ans.
Ça ne me dérange pas que les adultes, ils boivent de l’alcool, mais je n’aime pas quand ils m’obligent à en boire. Au mariage de ma tatie, j’ai bu du vin de l’honneur (sic) parce qu’ils insistaient, mais ce n’était pas bon. Après ils ont tous applaudi.Naël, 10 ans.
Je trouve que ça pue. Surtout la bière. Marius, 10 ans.
Quand mes cousins viennent, le meilleur moment c’est quand on fait tchin tchin ! tous ensemble. Tout le monde est heureux parce qu’on se voit pas souvent, alors c’est bien.Océane, 7 ans.
C’est dangereux l’alcool. Si on en boit trop on peut devenir alcoolique. Moi, j’en connais des gens qui sont alcooliques. Estéban, 8 ans.
Mes parents, ils ont une maladie à cause de l’alcool et ils n’arrivent pas à guérir. C’est pour ça que j’habite dans une famille d’accueil. Benjamin, 10 ans.
Les curés, ils en boivent à la messe (rires).Pierre, 10 ans.
Les adultes boivent de l’alcool parce que ça leur fait du bonheur. Moi, je préfère le coca, mais les adultes, quand il y a des copains qui viennent, c’est pas du coca qu’ils boivent. Moi, c’est clair, quand je serai adulte, j’en boirai. C’est certain. Enfin, je vais goûter et si ça me fait du plaisir j’en boirai. Mais si je trouve ça pas bon alors je boirai pas. Swan, 8 ans.
Les adultes boivent de l’alcool pour le plaisir. Ils boivent surtout quand il y a une fête. C’est pas comme la cigarette. Les gens qui fument c’est pour frimer, je pense, pas parce que c’est agréable. Kim, 9 ans.
Avec ma cousine, on vide les verres des grands et, après, on va se cacher dans la grange. On a la tête qui tourne et on se raconte des blagues. Oscar, 9 ans.
À la colo, les animateurs nous ont servi du jus d’orange qui avait de la vodka dedans parce que la veille, ils avaient fait une fête et ils se sont trompés de frigo. C’était dégueulasse, on aurait dit du moisi. J’ai tout recraché. C’était la première fois que je goûtais de l’alcool et ça ne m’a pas donné envie de recommencer.Yasmine, 8 ans.
Moi, mes parents, ils disent que le meilleur moment de la journée c’est quand on est couchés avec ma sœur et qu’ils se posent tranquillement pour boire un verre en amoureux. C’est comme ça qu’ils disent. Il se posent. Comme des oiseaux.Sara, 7 ans.
À vous de jouer
Quelle est la remarque la plus étonnante qu’un enfant vous a faite à propos de l’alcool ?
Une enquête menée auprès de plus de 10 000 adolescents français révèle que la grande majorité des mineurs se souviennent avoir vu ou entendu récemment une publicité pour des boissons alcoolisées. Ils se remémorent très bien la marque, qu’ils peuvent nommer. Sur la durée de l’enquête, les jeunes ont cité un total de 105 marques ! Le nuage de mots ci-dessus présente celles auxquelles les mineurs sont le plus exposés. Plus la taille de la police est grande, plus la marque correspondante a été fréquemment citée par les jeunes.
Crédit visuel : OFDT
10. La publicité pour l’alcool, omniprésente dans l’univers des mineurs
Les choix des parents sont sapés par la publicité et la promotion de l’alcool atteignant les enfants. Organisation mondiale de la Santé
J’espère vous avoir convaincu(e) du rôle que nous, parents, jouons dans la découverte, par notre enfant, des boissons alcoolisées (parfois sans nous en rendre compte). De là à dire que si nos ados boivent de l’alcool c’est à cause de nous, et rien que de nous, il y a un pas que je ne franchirai certainement pas. Les scientifiques s’accordent à dire que nos jeunes sont soumis, à l’extérieur de nos familles, à de fortes influences les incitant à boire de l’alcool (→97). Celle exercée par les publicités est probablement la plus détestable de toutes. Cette influence s’exerce dès la plus tendre enfance, nous allons le voir.
Les universités d’Otago et d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont mesuré la fréquence d’exposition des enfants, dans leur vie de tous les jours, au marketing de l’alcool. Les chercheurs ont réalisé pour cela une expérience étonnante, baptisée « Kid’s Cam36 ». Ils recrutèrent aléatoirement 168 enfants âgés de 11 à 13 ans. Pendant quatre jours, ils leur firent porter, de leur réveil jusqu’à leur endormissement le soir, un appareil photographique qui captura toutes les 7 secondes des images de leur environnement. L’analyse de ces clichés révéla que ces jeunes avaient été exposés 7,7 fois par jour à une marque d’alcool37. Une expérience tout aussi intéressante fut réalisée en Suisse en 2021. Les chercheurs de la fondation Addiction Suisse ont passé au crible les trajets et activités de mineurs de cinq villes, en notant de manière systématique chaque stimulus pro-alcool rencontré lors de ces trajets ou activités. Leur étude révèle que les mineurs sont confrontés en moyenne à un stimulus en lien avec l’alcool toutes les cinq minutes38.
La situation française n’est pas plus reluisante. La loi Évin, sous sa forme initiale, protégeait les enfants de l’exposition aux publicités pour l’alcool. Cette loi a malheureusement été tellement érodée, année après année, qu’aujourd’hui elle ne les protège plus de grand-chose39. Vous l’ignorez peut-être, mais la publicité pour l’alcool est autorisée quasiment partout en France, y compris aux abords des établissements scolaires.
Les mineurs témoignent d’une omniprésence du marketing des boissons alcoolisées. Ils en croisent dans la rue, dans les magasins, dans les séries, sur Internet. Partout. L’OFDT a interrogé plus de 10 000 adolescents mineurs40. Tenez-vous bien. Une large majorité d’entre eux (86 %) se souvient avoir vu ou entendu une publicité pour de l’alcool, et peut nommer la marque. Au total, 105 marques d’alcool, dont 28 qui reviennent très, très souvent. Parmi le top 6 figurent Heineken, Tuborg Skøll, Poliakov, 1664, Leffe et Desperados. Un mineur sur quatre déclare que la dernière publicité qu’il a croisée lui a donné envie de boire le produit (→23). Les associations de prévention demandent régulièrement l’interdiction de la publicité pour l’alcool aux abords des établissements scolaires. Chaque fois, elles se font retoquer. L’exposition des enfants au marketing des boissons alcoolisées n’intéresse visiblement ni le gouvernement ni les parlementaires.
À vous de jouer
Vous avez constaté la présence d’une publicité pour de l’alcool à proximité d’un établissement scolaire de votre commune ? Ça vous agace ? Et si vous écriviez à votre député pour exprimer votre mécontentement et connaître sa position sur le sujet ? Pour plus d’impact, vous pouvez joindre à votre courrier une photographie de la publicité en question et le nom de l’établissement scolaire. Je vous propose un courrier-type et des explications pour vous aider à trouver l’adresse de votre député dans le Cahier de travaux pratiques, téléchargeable sur sapremierecuite.fr
11. Âge de la première cuite : 15 ans
Dans les différentes cultures et religions, la transition vers l’âge adulte - qui est marquée par la puberté - s’opère traditionnellement par des rites de passage. […] Dans nos sociétés contemporaines, la pratique de ces rites s’est raréfiée. Elle a été remplacée par la prise de risque, la recherche des limites et un certain niveau de transgression des règles de la société.Dr Olivier Phan et al.41
Victor Hugo dit de l’adolescence qu’elle est « la plus délicate des transitions ». Il n’a pas tort. L’adolescence est une phase sensible, déterminante pour le reste de la vie. Mais c’est aussi la période de la première cuite.
Un petit Français sera ivre pour la première fois à l’âge de 15 ans (en moyenne). Cette première expérience de l’état d’ébriété a lieu durant ces années charnières que sont la fin du collège et l’entrée au lycée, entre la quatrième et la seconde. Si l’âge légal d’accès aux boissons alcoolisées est de 18 ans, dans les faits les mineurs n’ont aucune difficulté à s’en procurer (→24). Ils ont de fréquentes occasions de boire, loin du regard des parents. Pour eux, une fête sans alcool n’est pas une véritable fête. Ça n’a pas grand intérêt. Rien de tel, pour être populaire, que d’organiser une soirée chez soi, en l’absence des parents, et d’annoncer qu’il y aura de l’alcool. Les sociologues de l’OFDT reçoivent énormément de confidences, lorsqu’ils mènent des entretiens avec des mineurs, sur les usages de l’alcool dans cette tranche d’âge. « Les jeunes, disent-ils, ont plaisir à raconter “leur première fois” : les récits, souvent emphatiques et quasi scénarisés, s’accompagnent de signes d’émotion tangibles (rires, frissonnements, rougissements)42 . »













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)