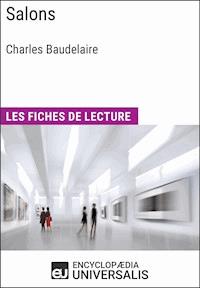
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Les trois
Salons publiés par Charles Baudelaire (1821-1867) en 1845, 1846 et 1859, (on peut leur ajouter le
Salon caricatural auquel il collabora en 1846, en donnant le Prologue et en participant aux légendes des gravures satiriques des œuvres exposées) ne forment qu’une partie de son œuvre critique.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Salons de Charles Baudelaire
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 41
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341001649
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Salons, Charles Baudelaire (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
SALONS, Charles Baudelaire (Fiche de lecture)
Les trois Salons publiés par Charles Baudelaire (1821-1867) en 1845, 1846 et 1859, (on peut leur ajouter le Salon caricatural auquel il collabora en 1846, en donnant le Prologue et en participant aux légendes des gravures satiriques des œuvres exposées) ne forment qu’une partie de son œuvre critique. Ils ont cependant assuré en grande partie sa renommée de critique d’art, moins de son vivant qu’après sa mort, et comptent aujourd’hui parmi les textes majeurs où se rencontrent l’art et la littérature.
• Dans la lignée de Diderot
Baudelaire avait été marqué par la lecture des Salons de Diderot, qui commençaient alors à paraître et dont on rapproche les siens aujourd’hui. Il se plaçait consciemment dans cette continuité. Les conditions de la critique d’art avaient pourtant changé depuis le XVIIIe siècle : le Salon était devenu une exposition régulière, annuelle à partir de 1831, qui présentait plus d’un millier d’œuvres, et parfois jusqu’à plusieurs milliers. La presse s’était, elle aussi, développée, et les conditions de la censure et du débat public n’étaient plus les mêmes : aussi chaque exposition suscitait-elle une littérature de plus en plus abondante, permettant à un public d’ailleurs considérable de se repérer dans la masse des tableaux, des sculptures, des estampes et des dessins exposés. Le genre du Salon est donc bien établi lorsque Baudelaire, sous le nom de Baudelaire-Dufäys, publie son premier compte rendu, en plaquette, à l’occasion de l’exposition de 1845. Il s’y montre assez classique dans le plan, suivant la hiérarchie académique, en traitant d’abord des tableaux d’histoire et des portraits, puis des tableaux de genre et de paysage, enfin de la sculpture, des gravures et des dessins, ainsi qu’en rangeant « les artistes suivant l’ordre et le grade que leur a assignés l’estime publique ». Cela ne l’empêche pas de commencer par celui qui est pour lui « le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes », c’est-à-dire Delacroix, dont la réputation n’était pourtant pas à l’époque totalement incontestée : sous des dehors traditionnels, Baudelaire fait passer sa propre hiérarchie et ses propres admirations.
• Le Salon de 1846, ou les préférences du poète
Il en va très différemment dans le Salon de 1846, où Baudelaire bouscule l’ordre établi. À une interrogation sur le rôle de la critique (chap. I, « À quoi bon la critique ? ») succède un chapitre sur le romantisme avec la célèbre définition « le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir », et l’affirmation, tout aussi célèbre, selon laquelle « qui dit romantisme dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimés par tous les moyens que contiennent les arts ». On ne s’étonnera pas qu’à un chapitre sur la couleur (III, « De la couleur » : « les coloristes dessinent comme la nature ; leurs figures sont naturellement délimitées par la lutte harmonieuse des masses colorées. Les purs dessinateurs sont des philosophes et des abstracteurs de quintessence. Les coloristes sont des poètes épiques ») succède une étude d’ensemble sur Delacroix (IV). Le même modèle se poursuit jusqu’aux détestations de Baudelaire (X, « Du chic et du poncif », XI, « De M. Horace Vernet »), et l’auteur termine comme il a commencé, par une réflexion synthétique en deux points : XVII, « Des écoles et des ouvriers » et XVIII, « De l’héroïsme de la vie moderne », où il aborde ce qui va devenir l’un de ses thèmes majeurs.
• Le Salon de 1859
Après ce sommet, où le Salon est davantage le support de la réflexion que l’objet précis du texte, Baudelaire abandonne le genre pour plus de dix ans. Certes, il donne de loin en loin des articles critiques, et fait en 1855 pour le journal Le Pays un début de compte rendu de la section des Beaux-Arts à l’Exposition universelle, réduit à une introduction (« Méthodes de critique. De l’idée moderne du progrès appliquée aux Beaux-Arts. Déplacement de la vitalité ») et à deux chapitres respectivement consacrés à Ingres et à Delacroix.
C’est après un séjour à Honfleur, au début de 1859, où il composa la plupart des grands poèmes intégrés à la seconde édition des Fleurs du mal





























