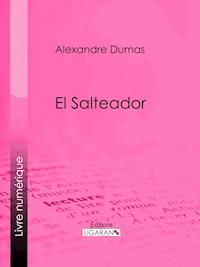
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au milieu des chaînes de montagnes qui sillonnent l'Espagne en tous sens, de Bilbao à Gabraltar, et d'Alicane au cap Finistère, la plus poétique sans contredit et par son aspect pittoresque et par ses souvenirs historiques, est la sierra Nevada, laquelle fait suite à la sierra de Guaro, séparée qu'elle en est seulement par la charmante vallée où prend une de ses sources le petit fleuve d'Orgiva, qui va se jeter à la mer entre Almunecar et Motril."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Au milieu des chaînes de montagnes qui sillonnent l’Espagne en tous sens, de Bilbao à Gibraltar, et d’Alicante au cap Finistère, la plus poétique sans contredit et par son aspect pittoresque et par ses souvenirs historiques, est la sierra Nevada, laquelle fait suite à la sierra de Guaro, séparée qu’elle en est seulement par la charmante vallée où prend une de ses sources le petit fleuve d’Orgiva, qui va se jeter à la mer entre Almunecar et Motril.
Là, de nos jours encore, tout est arabe : mœurs, costumes, noms de villes, monuments, paysages ; et cela quoique les Maures aient abandonné depuis deux siècles et demi le royaume des Almohades. C’est que cette terre que leur avait livrée la trahison du comte Julien, était la terre de prédilection des fils du prophète. Située entre l’Afrique et l’Europe, l’Andalousie est, pour ainsi dire, un sol intermédiaire qui participe des beautés de l’une et des richesses de l’autre, sans en ressentir ni les tristesses ni les rigidités ; c’est la végétation luxuriante de la Métidja, arrosée par les fraîches eaux des Pyrénées ; on n’y connaît ni l’ardent soleil de Tunis, ni le rude climat de la Russie. Salut à l’Andalousie ! la sœur de la Sicile, la rivale des Îles Fortunées.
Vivez, aimez, mourez aussi joyeusement que si vous étiez à Naples, vous qui avez le bonheur d’habiter Séville, Grenade ou Malaga.
Aussi, j’ai vu à Tunis des Maures qui me montraient la clé de leur maison de Grenade. Ils la tenaient de leurs pères et comptaient la léguer à leurs enfants. Et si jamais leurs enfants rentrent dans la ville d’Aben-el-Hamar, ils retrouveront et la rue et la maison qu’ils habitaient, sans que les deux cent quarante-quatre ans écoulés, de 1610 à 1854, y aient apporté grand changement, si ce n’est de réduire à quatre-vingt mille âmes cette riche population de cinq cent mille habitants ; si bien que la clé héréditaire ouvrira, selon toute probabilité, la porte d’une maison ou vide, ou dont leurs indolents successeurs n’auront pas même pris la peine de faire changer la serrure.
En effet, rien d’espagnol n’a germé sur ce sol dont la végétation naturelle est le palmier, le cactus et l’aloès ; rien, pas même le palais que le pieux Charles-Quint avait commencé de faire bâtir pour ne pas habiter la demeure des émirs et des califes, et qui, dominé par l’Alhambra, n’a jamais, sous l’œil moqueur de son rival, pu s’élancer au-delà d’un étage.
C’est en embrassant toutes ces merveilles d’un art et d’une civilisation auxquels n’atteindront jamais ses habitants actuels, que le royaume de Grenade, dernier débris et dernière forme de l’empire arabe en Espagne, s’allongeait sur les bords de la Méditerranée, de Tarifa à Almazarron, c’est-à-dire sur une longueur de cent vingt-cinq lieues à peu près, et s’enfonçait dans l’intérieur des terres, de Motril à Jaën, c’est-à-dire dans une profondeur de trente-cinq à quarante.
La sierra de Guaro et la sierra Nevada le coupaient dans les deux tiers de son étendue. Du sommet de Mulhahacen, son pic le plus élevé, le regard pouvait à la fois atteindre sa double limite : au midi, la Méditerranée, vaste nappe bleue, étendue d’Almunecar à Alger ; au nord, la vega de Grenade, immense tapis vert, déroulé de Huelma à la venta de Cardenas ; puis à l’est et à l’ouest, le prolongement indéfini de la chaîne immense aux cimes neigeuses, dont chaque crête semble la vague subitement gelée d’un océan soulevé contre le ciel. Enfin, sur un plan inférieur, à droite et à gauche de cette mer de glace, un double océan de montagnes dégénérant peu à peu en collines couvertes d’abord de lichens poudreux, puis de bruyères rougeâtres, puis de sapins sombres, puis de chênes verts, puis de lièges jaunissants, puis d’arbres de toute espèce mêlant leurs teintes différentes, en laissant néanmoins des intervalles où s’étendent, comme des tapis, des clairières d’arbousiers, de lentisques et de myrtes.
Aujourd’hui, trois routes partant, la première de Motril, la seconde de Velez-Malaga, et la troisième de Malaga, coupent la sierra neigeuse et conduisent des bords de la mer à Grenade, passant l’une par Joëna l’autre par Alcaacin, l’autre par Colmenar.
Mais à l’époque où commence cette histoire, c’est-à-dire vers les premiers jours de juin de l’année 1519, ces routes n’existaient pas encore, ou plutôt n’étaient représentées que par des sentiers à peine tracés où se posaient seuls, avec une insolente sécurité, les pieds des arrieros et de leurs mules. Ces sentiers, rarement ouverts au milieu de terrains plats, se prolongeaient à travers les gorges et les sommets, avec des alternatives de montées et de descentes qui semblaient faites exprès pour mettre à l’épreuve la patience des voyageurs. De temps en temps leur spirale étroite contournait quelque rocher à pic, rouge et chaud comme un gigantesque pylône égyptien, et alors le voyageur se trouvait littéralement suspendu, lui et son insoucieuse monture, au-dessus de l’abîme dans lequel plongeait son regard effaré. Plus le sentier s’escarpait, plus le rocher devenait brûlant, et plus le pied de l’homme ou de la mule risquait de manquer sur ce granit que le pas des caravanes, en brisant ses aspérités, avait fini par rendre poli et glissant comme du marbre.
Il est vrai qu’une fois ce nid d’aigle, qu’on appelle Ahlama, franchi, le chemin se faisait plus facile, et par une pente assez douce, en supposant que l’on vînt de Malaga et qu’on allât à Grenade, descendait dans la vallée de Joëna ; mais alors, à un péril en quelque sorte physique, succédait un danger qui, pour demeurer invisible jusqu’à l’instant où il menaçait de se produire, n’en était pas moins présent à l’imagination : du moment où les deux côtés du chemin devenaient praticables et offraient un refuge dans leurs épais maquis, ces deux côtés du chemin se hérissaient de croix chargées d’inscriptions sinistres.
Ces croix étaient celles qui décoraient les tombes des voyageurs assassinés par les nombreux bandits qui, dans ces temps de troubles civils, peuplaient particulièrement les sierras de Cordoue et de Grenade, c’est-à-dire la sierra Morena et la sierra Nevada.
Au reste, les inscriptions qui chargeaient ces croix ne laissaient aucun doute sur le genre de mort de ceux qui reposaient à leur ombre. En traversant les mêmes sierras trois siècles après les voyageurs que nous allons, dans quelques instants, faire apparaître aux yeux de nos lecteurs, nous avons vu des croix pareilles à celles que nous décrivons, et nous avons copié sur leurs lugubres traverses ces inscriptions assez peu rassurantes pour ceux qui les lisent :
ICI
ICI
Mais, d’habitude, l’inscription la plus commune est celle-ci :
Ce qui signifie tout simplement : « Ici, ils ont tué un homme. »
Cette espèce de haie mortuaire s’étendait pendant l’espace d’une lieue et demie ou deux lieues, c’est-à-dire pendant toute la largeur de la vallée ; puis on traversait un petit ruisseau qui, côtoyant le village de Cacin, va se jeter dans le Xenil, et l’on rentrait dans la seconde partie de la sierra.
Cette seconde partie, il faut l’avouer, était moins âpre et moins difficile à franchir que la première : le sentier se perdait dans une immense forêt de pins, mais il avait laissé derrière lui les défilés étroits et les rochers à pic. On sentait qu’on était arrivé dans des régions plus tempérées ; et après avoir cheminé une lieue et demie dans les sinuosités d’une montagne ombreuse, on arrivait à découvrir une espèce de paradis, vers lequel on descendait par une pente inclinée sur un tapis de gazon tout bariolé de genêts aux fleurs jaunes et embaumées, et d’arbousiers aux baies rouges comme des fraises, mais dont la saveur un peu grasse rappelle plutôt le goût de la banane que celui du beau fruit auquel il ressemble.
En arrivant à ce point de son voyage, le pèlerin pouvait pousser un soupir de satisfaction ; car il semblait que, parvenu là, il fût délivré désormais du double danger auquel il venait d’échapper : celui de se briser en roulant dans quelque précipice, ou d’être assassiné par quelque bandit de mauvaise humeur. En effet, on voyait à gauche du chemin, à la distance d’un quart de lieue à peu près, s’élever et blanchir, comme si ses murailles étaient de craie, une petite bâtisse tenant à la fois de l’auberge et de la forteresse. Elle avait une terrasse avec un parapet découpé en créneaux, et une porte de chêne avec des traverses et des clous de fer. Au-dessus de cette porte était peint le buste d’un homme au visage basané, à la barbe noire, à la tête coiffée d’un turban, et tenant en main un sceptre. Cette inscription était gravée au-dessous de la peinture : « AL REY MORO. »
Quoique rien n’indiquât que ce roi more, sous l’invocation duquel l’auberge florissait, fût le dernier souverain qui eût régné à Grenade, il était néanmoins évident, pour tout homme n’étant pas complètement étranger au bel art de la peinture, que l’artiste avait eu l’intention de représenter le fils de Zoraya, Aboul-abd-Allah, surnommé al Zaquir, dont Florian a fait, sous le nom de Boabdil, un des personnages principaux de son poème de Gonzalve de Cordoue.
Notre hâte à faire comme les voyageurs, c’est-à-dire à mettre notre cheval au galop pour arriver à l’auberge, nous a fait négliger de jeter un coup d’œil en passant sur un personnage qui, pour paraître au premier abord d’humble condition, n’en mérite cependant pas moins une description particulière : il est vrai que ce personnage était à la fois perdu, sous l’ombrage d’un vieux chêne et dans les sinuosités du terrain.
C’était une jeune fille de seize à dix-huit ans, qui par certains points paraissait appartenir à quelque tribu mauresque, quoique, par d’autres, elle semblât avoir le droit de réclamer sa place dans la grande famille européenne : croisement probable des deux races, elle formait un chaînon intermédiaire qui réunissait, par un singulier mélange, à l’ardente et magique séduction de la femme du Midi, la douce et suave beauté de la vierge du Nord. Ses cheveux, qui à force d’être noirs atteignaient le reflet bleuâtre de l’aile du corbeau, encadraient en retombant sur le cou un visage d’un ovale parfait et d’une suprême dignité. De grands yeux bleus comme des pervenches, ombragés par des cils et des sourcils de la couleur des cheveux, un teint mat et blanc comme le lait, des lèvres fraîches comme des cerises, des dents à faire honte à des perles, un cou dont chaque ondulation avait la grâce et la souplesse de celui du cygne, des bras un peu longs, mais d’une forme parfaite, une taille flexible comme celle du roseau qui se mire dans le lac, ou du palmier qui se balance dans l’oasis, des pieds dont la nudité permettait d’admirer la petitesse et l’élégance, tel était l’ensemble physique du personnage sur lequel nous nous permettons d’attirer l’attention du lecteur.
Quant au costume, d’une sauvage fantaisie, il se composait d’une couronne de jasmin de Virginie arraché au treillage de la petite maison que nous avons déjà décrite, et dont les feuilles d’un vert sombre et les fleurs de pourpre s’harmoniaient admirablement avec le noir de jais de sa chevelure. Son cou était orné d’une chaîne composée d’anneaux plats de la largeur d’un philippe d’or, enchevêtrés les uns dans les autres, et lançant de fauves reflets qui semblaient des jets de flamme. Sa robe, bizarrement coupée, était faite d’une de ces étoffes de soie rayées d’une bande mate et d’une bande de couleur, comme on en tissait alors à Grenade, et comme on en fabrique encore à Alger, à Tunis et à Smyrne ; la taille était serrée par une ceinture sévillane à franges d’or, comme en porte de nos jours l’élégant majo, qui, sa guitare sous la mante, s’en va donner une sérénade à sa maîtresse. Si la ceinture et si la robe eussent été neuves, peut-être eussent-elles blessé la vue par les tons un peu trop accentués de ces vives nuances, amour des Arabes et des Espagnols ; mais les froissements et les fatigues d’un long usage avaient fait de tout cela un charmant ensemble qui eût réjoui alors l’œil du Titien, et qui, plus tard, eût fait bondir de joie le cœur de Paul Véronèse.
Ce qu’il y avait surtout d’étrange dans cette jeune fille, quoique cette anomalie soit plus commune en Espagne que partout ailleurs, et à l’époque où nous la signalons qu’à toute autre époque ; ce qu’il y avait surtout d’étrange dans cette jeune fille, disons-nous, c’était la richesse du costume comparée à l’humilité de l’occupation. Assise sur une grosse pierre, au pied d’une de ces croix funèbres dont nous avons parlé, à l’ombre d’un énorme chêne vert, les pieds trempant dans un ruisseau dont l’eau miroitante les recouvrait comme d’une gaze d’argent, elle filait à la quenouille et au fuseau.
Près d’elle bondissait, suspendue au rocher et broutant le cytise amer, comme dit Virgile, une chèvre, bête inquiète et aventureuse, propriété habituelle de celui qui n’a rien ; et tout en tournant son fuseau de la main gauche, tout en tirant son fil de la main droite, et tout en regardant ses pieds qui faisaient bouillonner et murmurer le ruisseau, la jeune fille chantait à demi voix une espèce de refrain populaire qui, au lieu d’être l’expression de sa pensée, semblait ne servir que d’accompagnement à la voix qui murmurait au fond de son cœur et que nul n’entendait ; puis de temps en temps, non pas pour la faire revenir, mais comme pour lui adresser un mot d’amitié, la chanteuse interrompait son chant et son travail, appelait sa chèvre du mot arabe par lequel on désigne son espèce, et chaque fois que la chèvre entendait le mot maza, elle secouait mutinement la tête, faisait tinter sa sonnette d’argent et se remettait à brouter. Voici les paroles que chantait la fileuse sur un air lent et monotone dont nous avons, depuis, entendu les notes principales dans les plaines de Tanger et dans les montagnes de la Kabylie. Au reste, c’était le romancero connu en Espagne sous le nom de la chanson du roi don Fernand.
En ce moment elle leva la tête pour appeler sa chèvre ; mais à peine eut-elle prononcé le mot maza, que sa parole s’arrêta et que son regard demeura fixé sur l’extrémité de la route venant d’Ahlama. Un jeune homme apparaissait à l’horizon, descendant, au grand galop de son cheval andalous, la pente de la montagne, coupée, selon l’épaisseur ou la rareté des arbres, de larges bandes d’ombre et de soleil. La jeune fille le regarda un instant, se remit à son travail, et, tout en travaillant d’une façon plus distraite encore, comme si, ne regardant plus le chevalier elle l’écoutait venir, elle reprit le quatrième couplet de sa chanson, qui était la réponse de Grenade au roi don Fernand :
Pendant que la fileuse chantait ce dernier couplet, le cavalier avait fait assez de chemin pour qu’en relevant la tête elle pût distinguer et son costume et ses traits.
C’était un beau jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans, coiffé d’un chapeau à larges bords, dont une plume couleur de feu suivait d’abord la courbe pour s’en éloigner ensuite en flottant. Sous l’ombre que le feutre projetait sur sa figure, qui alors n’était plus éclairée qu’en demi-teinte, on voyait briller deux beaux yeux noirs que l’on comprenait devoir s’allumer, avec une facilité grande, de la flamme de la colère ou du feu de l’amour. Son nez, droit et d’une forme parfaite, surmontait deux moustaches légèrement relevées, et qui laissaient voir entre la barbe du menton et celle des lèvres des dents magnifiques, blanches et aiguës comme celles du chacal. Il était couvert malgré la chaleur, et peut-être même à cause de la chaleur, d’un de ces manteaux cordouans qui, taillés comme un puncho américain et fendus au milieu d’une ouverture destinée à passer la tête, couvrent le cavalier depuis les épaules jusqu’à l’extrémité des bottes. Ce manteau de drap couleur de feu, comme la plume du chapeau, brodé d’or à ses extrémités et tout autour de l’ouverture du col, couvrait un costume qui, si l’on en jugeait par le peu qui paraissait au jour, c’est-à-dire par le bout de ses manches et par les rubans de sa trousse, devait être d’une suprême élégance.
Quant à son cheval, qu’il maniait en cavalier consommé, c’était une charmante bête de cinq ou six ans, au col arrondi, à la crinière flottante, à la croupe vigoureuse, à la queue balayant la terre, et au pelage de cette couleur précieuse que la dernière reine de Castille, Isabelle, venait de mettre à la mode ; au reste, c’était merveille qu’avec cette ardeur qui les animait tous deux, cheval et cavalier eussent pu passer par ces rigides sentiers dont nous avons tenté la description, et n’eussent point roulé dix fois l’un et l’autre dans les précipices d’Alcaacin ou d’Ahlama.
Un proverbe espagnol dit qu’il y a un Dieu pour les ivrognes et une déesse pour les amoureux. Notre cavalier n’avait pas l’air d’un ivrogne ; mais, il faut le dire, il ressemblait comme deux gouttes d’eau à un amoureux. Ce qui rendait cette ressemblance incontestable, c’est que sans la regarder, et probablement même sans la voir, tant ses yeux étaient fixés en arrière et tant son cœur était tiré hors de lui, le cavalier passa devant notre jeune fille, en face de laquelle, bien certainement, le roi don Carlos lui-même, si sage et si retenu qu’il fût, malgré ses dix-neuf ans, eût risqué une halte tant elle était belle, quand, levant la tête pour regarder le dédaigneux voyageur, elle murmura :
– Pauvre garçon ! c’est dommage.
Pourquoi la fileuse plaignait-elle le voyageur ? À quel danger présent ou futur faisait-elle allusion ? C’est ce que nous allons probablement savoir en accompagnant jusqu’à la venta du roi More l’élégant caballero.
Pour arriver jusqu’à cette venta, qu’il paraissait si pressé d’atteindre, il devait franchir encore deux ou trois mouvements de terrain pareils, à peu de chose près, à celui au fond duquel se tenait la jeune fille lorsqu’il était passé sans la voir ou plutôt sans la regarder. Au fond de chacun de ces petits vallons, où le chemin seul était percé dans une largeur de huit ou dix pieds à peine et qui coupait d’épais maquis de myrtes de lentisques et d’arbousiers, se dressaient deux ou trois croix, indiquant que le voisinage de la venta n’avait aucunement préservé les voyageurs de cette destinée si commune, qu’il semblait que ceux qui passaient encore par les mêmes chemins où tant d’autres avaient péri, dussent avoir le cœur cuirassé de cet acier triple, dont parle Horace à propos du premier navigateur. En s’approchant de ces endroits de sinistre aspect, le cavalier se contentait de reconnaître que son épée battait toujours à son côté, et que ses pistolets étaient toujours pendus au crochet de sa selle ; puis, lorsqu’il s’en était assuré à l’aide d’une main plutôt machinale qu’inquiète, il franchissait du même pas de son cheval, et du même visage tranquille, le mauvais passage, el malo sito, comme on dit là-bas.
Arrivé au point culminant du chemin, il se dressait de nouveau sur ses étriers pour mieux voir la venta ; puis en l’apercevant il piquait d’un double coup d’éperon sa monture, laquelle, comme si le désir de servir son cavalier la rendait infatigable, se plongeait dans la petite vallée, pareille à la barque obéissante qui redescend dans la profondeur des vagues après en avoir surmonté la crête.
Ce peu d’attention que le voyageur donnait à la route qu’il parcourait, et ce grand désir qu’il paraissait avoir d’arriver à la venta, produisirent probablement deux effets. Le premier, c’est qu’il ne remarqua point, embusqués qu’ils étaient dans le maquis aux deux côtés du chemin, étagés sur un espace d’un quart de lieue, à peu près comme des chasseurs en battue, une dizaine d’hommes couchés à terre, et entretenant allumée avec un soin minutieux la mèche d’une escopette couchée à terre comme eux et près d’eux. Au bruit des pas du cheval ces hommes invisibles levaient la tête, s’appuyaient sur le bras et sur leur genou gauche, prenaient de la main droite l’escopette fumante, et machinalement, en se redressant sur un genou, en portaient la crosse à leur épaule. Le second, c’est que voyant la rapidité avec laquelle cheval et cavalier passaient, les hommes embusqués se faisaient cette réflexion, que le cavalier ayant sans doute quelque chose à faire à la venta, allait y descendre, et qu’il était inutile, par conséquent, de faire éclater sur la grande route un bruit dénonciateur qui pouvait écarter quelque caravane considérable, où les attendait un butin plus copieux que celui que l’on peut faire sur un seul voyageur, si riche et si élégant qu’il soit.
C’est qu’en effet ces hommes couchés n’étaient autres que les pourvoyeurs des tombes, sur lesquelles, en bons chrétiens, ils dressaient des croix, après y avoir couché les voyageurs assez imprudents pour essayer, au risque de leur vie, de défendre leurs bourses quand les dignes salteadores les saluaient, l’escopette au poing, de cette phrase sacramentelle qui est à peu près la même dans toutes les langues et chez toutes les nations : La bourse ou la vie !
C’était probablement à ce danger, qui ne lui était pas inconnu, que la jeune fileuse faisait allusion, quand, regardant passer le beau voyageur, elle avait laissé échapper ces mots accompagnés d’un soupir : C’est dommage !
Mais, on l’a vu, ces hommes embusqués soit pour une cause, soit pour une autre, n’avaient point donné signe de présence : seulement, de même que ces chasseurs en battue, auxquels nous les avons comparés, se lèvent de leur poste quand le gibier est passé, de même quelques-uns d’entre eux, avançant la tête d’abord, puis le corps tout entier, sortirent du bois derrière le voyageur, et s’acheminèrent vers la venta, dans la cour de laquelle le cheval et le cavalier s’élancèrent rapidement.
Un mozuelo se tenait dans cette cour, prêt à prendre la bride du cheval.
– Une mesure d’orge à mon cheval, un verre de xérès à moi, un dîner le meilleur possible à ceux qui me suivent !
Comme le voyageur achevait ces mots, l’hostalero parut à sa fenêtre, et les hommes du maquis à la porte.
Les uns et les autres échangèrent un coup d’œil d’intelligence qui signifiait, de la part des hommes du maquis : Nous avons donc bien fait de ne pas l’arrêter ?
Et de la part de l’hôte : Parfaitement bien fait.
Puis comme le cavalier, tout occupé de secouer la poussière qui couvrait son manteau et ses bottes, n’avait rien vu de ce double regard :
– Entrez, mon gentilhomme, dit l’hostalero. Quoique située dans la montagne, la posada du roi More n’est pas dénuée, Dieu merci. Nous avons toute sorte de gibier, excepté du lièvre, qui est un animal immonde, dans le garde-manger. Nous avons une olla podrida sur le feu, un gaspacho qui trempe depuis hier ; et, si vous voulez attendre, un de nos amis, grand chasseur de ces sortes d’animaux, est à la poursuite d’un ours descendu de la montagne pour manger mon orge, bientôt nous aurons de la venaison fraîche à vous offrir. – Nous n’avons pas le temps d’attendre le retour de ton chasseur, si séduisante que soit la proposition. – Alors je ferai de mon mieux, mon gentilhomme. – Oui, et quoique je sois convaincu que la senora dont je me suis fait le courrier soit une véritable déesse qui ne vit qu’en respirant le parfum des fleurs et en buvant la rosée du matin, prépare toujours ce que tu as de meilleur, et dis-moi dans quelle chambre tu comptes la recevoir.
L’hostalero ouvrit une porte et montra au cavalier une grande chambre passée à la chaux, avec des rideaux blancs aux fenêtres et des tables de chêne.
– C’est là, dit-il. – Bien, répondit le voyageur, verse-moi un verre de xérès, vois si mon cheval a sa mesure d’orge, et fais-moi cueillir dans ton jardin un bouquet de tes plus belles fleurs. – Cela va être fait, répondit l’hostalero. Combien de couverts ? – Deux, un pour le père, un pour la fille ; les domestiques mangeront dans la cuisine après avoir servi les maîtres ; ne leur épargne pas le val de Penas. – Soyez tranquille, mon cavalier, quand on parle comme vous, on est sûr d’être promptement et bien servi.
Et l’hostalero, pour donner sans doute la preuve de ce qu’il avançait, sortit en criant :
– Holà ! Gil, deux couverts ; Pérèz, le cheval a-t-il son orge ? Amapola, courez au jardin et coupez tout ce que vous trouverez de fleurs. – Très bien ! murmura le cavalier avec un sourire de satisfaction. À mon tour, maintenant.
Détachant alors de la chaîne qui pendait à son cou une petite boule d’or de la grosseur d’un œuf de pigeon, toute ciselée à jour, il l’ouvrit, la posa sur la table, alla chercher dans la première salle un charbon ardent, le mit dans la boîte d’or, et sur le charbon égrena une pincée d’une poudre dont la fumée se répandit aussitôt dans la chambre, exhalant ce parfum doux et pénétrant qui caresse l’odorat dès qu’on entre dans la chambre d’une femme arabe.
En ce moment l’hostalero rentra, tenant d’une main une assiette supportant un verre plein de xérès et de l’autre une bouteille nouvellement entamée ; derrière lui venait Gil avec une nappe, des serviettes et une pile d’assiettes ; enfin, derrière Gil parut Amapola, perdue dans une brassée de ces fleurs aux couleurs ardentes qui n’ont pas d’équivalent en France, et qui sont si communes en Andalousie que je n’ai pas même pu en savoir les noms.
– Faites un bouquet des plus belles fleurs, la fille, dit le cavalier, et donnez-moi les autres.
Amapola fit un choix des plus belles fleurs, et quand le bouquet fut massé :
– Est-ce cela ? demanda-t-elle. – Parfaitement, dit le voyageur ; liez-le maintenant.
La jeune fille chercha des yeux un fil, un cordon, une ficelle. Mais le voyageur tira de sa poche un ruban d’or et de pourpre dont il paraissait avoir fait provision pour cet usage, et dont il coupa une certaine mesure avec son poignard ; puis il donna le ruban à Amapola, qui lia le bouquet, et, d’après l’ordre du jeune homme, le posa sur une des deux assiettes dont Gil venait d’orner la table principale. Alors lui-même se mit à effeuiller les autres fleurs de manière à faire de la porte de la cour à la table un chemin tout jonché, comme ceux que l’on prépare au Saint-Sacrement le jour de la Fête-Dieu ; après quoi, appelant l’hostalero :
– Mon ami, lui dit-il, voilà un philippe d’or pour le dérangement que je t’ai causé.
L’hôte s’inclina.
– Maintenant, continua le jeune cavalier, si don Inigo Velasco de Haro te demande qui a commandé son dîner, tu lui diras que c’est un homme dont tu ignores le nom. Si dona Flor te demande qui a fait cette jonchée, qui a préparé ce bouquet, qui a brûlé ces parfums, tu lui répondras que c’est son courrier d’amour, don Ramiro d’Avila.
Et, s’élançant légèrement sur son beau cheval dont le mozuelo tenait la bride, il bondit d’un seul élan hors de la cour de la venta, et continua son chemin au galop dans la direction de Grenade.
Placée où elle était, c’est-à-dire au fond d’un de ces plis de terrain que nous avons indiqués, la belle fille à la chèvre n’avait pu ni voir entrer le jeune cavalier dans la venta, ni l’en voir sortir ; mais elle avait paru écouter avec attention si quelque bruit indicateur de ce qui se passait n’arriverait pas jusqu’à elle, et plusieurs fois, levant ses beaux yeux interrogateurs vers le ciel, elle avait semblé étonnée que le passage du beau et riche gentilhomme n’eût été suivi d’aucun évènement extraordinaire.
C’est qu’elle ignorait tout naturellement, n’ayant point quitté sa place et n’ayant point entendu le dialogue du voyageur avec l’hostalero, à quelle circonstance, toute égoïste de la part des familiers de la venta, le courrier d’amour de la belle dona Flor devait d’être sorti sain et sauf de leurs mains. Au reste, au moment même où, après avoir fait toutes les dispositions pour que la venta du roi More fût digne de recevoir don Inigo Velasco et sa fille, don Ramiro d’Avila s’élançait hors de la cour et reprenait le chemin de Grenade, l’avant-garde de la caravane annoncée par l’élégant maréchal des logis commençait à se faire visible aux yeux de la bohémienne. Cette caravane se divisait en trois corps bien distincts. Le premier, celui qui servait d’avant-garde et qui, ainsi que nous l’avons dit, commençait à paraître sur le versant occidental de la petite montagne, se composait d’un seul homme appartenant à la maison domestique de don Inigo Velasco ; seulement, comme les campieri de Sicile, qui, domestiques dans les temps de paix, deviennent soldats aux heures du danger, celui-là, revêtu d’un costume moitié livrée, moitié militaire, portait une longue rondache à son côté, et tenait droite comme une lance, et la crosse appuyée à son genou, une arquebuse dont la mèche tout allumée ne laissait pas de doute sur l’intention que la caravane avait de se défendre, au cas où elle serait attaquée. Le corps d’armée, qui venait à une trentaine de pas environ de l’avant-garde, se composait d’un vieillard de soixante à soixante-cinq ans et d’une jeune fille de seize à dix-huit. Enfin après eux, et marchant à la même distance que l’homme chargé d’éclairer la route, venait l’arrière-garde, composée de deux serviteurs portant rondache au côté et arquebuse fumante au genou. En tout, deux maîtres et trois domestiques.
Comme les domestiques sont destinés à remplir une médiocre place dans cette histoire, tandis qu’au contraire les deux maîtres doivent y jouer des rôles principaux, qu’on nous permette de négliger MM. Nunez, Camacho et Torribio, pour nous occuper spécialement de don Inigo Velasco de Haro et de dona Flor, sa fille.
Don Inigo Velasco était, comme nous l’avons dit, un vieillard de soixante à soixante-cinq ans, quoique le mot vieillard devienne impropre à l’endroit d’un homme vieux d’âge peut-être, mais à coup sûr jeune de corps. En effet, sa barbe à peine grisonnante, ses cheveux qu’il portait longs à la mode de Philippe le Beau et de Ferdinand le Catholique, à peine mouchetés de la neige d’hiver, indiquaient tout au plus un homme de cinquante à cinquante-cinq ans ; et cependant il était frappé de ce malheur, commun à tous ceux qui ont eu une jeunesse illustre, de ne pouvoir cacher leur âge, ayant plus d’une fois, et à des époques différentes, imprimé profondément sa trace dans l’histoire de son pays. À trente ans, don Inigo Velasco, héritier d’un des noms les plus illustres et d’une des familles les plus riches de la Castille, poussé au désir des aventures par l’amour que lui avait inspiré une jeune fille qu’il ne pouvait épouser, attendu que le père de dona Mercédès de Mendo, c’était le nom de cette reine de beauté, était ennemi du sien, leurs pères, à eux, s’étant juré une haine éternelle ; à trente ans, disons-nous, don Inigo Velasco, qui avait eu pour précepteur le père Marchena, c’est-à-dire un des premiers prêtres qui, au risque de se trouver en opposition avec les Saintes-Écritures, avaient reconnu, sur la démonstration de Christophe Colomb, que la terre pourrait bien être ronde ; don Inigo Velasco avait, par désespoir plutôt que par conviction, adopté les théories et secondé les prétentions du navigateur génois.
On sait ce qu’eut à souffrir à la cour des rois catholiques ce pauvre homme de génie, que les moins malveillants des conseillers d’Isabelle et de Ferdinand traitaient de visionnaire et de fou, lorsque, après avoir inutilement exposé à Gênes, sa patrie, le projet qu’il avait conçu de retrouver, en marchant vers l’ouest, l’empire du Cathay, indiqué par son prédécesseur Marco Polo ; quand, après avoir été repoussé par Jean II, qui envoya secrètement et traîtreusement un pilote tenter cette expédition, que tout haut on traitait d’insensée, il se présenta au roi d’Aragon Ferdinand et à la reine de Castille Isabelle, offrant de doter l’Espagne, non pas d’une ville, non pas d’une province, non pas d’un royaume, mais d’un monde !
Huit ans s’écoulèrent en démarches et en instances inutiles. Par bonheur pour l’illustre Génois, plus d’une fois déjà nous avons philosophé sur ce texte si riche des petites causes et des grands effets, par bonheur pour l’illustre Génois, disons-nous, la Providence permit qu’au moment où Christophe Colomb voulait entreprendre son voyage, qu’au moment où tombait avec son dernier rempart l’empire des califes en Espagne, le neveu d’une des plus tendres amies de la reine fût amoureux à en perdre la raison d’une jeune fille qu’il n’avait aucun espoir d’épouser.
Nous demandons humblement pardon à l’amour de le mettre au nombre des petites causes ; mais, petite ou grande, la cause produisit un effet immense. Nous avons dit la cause : disons l’effet. Ce neveu, on sait déjà son nom, c’était don Inigo Velasco, comte de Haro. Cette tante, c’était Béatrix, marquise de Moya. Or, la reine Isabelle n’avait pas de plus tendre amie, de confidente plus intime que la marquise de Moya : nous inscrivons le fait pour mémoire ; tout à l’heure nous allons y revenir. Quant à Velasco, il avait résolu d’en finir avec la vie, et, s’il n’avait pas été tué dix fois, c’est que, comme devant tous les cœurs résolus, la mort avait reculé devant lui. Dans les guerres que les rois catholiques poursuivaient contre les Maures, il avait constamment combattu au premier rang : il était à l’assaut des forteresses d’Ilosa et de Moclin, ces deux bastilles si importantes de la ville reine qu’on les appelait les deux yeux de Grenade ; il était au siège de Velez quand le zagal Abd-Allah essaya de faire lever le siège de cette ville et fut repoussé avec une perte terrible ; il était à la prise de Gibalfaro, lorsque la ville d’Ibrahim fut emportée et mise au pillage ; il était, enfin, sous les murs de la capitale de Boabdil, quand, après avoir, selon l’expression espagnole, mangé la grenade grain à grain, c’est-à-dire conquis le royaume ville à ville, les rois catholiques entourèrent la cité qu’ils bloquaient d’une ville nouvelle, avec maisons, églises, remparts, et qu’ils nommèrent Santa-Fé, en signe de leur espérance et du vœu qu’ils avaient fait de ne point abandonner le blocus de Grenade que Grenade ne fût rendue. Grenade se rendit le 25 novembre 1491, de l’an 897 de l’hégyre, le vingt-deuxième jour de la lune de moharram. Pour Colomb, qui depuis huit ans attendait, c’était le moment de revenir à la charge ; le roi Ferdinand et la reine Isabelle venaient d’achever l’œuvre commencée par Pélage il y avait sept siècles.
Ils venaient d’en finir avec les infidèles d’Espagne.
Colomb proposait son expédition en lui donnant pour but principal la conversion des infidèles d’un monde nouveau. Pour arriver à ce but, il ne demandait que deux caravelles, cent hommes d’équipage, et trois mille couronnes. Enfin, à côté du but religieux, il proposait, comme résultat matériel, des placers d’or inépuisables, des mines de diamants sans prix. Qui pouvait donc empêcher l’avare Ferdinand et la pieuse Isabelle de tenter une entreprise qui, au point de vue temporel et spirituel, présentait, une fois admise l’existence de ce monde inconnu, toutes les apparences d’une heureuse spéculation.
Ce qui l’empêchait, nous allons le dire. Christophe Colomb, élevant d’avance la récompense à la hauteur du service, demandait le rang d’amiral des flottes espagnoles, le titre de vice-roi de tous les pays qu’il découvrirait, le dixième des bénéfices que rapporterait l’expédition, et le maintien dans sa postérité mâle des titres qui lui seraient accordés. Ces prétentions paraissaient d’autant plus exagérées, que Christophe Colomb, quoiqu’il prétendît descendre d’une des plus illustres familles de Plaisance, quoiqu’il écrivît à la reine Isabelle que, si elle le nommait amiral, il ne serait pas le premier amiral de sa famille ; que Christophe Colomb, disons-nous, n’avait pu produire des preuves de sa noblesse, et que le bruit se répandait à la cour qu’il était tout simplement le fils d’un modeste tisserand de Cogorco ou de Nervi.
Ces prétentions, en conséquence, avaient soulevé l’indignation de l’archevêque de Grenade, Ferdinand de Talavera, chargé par Leurs Majestés Catholiques d’examiner le projet du pilote génois, comme on appelait généralement Christophe Colomb à la cour.
C’était surtout ce dixième dans les bénéfices, représentant juste l’impôt que l’Église prélevait sous le nom de dixme, qui blessait les susceptibilités religieuses de don Ferdinand de Talavera.
Or, le pauvre Christophe Colomb jouait de malheur, car ses trois autres prétentions, celle d’être élevé au rang d’amiral, celle de prendre le titre de vice-roi, enfin celle d’avoir l’hérédité de ce titre, comme dans une famille royale ou princière, avaient, de leur côté, blessé l’orgueil de Ferdinand et d’Isabelle, les souverains, à cette époque, n’étant point encore habitués à traiter de pair avec un simple particulier, et Colomb, tout pauvre et tout obscur qu’il était, parlant avec autant de fierté que s’il portait déjà sur la tête la double couronne d’or de Guacanagarie et de Montezuma.
Il en était résulté qu’après une discussion vive dans le conseil, où Christophe Colomb comptait deux partisans seulement, don Luys de Saint-Angel, receveur des revenus ecclésiastiques d’Aragon, et don Alonzo de Quintatilla, directeur des finances de Castille, la proposition avait été définitivement rejetée, à la grande satisfaction du roi Ferdinand, l’homme du doute et de la matière, et à la grande tristesse de la reine Isabelle, la femme de la poésie et de la foi.
Quant aux ennemis de Colomb, et ils étaient nombreux à la cour, ils regardaient la sentence comme définitive, et croyaient bien être débarrassés à tout jamais de ce ridicule rêveur qui faisait, près des services qu’il promettait de rendre, paraître mesquins tous les services déjà rendus. Mais ils avaient compté sans don Inigo Velasco, comte de Haro, et sans sa tante Béatrix, marquise de Moya.
En effet, le lendemain du jour où le refus de Leurs Majestés Catholiques avait été transmis à Colomb par l’archevêque don Ferdinand de Talavera, refus qu’avaient essayé d’atténuer don Luys de Saint-Angel et don Alonzo de Quintatilla, mais qui n’en avait pas moins laissé sans espoir le pauvre navigateur, dona Béatrix entra dans l’oratoire de la reine, et d’une voix sensiblement émue lui demanda audience pour son neveu.
Isabelle, étonnée de l’aspect presque embarrassé de son amie, la regarda un instant ; puis, avec ce ton de douceur qui lui était habituel quand elle parlait à ses familiers :
– Que dis-tu donc là, ma fille ? demanda-t-elle.
Ma fille était un nom d’amitié que la reine de Castille donnait habituellement, mais sans le prodiguer néanmoins, à ses amies particulières.
– Je dis à Votre Altesse que mon neveu don Inigo Velasco a l’honneur de solliciter d’elle une audience de départ. – Don Inigo Velasco, reprit Isabelle, cherchant évidemment à fixer ses souvenirs sur celui dont il était question, n’est-ce point ce jeune capitaine qui s’est si fort distingué pendant cette dernière guerre aux assauts d’Ilosa et de Moclin, au siège de Velez, à la prise de Gibalfaro, et dans mainte autre occasion ? – C’est cela ! s’écria dona Béatrix toute joyeuse, et surtout toute fière que le nom de son neveu eût éveillé de pareils souvenirs dans le cœur de la reine. Oui, oui, Altesse, c’est bien lui. – Et tu dis qu’il part ? demanda Isabelle. – Oui, Altesse. – Pour un long voyage ? – J’en ai peur. – Quitterait-il l’Espagne ? – Je le crois. – Ah ! ah ! – Il donne comme excuse qu’il n’a plus rien à y faire pour le service de Votre Majesté. – Et où va-t-il ? – J’espère que sur ce point, dit dona Béatrix, la reine daignera permettre qu’il lui réponde lui-même. – C’est bien, ma fille, dis-lui qu’il peut entrer.
Et tandis que la marquise de Moya, se chargeant d’être l’introductrice de son neveu, s’avançait vers la porte, la reine Isabelle s’assit, et, plutôt pour avoir une contenance que pour travailler réellement, elle prit une bannière qu’elle était en train de broder en l’honneur de la Vierge, à l’intercession de laquelle elle attribuait l’heureuse reddition de Grenade, laquelle avait eu lieu, on le sait, par capitulation, et sans qu’il y eût de sang versé.
Un instant après la porte se rouvrit, le jeune homme entra, conduit par dona Béatrix, et, à quelques pas d’Isabelle, s’arrêta respectueusement, tenant son chapeau à la main.
Don Inigo Velasco, que nous venons de montrer à nos lecteurs comme un magnifique vieillard de soixante à soixante-cinq ans, était, à l’époque de la prise de Grenade, un beau jeune homme de trente à trente-deux ans, avec de grands yeux et de longs cheveux noirs ; son visage pâle était profondément empreint de cette teinte mélancolique qui indique la présence d’un amour malheureux, et qui, par conséquent, est toujours une puissante recommandation près d’une femme, cette femme fût-elle reine.
Une blessure à peine guérie alors, mais dont la cicatrice s’était perdue depuis dans les premières rides de la vieillesse, sillonnait son front d’une ligne rougeâtre et attestait qu’il avait attaqué de près et en face les Maures, dont le cimeterre avait laissé cette trace sanglante sur son front.
La reine, quoiqu’elle eût souvent entendu parler de lui à la fois comme un beau cavalier d’amour et comme un beau capitaine de guerre, mais qui le voyait pour la première fois, regarda don Inigo avec ce double intérêt qui s’attachait d’abord au neveu de sa meilleure amie, et ensuite à un cavalier qui venait de combattre si vaillamment pour la cause de son Dieu et de ses rois.
– Vous êtes don Inigo Velasco ? demanda Isabelle après un moment d’attention, pendant lequel le plus profond silence avait régné dans l’oratoire où se tenaient cependant près d’elle ou loin d’elle, assis ou debout, selon la familiarité dont elles étaient honorées ou le rang qu’elles occupaient, une douzaine de personnes. – Oui, Altesse, répondit don Inigo. – Je vous croyais rico hombre ? – Je le suis en effet, Altesse. – Pourquoi ne vous couvrez-vous pas devant nous, alors ? – Parce que le respect que j’ai pour la femme m’interdit le droit que veut bien me rappeler la reine.
Isabelle sourit, et le tutoyant, comme c’était alors et comme c’est encore aujourd’hui l’habitude des rois et des reines de Castille à l’égard de ceux qu’on appelle de nos jours grands d’Espagne, et que l’on appelait alors ricos hombres :
– Eh bien ! don Inigo, demanda-t-elle, tu veux donc voyager, mon enfant ? – Oui, Altesse, répondit le jeune homme. – Et pourquoi cela ?
Le jeune homme garda le silence.
– il me semble pourtant, continua Isabelle, qu’il y a nombre de places à ma cour qui iraient bien à un jeune homme de ton âge et à un vainqueur de ton mérite. – Votre Altesse se trompe sur mon âge, répondit don Inigo en secouant tristement la tête, je suis vieux, Madame. – Toi ? fit la reine étonnée. – Oui, Madame ; car on est vieux, quelqu’âge que l’on ait, le jour où l’on a perdu toute illusion ; et quant à ce titre de vainqueur que vous me faites la grâce de me donner, comme à un Cid, je l’aurai bientôt perdu, puisque grâce à la reddition de Grenade et à la chute du dernier roi more, Aboul-abd-Allah, vous n’avez plus d’ennemis à vaincre dans votre royaume.
Le jeune homme prononça ces paroles d’un ton si profondément triste, que la reine le regarda avec étonnement, et que dona Béatrix, qui sans doute était au courant des chagrins d’amour de son neveu, essuya une larme qui roula silencieuse de sa paupière sur sa joue.
– Et où veux-tu aller ? demanda la reine. – Je veux aller en France, Altesse.
Isabelle fronça légèrement le sourcil.





























