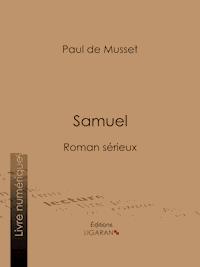
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "A vous, mesdames, et à vous jeunes gens, – non à d'autres, – sont adressées ces lignes. Si je ne les offre point, comme faisait Rabelais, aux buveurs très illustres, ce n'est pas que je manque d'estime pour eux, au moins. – Au contraire, je les révère fort ; mais tous les jeunes gens ne sont pas de bons buveurs, tandis que nos meilleurs buveurs sont des jeunes gens."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À vous, mesdames, et à vous jeunes gens, – non à d’autres, – sont adressées ces lignes. Si je ne les offre point, comme faisait Rabelais, aux buveurs très illustres, ce n’est pas que je manque d’estime pour eux, au moins. – Au contraire, je les révère fort ; mais tous les jeunes gens ne sont pas de bons buveurs, tandis que nos meilleurs buveurs sont des jeunes gens. Je ne vais pas non plus jusqu’à dire qu’un doigt sexagénaire soit indigne de tourner ces pages ; mais je me défie de ces gens qui s’obstinent à fredonner les airs de Grétry, et qui ne veulent pas seulement entendre ceux de Weber et de Rossini. – Ils ont pleuré devant Lekain, qui jouait Orosmane en culottes courtes, et sont restés secs devant Talma. Ils ont fait des folies pour mademoiselle Bigottini, et ne veulent plus trouver joli un seul minois de l’Opéra. – Donc, je m’en défie. Je ne les blâme point ; je n’oserais pas plus les tourner en ridicule qu’un ivrogne n’oserait rire d’un confrère en bouteille, ni qu’un brigand ne voudrait insulter un pendu. – Je sais que je serai comme cela dimanche. Je serai pire. Je serai maussade, injuste, tyran, exigeant, insupportable à tous mes proches : je vieillirai comme Saturne ; je serai avare comme l’enfer, et je tromperai mes héritiers par quelque bon tour. Vieux rime avec envieux. Vieillesse et envie cheminent souvent ensemble à califourchon, comme l’aveugle et le paralytique. Je les laisse passer paisiblement. Aux jeunes gens, dis-je, sont adressés ces écrits. – Et à vous aussi, mesdames. Il n’y a sous vos fronts d’enfants, ni latin, ni mathématiques, ni politique, ni grimoire. – Vous êtes bien heureuses : vous songez tout un jour à un bonnet, à un bout de tulle, ou bien à un spectacle ; le plaisir est la grande affaire qui vous occupe sans cesse. – Oh ! que vous entendez la vie bien mieux que nous ! À vous sont adressées ces pages. Vous me lirez, et puis vous me déposerez dans un petit coin, et vous m’oublierez comme a fait ma maîtresse. – Cela sera charmant. Voilà qui est convenu.
Lecteur sérieux et réfléchi, ne t’effraie point. Toi qui ne veux pas t’embarquer pour pêcher du fretin, jette toujours ta ligne ; tu trouveras par-ci par-là quelques pièces moins menues que le reste. Je ne prendrai pas de détours, comme l’auteur de Gargantua, pour te dire de ne point t’arrêter à la surface, et de chercher les secrètes pensées de l’auteur. Dans ce siècle de modération et de liberté, chacun peut dire hautement ce qu’il pense, et qui sait jusqu’où iront les progrès de la civilisation ? – Peut-être en viendra-t-on à ne plus jeter de pierres aux Saint-Simoniens ; peut-être un jour on ne nous forcera plus à monter la garde comme des soudards, – ce qui est un odieux impôt de cinq pour cent prélevé sur nos existences. Ô ciel ! qu’ai-je dit là ? Je viens de me compromettre.
Vive le métier de romancier ! Si on veut parler de quelque objet privé de toute noblesse, comme un fichu, une cravate, un mouchoir, on le peut. Le bon lecteur n’est point chatouilleux, ni à cheval sur l’étiquette, au coin de son feu, comme il l’est au théâtre. On peut lui nommer les choses par leur nom, et dire des épingles, sans être dans l’affreuse nécessité de désigner cet instrument, comme l’abbé Delille, par cette ingénieuse énigme :
nécessité qui me ferait infailliblement tomber malade. La Melpomène française est une belle dame trop prétentieuse et trop maniérée pour que j’ose me présenter devant elle. Il faudrait qu’elle devînt une bonne femme comme la Melpomène allemande. Je puis au moins, dans un roman, donner à mes personnages le costume, le langage et les manières qui me conviennent. Je puis décrire les choses comme je crois les voir, les expliquer comme je les comprends, sans rendre de compte à personne. Le style est le moindre de mes soucis. Quoique, par le temps qui court, le plus simple des substantifs ne puisse plus se montrer dans une phrase, sans être surchargé de trois adjectifs pompeux, comme la tête ridée du pape avec sa triple couronne, je ne m’embarrasserai point du goût du jour. Je pense que dans une réunion où les hommes seraient en habits de velours de toutes couleurs, et en gilets épinglés ; où chacun porterait des chaînes d’or, des bagues et des breloques, on ne me mettrait point à la porte pour m’être présenté vêtu d’un costume de drap noir. Daignez, bon lecteur, m’admettre comme je suis. Je ne vous serai point annoncé comme la comète ou le Messie. Il est bien fâcheux que je n’aie pas même un ami intime parmi messieurs les journalistes, pour dire seulement que cette histoire est l’ouvrage le plus remarquable de l’époque, ou quelque autre bagatelle semblable. – Je présume bien que vous êtes convaincu comme moi de la nécessité d’être d’une coterie. Cependant, je ne suis point muni de ce passeport littéraire, et je vous dirai tout bas, – à vous qui êtes évidemment une personne de goût, puisque vous coupez mes pages, – que si l’histoire de Samuel vous amuse, il suffira que vous fassiez part à votre voisin du plaisir qu’elle vous aura causé ; que si au contraire elle vous ennuie, toutes les colonnes des journaux perdraient leur temps à me donner des louanges. Ce raisonnement, tendant à prouver que je dois rester dans une douce insouciance, je le proclame bon. Une publication donne toujours plus de soucis qu’on ne pense. Je vous ferais frémir en vous contant seulement de quelle façon se fait le choix d’un titre.
Figurez-vous l’auteur, l’éditeur, et quelques amis, assis au coin du feu. Tous avec le visage soucieux, les sourcils froncés, le cigare à la bouche pour chercher une inspiration sublime dans le tabac ; toute une jambe étendue, et l’autre pliée avec les mains croisées sur le genou ; tous se balançant en silence, et passant un volume entier dans l’alambic de leurs cervelles, afin d’en réduire la quintessence à un seul mot. – Un seul mot d’une longueur donnée, mesurée au compas par l’imprimeur. – Voilà dans quelle position je me trouvais l’autre jour. Les premiers titres que nous inventâmes furent raisonnables ; mais, nos têtes s’échauffant, nous avions fini par n’avoir plus le sens commun. J’en étais venu à vouloir qu’on mît sur une couverture noire : les Trois Corps Morts. – À quoi on m’opposa heureusement qu’il faudrait au moins un volume par corps mort, ce qui me parut plausible. – D’ailleurs, il y aurait un danger : peut-être, les gens délicats demanderaient-ils à ne souscrire que pour un seul corps mort. Je voulus alors que le titre fût : L’Homme actif et l’Homme paisible. On me fit à cela de nombreuses objections. Puis on me proposa un substantif comme : Impulsions, ou un adjectif comme : Résolu. – Ce qui me fit dresser les cheveux sur la tête, à force d’affectation. Je répondis que je mourrais plutôt que d’accepter un titre privé d’article. Je crois que si le conseil s’était prolongé jusqu’au soir, nous aurions fini par trouver quelque chose de plus effrayant que les titres à bourreaux ou à cadavres, de plus prétentieux que ceux sans article, de plus affecté que tous ceux des romans et contes dits philosophiques. Peut-être étions-nous près d’inventer quelque chose d’aussi maniéré que la Table de Nuit elle-même, lorsqu’il me vint une heureuse idée. Je pensai tout à coup que s’il ne manquait au Mariage de Figaro, que d’avoir pour titre : Sous les Maronniers, et au Barbier de Séville, que de s’appeler : Par Devant Notaire, ce ne sont là que de légers défauts. – Je pris donc un sage parti ; le parti que je vous recommande comme le meilleur, cher lecteur, toutes les fois que vous serez indécis après une longue délibération : – Je m’avançai vers l’éditeur, et je le priai de mettre la première chose venue. – Nous avons choisi Samuel.
Ce qui m’a encore confirmé dans une résolution si courageuse, c’est une réflexion dont je vous ferai part. Ne vous est-il jamais arrivé, après avoir fait longtemps la cour à une jolie dame, sans succès, de vous dire un beau jour : « Si par hasard, cette femme ne songeait pas à moi le moins du monde ? » – Eh bien ! le même doute m’est entré dans l’esprit. J’ai remarqué souvent qu’un auteur qui lance à la mer un nouveau volume, s’imagine que tout Paris ne s’occupe que de lui, tandis qu’il n’en est rien. J’ai conclu de là que le bon public dont vous faites partie, cher lecteur, ne se soucie guère d’un titre.
On prétend que notre génération énervée a besoin, quand on lui sert un mets nouveau, qu’il soit abondamment assaisonné d’épices. – Je n’en crois rien. – Peut-être le piment et l’alcool dont on accommode les ouvrages à la mode, ne font-ils que dégoûter les convives d’aller plus avant. Quelques années feront justice de ces fabricants de livres qui travaillent sans conscience, et qui croient suppléer au vide de leurs idées, en faisant de l’escrime avec les mots. Le public est comme les femmes ; il se lasse, et change de goûts. – Puisqu’il doit un jour s’ennuyer de la musique de Rossini, je vous demande si, avant cela, il ne sera pas excédé des chroniques en vieux style, des costumes du quinzième siècle, et de ces drames à couleurs locales, dont on ne peut pas vérifier l’exactitude ? – Nous serons tous submergés, bon lecteur ; gloire à ceux qui reparaîtront à la surface de l’eau ! Voilà le Don Juan de Mozart qui, au bout de cinquante ans, fait son entrée à l’Opéra ; et sans doute, nous allons en entendre les morceaux estropiés par les orgues barbares. – C’est là un succès ! Et l’auteur, pendant qu’on prépare son triomphe, n’en fait pas moins dans la terre une laide grimace. En y pensant, il y a de quoi devenir épicurien.
Cela ne m’empêchera point de vous présenter l’histoire de Samuel. Au moment de couper les cordes qui retiennent encore ce fragile ballon, les craintes et les scrupules sont venus m’assaillir ; mes amis ont étendu leurs mains en criant :
– Arrêtez, arrêtez ! Bien des personnes seront blessées par les opinions, les réflexions et les croyances de votre Samuel. On vous accusera d’avoir mis vos idées dans les discours que vous faites tenir à ce personnage ; vous aurez beau vous en défendre, on ne vous croira point.
– Eh bien ! répondis-je, je prendrai le parti de ne pas me défendre. Vous prétendez que je vais me faire une mauvaise réputation ? C’est-à-dire, n’est-ce pas, que des mamans me regarderont de travers ; que des jeunes filles recevront la consigne de baisser les yeux, et de pincer les lèvres à mon approche ; que les maris se défieront de mes politesses, les pères de ma patience à les écouter ; que des dames s’éventeront, en tournant la tête sur leur épaule. – Et que me fait tout cela, mes amis ? Je puis tirer franchement aujourd’hui du fond de mon cœur des vérités que chacun cache dans le sien. J’ai dissimulé aussi bien que les autres assez longtemps. – Ne suis-je pas à ma vingt-septième année ? Ce que l’avenir me réserve ne vaudra peut-être jamais le passé. – J’ajouterai quelque chose de bien plus fort : vous savez qu’un jeune homme qui aime le tabac à priser doit renoncer à tous succès dans le monde ? Eh bien ! je vous assure que si je trouvais du plaisir à me mettre dans le nez cette poudre noire, je n’aurais aucun scrupule à le faire. –
Les ciseaux étaient levés ; je fermai les yeux en donnant un furieux coup dans le câble, et Samuel s’élança gaîment au milieu des orages. Les vents l’ont porté jusqu’en vos mains, lecteur judicieux. En avant donc. – Courage et patience.
Dans l’autre grotte était assis le stupide Belford, les mâchoires pendantes.
RICHARDSON
D’habitude il songeait creux.
RABELAIS.
Dans un appartement fort simple de la rue Vivienne, était assis Samuel, garçon de vingt-cinq ans, plongé dans la rêverie, – les coudes sur une table, et la tête posée dans ses mains. – Il y a de cela environ un an. À voir ce jeune homme tenir ses yeux fixés sur le bois d’une table, avec la constance d’un savant enfoncé dans ses observations microscopiques, vous auriez aussitôt pensé que c’était un amoureux. Cette rêverie avait bien été causée d’abord par le souvenir d’une jolie personne ; mais les idées du songeur avaient fait du chemin en peu de temps. Après de longs détours, elles s’étaient repliées sur lui-même, et Samuel s’efforçait de soulever un coin du voile qui cache les secrètes intentions de la nature, en jetant dans son propre cœur un regard sévère et perçant. Je ne sais si Gall aurait eu raison d’assurer que cette disposition philosophique était marquée sur le crâne de ce garçon par deux protubérances égales, placées au sommet du front ; mais je puis assurer que Samuel, dès l’âge de cinq ans, avait la manie de briser tous ses jouets d’enfant pour en examiner le mécanisme intérieur. On ne s’étonnera donc pas que plus tard il soit descendu, avec une attention digne d’Archimède, dans un abîme de réflexions psychologiques ; ce qui ne m’empêche pas de le soupçonner fortement de matérialisme, autant que j’en puis juger par le peu de lignes écrites de sa main, que j’ai trouvées dans ses albums.
Samuel était doué d’un esprit souverainement actif et entreprenant ; il joignait à cette qualité une prudence et une discrétion rares. Conduire avec nerf une affaire importante, était pour lui un besoin et une vocation. Il déployait une vigueur redoutable dans l’exécution, après avoir préparé le succès par de longues et habiles machinations. À l’âge de vingt ans, comme il se trouva sans aucun parent, obligé de pourvoir à son existence, il apprit de bonne heure à connaître les hommes. Son père avait bien acheté, de son vivant, une assez jolie propriété située près de Vendôme, mais un étranger en avait l’usufruit ; de sorte que Samuel, avec la certitude de posséder un jour assez de biens pour vivre honorablement, ne se vit pas moins forcé de chercher un emploi. Comme sa famille avait occupé une belle position dans le monde parisien, notre jeune homme s’imagina que des amis puissants allaient lui tendre les mains et le placer auprès d’eux. On lui parla, en phrases pompeuses, des regrets qu’avait laissés son père ; on le reçut avec politesse ; on le fit peu rester dans les antichambres ; les huissiers reconnurent son nom, qu’ils prononcèrent distinctement ; de hauts fonctionnaires, qui auraient pu le recevoir avec fierté, ou prendre le ton d’une protection humiliante, daignèrent se lever de leurs sièges, s’interrompre dans leurs importants travaux, et lui parler comme à un homme ; quelques personnes à qui sa famille avait jadis rendu de grands services, l’invitèrent à dîner comme par le passé ; mais ce fut là tout. Heureusement que Samuel n’était pas de ces gens qui, sur un mot obligeant, s’imaginent que tous les cœurs leur sont ouverts. Ceux-là composent cette foule d’êtres myopes, qui ne tournent jamais leurs yeux que sur le point où le ciel est clair, sans oser jamais regarder l’orage ; ils restent gueux et abandonnés, ayant en poche, toute leur vie, quelque espérance qui jamais ne se réalise. Samuel aimait au contraire à promener ses regards sur tous les points de l’horizon, et le côté le plus chargé de nuages menaçants était toujours celui contre lequel il tournait sa face. Il aimait à juger les choses comme elles arrivent en ce monde, et les créatures comme Dieu les a faites. C’est pourquoi il s’abreuva si copieusement de déceptions ; il se frotta si rudement contre l’humanité, comme à une machine électrique, et en reçut de si bonnes commotions d’ingratitude, d’égoïsme et de fausseté, qu’il ne lui fallut pas huit jours pour donner la clé des champs à toutes ses espérances, et les chasser comme une nuée d’oiseaux parasites ; mais aussi cette expérience sévère jeta dans le fond de son caractère, naturellement bon, une couche d’amertume et de mépris des hommes qui, depuis, perça toujours dans l’énergie de ses résolutions et dans l’ironie de ses discours, car Samuel n’était pas non plus de ces gens qui, repoussés partout, payés en monnaie de cour, se retirent sans fiel avec la conscience de leur importunité, vivent médiocres, honteux et mal vêtus, tout en remerciant le sort du morceau de pain sec dans lequel ils peuvent mettre la dent. On désigne faussement ceux-ci par le nom de philosophes.
Dès que notre garçon de vingt ans eut percé d’un seul regard le brouillard des politesses administratives ; dès qu’il eut reconnu les coutures de fil blanc de tous ces habits diplomatiques, et qu’il eut posé le doigt sur la sécheresse et la mauvaise volonté de ses prétendus amis :
– Voilà donc les hommes puissants ! s’écria-t-il. Ne faut-il, pour parvenir, qu’une dose d’égoïsme recouverte de formalités niaises, que la foule des aveugles nomme habileté ? L’humanité est donc bien pauvre ! – Patience, ma génération montera à son tour. Je saurai quelque jour combattre pour mon patron, tout aussi bien que le plus habile de ces parvenus ; car leur façon de livrer bataille à leur prochain est puérile et misérable.
– À vingt ans on est présomptueux. – J’ai devant moi les cinq plus belles années de ma vie, pour chercher le plaisir seulement, et je veux m’exercer, dans cette guerre sans importance, à devenir un rude jouteur pour le moment où j’aurai affaire aux hommes. Je prends donc pour devise, en amour comme en guerre, celle du héros de Richardson à qui l’imprenable Clarisse dut sa ruine : – Debellare superbos.
Notre ami Samuel avait reçu une éducation solide et brillante. Il fit un cours de mathématiques pour les candidats aux écoles militaires, et gagna bientôt assez d’argent pour se maintenir sur un pied respectable dans la bonne société. On conçoit que la devise qu’il avait choisie, et les règles de conduite qu’il s’était imposé, portèrent une altération notable à sa sensibilité. Cependant Samuel ne tarda pas à devenir amoureux sincèrement d’une jolie et aimable enfant, plus jeune que lui de quatre ans : c’était la fille unique d’un homme riche, qui avait toujours témoigné une vive amitié à notre jeune homme, et pourtant Samuel, après plusieurs mois d’une cour assidue et secrète, commençait à envisager sans remords l’occasion prochaine, et perfidement préparée, d’une ingratitude envers cet honnête père. – C’est ainsi que sont les jeunes gens. – Lorsque des évènements imprévus, qui nécessitèrent le départ subit de cette aimable fille et de sa famille pour l’Angleterre, vinrent la sauver du danger qu’elle courait en se laissant aller sans défiance à un premier attachement, pour un garçon aussi dangereux que Samuel. S’il y a un remède à l’amour, c’est bien l’absence. Nos amants s’écrivirent quelques lettres en secret ; mais le risque était grand pour la demoiselle ; et puis Londres est bien loin. Samuel ne pouvait nourrir l’activité de son esprit avec une passion outre-mer ; la correspondance dura six mois au plus. La petite demoiselle resta près de cinq ans en Angleterre. Elle touchait à ses vingt-un ans, lorsque son père acheta près de Vendôme le château de Beauroc, qui, par un hasard singulier, était voisin de la maison que Samuel ne pouvait manquer d’habiter un jour. Pendant ces cinq belles années, notre héros avait obtenu près des dames une série de succès assez importants pour lui faire oublier de naïves amours avec une jeune fille de seize ans ; cependant il ne reçut pas avec une indifférence absolue la nouvelle de son retour en France, soit qu’il eût aimé cette demoiselle plus ardemment que les autres femmes, soit que cette intrigue abandonnée lui fût restée dans l’esprit comme une affaire incomplète qu’il était de son honneur de renouer un jour, et de conduire à une heureuse fin. Mais il est temps de laisser ces évènements passés, et de revenir à Samuel, accoudé sur sa table, pour vous apprendre par quel enchaînement de réflexions il en était venu à songer creux.
Pour une combinaison neuve et piquante, le hasard en fait mille qui semblent n’avoir aucun but ; il accompagne les évènements de quelque importance de minuties insignifiantes, en manière de hors-d’œuvre. Ce fut par une de ces fantaisies du sort, que Samuel rencontra dans la rue son notaire, encore tout ému des gros honoraires que lui valait la vente du château de Beauroc. – Et voyez combien l’organisation de l’homme est mystérieuse et inconnue. – À cause de cette rencontre toute simple, Samuel, en regagnant son logis, répéta plusieurs fois tout bas le nom de Juliette (c’était celui de la jeune fille). Il regardait avec distraction les pavés, tandis que le souvenir des formes délicates de la jolie demoiselle lui rentrait, à chaque pas, plus avant dans l’esprit ; et cependant il n’avait pas vu Juliette depuis près de cinq ans ; il n’avait pas même pensé à elle depuis plusieurs mois. En arrivant chez son portier, qui lui remit deux lettres, sur lesquelles l’homme distrait ne daigna pas jeter un regard, les souvenirs avaient crû, et s’étaient condensés, au point que Samuel voyait distinctement devant lui le visage doux et sérieux de la jeune fille. – En tournant ses yeux sur sa fenêtre, dorée par le soleil couchant de juin, il aperçut clairement les deux belles grappes de cheveux blonds qui pendaient contre les joues un peu pâles de Juliette. Ce fut bien pis encore lorsqu’il se fut assis commodément et appuyé sur sa table. Les anciennes impressions de ses premiers amours accoururent en foule autour de Samuel, comme une troupe d’oiseaux étourdis, et l’emportèrent sur leurs ailes, bien loin d’un appartement fort simple de la rue Vivienne. – Tout cela pour un mot d’un notaire.
Qui donc m’expliquera ce mécanisme humain, dont une force motrice, aussi faible que le mot d’un notaire, peut faire marcher les rouages si rapidement et si longtemps ?
Notre amoureux distrait se fit à lui-même cette question, et laissa de côté la belle Juliette pour chercher à deviner par quelle raison, après cinq ans d’indifférence, il se sentait pris aux cheveux par ces vieilles impressions : mais le songeur eut beau fouiller dans le coin de son âme qu’il pouvait apercevoir, il n’y trouva rien ; ce qui lui causa une vive humeur contre lui-même, car il avait quelque prétention à la force de caractère, et c’était à ses yeux une preuve de faiblesse que d’être ainsi emporté par des caprices d’imagination, d’anciennes émotions réveillées, ou par des influences physiques : Il ne pouvait souffrir de se voir à la disposition d’une manie dont la cause était insaisissable ; et quand il sentait son sang bouillir ou sa cervelle en fermentation, il voulait que ce fût par un motif important, ou pour un projet dont l’exécution dût offrir un résultat.
Le raisonneur se leva donc, et se promena dans sa chambre pour chasser une image importune ; il ouvrit au hasard une des lettres qu’il venait de recevoir ; elle était d’une femme à la mode que Samuel aurait dû aimer beaucoup, parce que cette femme était jolie, bien mise et spirituelle. – Je ne vois pas ce qu’un homme peut exiger de plus. – La lettre contenait, en termes fort gracieux, les expressions d’un amour poli et de bon goût ; elle n’était pas trop longue et donnait un rendez-vous ; aussi Samuel en prit-il lecture avec plaisir, et la mit-il soigneusement dans son portefeuille, à côté d’un bon nombre d’autres toutes pareilles ; puis il vit de nouveau passer devant ses yeux le visage doux et sérieux de Juliette, accompagné de deux grappes magnifiques de cheveux blonds.
Cette fois notre jeune homme voulut raisonner à fond sur une impression aussi tenace. Il songea que son patrimoine, situé près du château de Beauroc, étant occupé par un usufruitier dont il fallait attendre la mort, il y aurait sottise et démence à s’abandonner à ses souvenirs ; il se répéta plusieurs fois que, jusqu’à la prise de possession de sa propriété, que Juliette fût en Angleterre ou à Beauroc, ce serait pour lui la même chose. Samuel s’efforça donc de penser à son rendez-vous, car faire des châteaux en Espagne était, suivant lui, une faiblesse digne de pitié ; c’était s’aveugler à plaisir et chercher à voir les choses autres qu’elles ne sont. Cette façon de penser l’avait entraîné jusqu’à prendre en horreur les romans où les hommes sont toujours peints sous les traits imaginés par la cervelle d’un écrivain, et non avec ceux que l’inépuisable nature leur donne. Les évènements apprêtés à grands frais, qu’on y accumule sans ordre, lui inspiraient surtout un dégoût sincère, lorsqu’il les comparait aux mystérieuses combinaisons du sort. Le sévère Samuel, ayant rappelé à lui tous ses principes, s’étendit avec la dignité d’un stoïcien dans un fauteuil, – où le visage doux et sérieux de Juliette vint encore le poursuivre, accompagné de deux belles grappes de cheveux blonds. – Il ne résista plus ; il se laissa conduire par le joli fantôme, et voyagea longtemps en sa compagnie, par les plaines et les ombrages de sa première jeunesse, avec plus de rapidité que n’en a le cheval ailé du Juif-Errant.
Tout-à-coup il se rappela qu’après le départ de la jeune fille pour l’Angleterre, dans l’innocence primitive d’un cœur sincèrement épris, il avait écrit une assez forte quantité de notes sur les détails de ses premières amours, pour servir plus tard à ses mémoires. Il courut à son secrétaire. Sous un immense paquet de lettres, il trouva les fragments incomplets qu’il ouvrit, et dont la naïveté le fit sourire dès la première page. Je consens à en mettre une partie sous vos yeux, bons lecteurs, afin de vous faire connaître l’aimable jeune fille dont l’image était si profondément empreinte dans l’esprit de Samuel.
Tu ne reverras pas cinq minutes pareilles
À celles de ce soir. – Oh ! retiens-les longtemps,
Cœur gonflé d’avenir, amant de dix-sept ans.
SAINTE-BEUVE.
Je veux la séduire, la malheureuse !
ODRY.
« J’ai à remercier la Providence d’une délicieuse soirée qu’elle vient de m’accorder à peu de frais. »
« Certes je suis forcé de convenir que le bonheur d’un homme ne nécessite pas toujours les pleurs de plusieurs êtres, car j’ai goûté ce soir, sans porter préjudice à personne, un plaisir aussi vif qu’aurait pu m’en procurer la combinaison la plus compliquée, ayant pour résultat la misère et le deuil de l’humanité tout entière. Je trouvai chez le respectable père de Juliette, une réunion de petites filles, toutes entre douze et seize ans. »
« Tout ce petit monde-là était frais, éveillé, bien portant. On babillait, on riait à perdre haleine pour une mouche, un rien. – On imitait M. de… – madame de… – On se moquait de tout le monde ; on sautait par la chambre ; on était bien contentes sans savoir pourquoi. Le père de Juliette se pâmait d’aise en regardant les petites amies de sa fille. »
« Lorsque j’entrai le bruit cessa ; on resta immobiles comme des statues. – Impossible de faire ouvrir une de ces bouches si bruyantes tout à l’heure. On ne savait plus que faire ; on n’avait rien à dire ; on n’avait nulle raison de rire. Un enfant de six ans rangeait en bataille des soldats de plomb sur une table. »
« – Prenez-moi un tube de verre, dis-je, et jetez-moi ces soldats à terre en soufflant contre eux des boules de mie de pain.
– Oh ! l’heureuse idée ! ô l’homme ingénieux ! Bravo, bravo !
On apporte un tube de verre, et me voilà chargé de relever chaque soldat renversé. – Une sotte occupation, dira-t-on. – Point du tout ; j’y pris un vif plaisir. Je ne me moquerai plus des tartines de Werther. »
Samuel haussa les épaules.
« Juliette m’a présenté, pendant ce jeu d’écoliers, sa main ouverte pour recevoir une boule de pain. Je fus émerveillé de la blancheur et de la beauté de cette main. Juliette est plus grande, plus savante et plus formée que ses petites amies. – J’appuyai fortement en posant la boule de pain. Je ne sais si la jolie fille le fit exprès, mais cette circonstance se renouvela plusieurs fois pendant le jeu. Je ne crois pas avoir commis en cela un grand crime. – Juliette fut sérieuse toute la soirée ; je lui demandai la cause de cette gravité.
– Il n’est pas nécessaire, dit-elle, que vous me regardiez comme une petite fille.
Juliette marcha devant moi d’un air digne et composé. – C’était une femme.
– Non assurément, pensai-je en sortant, je n’ai pas commis un grand crime en appuyant dans la main de Juliette plus qu’il n’était nécessaire. Pourquoi diable aussi cette main se trouva-t-elle si jolie et si blanche ! »
– Voilà un conte pour les enfants, dit Samuel avec humeur. Est-ce bien moi, bon Dieu ? Je l’aimais donc comme le bon Paul aimait la simple Virginie ? Puis après, comme Saint-Preux aimait la romanesque Julie ? Pourquoi n’ai-je pas supprimé cet inutile prélude, et ne l’ai-je pas aimée de suite, comme François aimait la Féronnière ? C’est ma faute, ma faute.
« J’ai fait ce soir un coup de maître. Nous étions bien une dizaine chez Juliette. De tous les assistants, elle seule et moi avions moins de cinquante ans. Deux négociants causaient safran ; trois fortes têtes parlaient politique ; les autres entouraient l’honnête père, et l’accompagnaient dans l’inépuisable sujet des fournitures et de l’administration. – Circonstance heureuse pour moi, car, Juliette ayant depuis longtemps perdu sa mère, je me trouvais seul près d’elle. En me penchant de son côté pour lui parler bas, je vis la plus charmante petite oreille. – Comment ne pas laisser tomber quelques mots d’amour dans cette jolie antichambre de son cœur ? »
– Bon ! c’est du Louis XV, pensa Samuel.
« – Savez-vous l’anglais, me dit-elle.
– Parfaitement : I love you.
– Parlez-moi italien.
– Volontiers : Sono di voi innamorato morto.
À seize ans entendre ainsi une déclaration subite ! – Il y avait de quoi perdre la respiration et devenir toute rouge. Juliette porta son mouchoir à son visage, et s’écria :
– No, no, no !
C’était répondre dans les deux langues à la fois.
Une lampe qui éclairait seule la chambre, se trouvait posée sur une table où j’appuyais mon coude. Un léger coup dans le pied de la lampe, suffit pour la faire tomber avec un grand vacarme. Dans le tumulte et l’obscurité je pressai dans mes bras la taille de Juliette ; ma bouche rencontra ses lèvres, et j’eus le temps d’ajouter :
– Croyez-moi ; rien n’est plus vrai : Je vous aime.
On apporta de la lumière. Juliette pleurait à chaudes larmes. Un homme en culottes courtes observa, en prenant une prise de tabac, que les jeunes filles ont les nerfs fort délicats. Il sera sans doute parlé longtemps de l’accident de ce soir ; ce sera un souvenir pour Juliette. Pour avoir une idée de l’importance de cet évènement, il faut connaître l’honnête père. Ancien administrateur, et homme formaliste, si un valet fait une faute, cet homme régulier écrit une lettre, dont il garde la minute, à son intendant pour que celui-ci se charge de réprimander le valet placé sous ses ordres. Si un meuble dégradé demande une réparation, il faut un rapport sur papier Tellière. On voit que cet heureux propriétaire trouve, dans une vitre cassée ou une clé perdue, de l’occupation pour toute une matinée. »
Samuel ouvrit aussi une lettre de la jeune fille :
« Quel plaisir j’ai éprouvé hier, lorsque vous avez dit que vous aimiez les femmes d’un caractère sérieux et réfléchi ! Sans doute vous avez raison d’assurer qu’une demoiselle qui rit à tous propos, ne peut être qu’une femme insignifiante, car j’ai trouvé tous vos raisonnements meilleurs que ceux de M. D. Je prenais un grand intérêt à votre discussion, sans oser détourner les yeux de mon ouvrage. Je sais donc à présent pourquoi vous me préférez aux autres demoiselles ; mais moi, qui ne suis pas capable de raisonner comme vous, croiriez-vous bien que je ne saurais dire pourquoi vous m’avez plu ? Le sort la voulu ainsi ; je n’en sais pas davantage. Il y a peut-être là-dedans une prédestination. Je voulais absolument demander des conseils et des éclaircissements à quelqu’un de plus savant que moi ; et, ne sachant à qui m’adresser, j’ouvris au hasard des livres dans la bibliothèque de mon père. Je tombai sur une scène d’une pièce anglaise, où une demoiselle s’appelle comme moi Juliette. Ce rapprochement me frappa. J’emportai le livre dans ma chambre. Cette Juliette devient amoureuse d’un beau jeune homme qui se nomme Roméo, en causant avec lui une seule fois dans un bal. J’ai lu toute la tragédie avec un grand plaisir. Ces amants finissent par mourir ensemble ; ainsi leur passion est bien ardente et bien durable pour s’être formée si vite. Malgré tout cela, je suis bien tourmentée. Vous voulez que je vous reçoive en secret pour causer longuement ; je désirerais vous l’accorder, et je n’ose. Cette pensée seule m’effraie beaucoup, et cependant je vous assure que je le voudrais. La Juliette de la tragédie anglaise a des entrevues avec son amant la nuit dans sa chambre. Je ne vois pas qu’on la blâme de cela, et pourtant ce doit être fort mal. Je ne sais à quoi me résoudre. Adieu, je vous aime. »
Au bas de cette lettre était une note au crayon.
« Oh ! le joli métier que celui d’une jeune fille bien élevée ! Oh ! l’existence aimable et douce ! Pour être une bonne fille à marier, il ne faut pas avoir un caractère à soi ; il faut être toute pareille aux autres filles à marier. On a des institutrices ou des mamans qui vous enseignent à être une bonne fille à marier. Les institutrices et les mamans prennent le mot convenances et vous le font entrer sous le crâne, après en avoir arraché tout ce que la nature y avait mis. »
Cette opération faite, vous n’avez plus de caractère, vous n’avez plus ni un goût, ni une vocation, ni une âme, ni une idée. Vous êtes convenable. – Une fois mariée, vous laissez aller au vent une bonne portion de convenances, et votre caractère reprend un peu le dessus ; vous n’êtes plus obligée d’être semblable à toutes les autres femmes. Je serais embarrassé de définir ce redoutable mot ; mais je puis vous assurer que si vous avez un désir vif, quel qu’il soit, convenances est là pour vous faire un crime de ce désir, et une nécessité de le dissimuler. Et que sera-ce donc si une jeune fille se laisse aller à aimer tout bas ? si elle fait une place dans son cœur à un petit bout de passion ? Oh ! la malheureuse créature ! Dans quelle infernale série de dissimulations n’est-elle pas obligée de se jeter ! Quel métier, bon Dieu ! Me préserve le ciel d’être une jeune fille à marier. – Mais toi, nature, notre mère, toi qui renverses souvent en un jour, comme une marée indomptable, les digues élevées contre toi pendant vingt ans ; toi qui tires de tes trésors de beauté tant d’éblouissantes richesses, comment ne t’indignes-tu pas, et ne viens-tu pas arracher tes dons précieux à ceux de tes enfants qui en font un si misérable usage ? Va, nature, notre mère, je travaillerai pour toi ; je ramènerai dans tes voies cette jeune fleur qu’on t’a dérobée. Je la tirerai d’une terre factice où elle perdrait sa sève et son parfum ; je l’emporterai dans mes bras, et je la rendrai à la terre libre, à l’eau du ciel, au soleil, aux vents et aux orages. Les hommes pourront appeler cela une séduction ; ils pourront crier au rapt ; ils pourront ouvrir les livres sortis de leurs cerveaux desséchés ; les livres au nom desquels ils osent faire de la justice un trafic, et retirer la vie à tes créatures ; les livres au nom desquels ils font asseoir celui que la passion a égaré à côté de celui qui a obéi à un vil intérêt. Mais toi, nature, ma mère, tu m’absoudras, car tu ne connais pas leurs mots privés de sens ; leurs livres tomberont en pourriture ; leurs injustices seront oubliées ; et toi seule tu survivras à tout, féconde et jeune comme au premier jour. Va, je te servirai ; je me fie à toi, nature, ma mère.
Dans une autre lettre il y avait cette note au crayon :
« Juliette n’ose pas m’accorder une entrevue ; elle demande encore huit jours de réflexion. Il faudra bien qu’elle se décide. L’instant approche. Comme Lovelace, je rôde sans cesse autour de ma charmante ; mais le beau mérite qu’a ce Lovelace à séduire les miss anglaises avec une fortune immense, des laquais en grand nombre, des entremetteuses à gages, une foule d’amis puissants et dévoués qui le servent comme des esclaves ! Je fais la guerre sans avoir une seule de ces armes, et je veux réussir aussi bien qu’il aurait pu le faire. »
– Voilà qui est plus raisonnable, dit Samuel.
Et il enferma tous ces inutiles papiers.
Rien n’est plus contrariant pour un homme d’un esprit actif, que la nécessité de laisser inachevée une affaire qui lui tient au cœur. Samuel se trouvait dans cette position désagréable. Quelques minutes de réflexion lui suffirent pour acquérir la certitude qu’il était de toute impossibilité pour lui de se rapprocher de Juliette.
– Il y a des moments, pensait-il, où l’homme doit se décourager et attendre. Je n’ai pas à me reprocher une seule négligence, une occasion manquée, ou une maladresse ; le reste est entre les mains du sort. Tout dépend de cette question : Ai-je du bonheur ? La vie n’est qu’une table de jeu dont le banquier est là-haut. Parmi les joueurs on en voit qui risquent peu et qui pourtant perdent tout, d’autres qui placent toutes leurs chances sur une seule carte, et gagnent cent fois leur enjeu. Les plus obstinés sont ordinairement ceux qui portent, sans le savoir, ces mots gravés sur leur front : « Tu perdras toujours. » L’homme médiocre ne sera jamais à ce beau jeu qu’un triste ponte, ballotté par de misérables chances et des gains chétifs, quand il mettrait sa vie sur un dé. Certes, le sort peut me séparer pour toujours de Juliette ; mais je fais le serment que si jamais je retrouve cette femme, je la poursuivrai avec acharnement ; c’est une guerre que je déclare dans cet instant ; j’en prends le ciel à témoin. Que le hasard dispose des évènements à sa fantaisie, les circonstances lui appartiennent ; ma volonté est à moi, elle sera invariable ; je ne l’abandonnerai qu’en mourant. À présent, que la Providence s’arrange comme elle voudra !
Cet engagement pris avec lui-même rendit à notre raisonneur son assurance et sa tranquillité ; il fit un tour par la chambre, après avoir pourtant répété avec un soupir :
– Tout est dans cette question : Ai-je du bonheur ?
Et il voulut oublier Juliette ; mais il sentit avec dépit qu’il avait laissé une pensée s’emparer entièrement de son esprit, et qu’il aurait à lutter contre elle bien longtemps avant de l’en chasser.
– Je ne suis pourtant pas un homme né malheureusement, dit-il ; je n’ai jamais eu à me plaindre d’une fatalité obstinée ; je ne suis pas brouillé avec le hasard ; mais il est bien triste de ne pouvoir jeter un seul regard dans l’avenir. Reverrai-je Juliette ? Je voudrais commencer aujourd’hui cette guerre que j’ai juré d’entreprendre ; dussé-je mettre ma tête au jeu et dire : Tout ou rien.





























