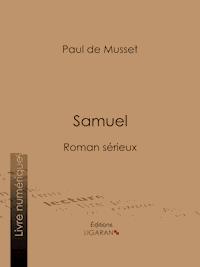Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Non, mon cher Jean, nous ne sommes pas aussi près de nous haïr que vous le dites, et vous avez eu grand tort de veiller jusqu'à trois heures pour m'écrire ces six pages de reproches que je ne mérite pas. Non, vous ne trouverez jamais dans mon coeur rien qui ressemble à la haine. Chassez bien loin cette mauvaise pensée que le chagrin et l'insomnie vous ont soufflée."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097870
©Ligaran 2015
Ce livre n’a pas besoin d’explication. Son unique raison d’être est l’accomplissement d’un devoir, et c’est ce que tous les honnêtes gens ont parfaitement compris.
Quant aux attaques dont l’auteur a été l’objet, il n’y répondra pas. On ne le fera pas si aisément sortir de la réserve qu’il s’est imposée. La déclamation, les injures, les menaces irréfléchies contre lesquelles la loi offre toutes les garanties désirables, n’intimident personne et ne prouvent rien.
Non, mon cher Jean, nous ne sommes pas aussi près de nous haïr que vous le dites, et vous avez eu grand tort de veiller jusqu’à trois heures pour m’écrire ces six pages de reproches que je ne mérite pas. Non, vous ne trouverez jamais dans mon cœur rien qui ressemble à de la haine. Chassez bien loin cette mauvaise pensée que le chagrin et l’insomnie vous ont soufflée. Prenez patience ; attendez un peu, et vous reconnaîtrez que vous avez en moi une sœur, une mère tendre. Mon Dieu ! non, je ne vous ferme point ma porte ; je ne vous ordonne point de vous éloigner ; je ne soupire pas après le moment où chaque seconde qui s’écoulera augmentera d’un tour de roue la distance qui nous sépare. Pouvez-vous m’assurer que vous êtes guéri ? votre cœur est-il disposé, comme le mien, à goûter le charme d’une amitié fraternelle ? ma présence est-elle sans danger pour vous ? alors, venez me voir et demeurez près de moi aussi longtemps qu’il vous plaira. Mais, par malheur, nous n’en sommes pas là ; votre blessure saigne horriblement. Vous me parlez d’amitié avec l’amertume et la colère de l’amour qui n’est plus partagé. Vous voyez bien qu’il faut partir.
À quoi bon chercher l’explication et les causes de mon refroidissement ? L’amour s’en va sans raison, comme il est venu, ou plutôt il meurt, parce que tout a une fin. Et croyez-vous qu’on s’en débarrasse de parti pris, comme d’une robe qu’on ne veut plus mettre ? Vous m’accusez d’avoir opéré dans mes sentiments une véritable amputation avec la férocité d’un chirurgien. Hélas ! mon cher enfant, plût à Dieu que ma folie eût duré autant que la vôtre ! Je la regrette, je la pleure ; mais il ne dépendait ni de vous ni de moi de la prolonger d’une minute seulement. J’en suis sortie, comme d’un rêve charmant ; mais une fois qu’on s’est éveillé de ce sommeil-là, rien ne peut plus vous le rendre. Mettez-vous bien cela dans l’esprit. De vains ménagements ne feraient que vous nuire. L’avenir appartient à la sainte amitié. Sur la page de l’amour il faut écrire le mot : Jamais ! N’hésitez pas, partez pour l’Italie.
Je souris en voyant votre orgueil masculin se cabrer, quand je vous appelle mon cher enfant. Vous oubliez que vous n’aviez pas encore vingt ans le jour de notre première rencontre. L’ardeur de votre âge, l’emportement de votre passion vous ont empêché de comprendre la chasteté de ma tendresse, la maternité de mon amour. Je ne vous ai point aimé pour votre jeunesse, comme l’auraient fait ces femmes vulgaires qui sont les jouets de leurs sens ; mais bien malgré votre jeunesse. C’est elle qui aurait dû me préserver d’une faiblesse que je déplore aujourd’hui, parce que notre séparation en est la conséquence nécessaire. Au lieu de m’accuser, rappelez-vous donc que je vous ai cédé pour vous épargner une souffrance. Je le reconnais trop tard : mon dévouement n’a servi qu’à vous préparer une douleur plus grande. Je suis comme une sœur de bon-secours qui aurait mis son malade à deux doigts de la mort pour l’avoir trop accablé de soins ; et c’est afin de ne pas vous achever par une pitié malentendue que je vous le répète : Il faut absolument que vous partiez.
Il me reste à répondre à votre dernière accusation ; bien des femmes à ma place ne vous la pardonneraient pas ; mais je ne saurais m’en fâcher, tant elle me semble frivole ! Vous m’appliquez le mot de Saint-Lambert sur Jean-Jacques Rousseau : « Il marche accompagné de sa maîtresse, la réputation. » Ma gloire, dites-vous, s’est jetée entre nous deux. Mon nouvel amant est le public. Je vous méprise parce que vous êtes obscur, et que me voilà tout à coup célèbre. Le succès m’enivre. J’ai honte de vous avoir aimé ; je voudrais pouvoir vous supprimer de ce monde, après vous avoir fait manquer votre carrière, après vous avoir tout ravi, le bonheur, le repos, et jusqu’à votre nom, – car il paraît que vous ne vous appelez même plus Jean Cazeau.
Il n’y a qu’une petite difficulté à tout cela : c’est que ma gloire n’existe point. Je ne crois pas sérieusement à ma réputation, et je ne fais nul cas de ce succès que le caprice d’un sot public est venu faire, entre mille autres productions éphémères, à mes Chansons créoles. Je suis née, il est vrai, avec quelques dispositions pour la musique. J’ai appris à composer, toute seule, ou à peu près. Par quelques dons naturels assez heureux, par de l’originalité j’ai suppléé, tant bien que mal, à la connaissance qui me manquera toujours des règles fondamentales de ce bel art, à cette solide éducation qui n’est donnée qu’aux hommes, et sans laquelle le génie lui-même ne vole jamais que d’une aile.
Les éditeurs sonnent à ma porte, et demandent d’un air affairé à quelle heure je serai visible ; mais au premier morceau de ma façon qui n’obtiendra pas les suffrages des badauds, le bruit de la sonnette ne m’annoncera plus que mes amis.
Mon nom d’emprunt grandit chaque jour. – On ne l’en oubliera que plus vite.
On se demande : « qui est ce William Caze ? un étranger, sans doute, – C’est une femme, répond quelqu’un de bien informé, – Une femme ! ah ! bah ! est-elle jeune, jolie, galante, mariée, veuve ou séparée ? »
Tous ces propos répétés par la médisance, l’envie et la curiosité, font ce qu’on appelle la réputation, et vous ne croyez pas que je la méprise !
Mon cher Jean, lorsqu’on dira devant vous : « Sait-on qui est son amant ? » – Je vous prie de répondre hardiment : « Elle n’en a pas et ne veut plus en avoir. »
Puisse l’assurance que je vous en donne vous consoler promptement ! mais il faut partir. C’est l’ordre de votre mère et la prière de votre sœur. Vous avez retenu votre place aux messageries royales pour ce soir ; perdre encore une fois vos arrhes serait pitoyable. Vous m’avez assez donné de preuves d’amour ; prouvez-moi donc une fois que vous avez du courage. Que votre prochaine lettre soit datée de Lyon ou de Marseille. Tantôt, je mettrai mes habits d’homme pour aller vous voir, vous aider à faire vos préparatifs de départ et vous serrer la main.
OLYMPE DE B***.
Le malheureux jeune homme à qui cette lettre était adressée commença par y chercher quelque mot sorti du cœur, quelque pâle étincelle de l’ancien amour, et, ne l’y trouvant point, il pleura des larmes amères. Comme tous les amants abandonnés, il s’était imaginé que six pages de reproches écrites au milieu de la nuit sous l’influence d’un violent désespoir seraient d’un effet irrésistible. Pour la vingtième fois depuis un mois, cette espérance était déçue. À la seconde lecture, il comprit que le véritable but de cette froide réponse était de le décider à partir.
– Elle veut absolument se débarrasser de moi, dit-il, en froissant le papier entre ses doigts. Ma présence sur le pavé de Paris lui devient incommode. Elle a beau s’en défendre, il est évident que je la gêne dans son nouveau rôle de femme célèbre. Mais que signifie cette tendresse chaste, cette maternité dont elle s’avise tout à coup, au bout de trois ans ? Me serais-je mépris à ce point ? Si l’on y regardait de près, ne verrait-on pas que c’est elle qui s’est jetée à ma tête ? Ai-je rêvé que nous étions amants ? Non, ce n’est pas ainsi que ma mère m’a aimé. Elle se joue effrontément de ma simplicité. Ah ! elle a raison : il faut que je parte et que je l’oublie… Cependant, il est bien à elle de penser à venir me serrer la main une dernière fois ; je l’embrasserai au moment du départ. Je la presserai sur mon cœur.
Ranimé par la perspective de cet embrassement, le pauvre jeune homme n’envisageait plus avec autant d’horreur le moment de l’adieu suprême. Il ouvrit sa malle de voyage avec empressement, et déjà il commençait à préparer son bagage, lorsqu’il pensa qu’Olympe le viendrait voir, en effet, mais pour s’assurer qu’il partait. À cette idée de grosses larmes lui jaillirent des yeux. Il laissa tomber à terre les hardes qu’il tenait dans ses mains, et il s’assit, les bras pendants, le menton sur la poitrine dans un abattement profond.
Au moment où il s’était séparé de madame de B***, Jean, n’ayant pas eu, depuis trois ans, d’autre domicile que celui de sa maîtresse, avait acheté quelques meubles indispensables pour s’installer dans un appartement composé de deux chambres, et situé sur le quai de Gèvres. Un lit en bois de noyer, une table carrée pouvant servir de bureau, un vieux secrétaire en acajou rose, fort terne, mais qui aurait eu quelque prix si on l’eût remis à neuf, composaient, avec quatre chaises de paille, son modeste ameublement. La belle vue des quais, du pont au Change, et des vastes bassins de la Seine aurait fait de ce petit réduit un séjour agréable pour tout autre qu’un amant malheureux ; mais l’abandon et le chagrin l’avaient rendu plus sombre qu’une prison aux yeux du pauvre Jean. Quatre heures venaient de sonner à l’horloge du Palais de Justice, quand un fiacre s’arrêta devant la maison. Le portier fit un sourire malin en voyant passer un bambin coiffé d’un chapeau à larges bords, vêtu d’une redingote trop large pour lui ; la main gauche dans la poche d’un pantalon à plis, maniant de la droite une badine de jonc et marchant d’un pas résolu, comme un écolier qui en est à sa première paire de bottes.
– Cette malle est encore vide ! Je m’en doutais, dit Olympe, en jetant son chapeau et sa canne sur la table. Vous savez bien que la diligence de Lyon part exactement au coup de six heures. À quoi donc pensez-vous ?
Jean secoua la tête, comme s’il eût répondu : « Je ne pourrai jamais ! »
– Quel besoin, dit-il, après un moment de silence, quel besoin avez-vous de m’envoyer à trois cents lieues ? Ne pouvez-vous me laisser dans ce coin ?
– Pour y ruminer votre ennui ! reprit Olympe, pour y tomber malade peut-être ! Non certes, je ne puis vous le permettre. Cette faiblesse est insupportable. Je vous déclare que si vous restez, je ne vous reverrai de ma vie, et je brûlerai vos lettres sans les lire. Voyons : êtes-vous un homme ? Ouvrez cette armoire et passez-moi votre linge ; nous allons faire votre malle ensemble.
Jean obéit machinalement. Il ouvrit l’armoire, on tira le linge et les habits, tandis qu’Olympe rangeait chaque pièce dans la malle, avec la dextérité d’une personne habituée aux voyages. On délibéra sur les livres qu’il convenait d’emporter, outre le Guide en Italie d’Artaria. Jean fouilla dans son secrétaire et y prit un gros paquet de lettres qu’il voulut glisser à la dérobée dans sa malle ; mais Olympe lui frappa doucement sur l’épaule.
– Que faites-vous là ? dit-elle. J’espère bien que vous ne serez point dévalisé par les brigands de la Romagne ; cependant il y a des aubergistes voleurs. On peut perdre son bagage ; une correspondance amoureuse n’est pas un objet de première nécessité sur les grandes routes. C’est à votre retour que vous relirez ces lettres. Remettez-les à leur place, mon cher enfant. Un jour, quand je serai devenue votre compagnon, votre frère William Gaze, je vous dirai que mon cœur ne désavoue pas ce qui est écrit là ; mais à la condition que nous parlerons de l’ancienne Olympe comme d’une personne morte depuis longtemps. Remettez toute cette correspondance dans votre secrétaire, et contentez-vous d’emporter la clef.
Lorsque les lettres furent rentrées dans le vieux meuble, les bagages étant achevés, madame de B*** regarda sa montre.
– Nous avons encore un quart d’heure, dit-elle en s’asseyant sur la malle. Écoutez-moi, cher Jean : Puisque vous avez du courage et l’envie de me satisfaire, je vous tiendrai compte de votre soumission. Je ne suis pas si dure et si cruelle que j’en ai l’air. Au moment où vous allez partir, mon cœur se serre, comme le vôtre ; je regrette cette nécessité de nous séparer pour quelques mois, et à présent que c’est une résolution prise, je ne vous déguiserai plus mon émotion. Ces petites chambres où vous avez tant souffert me sont chères. Je voudrais pouvoir y revenir pendant votre absence, pour y penser à vous, pour m’isoler, pour y travailler paisiblement, loin des importuns, loin de mes amis eux-mêmes, car j’aurai des jours de tristesse, où tout le monde me sera odieux. Si vous n’y voyez point d’inconvénient, donnez l’ordre à votre concierge de me remettre la clef de votre appartement, quand il méprendra fantaisie de venir m’y installer.
Jean trouva cette idée admirable, et ne manqua pas de l’adopter avec enthousiasme. Il voyait dans ce caprice de son amie une pitié, une tendresse, une délicatesse charmantes. Dans l’effusion de sa joie, il se mettait à genoux devant Olympe et lui baisait les mains en la remerciant de se montrer enfin clémente et bonne. Il promettait de surmonter ce fatal amour qui l’empêchait encore de goûter une amitié si douce. Mais comme il parlait de sa guérison prochaine avec trop de passion, madame de B*** lui ordonna de se calmer s’il ne voulait la voir redevenir impitoyable. Pendant ce débat, le quart d’heure s’était écoulé. Olympe avait eu soin de ne pas renvoyer sa voiture, pensant qu’elle pourrait servir. On y transporta les bagages. Jean commanda au concierge de remettre les clefs de l’appartement à son ami William Caze lorsqu’il viendrait les demander ; à quoi le concierge ne manqua pas de répondre qu’il était aux ordres de madame, et l’on partit pour la rue Notre-Dame-des-Victoires.
Dans la cour des messageries, Jean parut sortir de son accablement. Le bruit, l’agitation, le désordre du départ faisaient une heureuse diversion à ses tristes pensées. On procéda bientôt à l’appel des voyageurs. Son nom était le premier sur la liste. Les mains et les lèvres tremblantes, il s’approchait d’Olympe pour l’embrasser :
– Montez donc, lui dit-elle avec vivacité ; le voyage sera long ; il ne faut pas laisser prendre votre place.
– Oui, répondit Jean, le voyage sera long.
Et il monta sur le marchepied, en murmurant tout bas :
– Le dernier baiser, le dernier adieu, elle me le refuse ! Elle veut que j’emporte mon dernier sanglot. Ingrate créature !
Mais lorsqu’il fut assis dans le coupé, Jean vit une petite main frapper le carreau de vitre qui était fermé. Il s’empressa d’ouvrir. Cette main tendue vers lui cherchait la sienne ; Olympe se dressait sur la pointe du pied pour atteindre plus haut, et dans cette attitude forcée il y avait je ne sais quoi de gracieux et de tendre, en sorte que le reproche, qui grondait encore, s’éteignit tout à coup. Tandis que Jean écoutait d’une oreille distraite des recommandations banales sur les soins qu’il devait prendre, les précautions contre le froid de la nuit et les courants d’air, l’heure sonna, et la main qu’il tenait se retira de la sienne. Il entendit l’adieu d’Olympe se mêler au bruit des coups de fouet, aux cris du postillon, et les chevaux partirent au trot.
Lorsque le roulement de la lourde voiture se perdit dans le lointain parmi les autres bruits de la rue, un jeune garçon, auquel personne n’avait pris garde dans la cour des messageries à cause de sa petite taille et de sa mise qui sentait un peu ce qu’on appelait alors le bousingot, leva les bras vers le ciel en s’écriant : « M’en voilà donc débarrassée ! »
Le lendemain, le même bambin se présentait au domicile de Jean Cazeau, accompagné d’un homme en manches de chemise, aux mains noires, portant un trousseau de ferrailles passées dans un large anneau. Le concierge n’hésita point à donner les clefs de l’appartement. L’homme aux mains noires reçut l’ordre d’ouvrir le secrétaire, et tandis qu’il s’efforçait de crocheter la serrure, l’écolier observait ses mouvements avec un intérêt extrême. Enfin l’obstacle céda, et la tablette du secrétaire s’abaissa. Olympe se jeta sur ses lettres.
– J’ai dérangé la serrure, dit l’ouvrier ; faut-il l’emporter pour la remettre en état ?
– C’est inutile, lui répondit-on en lui donnant une pièce de vingt sous ; il m’est indifférent que ce secrétaire soit ouvert ou fermé.
Le serrurier se retira enchanté de son salaire. Il était à peine dans la rue, quand Olympe descendit les degrés, et rendit au concierge les clefs de l’appartement. Elle portait sous son bras un paquet enveloppé dans un journal.
– Madame verra bien, dit le concierge, que j’aurai grand soin du ménage de monsieur. S’il survenait quelque chose, j’en avertirais madame. Elle n’a qu’à me donner son nom et son adresse.
– Vous ne les savez donc pas ? demanda Olympe.
– Non, madame.
– Fort bien. Je vous les donnerai à ma prochaine visite.
Mais le concierge attend encore la visite d’Olympe. Elle ne revint jamais au quai de Gèvres.
Vers huit heures du soir, les habitués du petit salon de madame de B*** la trouvèrent tenant à la main des pincettes et remuant un monceau de papiers qui brûlaient dans la cheminée. Elle était dans un de ces négligés que les femmes ordinaires ne portent tout au plus qu’avant l’heure du déjeuner : robe de chambre ouverte, en soie jaune, manches larges, babouches turques sans quartier, résille espagnole, chemise d’homme et cravate noire. Les amis d’Olympe ne s’étonnèrent point de cette toilette bizarre, en ayant vu bien d’autres. Leur mise était d’ailleurs assortie à celle de la maîtresse du logis. Ces fidèles habitués, au nombre de trois, venaient chaque soir témoigner leur amitié pour madame de B*** et leur admiration pour ce génie nouvellement révélé, en faisant chez elle une large consommation de grog, de vin chaud et de bière. C’était une manière de vivre en gens du monde sans renoncer aux habitudes de café.
Le plus ancien en date dans l’intimité d’Olympe était une espèce de campagnard sauvage qu’on appelait Caliban, car tout le monde avait un sobriquet dans cette compagnie débraillée. Caliban, ayant connu Olympe au pays, avait le privilège du tutoiement, et disait parfois de dures vérités à son amie. Son surnom lui venait de ce qu’il arrivait toujours mouillé jusqu’aux os ou couvert de poussière, selon la saison.
Le second était un homme instruit, puriste en littérature, à vues étroites en matière de beaux-arts, à cheval sur les règles les plus rebattues et qui jouissait d’un certain crédit de connaisseur, même hors du salon de madame de B*** ; mais cet esprit cultivé habitait un corps inculte, malpropre jusqu’à incommoder ses voisins‚ modèle curieux de sans-gêne et de cynisme, c’est pourquoi on l’appelait le seigneur Diogène. Nous devons cette justice à Caliban, de dire qu’il n’était point envieux et qu’il savait gré à Diogène d’être encore plus malpropre que lui.
Le troisième ami intime, jeune homme d’une stature colossale, écuyer consommé sans avoir de chevaux, peintre sans talent, d’une ignorance crasse, mais excellent et honnête cœur, eût arpenté tout Paris pour rendre un service à son cher William qu’il aimait en bon camarade. Robuste comme un cuirassier, doué d’une force de poumons peu commune et doux comme un agneau, il menait souvent Olympe au parterre des théâtres, lorsqu’elle se déguisait en homme. Son habillement méritait le nom de costume. On y reconnaissait quelque chose approchant d’un pourpoint, des brandebourgs allemands, des olives polonaises, le pantalon à la cosaque, le manteau à la Henri III, le chapeau sombrero, le col de chemise en fraise. C’était une espèce de Franconi-Van Dyck. Au demeurant, le meilleur fils du monde, tapageur, gai comme un pinson, et n’ouvrant guère la bouche sans dire une drôlerie ou une ânerie. On l’appelait Hercule, don Stentor ou le Terre-Neuve. D’autres figures venaient se joindre à cette cour hétéroclite, mais avec moins d’assiduité.
Caliban, qui aimait les coins, s’était assis à terre entre la fenêtre ouverte et le rideau. Diogène préparait un grog fortement chargé d’alcool, tandis que le Terre-Neuve fumait un cigare, à cheval sur une chaise.
– William, dit le seigneur Diogène en tournant la cuiller pour faire fondre le sucre, j’ai à vous parler. Vous savez que Jean est mon plus intime et mon meilleur ami. Il nous manque à tous, et je ne puis croire que vous ne le regrettez pas vous-même. Son exil a duré assez longtemps, il faut le rappeler.
– Bien dit ! s’écria Hercule. Je soutiens Diogène ; je lui monte en croupe.
– Le moment de rappeler Jean n’est point encore venu, répondit Olympe. Les raisons de son exil me regardent : c’est une question dans laquelle je ne puis admettre d’autre juge que moi.
– Ces raisons, reprit Diogène, ne sont pas un mystère pour nous, et si vous voulez que nous en parlions à cœur ouvert, je vous prouverai bien qu’elles sont toutes en faveur du rappel.
– Parlez à cœur ouvert, afin que je vous comprenne.
– Eh bien, quand on a aimé un homme, le moins qu’on lui puisse laisser c’est un peu d’amitié.