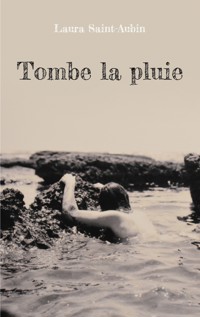Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Entre rêve et réalité. Entre noirceur et lumière. Entre psychologie et terreur. Sans un bruit est un livre touchant, trouvant un écho en chacun de nous. Traitant de la dépression liée à l'enfance et à la création de soi, mettant en lumière d'irrépressibles phobies tapies dans l'ombre, l'auteure partage avec une certaine sensibilité, une fiction sincère, dont de nombreux points sont autobiographiques. C'est avec cette histoire-thérapie qu'il est possible de commencer la guérison.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laura Saint-Aubin, trente ans, vit en Provence, en France. Elle est l'auteure de Sans un bruit, son premier ouvrage publié en auto-édition.
Je dédie ce premier livre (du moins le vrai premier) à mon Amour de toujours et à ma fille. Victor, pour ton soutien sans faille, pour ta bienveillance et ton amour, pour la personne que tu es. Une fois encore, merci de ton aide dans ce projet.
Et Rosie, pour m’avoir permis de trouver ma liberté, et de me trouver moi-même.
Je vous aime.
Never had a dream this lonely
Where did everybody go ?
Never had a dream this dark
Wake me up, let's make it so, Avatar
I'm gonna pull you down
I'll take you where it hurts (...)
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Waiting forevermore
All in vain
Nobody came, Avatar
Stand up and fight
Stand up and look into the light
Pushing the clouds away
Stand up and fight
Stand up and see the sky turn bright
Fight for a better day, Turisas
Sommaire
Une ombre
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Le déni
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
La colère
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
La dépression
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
L’acceptation
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Une ombre
1
La terreur qui n’a cessé de croître durant cette année 93, s’est imposée à moi, par un bel après-midi d’été, et depuis lors, ne m’a jamais quitté. En ce temps là, je faisais cuire des steaks bien gras au fast-food de l’autoroute, à la périphérie du village de Resist, durant les chaudes après-midis de ces interminables vacances d’été 93. Pas que ce boulot soit plaisant, bien au contraire, je pense qu’il faut être complètement fou - ou pas assez ambitieux - pour avoir envie d’y rester bosser plus de 2 mois. Mais comprenez-vous qu’il fallait bien continuer à rassembler un peu (beaucoup) d’argent si je voulais « me faire un avenir », comme disaient les gens d’ici. J’allais être bénéficiaire d’une bourse d’étude, mais cela ne pouvant pallier à tous les frais liés à ma scolarité, depuis mes seize ans, je travaillais à chaque vacances pour me constituer des économies.
J’avais donc l’ambition de quitter ce patelin de culs-terreux arriérés pour la ville et surtout pour l’Ecole Nationale Vétérinaire.
De tous, c’était le pire job, mais je ne rechignais pas à la tâche malgré les odeurs prenantes de gras, les supérieurs (et même les employés) qui vous prennent pour un esclave - pas le temps d’aller boire ou pisser durant le service - les conversations minables de vos collègues de travail, vos cheveux constamment poisseux par les émanations d’huile... le tout pour un contrat de 20H par semaine payé au SMIC ; pas cher payé pour cuire en même temps que ces satanés steaks. Autant vous dire qu’il fallait être plutôt motivée.
Dans mon cas, je n’ai pas eu le choix, ne pouvant compter sur l’aide de mes chers parents, il fallait que je me débrouille par moi-même, et puis, c’était la seule boîte qui ait bien voulu de moi.
Je n’avais alors que 18 ans lorsque c’est arrivé. J’étais une jeune « vieille » fille pour mon âge, très raisonnable, et extrêmement terre à terre.
Constamment la tête plongée dans les bouquins, je ne parvenais jamais à m’intégrer auprès mes semblables, et ce depuis l’enfance. Dernière d’une fratrie de cinq enfants, arrivée dans ce monde sans être désirée, avec quasiment vingt ans de retard, l’ironie du sort a finalement voulu que je devienne, contre mon gré, le bébé médicament de mes parents. Une sorte d’antidote à tous leurs manques et à toutes leurs faiblesses. Elevée en cage, à l'écart des autres, et même de mon frère et de mes soeurs - tous divisés par les parents - je ne parvenais pas plus à trouver une place au sein de cette famille toxique.
Les seuls intérêts qui occupaient tout mon temps étaient la musique rock et metal, le chant, et les études. Le chant était une sorte de thérapie, profondément enfoui en moi, mais totalement intériorisé. Je pensais ne pas trop mal me débrouiller, mais il me manquait une sacré bonne dose de confiance en soi pour pouvoir en faire quelque chose. Le metal me faisait un bien fou. Je pense que c’est en partie cette sincérité, cette énergie, cette colère, et ce refus de l’autorité, qui m’ont permis de supporter la vie à la maison.
Et en cette période, j’étais surtout concentrée sur les études, car voyez-vous, c’ était ma seule chance de réussir et ma seule chance de pouvoir quitter ce sombre nid.
Durant ce pénible mois d’août 93, nous vécûmes « un drame » familial qui accentua cette irrépressible envie de partir. Le vieux chien de la famille mourut. Un classique, me direz-vous, oui mais pas ici...
Parmi les maux et les peurs de mes parents, dont je faisais allusion plus haut, la maladie et la mort constituent deux horribles bêtes noires chez eux, et qui ont malheureusement fait partie intégrante dans l’éducation de leurs enfants. Qu’on le veuille ou non, on récupère les peurs de nos parents, des fois de nos grands-parents, jusqu’ à en prendre conscience et jusqu’à y mettre un terme.
Au cours de leur existence - qui se voulait différente et meilleure que celles de leurs parents avant eux - ils avaient, comme nous tous ici bas, vécus des épreuves, parfois réellement terribles, auxquelles ils n’avaient jamais fait face. Et au plus, ces expériences étaient terrifiantes, plus loin, toujours plus profond, ils enfonçaient la tête dans le sable, ne pouvant affronter la réalité.
Le passé était tabou, personne n’ osait jamais poser de question sur les sujets défendus - mais bien connus -, au risque de provoquer... (provoquer quoi au juste ? La dénégation ? Une explosion ?
L’effondrement des personnes ?), bref au risque, de rentrer dans des débats autant mouvants que du sable, autant engloutissants qu’une tornade.
Ainsi, ces peurs obscurcissaient un peu plus le tableau familial, déjà très sombre.
Fifi, une petite chienne issue d’un croisement de chien de berger, fut adoptée par mes parents pour « remplacer » leur ancien chien décédé.
Ainsi, elle fut le chien de la famille pendant un nombre respectable de 17 années. C’était une compagne de vie formidable, pas très jolie et assez caractérielle avec ses semblables et certaines personnes qu’elle ne « sentait pas », mais extrêmement intelligente et câline. N’ayant eu personne de mon âge avec qui jouer étant enfant, je l’ai pas mal embêtée, la déguisant, la prenant en photo... et elle m’a toujours laissé faire, même si son regard en disait parfois long sur le fait de lui faire porter un petit fichu de poupée. Ainsi, elle vieillissait pendant que moi je grandissais. Peu à peu elle subissait la dégénérescence naturelle du corps et de l’esprit que cause le temps. Et même la sur-médication, et même tous les efforts du monde n’ont pas pu arrêter cela. C’était triste, pour tout le monde, mais que pouvait-on bien y faire ? Pour mes parents, et encore un peu plus pour mon père, qui considérait réellement Fifi comme un sixième enfant - peut-être parfois plus aimée que certains d’entre eux -. Un sixième enfant qui resterait toujours à un stade de petit enfant, qui ne partirait pas de la maison, qui ne vous briserait pas le coeur ; avec vous quoi qu’il arrive. C’était un animal qui lui donnait de l’amour, un amour de substitution quand celui au sein du couple est inexistant et lorsque celui avec les enfants s’étiole...
Son déclin créait pour lui, un trop grand supplice.
Et lorsqu’elle vint à mourir, c’est un peu comme si une part de mon père était morte avec elle. Nous étions tous peinés, ce qui est normal, nous nous étions beaucoup attachés à elle depuis tout ce temps où elle avait partagée nos vies, mais mon père était totalement déprimé. Et cela dura... éternellement, je crois bien. Je pense, en mon for intérieur, que cette mort s’est, en quelque sorte, ajoutée à toutes celles dont il n’avait pas réussi à faire le deuil. Tous ces morts, tous ces vivants et tous ces regrets...
2
Voilà à peu près à quoi ressemblait une de mes journées-types de cet épuisant mois d’août 93. Je me levais vers 9H, déjeunant seule, sur l’énorme table de chêne massif de la salle à manger, un éternel bol de céréales au chocolat bourrées de sucre, avec un verre de jus d’orange en brique, pour faire descendre le tout. Seule dans le silence matinal, avec pour compagnie le tic-tac de la grosse horloge murale.
Ma mère ne descendait que vers 10 voire 11 H, les yeux oedémateux, pochés, bordés de cernes noires et profondes, témoignant d’une longue soirée de programmes télévisés sur les ovnis ou la vie après la mort... Sans même un « bonjour », elle avalait une ou deux madeleines et pestait d’être débordée, d’avoir le balai et la cuisine à faire, pendant que mon père glandait.
En réalité, il ne glandait pas, il s’échappait comme il le pouvait, se trouvant des prétextes pour pouvoir sortir de ces quatre murs bien épais. Il se levait chaque jour à 7H, prenait toujours un identique petit-déjeuner, se préparait, sortait en vélo chercher le pain, en empruntant son éternel chemin, et allait ensuite courir sur le même parcours... Sempiternellement.
Ainsi, je ne restais pas bien longtemps dans la même pièce que ma mère à son réveil, quitte à partir au travail plus tôt que prévu. Je prenais donc mon vélo dans le garage et pédalais plus ou moins doucement sur le chemin, selon l'heure à laquelle j’avais quitté la maison.
En général j’arrivais au fast-food en une dizaine de minutes, déjà transpirante de si bonne heure, à cause de la chaleur et de l'effort. Pendant que j’accrochais l’antivol au cadre de mon vélo, je jetais un rapide coup d’oeil à la terrasse du restaurant et voyais là, toujours la même image désespérante. Attablée, comme s’il s’agissait là d’un joyeux pique-nique, la troupe des équipiers qui allaient, comme moi, prendre leur service, riant à gorge déployée avec les managers et directeurs du restaurant - tous des faux-culs feignant d’être votre ami par devant et bavant sur votre compte dès que vous aviez le dos tourné-. Un troupeau d’éléphants, avec leurs gros culs, partageant, dans un vacarme épouvantable, à seulement 10H45, cet éternel repas composé d’un énorme hamburger de boeuf, de quantité de frites huileuses et beaucoup trop salées, et d’un demi-litre de soda, et ce, tous les jours. Peu importait l’heure, ici tout le monde bâfrait constamment et chacun tenait à prendre son menu qui lui était dû - en entier hein - par service.
De les voir s’empiffrer ainsi et sentant l’odeur poisseuse des bacs à huiles non vidangés, combinée à l’odeur de gras de boeuf, je ravalais une remontée acide, écoeurée.
Je me dirigeais directement aux vestiaires, saluant brièvement les personnes que je croisais au passage. La terrasse et la « salle de repos » (ah bon on a droit au repos là-bas ?) qui était en fait découpée en deux parties : le vestiaire, les toilettes d’un côté, et d’autre part un minuscule espace où un vieux canapé miteux avait été placé, avec une table et une petite télé - étaient les deux seuls endroits du restaurant où vous aviez le droit de discuter sans que l’on ne vous presse de trop (et encore). Ainsi se déroulaient toutes les conversations croustillantes - ou pas - sur qui à fait quoi, machin a dit ceci, machin a dit cela, etc, etc.
Je peux vous garantir qu’ici, il fallait faire extrêmement attention à ce que vous racontiez. La moindre petite information se voyait déformée dans un téléphone arabe géant. À part les étudiants, et il y en avait peu finalement, la plupart de mes chers collègues de travail n’avaient littéralement pas de vie. Ils prenaient sincèrement plaisir à venir ici écouter et raconter des saletés sur untel ou untel et à les colporter.
Me tenant à distance de tout ceci, je revêtais mon magnifique uniforme d’équipier polyvalent avec la jolie casquette visière qui va bien et le badge indiquant « en formation » sans oublier les sur-chaussures de plastique !
Puis quand l’heure du service approchait, tout ce petit cheptel venait se poster devant la pointeuse - une horrible machine comptabilisant les heures de chacun des employés - avec sa petite carte personnelle, gloussant perpétuellement comme des dindons, se faisant des vannes graveleuses, ou se moquant de la place que chacun allait devoir occuper durant « le rush ». En effet, on prenait connaissance de la fonction qui nous avait été attribuée pour le service, avec le grand tableau blanc de l'entrée - schéma préparé par un manager à la manière ridicule d’un savant plan de guerre Chacun se parait ensuite d’une charlotte en filet pour retenir les cheveux et d’un tablier jetable en plastique. Puis, le troupeau attendait que les secondes passent, les yeux rivés sur la machine de malheur.
A chaque heure de pointe, c’ était identique, les gens étaient dans les starting-block, bien décidés à pointer dans les premiers afin d’être certains de ne pas perdre une seule minute sur leur salaire.
Ensuite, lavage de mains militaire à la queue-leu-leu et en vitesse et instantanément votre référent du jour, s’occupant de mener son équipe pour « le rush », vous hurlait dessus « MACHIN A TA PLACE » ainsi qu’ une cadence à respecter.
Vous pouviez être seul à votre poste ou par deux, voire trois - ce qui était bien pire que d’être seul, surtout selon avec qui vous bossiez -.
C’est donc de cette manière que le service démarrait, des robots cuisant et assemblant des hamburgers, ou faisant frire des frites ou des nuggets... Si cette petite armée de bons soldats avait bien travaillé durant « le rush », le manager responsable payait alors sa tournée d’eau pour tout le monde ! Merveilleux !
Ainsi se déroulait un service, où la cadence se calmait tout de même un peu - heureusement -, généralement après 13H et se poursuivait jusqu’à 15H. Ensuite, même principe, on dépointait, jetait son tablier et sa charlotte à la poubelle puis on se lavait les mains et filait aux vestiaires. Et là, une fois encore, vous aviez droit au compte rendu de tout le monde sur tout le monde, et ce dès les vestiaires jusqu’au repas de groupe. Je ne m’y joignais évidemment jamais et reprenais tout de suite mon vélo pour rentrer chez moi.
Chez moi, où ne m’attendait aucun repas, aucun accueil, rien en fait. Fatiguée, je me préparais moi-même un petit repas rapide - au départ en tous cas, jusqu’à ce que cela devienne trop lourd, et que j’abandonne, après ces quatre heures à « cuisiner ». Je finissais alors par emporter un repas du fast-food et le mangeais une fois rentrée.