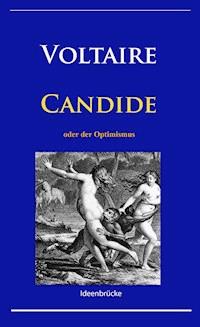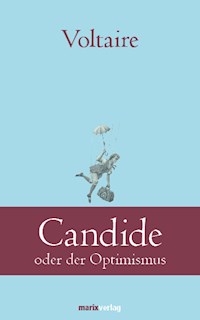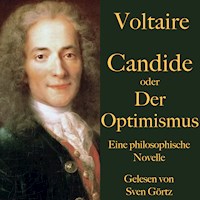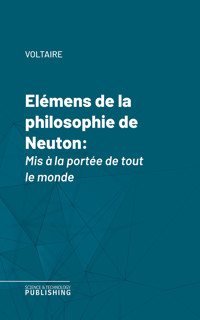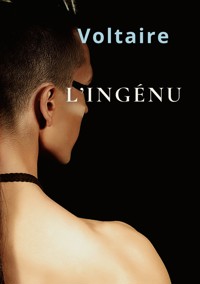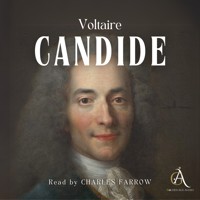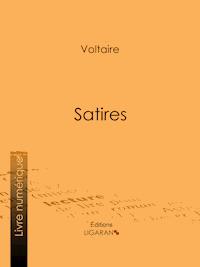
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Pour tous rimeurs, habitants du Parnasse, De par Phébus il est plus d'une place : Les rangs n'y sont confondus comme ici, Et c'est raison. Ferait beau voir aussi, Le fade auteur d'un roman ridicule, Sur même lit couché près de Catulle ; Ou bien Lamotte ayant l'honneur du pas, Sur le harpeur ami de Mécénas : Trop bien Phébus sait de sa république, Régler les rangs et l'ordre hiérarchique ; Et, dispensant honneur et dignité, Donne à chacun ce qu'il a mérité."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091274
©Ligaran 2015
(1714)
POUR LE MONDAIN ET LA DÉFENSE DU MONDAIN
Ces deux ouvrages ont attiré à M. de Voltaire les reproches non seulement des dévots, mais de plusieurs philosophes austères et respectables. Ceux des dévots ne pouvaient mériter que du mépris ; et on leur a répondu dans la Défense du Mondain. Toute prédication contre le luxe n’est qu’une insolence ridicule dans un pays où les chefs de la religion appellent leur maison un palais, et mènent dans l’opulence une vie molle et voluptueuse.
Les reproches des philosophes méritent une réponse plus grave. Toute grande société est fondée sur le droit de propriété ; elle ne peut fleurir qu’autant que les individus qui la composent sont intéressés à multiplier les productions de la terre et celles des arts, c’est-à-dire autant qu’ils peuvent compter sur la libre jouissance de ce qu’ils acquièrent par leur industrie ; sans cela les hommes, bornés au simple nécessaire, sont exposés à en manquer. D’ailleurs l’espèce humaine tend naturellement à se multiplier, puisqu’un homme et une femme qui ont de quoi se nourrir et nourrir leur famille élèveront en général un plus grand nombre d’enfants que les deux qui sont nécessaires pour les remplacer. Ainsi toute peuplade qui n’augmente point souffre, et l’on sait que dans tout pays où la culture n’augmente point, la population ne peut augmenter.
Il faut donc que les hommes puissent acquérir en propriété plus que le nécessaire, et que cette propriété soit respectée, pour que la société soit florissante. L’inégalité des fortunes, et par conséquent le luxe, y est donc utile.
On voit d’un autre côté que moins cette inégalité est grande, plus la société est heureuse. Il faut donc que les lois, en laissant à chacun la liberté d’acquérir des richesses et de jouir de celles qu’il possède, tendent à diminuer l’inégalité ; mais si elles établissent le partage égal des successions ; si elles n’étendent point trop la permission de tester ; si elles laissent au commerce, aux professions de l’industrie, toute leur liberté naturelle ; si une administration simple d’impôts rend impossibles les grandes fortunes de finance ; si aucune grande place n’est héréditaire ni lucrative, dès lors il ne peut s’établir une grande inégalité ; en sorte que l’intérêt de la prospérité publique est ici d’accord avec la raison, la nature et la justice.
Si l’on suppose une grande inégalité établie, le luxe n’est point un mal ; en effet, le luxe diminue en grande partie les effets de cette inégalité, en faisant vivre le pauvre aux dépens des fantaisies du riche. Il vaut mieux qu’un homme qui a cent mille écus de rente nourrisse des doreurs, des brodeuses ou des peintres, que s’il employait son superflu, comme les anciens Romains, à se faire des créatures, ou bien, comme nos anciens seigneurs, à entretenir de la valetaille, des moines, ou des bêtes fauves.
La corruption des mœurs naît de l’inégalité d’état ou de fortune, et non pas du luxe : elle n’existe que parce qu’un individu de l’espèce humaine en peut acheter ou soumettre un autre.
Il est vrai que le luxe le plus innocent, celui qui consiste à jouir des délices de la vie, amollit les âmes, et, en leur rendant une grande fortune nécessaire, les dispose à la corruption ; mais en même temps il les adoucit. Une grande inégalité de fortune, dans un pays où les délices sont inconnues, produit des complots, des troubles, et tous les crimes si fréquents dans les siècles de barbarie.
Il n’est donc qu’un moyen sûr d’attaquer le luxe ; c’est de détruire l’inégalité des fortunes par les lois sages qui l’auraient empêché de nuire. Alors le luxe diminuera sans que l’industrie y perde rien ; les mœurs seront moins corrompues ; les âmes pourront être fortes sans être féroces.
Les philosophes qui ont regardé le luxe comme la source des maux de l’humanité ont donc pris l’effet pour la cause ; et ceux qui ont fait l’apologie du luxe, en le regardant comme la source de la richesse réelle d’un État, ont pris pour un bon régime de santé un remède qui ne fait que diminuer les ravages d’une maladie funeste.
C’est ici toute l’erreur qu’on peut reprocher à M. de Voltaire ; erreur qu’il partageait avec les hommes les plus éclairés sur la politique qu’il y eût en France, quand il composa cette satire.
Quant à ce qu’il dit dans la première pièce, et qui se borne à prétendre que les commodités de la vie sont une bonne chose, cela est vrai, pourvu qu’on soit sûr de les conserver, et qu’on n’en jouisse point aux dépens d’autrui.
Il n’est pas moins vrai que la frugalité, qu’on a prise pour une vertu, n’a été souvent que l’effet du défaut d’industrie, ou de l’indifférence pour les douceurs de la vie, que les brigands des forêts de la Tartarie poussent au moins aussi loin que les stoïciens.
Les conseils que donne Mentor à Idoménée, quoique inspirés par un sentiment vertueux, ne seraient guère praticables, surtout dans une grande société ; et il faut avouer que cette division des citoyens en classes distinguées entre elles par les habits n’est d’une politique ni bien profonde ni bien solide.
Les progrès de l’industrie, il faut en convenir, ont contribué, sinon au bonheur, du moins au bien-être des hommes ; et l’opinion que le siècle où a vécu M. de Voltaire valait mieux que ceux qu’on regrette tant n’est point particulière à cet illustre philosophe ; elle est celle de beaucoup d’hommes très éclairés.
Ainsi, en ayant égard à l’espèce d’exagération que permet la poésie, surtout dans un ouvrage de plaisanterie, ces pièces ne méritent aucun reproche grave, et moins qu’aucun autre celui de dureté ou de personnalité que leur a fait J.-J. Rousseau ; car c’est précisément parce que le commerce, l’industrie, le luxe, lient entre eux les nations et les états de la société, adoucissent les hommes, et font aimer la paix, que M. de Voltaire en a quelquefois exagéré les avantages.
Nous avouerons avec la même franchise que la vie d’un honnête homme, peinte dans le Mondain, est celle d’un sybarite, et que tout homme qui mène cette vie ne peut être, même sans avoir aucun vice, qu’un homme aussi méprisable qu’ennuyé ; mais il est aisé de voir que c’est une pure plaisanterie. Un homme qui, pendant soixante et dix ans, n’a point peut-être passé un seul jour sans écrire ou sans agir en faveur de l’humanité, aurait-il approuvé une vie consumée dans de vains plaisirs ? Il a voulu dire seulement qu’une vie inutile, perdue dans les voluptés, est moins criminelle et moins méprisable qu’une vie austère employée dans l’intrigue, souillée par les ruses de l’hypocrisie, ou les manœuvres de l’avidité.
K.
(1736)