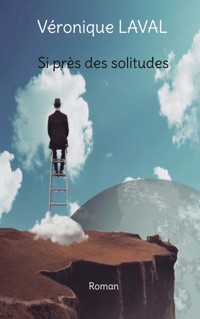
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quelles motivations ont poussé Maeva, originaire de Marseille, à s'exiler dans un monastère perdu dans les montagnes du Bhoutan ? Quand, Léo, jeune écrivain en mal d'inspiration voyage en Inde puis au Bhoutan et gravit les marches jusqu'au lieu sacré où il espère trouver dans cette aventure un nouveau souffle pour son futur roman, il n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'il rencontre la vieille nonne qui lui raconte son histoire. Le récit de Maeva ramène Léo vers son pays d'origine, la France. De Marseille à Nouméa, les personnages évoluent autour des rebondissements qui ponctuent leur existence où la trahison, l'attente, le doute et la désillusion s'enchevêtrent. Ce roman à l'instar d'une promenade philosophique évoque la solitude sous plusieurs angles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Roman
La trace d'un inconnu - 2021
Depuis longtemps, je vivais au Bhoutan dans le monastère de Taktshang niché dans l’Himalaya oriental à l’est du Népal au cœur de la vallée de Paro. Accroché à une falaise de 3 120 mètres d’altitude à 700 mètres au-dessus du vide, il dominait sur la montagne. Il semblait avoir poussé dans la roche et être retenu par les racines profondément ancrées au milieu de la végétation qui l’encerclait. Aucun bus ni taxi ne desservait le lieu surnommé « le monastère du nid du tigre ». On ne pouvait y accéder qu’en marchant ou en voyageant à dos d’âne. Le sentier montait dans une forêt de chênes puis de pins jusqu’à une plateforme où des moulins et des drapeaux de prières accueillaient les pèlerins. De là, le coup d’œil sur le Taktshang laissait les visiteurs sans voix face au paysage comparable à une peinture chinoise. Au terme de trois heures d’effort, il fallait emprunter un chemin encore plus escarpé à pied, puis gravir un gigantesque escalier en colimaçon avant la récompense d'une vue panoramique à couper le souffle qui englobait un complexe de plusieurs temples.
La bâtisse impressionnait par la puissance de la tour centrale et par la richesse ornementale des éléments architecturaux entourant la cour : piliers, colombages, galeries, madriers avaient subi un incendie en 1998. Une bonne partie des trésors du lieu, notamment des statues et des peintures anciennes, avaient été entièrement reconstruits. Les hauts murs blancs des sept temples, les toits aux rives retroussées en forme de pagode, les portes d’entrée massives, les fenêtres ourlées de bois faisaient voler en éclats tout préjugé sur l'absence de civilisation. De nombreux fidèles s’y rendaient en ce dimanche pour recevoir une bénédiction et déposer leur offrande.
À l’aube de mes quatre-vingts printemps, j'ai croisé ce jour-là un jeune homme. Essoufflé, il semblait perdu. Quand je me suis approchée de lui, mon crâne rasé et mon vêtement, une robe pourpre drapée attisait sa surprise. Ma physionomie ne correspondait pas à ses attentes. J’avais l’habitude des regards interrogateurs que me jetaient les visiteurs. Comme tant d’autres, le jeune homme, pensait rencontrer des faciès burinés aux yeux bridés, croiser des pommettes saillantes rougies par le froid, des êtres atypiques et étrangers à ceux qu'il avait coutume de voir. Lui aussi venait d’occident. Il comptait parmi ces innombrables touristes que j’accueillais. Je l’ai invité à me suivre et me suis exprimée dans ma langue d’origine, le français.
— Êtes-vous venu faire une retraite, suivre les enseignements ?
— Non, a-t-il répondu.
— Je vis ici depuis… Oh ! La durée de ma vie dans ce monastère n’a pas d’importance. Il paraissait inquiet que je m’adresse à lui en ces termes. La nonne en face de lui semblait perdre la tête. « La notion du temps n’a aucun intérêt », ai-je ajouté pour lui signifier que je gardais intactes toutes mes facultés mentales. Quelle raison l’avait poussé à grimper ces marches ? Il demeurait évasif, incertain dans sa réponse. Cette excursion devait se charger de le surprendre. Il avait d’abord traversé le nord de l’Inde avant d’arriver au Bhoutan puis dans ce lieu recommandé.
Il considérait le dépaysement comme une banalité dans un pays où tout était à découvrir. À son sens, tout voyageur ordinaire ressentait à peu près la même excitation face à l’inconnu. Il s’appelait Léo, un écrivain en quête d’émotion. Il ne semblait pas inspiré. Peut-être cherchait-il à publier son prochain livre sur le bouddhisme ? En vérité, un thème le hantait, la solitude. En venant ici, il était convaincu d’arriver au cœur de ses espérances. La solitude n’existait pas dans cet endroit et il l’ignorait autant qu’il se trompait. Habiter dans un monastère relevait d’un véritable choix. Je menais une vie loin de tout au sein d’une communauté, mais je ne me sentais pas seule. Quel sens donnait-il à ce mot ? Je n’étais pas née dans ce lieu et ma jeunesse s’était déroulée ailleurs. Mes propos engendraient son malaise, on aurait dit qu’il avait envie de faire demi-tour et de dévaler la montagne en sens inverse. Il n’avait jamais médité, ne connaissait pas le bouddhisme. Sans lui laisser le temps de reconnaître son ignorance, j’ai affirmé : « La curiosité attire beaucoup de monde par ici, certains présomptueux gravissent les sommets et chutent au fond du ravin. Les sept temples peuvent tous se visiter. Le site sacré a été construit en 1692 autour d’une grotte située à trois cents mètres au-dessus du monastère, appelée « la tanière du tigre ». Au VIIIe siècle, Guru Rinpoché y avait médité durant trois ans, trois mois, trois semaines, trois jours et trois heures. Il serait venu à dos de tigresse du Tibet pour convertir la région au bouddhisme ». Léo m’écoutait. Sans tenir compte des turpitudes internes de l’écrivain, je lui ai raconté l’histoire d’un jeune moine, un enfant que son maître éduquait à la méditation. Il lui avait conseillé de fixer son attention sur sa respiration pour l’aider à se concentrer. L’enfant, agacé, l’avait regardé et s’était rebellé : « J’en ai marre de m’appliquer à inspirer et à expirer ». À ces mots, le maître lui avait ordonné de le suivre. Il l’avait l’entraîné au bord d’une rivière, lui avait demandé de se mettre à genoux et de pencher la tête au-dessus de l’eau. Au même instant, il avait plaqué sa main à l’arrière de la tête du jeune moine et l’avait immergé en la maintenant fermement sous l’eau quelques minutes. Le garçon s’était débattu et le maître avait relâché son emprise avant de l’interroger : « Alors, tu en as toujours assez d’inspirer et d’expirer ? » De cette fable, le jeune moine devait tirer cet enseignement : On peut comparer chacune de nos respirations à une seconde de notre vie, notre existence ne tient qu’à ce souffle permanent qui entre et sort de notre corps.
Après j’ai demandé : « Combien de temps comptez-vous rester » ? Il n’en avait aucune idée non plus. Ce garçon me plaisait. Son air paumé, indécis, me séduisait et m’émouvait. Je songeais à m’impliquer dans son projet d’écriture. Je lui ai soufflé l’idée de retracer mon passé qui pourrait devenir l’objet de son prochain livre.
Ma suggestion surprenante correspondait à l’objectif de son aventure. J’ai pris sa main et l’ai serrée en me présentant : « Je m’appelle Maeva ». Mais des conditions s’imposaient pour toute la durée de son séjour. Il aurait l’obligation d’apporter son aide au sein de la communauté. L’air circonspect, il attendait mes instructions. Il préparerait les repas, participerait aux tâches ménagères, jardinerait. Aucune de ces besognes, même familières, ne lui semblait évidente. Et s’il le désirait, il expérimenterait la méditation. Malgré mes exigences et son manque de pratique dans les travaux qu’il aurait à assumer, il a conclu :
— C’est entendu, je reste.
Le prenant par le bras, je l’ai entraîné derrière moi.
***
Léo a passé sa première nuit dans un des logements réservé aux moines. C’était la première fois qu’il dormait dans un temple. Lorsqu’il a enfin pu ôter ses chaussures, il a ressenti un vif soulagement. Il souffrait d'ampoules aux pieds. Les yeux ouverts, il ne parvenait pas à tomber dans les bras de Morphée, il s’imprégnait du lieu, ne comprenait pas encore ce qu'il vivait. Dans le silence environnant, il se frayait un chemin vers la sérénité. Le froid piquait sa peau, la couverture remontée sur les épaules, il s’est recroquevillé en chien de fusil. Il a enfin fermé les paupières et a glissé dans le sommeil. Il s’est réveillé en pleine nuit, désorienté, effrayé de ne plus se rappeler pourquoi il dormait dans ce lit inconfortable. Le lendemain, il découvrait que les jeunes moines entraient au monastère entre six et neuf ans. Placés sous la tutelle d’un proviseur, ils apprenaient à lire le chokey, la langue sacrée des textes anciens ainsi que le dzongkha et l’anglais. Ils devaient choisir entre deux axes : étudier la théologie et la théorie bouddhiste ou prendre la voie la plus commune qui consistait à servir dans les rituels et dans les pratiques personnelles de la foi.
Leur quotidien se déroulait dans l’austérité du monastère où ils devaient s’habituer à se nourrir avec parcimonie et à vivre sans chauffage. Léo détectait maintenant l'origine du froid qui l’avait réveillé. L’absence d’eau chaude rendait les conditions de vie spartiates, même les sanitaires équivalaient à de simples trous dans la terre. La formation spirituelle se poursuivait tout au long de leur existence. En plus de servir la communauté dans des rôles sacramentelle, les moines pouvaient entreprendre plusieurs retraites silencieuses, d’une durée de trois ans, trois mois, trois semaines et trois jours. Puis je l'ai conduit à l’intérieur des temples où des fleurs de lotus, la roue de la vie, des mandalas cosmiques, le vieillard de longue vie, les quatre amis d’une beauté artistique inouïe aux couleurs riches recouvraient murs et plafonds peints. Des statues de Guru Rinpoché, le père du bouddhisme au Bhoutan, considéré comme le second Bouddha, mais aussi une oeuvre de la divinité Tamdin, qui prend soin des nouveau-nés, siégeaient dans le lieu. Des tankas ornaient la façade au fond de l’autel coiffé d’un tissu jaune d’or brillant posé sur un brocard rempli de figurines et d’offrandes : des lampes à beurre, sept bols en cuivre plein d’eau, fleurs, encens, pierres semi-précieuses…
Les moines renonçaient à leurs possessions et aux attachements extérieurs. Pour symboliser d’un signe fort leur consécration entière à la spiritualité, ils se rasaient le crâne. Leur mode de vie simple se reflétait aussi dans leurs habits. Composé d’une robe, l’uttarasanga, d’un pagne, le antaravasaka, d’une toge, le sanghati, l’ensemble de couleur orangée s’appelait civara. Alors qu’ils avaient renoncé à leurs biens personnels, ils possédaient malgré tout un bol pour recevoir les offrandes, un rasoir, une aiguille et un filtre à eau. Au sein de leur habitation sommaire, certains moines passaient la nuit à même le sol sur un tapis souvent peu épais, seul ou dans un dortoir à plusieurs.
Leur journée commençait entre trois heures et quatre heures du matin. Dès le réveil, ils nettoyaient leur chambre et entamaient une séance de méditation et de prière. En silence, leur bol sur l’épaule, ils quittaient le cloître pour traverser le village. Ils dépendaient de la générosité de la population qui, à leur passage, remplissait leur écuelle de riz, de fruits, de gâteaux secs… De retour au monastère, ils prenaient le premier repas. Une autre séance de méditation et de prière débutait avant un second repas en fin de matinée, le dernier de la journée. Parfois, ils ne prenaient qu’un repas en vingt-quatre heures. L’après-midi, les moines s’affairaient autour d’activités qui incluaient l’enseignement du bouddhisme, une instruction scolaire, l’entretien du lieu et de son terrain. Ils étaient autorisés à pratiquer des travaux manuels et artisanaux. La méditation et la prière venaient clôturer la fin de leur journée.
***
Né à Reims, l’enfance de Léo s’était déroulée auprès d’un père vigneron et d’une mère infirmière. Le couple et leur fils partageaient la grande maison familiale avec les grands-parents paternels du jeune garçon. Après le décès du grand-père de Léo, son père avait repris l’exploitation viticole qui comptait plus de deux hectares dans sa totalité. Virginie, originaire du nord de la France, avait suivi une formation d’infirmière de bloc opératoire. Elle avait rencontré son mari Bernard au CHU de Reims. Durant six années, elle avait poursuivi sa profession tout en l’accompagnant dans son activité de viticulteur. Tenue aux astreintes, aux gardes et aux urgences médicales, elle s’était heurtée aux difficultés d’assumer deux métiers en parallèle. Victime d’épuisement, elle avait reconsidéré le calendrier de l’infirmière avec celui de l’exploitation. À l’hôpital, son travail à mi-temps lui seyait jusqu’au jour où sa hiérarchie lui avait demandé de reprendre son poste à temps complet pour les besoins du service. Compte tenu de l’organisation personnelle mise en place par le couple, la décision de quitter l’hôpital devenait inéluctable. Ensuite, l’entreprise n’avait cessé de prospérer.
Sa mère aimait le contact avec la clientèle, son père préférait fouler la terre. Virginie s’occupait donc de la vente, de l’expédition des bouteilles et des charges administratives. La tentative des parents de transmettre à Léo leur vocation pour qu'il reprenne le flambeau avait échoué. L’adolescent ne possédait pas l’engouement de ses proches pour les vignes. Il souhaitait devenir journaliste. Malgré leur déception, Virginie et Bernard avaient respecté et accepté son choix. Après ses années d’études, Léo avait travaillé dans la presse régionale. Mais très vite, griffonner des articles sur l’actualité l’avait lassé. Dans ce contexte, il ne parvenait pas à exprimer sa créativité aussi librement qu’il l’avait envisagé. Il rêvait d’écrire un roman. Deux ans plus tard, il publiait son premier livre.
Après trois ouvrages, son inspiration s’est essoufflée. À cette époque, dans l’expectative de voyager, il avait décidé de prendre une année sabbatique, comptant bien sur le pouvoir des péripéties de son aventure pour le stimuler et se réinventer.
Chaque jour, respectueux de ses obligations, Léo participait aux tâches domestiques. Le soir, une fois son travail accompli, il me retrouvait dans le jardin du monastère après la dernière méditation. Là, je lui offrais un thé au lait aromatisé d’un mélange de gingembre, laurier, cardamome et cannelle et des gâteaux. Puis il enclenchait son enregistreur.
Sommaire
PREMIERE PARTIE
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CHAPITRE 4
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE 5
CHAPITRE 6
CHAPITRE 7
CHAPITRE 8
CHAPITRE 9
CHAPITRE 10
CHAPITRE 11
TROISIEME PARTIE
CHAPITRE 12
CHAPITRE 13
CHAPITRE 14
CHAPITRE 15
CHAPITRE 16
CHAPITRE 17
CHAPITRE 18
QUATRIEME PARTIE
CHAPITRE 19
CHAPITRE 20
CHAPITRE 21
PREMIERE PARTIE
La solitude sur les routes
« Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie » Confucius
- 1 -
Le récit de Maéva
Par un week-end d’automne, à cette période présageant la fin d’un cycle de vie, où pourtant toute la nature flamboie, où d’immenses taches jaunes, rouges, vertes et brunes tapissent le paysage, mon regard rêveur chevauchait à travers cette myriade de couleurs éparpillées que lui offrait l’arrière-saison. Comme toutes les fins de semaine, mon père Joris retrouvait ma mère Clarisse et moi-même. Comme toutes les fins de semaine, après avoir parcouru des milliers de kilomètres sur le bitume de l’Europe, il manifestait son bonheur de nous revoir malgré la fatigue. Depuis vingt ans, pour rien au monde, il n’aurait désiré exercer un autre métier, et ce, en dépit des contraintes et des inconvénients qu’il causait au sein de sa famille. Après son mariage, à ma naissance, la situation s’était compliquée. Ma mère tentait désespérément de le convaincre sinon de choisir un autre travail, mais tout au moins de ne plus partir des semaines entières sur les routes.
Elle rêvait de passer ses soirées en tête-à-tête avec Joris. Malheureusement, tous ses efforts pour l’amener à changer d’avis demeuraient vains. Je souffrais autant que ma mère de l’absence de mon père. Elle jugeait leur niveau de vie médiocre. Il la confrontait à ses contradictions. S’il acceptait son idée, sa rémunération diminuerait. Cette énième discussion a débouché sur une dispute. Le salaire plus élevé qu’il percevait ne leur permettait même pas de s’évader un peu le week-end puisqu’il revenait épuisé de sa semaine. Un revenu inférieur n’aurait pas changé grand-chose, mais au moins, Joris serait rentré tous les soirs. « Tu ne te rends plus compte du manque d’initiative dont tu fais preuve. Tu te complais dans ta monotonie », lui reprochait-elle. Rester à Marseille pesait lourd dans la vie que menait Clarisse. Elle rêvait de voyager et à défaut de grand projet pour les vacances, elle se serait contentée d’une escapade le week-end.
On aurait pu croire que Joris était né dans un camion. Enfant, sa passion pour les poids lourds lui tournait déjà la tête. Un intérêt qui avait traversé son adolescence et avait tenu sa promesse jus-qu’à l’âge adulte puisqu’il en avait fait sa profession. Une évidence pour lui. Il savourait son autonomie. Derrière le volant de son camion, il ne connaissait pas la monotonie. Même s’il demeurait prisonnier dans sa cabine où il passait les trois-quarts de sa vie, le paysage qui défilait sous ses yeux suffisait à combler son désir de liberté, il se sentait à l’unisson avec la nature qu’il ne touchait pourtant que du regard. Il admirait le célèbre navigateur Olivier de Kersauson dont il avait suivi toutes les courses, sa carrière ne possédait plus aucun secret pour lui. Je pense que mon père Joris aurait aimé s’appeler Cousteau, Tabarly ou Des-joyeaux. Mais voilà, en guise de bateau, il possédait un camion et il naviguait sur des rubans de goudron solide et dur aplati au rouleau compresseur. Solitaire dans l’âme, il n’aurait pu supporter de vivre la lassitude qu’engendrerait un quotidien différent du sien. Il fuyait par exemple l’idée de travailler dans un bureau. Il n’aurait pas accepté non plus que la monotonie s’installe au sein de son ménage. Ne plus savoir quoi raconter à sa femme en rentrant chez lui le soir l’exaspérerait. Bizarrement, il ne redoutait pas l’ennui sur la route, au contraire, rouler l’excitait. Ne parler à personne du matin au soir ne l’effrayait pas. Il retrouvait l’usage de la parole au moment de son rendez-vous hebdomadaire avec nous. Il aimait écouter ma mère raconter le déroulement de sa semaine comme si elle narrait l’histoire de quel-qu’un d’autre. Ses anecdotes journalières se transformaient en un récit où la banalité du quotidien s’envolait. Il buvait ses paroles comme quelqu’un qui s’installe devant sa série préférée. Il n’aurait pas supporté de devenir le réceptacle de ses contrariétés au travail. Elle ne l’aurait sans doute même pas regardé en lui parlant, ce qui aurait agacé mon père. Tandis que là, elle s’asseyait en face de lui, gaie, heureuse, et confiait les bons et les mauvais moments qu’elle avait endurés, et même quand elle relatait un épisode irritant, son visage restait serein et conservait le sourire les yeux rivés dans ceux de Joris. Voilà toute la différence qu’il aimait savourer. Chauve, il approchait la quarantaine, d’épais sourcils châtains ourlaient ses paupières. Sans doute à cause de son crâne dépourvu de cheveux, ils paraissaient plus fournis au-dessus de ses pupilles noires. Il portait une moustache et un bouc lui faisait écho.
La location de notre appartement dans le 10e arrondissement de Marseille se transformait en un véritable poulailler. Les paroles fusaient de toutes parts entre les murs. Notre quartier très calme se situait dans une zone péri-industrielle. La joie qu’éprouvait mon père à se retrouver parmi nous lui faisait oublier son épuisement hebdomadaire. Je détestais les dimanches soir. Bien que je sois rodée à son absentéisme, son départ le lundi matin laissait notre demeure amputée pour les cinq jours suivants. Je vivais une situation incomparable à celle des filles du collège. Dans la cour de récréation, le lundi matin je m’autorisais une entrée en scène enthousiaste après les deux jours où la présence de mon père m’avait ragaillardie. Je me mêlais aux conversations, complice de mes amies, je libérais tout ce que je renfermais ensuite dans mon for intérieur. C’était la journée de mon intégration dans le groupe. Le reste de la semaine, envieuse et à l’écart de leurs éclats de rire, j’écoutais mes camarades poursuivre leurs échanges sur leurs veillées en famille. Je me montrais incapable d’adhérer à leur délire, d’autant qu’avec ma mère, mes soirées ressemblaient à une mer d’huile. Leurs bavardages me renvoyaient à cette différence et à cette scission dont la violence involontaire de leur part me poussait au retranchement. Elles me reprochaient mes silences, leur incompréhension et leurs accusations se rajoutaient à ma tristesse. Elles n’imaginaient pas à quel point je rêvais d’une famille comme la leur.
Parfois, hors de l’autorité scolaire, notre liberté retrouvée, mes camarades et moi, nous promenions dans le quartier de la Plaine. Nous traversions les rues aux murs colorés par le street art, nous flânions sur les marchés avant de rejoindre le vieux port. Entre le cours Julien et la place Jean Jaurès, les allées regorgeaient de graffitis. Nous en profitions pour regarder les boutiques et nous nous arrêtions pour boire un verre dans un bar sur la place Notre-Dame du Mont. Quelquefois, nous errions au cœur du quartier historique, le plus ancien et le plus touristique de la ville. Il ressemblait à un village provençal avec ses artères étroites et ses façades colorées caché au milieu de la ville marseillaise. Ses rues regorgeaient de créateurs et d’artisans pour le bonheur des passants. Ici aussi, le street art restait ubiquiste.
Ma mère travaillait dans l’hôtellerie. Son métier d’hôtesse d’accueil exigeait d'elle une grande disponibilité. Certains week-ends, mes parents ne faisaient que se croiser et ne partageaient que quelques heures ensemble. Mon père la rejoignait sur le lieu de son travail à l’heure du déjeuner. Ce week-end-là où nous avions la chance d’être réunis tous les trois, mes parents avaient prévu une promenade dans la forêt de Saint-Pons. À la fraîcheur matinale, munis d’un pique-nique, nous avons quitté l’appartement afin d’y passer le dimanche. En traversant la forêt, une étendue de feuilles desséchées jonchait le sol. Des rais de soleil se faufilaient formant de belles diagonales entre les arbres. Nos pas crissaient sur la masse végétale qui avait perdu l’éclat de sa palette automnale devenue terne à l’approche de l’hiver. Tout se déroulait bien jusqu’à ce que ma mère, qui semblait radoter, relance mon père. Où qu’elle se trouve, elle ne parvenait plus à retenir son obsession de voyager. Bien sûr, à Marseille, la mer et le soleil offraient un environnement et une qualité de vie exceptionnelle. À quelques kilomètres, les calanques qui s’étendaient sur plus de vingt kilomètres de côtes cachaient une succession d’anses et de criques où se baigner dans la Méditerranée. Mais elle rêvait de destinations lointaines, de dépaysement. Elle étouffait dans sa vie sans projets. Pensant détendre l’atmosphère, mon père croyait de bon augure de déclencher une ambiance plus légère en plaisantant : « tu aimes l’aventure, de quoi te plains-tu, tu vis avec un baroudeur ! » Ce qui au lieu d’amener un sourire sur son visage l’a fortement agacé : « Tu parles d’un aventurier ! Tu te prends pour Indiana Jones alors que tu passes ton temps dans un camion ! Tu mélanges tout, moi, je rêve de vrais voyages en famille, de vacances ! » L’humour lourd et plein de mauvaise foi de mon père marquait sa volonté de ne pas ranimer une conversation maintes fois répétée. Ils ne parvenaient pas à se mettre d’accord. Lui, pensait qu’elle exagérait, elle, croyait brasser de l’air face à un mari qui ne l’écoutait pas. Certes, ils ne roulaient pas sur l’or, mais tout de même, ils vivaient sous un toit digne de ce nom, mangeaient à leur faim tous les jours. Mais possédaient-ils les économies leur permettant d’organiser un voyage onéreux ? Sans doute que non. Marseille et ses alentours contentaient mon père qui se satisfaisait de peu. Il ne s’incluait pas parmi les personnes qui projettent de parcourir le monde ni ne possédait la curiosité suffisante pour l’envisager. Le tempérament vagabond de ma mère s’opposait au sien, plus prosaïque. Cependant, sous son écorce, il craignait de perdre Clarisse. Il se rendait bien compte du fossé qui se creusait. Il avait cru à une lubie de sa femme, à une crise passagère, fugace. Maintenant, il avait la certitude que sa manière de penser à lui devenait obsolète. Bien que les occasions de se disputer demeurent rares puisqu’ils se voyaient peu, ma mère se servait de ce temps imparti pour le blâmer. Ils auraient sans doute déjà divorcé s’ils se côtoyaient tous les jours. Leur couple s’asphyxiait. Ce jour-là, je les avais devancés, les abandonnant à leur querelle. Arrivée près de la belle cascade, je me rafraîchissais les mains sous le jet d’eau en attendant qu’ils me rejoignent.
Quand Joris retournait le lundi matin dans l’entreprise de transport agroalimentaire, le jour n’était pas encore levé. Cette fois-ci, il partait dans le sud de l’Italie. Il connaissait la plupart de ses clients en Europe. Ses fonctions ne se limitaient pas à la conduite, il veillait aussi au bon chargement de son véhicule, calculait le meilleur itinéraire jusqu’à son point de livraison et se souciait de satisfaire les acheteurs. Mon père misait tout sur la qualité de ses prestations. À l’aide d’un hayon élévateur, il disposait les marchandises les plus lourdes sous les plus légères selon leur dimension, leur forme. Il s’assurait de ne pas poser les fournitures contre les portes ou ridelles afin d’éviter qu’elles ne basculent à l’ouverture et les fixait pour rouler en toute sécurité. Une cargaison mal calée risquait de glisser en défonçant l’avant du véhicule en cas d’arrêt brutal, de tomber en route ou sur le conducteur à l’ouverture des battants ou encore de chuter lors du déchargement, de provoquer le renversement du poids lourd.
Durant son trajet, la radio lui tenait compagnie, le maintenait éveillé. Sans son patron sur le dos, il gérait ses tâches seul. Il croisait d’autres camionneurs, souvent les mêmes, en compagnie desquels il se détendait le temps d’un repas. Son véhicule prêt, il grimpait sur le marchepied antidérapant jusqu’à sa cabine où il s’installait derrière le volant. Les week-ends lui permettaient de compenser le manque de sommeil, car pendant cinquante à soixante-dix heures de travail hebdomadaire, il ne dormait en moyenne que quatre heures par nuit. Une couchette aménagée à l’arrière du siège conducteur lui servait de lit. La plupart du temps, il conduisait avec l’envie de fermer l'oeil. Chaque jour, il insérait sa carte chronotachygraphe. Elle enregistrait son heure de départ et d’arrivée, la vitesse à laquelle il roulait. Avant de démarrer, il buvait un café issu de son thermos toujours rempli. À la première station, il prenait de l’essence. Dès qu'il avait un moment, il remplissait ses feuilles journalières. Il traversait Parme, Bologne, Rimini, suivait la mer Adriatique toujours sur l’autoroute puis arrivait à Pescara, l’endroit où se situait un self-service où il avait l’habitude de retrouver Ronan, son ami et collègue de longue date. Depuis que les essuie-glaces de son camion avaient disparu un jour au moment d’une pause pendant le déjeuner, il se méfiait du choix de ses étapes. Après 780 kilomètres, mon père rejoignait Ronan. Depuis des années, ils se voyaient dans ce restoroute à l’heure du dîner. Célibataire, peu importait à Ronan de partir deux ou trois semaines, personne ne l’attendait. Tous deux n’avaient plus beaucoup de secrets l’un pour l’autre. Joris lui confiait ses soucis avec ma mère. Il avait le sentiment que son désir de tourisme comptait plus que lui.
- 2 -
Chaque jour, un essaim d’adolescents, filles et garçons mélangés, s’échappaient du collège comme une harde de bêtes sauvages sortie d’une cage. Nous nous écartions, mes amies et moi-même, de l’affluence pour ne constituer qu’un petit groupe qui, tout en longeant le trottoir et la grille bavardait et plaisantait durant le chemin de notre retour. En ce vendredi, veille de week-end, l’excitation se renforçait. Nous marchions pendant un bon quart d’heure avant de nous séparer. Je montais dans le bus bondé. Si je voyais des places libres au fond, j’aimais m’asseoir sur la banquette arrière. Une fois installée, je me livrais à mon rituel favori. Quand le moteur ronflait et que le chauffeur démarrait, j’agitais la main. Mes camarades s’attardaient sur le trottoir en attendant que l’autocar s’éloigne. Je collais mon visage contre la vitre jusqu’à ce que leurs silhouettes rétrécissent et qu’elles deviennent des êtres en pointillés.





























