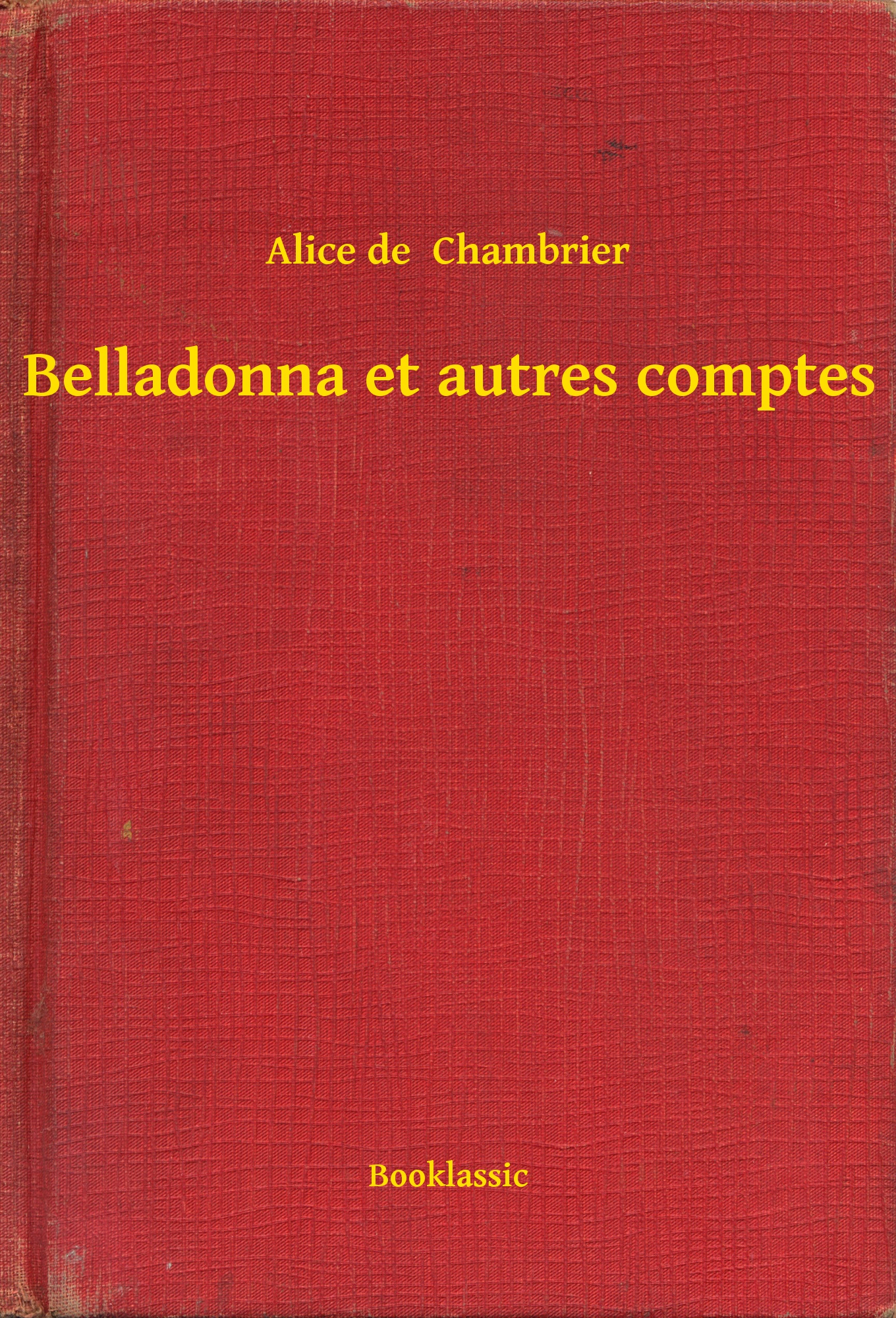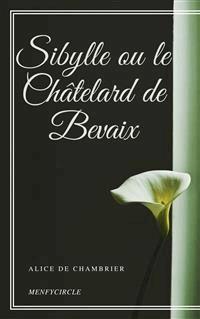3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Aymon du Terreaux, maître du "Châtelard" de Bevais, s'entend avec sire Vautier de Rochefort et les seigneurs de la Molière et de Fresne pour rançonner les voyageurs, tant sur les chemins que sur le lac de Neuchâtel, et miner le pouvoir de Conrad, le comte de Neuchâtel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sibylle ou le Châtelard de Bevaix
Chapitre 1 - LE CHATELARD ET L’ABBAYEChapitre 2 - SIBYLLEChapitre 3 - MESSIRE DE ROCHEFORTChapitre 4 - LE CHATELARD DE BEVAIXChapitre 5 - À ROCHEFORTChapitre 6 - CHEZ CONRAD DE NEUCHÂTELChapitre 7 - LE RETOURChapitre 8 - GASTONChapitre 9 - LA FAMILLE DU PRISONNIERChapitre 10 - UN PEU DE PAILLE DANS UN CACHOTChapitre 11 - LA SCIENCE DE LA CLAUDETTEChapitre 12 - COMMENT L’AMOUR NAÎTChapitre 13 - UN PROJET DE BRIGANDSChapitre 14 - LE MESSAGERChapitre 15 - LE TRAITRE DÉMASQUÉChapitre 16 - LA VISITE DU PÈRE ANSELMEChapitre 17 - LA SŒURChapitre 18 - LE RENARD VAINCU PAR LE LIONChapitre 19 - VISITES TARDIVESChapitre 20 - ÇA ET LÀChapitre 21 - LE SIÈGEChapitre 22 - LIBRES !ÉPILOGUENotes de bas de pagePage de copyrightChapitre 1 - LE CHATELARD ET L’ABBAYE
Au commencement du XVe siècle, le village de Bevaix était loin de ressembler à ce qu’il est aujourd’hui. Il se composait de quelques maisons assez misérables, éparses dans la verdure. De bons plants de vigne couvraient déjà les pentes très inclinées des terrains qui s’abaissent vers le lac, mais à l’endroit qu’on nomme encore aujourd’hui le Châtelard et qui est un des bons crûs de la contrée, sur un mamelon exposé au soleil, s’élevait un castel bien fortifié. Il se composait d’une tour à plusieurs étages, d’où l’on pouvait aisément surveiller tout le pays, et d’un petit corps de bâtiment contigu. D’étroites fenêtres, percées dans les murs, laissaient à peine entrer le jour dans l’intérieur. Du côté du lac, dont les eaux s’élevaient beaucoup plus haut qu’aujourd’hui, l’abord du château était difficile. Il y avait bien un chemin pour se rendre sur le rivage, mais il était si bien dissimulé au milieu des broussailles et des joncs, que les gens du château seuls en connaissaient l’existence. Un large fossé, bordé d’une double haie de grands arbres, entourait les côtés Est, Ouest et Nord du bâtiment, et le défendait contre toute attaque venant de la terre. Un pont-levis presque toujours levé, sur lequel un homme à cheval avait peine à passer, était la seule issue visible du sombre donjon. Telle apparaissait la résidence du châtelain de Bevaix, Messire du Châtelard, comme l’appelaient les paysans et les serfs, de son vrai nom Aymon-Guillaume du Terreaux, seigneur de Bevaix.
C’était un homme farouche et sombre, d’une stature herculéenne. Ses yeux, très enfoncés sous ses sourcils, avaient une expression sardonique et cruelle. Il était redouté de tous ceux qui se trouvaient sous sa domination. Sa charge consistait à recueillir les droits de passage de tous les étrangers qui traversaient le pays ; mais peu à peu la contribution régulière que les voyageurs devaient payer au châtelain se changea en une rançon arbitraire et souvent si élevée que les malheureux avaient peine à la solder.
Un autre revenu du sire du Châtelard était le droit d’épave. Malheur à ceux dont les barques désemparées se voyaient surprises par l’ouragan et jetées au rivage. Elles étaient impitoyablement pillées et leurs passagers, retenus en captivité, devaient payer aussi de fortes rançons. L’usage n’accordait cependant au sire du Châtelard que la propriété des objets que le flot jetait à la rive ; mais qu’importait le droit au farouche châtelain ? Il ne connaissait que la force, et quand une proie s’offrait à lui, il s’empressait de la saisir.
Sur l’autre rive du lac de Neuchâtel, dans la direction de l’Occident, se dresse encore aujourd’hui une grande tour carrée. Pendant les beaux soirs d’été, lorsque l’air est pur, elle se détache admirablement sur le fond plus clair du ciel. C’est la tour de la Molière. Elle n’est plus aujourd’hui qu’un but paisible de promenades, mais alors elle était le repère d’un homme cruel et dangereux qui, une fois réfugié entre ces murs de pierre, pouvait braver impunément qui que ce fût.
Grâce à son admirable position, la tour de la Molière dominait tout le pays. Elle communiquait par signaux avec deux châteaux forts, outre le château de Bevaix : celui de Fresne, près de Sainte-Croix, et celui de Rochefort. De cette façon, les malheureux voyageurs et les marchands pouvaient être de loin dénoncés, épiés et pillés au moment favorable. Lorsque le seigneur de Fresne apercevait, le soir, quelque convoi longeant une des deux rives du lac ou le traversant en barque, et qu’il ne pouvait l’assaillir lui-même, il agitait au haut de la tour un fanal rouge dont les mouvements, diversement combinés, avertissaient le seigneur de la Molière, qui transmettait immédiatement et de la même façon ses instructions à Bevaix et à Rochefort. Alors, pour peu que la lune fût voilée et que le temps fût sombre, des bandes d’hommes armés se postaient silencieusement le long des chemins et attendaient le passage du malheureux convoi. Des scènes horribles se passaient. Au matin, les pillards rentraient tranquillement chez eux, emmenant prisonniers et butin.
Un pareil état de choses n’était pas sans soulever des plaintes amères, mais le comte Conrad de Neuchâtel avait bien autre chose à faire pour le moment qu’à châtier ses indignes vassaux. Tout occupé à réprimer les soulèvements suscités sans trêve par son cousin Vauthier, baron de Rochefort, il se bornait à menacer les pillards, qui continuaient leur métier de plus belle.
À cinq minutes du Châtelard se trouvait une abbaye de Bénédictins, dont le couvent avait été donné à celle de Cluny. Aujourd’hui encore on en peut voir quelques restes, bien que le bâtiment proprement dit n’existe plus ; on s’est même servi du portail pour édifier la porte principale de la petite église de Bevaix. Dans la cour où les moines se promenaient autrefois, poules et canards picorent à l’aise, tandis qu’une ferme occupe l’emplacement des cellules.
Au temps où nous sommes, la communauté religieuse comptait environ trente membres, y compris le prieur. Celui-ci était un gros homme, joufflu, à l’air bien portant, qui se trémoussait toujours sans faire grand’chose. On le voyait partout, dans la vigne plantée depuis la maison jusqu’au lac, et qu’une partie des moines s’occupait à cultiver ; dans les champs de blé qui environnaient l’abbaye et en dépendaient ; sous les arbres du verger, dont il aimait beaucoup à goûter les fruits mûrs. Le long des vignes qui entouraient les bâtiments, fleurissaient de superbes roses cultivées par un des frères, dont elles étaient l’innocente passion. Il y en avait de toutes les espèces, et c’était vraiment un joli spectacle que de voir, l’été, le jardin du couvent avec sa couronne de fleurs et ses arbres chargés de fruits, où les oiseaux se poursuivaient en chantant.
L’intérieur de l’abbaye n’était pas triste non plus : les murs étaient loin d’avoir l’épaisseur de ceux du Châtelard, le soleil pouvait facilement entrer par les fenêtres, et les bons religieux avaient un air content qui faisait plaisir et contrastait étrangement avec les visages sombres que l’on rencontrait dans la demeure voisine. Au premier coup d’œil jeté sur les deux habitations, on aurait dit que l’abbaye était le ciel et l’autre l’enfer.
Cependant le ciel et l’enfer ne vivaient pas aussi séparés qu’on aurait pu le croire. Les psaumes se mêlaient parfois aux imprécations et les hommes d’église ne dédaignaient pas d’aller faire quelques petites visites chez les pillards. Toujours ils y trouvaient leur profit et jamais ils n’en revenaient sans quelque ornement de prix pour leur autel. De la chapelle où ils célébraient leur culte, partait un souterrain soigneusement dissimulé, qui aboutissait dans l’intérieur du Châtelard. C’était par là que se faisaient les communications ; mais durant les expéditions nocturnes de leurs voisins, les pieux moines, le prieur en tête, fermaient soigneusement leurs yeux et leurs oreilles, ce qui fait qu’ils pouvaient sans remords continuer leurs relations amicales avec le Châtelard. Du reste, ils faisaient du bien dans leurs domaines, et plusieurs fois le prieur avait réussi à obtenir du châtelain la grâce de quelque infortuné serf.
Chapitre 2 - SIBYLLE
Si l’abbaye avait ses roses, le Châtelard en possédait une aussi ; c’était Sibylle, la fille unique de Guillaume du Terreaux. Ses traits, d’un galbe régulier et quelque peu sévère, étaient animés par de grands yeux noirs, profonds et lumineux. Elle vivait avec son père, qui s’inquiétait peu d’elle et qu’elle craignait extrêmement. Sa mère était morte depuis longtemps. Dame Zabeau, une espèce de gouvernante, au ton grondeur, au regard louche, avait été chargée d’élever la jeune fille ; éducation un peu sommaire, il faut le dire : Sibylle avait appris à filer et à coudre ; c’était tout ce dont une personne de sa condition avait besoin. Mais à l’insu de tous, à côté de cette éducation extérieure, la jeune fille en avait reçu une seconde toute intérieure. Le grand, le premier maître de l’enfant avait été la nature.
Pendant les longues heures où son père, occupé de ses projets sinistres, ne songeait guère à elle, et où dame Zabeau parcourait la maison du haut en bas, rechignant et rudoyant la petite lorsqu’elle se trouvait sur son passage, Sibylle avait pris l’habitude d’errer seule au dehors. Elle allait s’asseoir au bord des champs de blé de l’abbaye et restait là à regarder tantôt le ciel, tantôt le lac dans lequel les Alpes venaient réfléchir leurs sommets. Son imagination enfantine peuplait d’êtres fantastiques tout ce qui l’entourait. Le vent était son grand ami. N’est-ce pas lui qui abattait en automne les fruits mûrs des arbres, qui amenait au rivage les choses précieuses que son père recueillait et dont elle profitait souvent ? Il y avait aussi les coquelicots et les bluets qu’elle récoltait par gerbes pour en tresser patiemment de longues guirlandes. Quelquefois, fatiguée, elle s’endormait au bord du chemin. Les paysans et les serfs qui passaient avaient grand soin de ne pas l’éveiller. La petite demoiselle aux fleurs, comme ils avaient pris l’habitude de l’appeler, était bonne pour eux ; elle leur parlait doucement et ne s’amusait jamais à les harceler de toutes sortes de manières, à l’exemple des enfants des seigneuries voisines. Un insecte sous l’herbe, un papillon sur une fleur étaient pour Sibylle un long sujet de ravissement.
La religion n’existait pas pour Sibylle. Qui lui en aurait parlé ? Ce n’était pas dame Zabeau, qui ne croyait qu’au diable, dont elle avait une crainte affreuse ; et les rares fois que la fillette avait entendu prononcer le nom de Dieu, c’était toujours avec accompagnement des épithètes les plus grossières. Il en était résulté pour elle une impression vague, où Dieu lui faisait l’effet d’un fantôme immense, qui habitait extrêmement loin, sans doute, et dont on avait peur, tout en s’en moquant. Les moines auraient pu donner à l’enfant quelque éclaircissement à ce sujet, mais elle les redoutait et fuyait leur approche.
Cependant, tout en étant presque païenne, Sibylle ne laissait pas de valoir mieux que beaucoup de chrétiennes. Le cœur chez elle remplaçait la piété. Sans en avoir jamais été instruite, elle avait comme l’intuition de ce qui était juste. Quoique témoin depuis bien des années des scènes de violence dont sa demeure était le théâtre, et sans que personne lui en eût révélé la turpitude, elle en éprouvait une horreur insurmontable. Mais à qui s’adresser pour y remédier ? Dans la nature, ne voyait-elle pas chaque jour se reproduire les mêmes scènes ? Les forts ne l’emportaient-ils pas sur les faibles ? L’araignée mangeait la mouche ; l’aigle fondait sur les petits oiseaux ; le chat sur les souris ; l’homme puissant pouvait donc bien dépouiller et mettre à nu le pauvre et le misérable. Mais quelle était donc cette voix mystérieuse qui criait alors à la jeune fille : « C’est infâme, c’est affreux ! »
Sibylle savait qu’elle était belle, et pourtant nul ne le lui avait dit. Elle avait vu que dans la nature, parmi les fleurs, les insectes et les oiseaux, il y avait des espèces plus éclatantes que d’autres ; qu’il se rencontrait des papillons aux couleurs chatoyantes, mais aussi de pauvres vers, n’inspirant qu’un sentiment de dégoût ; des fleurs brillantes, cultivées avec soin, et d’autres écrasées avec mépris ; des oiseaux que l’on protégeait et d’autres qu’on s’acharnait à détruire ; et le jour vint où l’enfant se demanda ce qui en était d’elle-même. Alors, inquiète et rougissante, elle alla se pencher au-dessus de la source voisine et s’y regarda longtemps ; elle s’y vit telle qu’elle était, le visage très pâle et régulier, le regard doux et fier, d’abondants cheveux noirs ondulés et tordus sur la nuque en anneaux brillants. La jeune fille eut un long soupir de joie et rentra songeuse au Châtelard, puis elle n’y pensa plus.
À l’époque où commence ce récit, Sibylle venait d’avoir dix-sept ans. Sa vie s’écoulait triste et monotone entre les murs du vieux castel, et ses illusions enfantines avaient lentement fait place à des réalités plus sévères.
Par une belle matinée de printemps, elle errait rêveuse dans la campagne. Elle retenait d’une main les plis trop longs de sa robe, et de l’autre cueillait quelque fleur prête à s’ouvrir. Longtemps elle suivit un sentier qui longeait le lac, puis s’engagea dans un vaste terrain marécageux qui occupait toute la prairie à l’Ouest du village. Quelques nénuphars aux vives couleurs l’y avaient attirée. En ce moment, une famille de serfs s’y occupait à couper les joncs. Le père et la mère travaillaient activement, deux petits enfants de trois à quatre ans les regardaient faire. L’un d’eux s’empara de la faucille d’un paysan pendant que celui-ci liait la récolte, et commença à s’en amuser. Malheureusement, l’autre ayant voulu la lui prendre, s’en blessa grièvement. Aux cris qu’ils poussèrent, Sibylle s’approcha et saisit le pauvre petit dans ses bras. Les parents accoururent effrayés et essayèrent de le panser, mais ils manquaient des choses nécessaires.
Pendant qu’ils étaient ainsi occupés, un vieillard de haute taille sortit d’une cabane située à peu de distance, à l’ombre de quelques arbres, et s’avança vers le groupe. Une barbe d’un blanc de neige lui descendait jusqu’au bas de la poitrine ; sous ses sourcils rayonnaient de grands yeux gris, à l’expression un peu sauvage. Bien qu’il parut être déjà fort âgé, il marchait encore d’un pas assuré. Il vint au groupe et aperçut la damoiselle du Châtelard, essayant de bander la plaie de l’enfant. Il regarda un instant ce spectacle sans mot dire, puis posa sa main sur l’épaule de Sibylle :
– Vous n’avez rien de ce qu’il faut pour soigner ce marmot, dit-il. J’ai un onguent qui guérit les plaies ; venez jusqu’à mon logis, je vous en donnerai.
La jeune fille, et les pauvres gens derrière elle, le suivirent.
La hutte, qui à l’extérieur avait l’air misérable, offrait à l’intérieur un certain confort. Une étoffe brune, simplement clouée sur les planches mal jointes, empêchait l’air d’entrer et interceptait l’humidité. Sur une table grossièrement équarrie, se trouvait une pile de manuscrits et un pot d’encre noire et épaisse. Après avoir soigné l’enfant, Sibylle s’approcha avec curiosité de ces objets entièrement nouveaux pour elle, et machinalement saisit entre ses doigts une grosse plume d’oie taillée. Le vieillard fit sortir les serfs, puis regarda en souriant la jeune fille absorbée dans ses pensées :
– Ne savez-vous pas à quoi cela sert, noble damoiselle ?
Elle tressaillit, un peu honteuse, et ne répondit point.
Le vieillard l’observait avec bienveillance.
– Voulez-vous que je vous en montre l’emploi ?
Elle acquiesça d’un signe, s’assit à côté de son hôte sur un escabeau à trois pieds posé devant la table, et regarda avec intérêt la manière dont il s’y prenait pour dessiner les uns à côté des autres de petits caractères étranges à l’aide desquels on pouvait nommer ce qu’on voulait et s’entretenir même avec ceux dont on était séparé.
– Voyez plutôt, dit le vieillard en interrompant son travail pour saisir un parchemin usé et jauni par le temps. Ceci a été écrit il y a bientôt mille ans, par les grands hommes de l’Église. C’est la Bible, et non seulement moi, mais tous les hommes, jusqu’à la fin des temps, pourront, en étudiant ces petits signes, apprendre à connaître et s’approprier le salut donné aux pécheurs.
Sibylle leva sur son maître improvisé un regard tout plein d’une stupéfaction profonde.
– C’est que je ne comprends pas très bien, dit-elle ; on ne m’a jamais parlé de cela. Chez mon père, je ne vois que dame Zabeau et les gens d’armes ; mais dame Zabeau est si grondeuse et les gens d’armes sont si grossiers ! Il y a bien encore quelquefois les moines, mais j’ai peur d’eux et je me sauve quand je les aperçois. Ô messire ! croyez-vous que je pourrais apprendre à lire et à écrire comme vous ?
– Pourquoi pas ? Il ne s’agit que d’en prendre la peine. Je vous enseignerai cela, ma fille, et vous pourrez copier et lire avec moi le saint livre de Dieu dont je viens de vous parler.
Sibylle resta un moment sans répondre. Une question se pressait sur ses lèvres, mais elle avait honte de la formuler et de paraître ignorer ce que l’étranger savait si bien. Enfin, elle se hasarda, et murmura presque à voix basse :
– Je voudrais savoir au juste qui est Dieu.
Puis elle attendit. Comme il va se moquer de moi ! pensait-elle. Mais non, le vieillard n’eut pas le moindre sourire ; au contraire, quelque chose comme un étonnement douloureux passa sur son visage. Il hésita un instant :
– Dieu, c’est quelqu’un de bon, de juste et de saint, quelqu’un qui hait l’injustice et qui veut que les hommes puissants et forts soient bons et doux pour les faibles, quelqu’un qui ne se plaît que là où règne la paix et l’amour.
Sibylle leva lentement sur son compagnon ses beaux yeux humides de larmes, et murmura tristement :
– Alors, il ne vient jamais au Châtelard.
– Mais vous pouvez l’y inviter et l’y retenir.
Sibylle eut un cri d’effroi :
– Vous n’y pensez pas ! Et mon père ! Il ne le supporterait pas un instant.
– Votre père serait impuissant à se défaire de cet hôte. Du moment que vous tiendrez à lui, il s’établira chez vous ; rien au monde ne saurait l’en déloger. C’est un ami précieux. Il apporte le bonheur avec lui, mais en retour il demande quelques sacrifices… Voici la nuit qui vient, il faut rentrer chez vous, ma fille. Réfléchissez à ce que vous avez appris aujourd’hui. Lorsque vous désirerez en connaître davantage, revenez me voir.
Chapitre 3 - MESSIRE DE ROCHEFORT
Sibylle s’en revint toute rêveuse au Châtelard. Les paroles de son nouvel ami l’avaient remuée. Au seuil du château, elle rencontra dame Zabeau. La revêche personne l’interpella suivant son habitude :
– Te voilà seulement ! Qu’as-tu fait tout l’après-midi à vaguer dans les champs ? Est-ce l’affaire d’une damoiselle de s’en aller ainsi bayer aux corneilles quand il y a à coudre et à filer dans la maison ?
Comme la remontrance n’en finissait pas, Sibylle s’impatienta :
– Laissez-moi passer, dame Zabeau, fit-elle en l’écartant résolument.
C’était la première fois que la jeune fille en usait ainsi avec la mégère ; aussi celle-ci fut-elle si stupéfaite, qu’elle resta bouche béante, sans pouvoir revenir de son étonnement. Sibylle, sans s’en inquiéter, monta au second étage du château, dans sa chambre, petite pièce dont une élégante de nos jours ne se serait certes pas contentée.
La fenêtre étroite et basse qui donnait sur le lac était percée dans un mur de cinq pieds d’épaisseur, et formait comme une espèce de cabinet plus clair que le reste de la chambre. C’est là que Sibylle, assise sur un escabeau et son rouet devant elle, oubliait de travailler et se perdait dans ses rêves, jusqu’à ce que dame Zabeau, entrant bruyamment, la réveillât de sa voix aiguë et grondeuse.
Dans la chambre même, se trouvait une couchette, très étroite et très dure, avec une peau d’ours pour couverture. Une cruche d’eau et une grande sébile en bois complétaient l’ameublement. Rien de plus simple, comme on voit. Mais accoutumée à cette simplicité depuis son enfance, Sibylle ne désirait rien au-delà et ne songeait pas même qu’il y eût des appartements plus beaux que le sien.
Ce fut près de la croisée que la jeune fille alla se réfugier, le cœur tout plein encore de ce qu’elle venait d’entendre. Le coucher du soleil était splendide, les Alpes teintées d’or et de rouge se miraient dans le lac. De longs nuages d’un jaune orangé flottaient dans l’azur indécis. Quelques hirondelles rasaient en passant la surface de l’eau et leurs petits cris se mêlaient au chant lointain d’un pêcheur amarrant sa barque à la rive.
Après avoir longtemps contemplé ce spectacle, la jeune fille jeta un coup d’œil derrière elle, dans l’intérieur de la chambre, et frissonna. Les vieux murs étaient humides et sombres, un crépuscule vague et terne enveloppait tous les objets. Sibylle se tourna de nouveau vers la fenêtre. Elle avait peur de l’ombre, et là tout était lumière. Si Dieu habitait quelque part, c’était sans doute sur ces hauteurs rayonnantes ; comment pourrait-il consentir à entrer dans la demeure sinistre qu’elle habitait ? Le vieillard s’était certainement trompé…
La nuit descendait lentement. Seules les plus hautes cimes rayonnaient encore, pareilles à des diamants semés sur un manteau de turquoise. Enfin l’obscurité confondit tous les aspects, voila toutes les couleurs, tandis que dans le ciel assombri la lune glissait silencieusement, pareille à une faucille d’argent oubliée là par quelque ange voyageur.
Une voix rude et légèrement enrouée répéta soudain à plusieurs reprises le nom de la jeune fille et la fit tressaillir. C’était celle de son père. Elle se hâta de descendre. Que voulait-il ? Il était rare qu’il l’appelât et qu’il eût besoin d’elle. Un grand bruit montait de la salle d’en bas. On y buvait, on y chantait, en l’honneur de quelque étranger sans doute, arrivé subitement. Le cœur de Sibylle battit avec violence. Lorsqu’il y avait des visiteurs au château, elle se cachait toujours, laissant dame Zabeau les servir. Elle avait en horreur le bruit et l’orgie ; mais ce soir son père commandait, il fallait obéir. Elle poussa la porte et entra.
Une vive lueur remplissait la pièce, projetant des reflets fantastiques sur les vieux murs nus. Elle était produite par la flamme du foyer, où rôtissait un énorme quartier de bœuf. Autour du feu se tenaient, moitié assis, moitié couchés, les hommes d’armes du Châtelard. Presque tous avaient au visage d’énormes balafres qui le sillonnaient d’une raie sanglante. Leurs yeux jetaient des clartés fauves, leurs cheveux étaient en désordre.
Dans un coin de la pièce, autour d’une table, quatre personnages s’occupaient à vider d’un trait les gobelets que dame Zabeau remplissait sans relâche. C’était d’abord le seigneur du Châtelard, Messire du Terraux ; excité par tout le vin qu’il avait absorbé, il parlait avec volubilité, d’une voix rauque. À côté de lui, sa figure ronde toute enluminée, ses mains grassouillettes croisées sur son ventre, éclatant parfois d’un petit rire bête qui résonnait comme un hoquet, était assis le prieur de l’Abbaye. Le troisième convive était encore un moine, l’âme damnée du couvent.
Maigre, sec, le regard perçant, les lèvres minces et serrées, la figure émaciée et taillée en lame de couteau, complètement imberbe, il avait quelque chose de démoniaque dans toute sa personne. C’était lui qui, rencontrant un jour sur un chemin sombre un pauvre clerc, avait reçu cette salutation peu flatteuse, murmurée d’une voix tremblante et accompagnée d’un signe de croix : Vade retro, Satanas.
Le quatrième convive offrait un contraste frappant avec ses compagnons. Élégant, souple, nerveux, unissant à l’allure du serpent celle du chat, il observait tout ce qui se passait autour de lui, bien qu’ayant l’air de ne regarder que son verre. Ses yeux gris-bleus, très grands et très beaux, étaient d’une mobilité effrayante, et son regard semblait ne pouvoir se fixer nulle part. C’était Vauthier, châtelain de Rochefort et des Verrières, bâtard du comte Louis de Neuchâtel. D’un caractère ambitieux et indépendant, il avait été durant plusieurs années en lutte avec le comte Conrad de Fribourg, seigneur de Neuchâtel. Mais un traité venait d’être conclu entre eux, ce qui n’empêchait pas Vauthier de fabriquer des actes faux, grâce auxquels il pourrait entrer en possession de tel ou tel fief, ou en faire don à quelque seigneur qu’il désirait avoir pour allié.
Sibylle s’approcha lentement de la table, puis attendit que son père lui adressât la parole. Sa silhouette se détachait en sombre sur le clair, qui faisait ressortir la grâce incomparable de sa taille. Un peu pâle, le regard à demi baissé, elle semblait un être d’une espèce supérieure égaré dans ce triste milieu.
Ce fut Vauthier qui le premier l’aperçut. Il laissa tomber sur la table un poing aussi dur que l’acier :
–