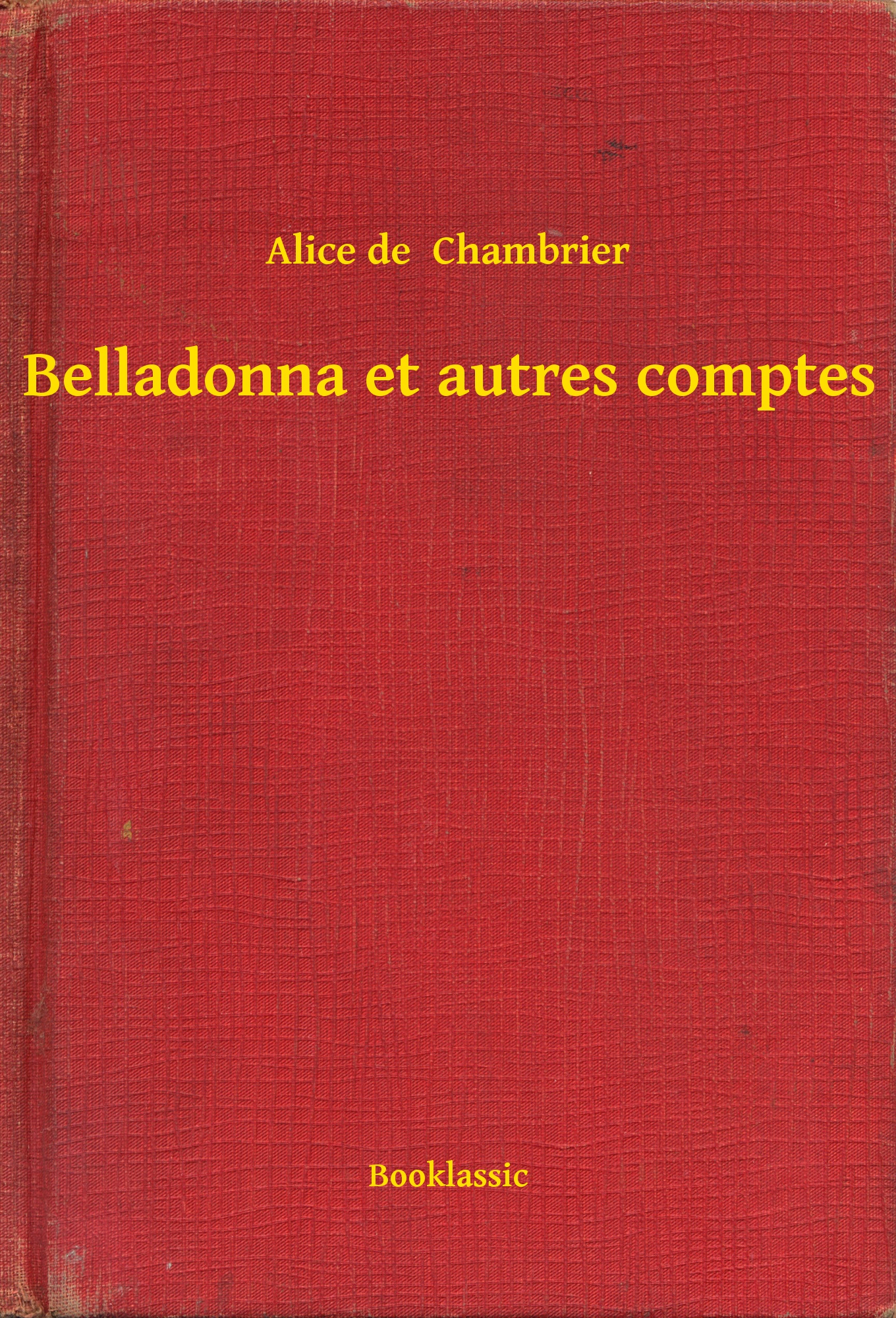
0,88 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Recueil de contes.
"Nous sommes comme alors a la fin de mai, un radieux soleil éclaire le grand marché qui se tient tous les jeudis sur la place des Halles a Neuchâtel. Les vendeuses sont tout a leur affaire ; il y en a de jeunes, de vieilles, de laides, de jolies. Les unes, les yeux éveillés, l’oreille au guet, ont l’air de chiens de chasse éventant le gibier qui peut s’approcher sous la forme de femmes de chambre, de cuisinieres et meme de fines et élégantes dames, qui aiment a faire leurs emplettes elles-memes."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Belladonna et autres comptes
Alice de Chambrier
BELLADONNA
– Viens ici, Andréa, j’ai quelque chose à te dire…
Je m’approchai de mon jeune maître, et jetai sur lui un regard inquiet. Il était à demi étendu sur une causeuse et, tout en parlant, roulait avec nonchalance entre ses doigts une cigarette presque consumée.
Le comte Antonio Pasquali était le dernier descendant d’une illustre famille italienne ; son père, mort un an auparavant, m’avait fait promettre de veiller toujours sur le jeune homme, et bien que je fusse d’une condition inférieure, – de père en fils nous avions été intendants des domaines Pasquali – Antonio voulait bien la plupart du temps écouter mes conseils et les suivre.
Il avait un caractère naturellement gai et enjoué, mais depuis qu’il avait été passer quelque temps dans un vallon perdu au milieu des Alpes, à trois heures au-dessus d’Airolo, il était devenu d’une indicible mélancolie dont je ne pouvais trouver la cause et que rien ne parvenait à vaincre. Il ne voulait plus sortir, plus voir personne ; je lui conseillais de se marier : il ne consentait pas à en entendre parler, quoiqu’il eût pu choisir à son gré parmi les plus jolies signorine de toute l’Italie.
Pour moi, je n’aurais pas fait tant de façons. Il y avait à l’hôtel même où nous étions trois petites duchesses, avec des teints dorés et des yeux brillants comme des étoiles.
Ma foi, à la place du comte, la seule chose qui m’eût un peu retenu aurait été la nécessité de choisir ; car pour les signorine, au moindre signal elles eussent franchi tous les obstacles, et rejoint le beau seigneur pâle et triste qui depuis son retour des Alpes ne les regardait même plus, tandis qu’avant il était fort empressé auprès d’elles. Quand sa voiture croisait la leur, elles avaient beau lui lancer des regards brillants comme des éclairs, tousser d’une façon intéressante, rire juste assez pour se faire remarquer, sans cependant que cela eût mauvais air, rien ne réussissait ; le comte Pasquali ne voulait pas voir les pauvres petites, et je me creusais la tête sans succès pour deviner ce qu’il pouvait trouver de si absorbant dans la contemplation du tapis de pied de sa calèche.
Nous nous trouvions alors sur les rives du lac Majeur, et mon maître attendait là la venue de l’hiver, qui devait le ramener à Rome, sa résidence ordinaire. L’appartement du comte se trouvait au rez-de-chaussée dans une dépendance de l’hôtel, et donnait sur un bosquet plein de sentiers mystérieux.
– Assieds-toi là, à côté de moi, Andréa Marchesci, continua le comte. Je vais t’expliquer la raison de ma manière d’être, et nous verrons si, après cela, tu te moqueras encore de ma mélancolie ; mais avant que je commence, donne-moi un verre d’eau et une autre cigarette.
Et il jeta négligemment par la fenêtre ouverte le reste de celle qu’il tenait. Je me hâtai de suivre ses ordres ; il but quelques gorgées du verre que je posai sur un guéridon à côté de lui, lissa ses longues moustaches avec son mouchoir de baptiste brodé à jour et commença :
– Ce que j’ai à te dire, mon ami, est profondément bizarre ; tu te rappelles que tu m’accompagnas jusqu’à Airolo, ce village extraordinaire, détruit en un jour, ressuscité comme par enchantement, et dont le nom naguère obscur reste actuellement attaché à l’une des plus grandes entreprises de notre siècle.
Après t’avoir embarqué dans la diligence qui devait te ramener ici, je me dirigeai vers le tunnel du Gothard [1]. À chaque instant quelque type étrange se présentait devant moi ; je m’amusais de la différence de figure et d’allure des ouvriers suisses et de mes compatriotes. Les Italiens se promenaient gravement ; la plupart portaient leur habit de velours râpé sur la poitrine, au lieu de s’en couvrir le dos ; presque tous avaient des airs de grands seigneurs déguisés. Je m’arrêtai à l’entrée du tunnel ; c’était au moment où une escouade de travailleurs allait se mettre en marche pour accomplir ses six heures de travail réglementaires. Tous les hommes allumaient leurs lampes en riant et en criant ; c’était un tumulte assourdissant. Bientôt le signal du départ fut donné, les ouvriers s’enfoncèrent en chantant dans la ténébreuse galerie, leurs formes disparurent dans l’ombre ; seules leurs lampes étaient encore visibles, elle se balançaient dans la nuit comme des étoiles.
Mille pensées se présentèrent à mon esprit devant ce spectacle fantastique, et j’évoquai aussitôt l’image de tout un peuple de gnomes poursuivant une œuvre gigantesque au milieu des entrailles de la terre… Le sifflement aigu d’une locomotive m’arracha subitement à ce rêve. Une sorte d’étouffement me saisit en songeant que c’étaient des hommes, mes semblables, qui travaillaient dans ces profondeurs horribles, que presque chaque jour quelques-uns d’entre eux tombaient frappés à mort par une pierre ou par un wagonnet lancé dans la nuit et, succombaient là, loin du jour, que leurs cadavres ne revoyaient pas même ; car souvent leurs camarades les enterraient à quelques pas du lieu où ils avaient été atteints. Ceux qui sortaient du tunnel sains et saufs étaient saisis par la maladie, et le plus ordinairement ils se trouvaient vaincus par elle. Au commencement de la grande entreprise, la majeure partie des ouvriers venait du Piémont ; aujourd’hui, on ne trouve presque plus de ceux-là, les Piémontais sont morts, et il a fallu aller chercher plus loin de nouvelles forces et de nouveaux bras.
Ah ! vraiment on pourrait croire parfois qu’il y a une malédiction attachée au travail, car les plus belles œuvres, même celles qui doivent servir à la paix et au bonheur des peuples, ne peuvent s’achever sans effusion de sang. Ici-bas chaque monument du génie a ses martyrs obscurs ou célèbres qui fondent sa gloire et assurent sa durée.
Ce fut en poursuivant ces réflexions que je pris le chemin de Piora. J’eus bientôt dépassé le village de Madrano, quelques maisons noires, cognées les unes contre les autres, avec des rues larges comme des escaliers de poules. La seule curiosité de ce hameau est un chasseur de chamois, qui est censé tuer beaucoup de ces animaux et vendre leurs cornes aux amateurs, mais qui se trouve toujours à court de cette marchandise-là lorsqu’on vient pour lui en acheter.
De Madrano, le chemin monte insensiblement et se confond la plupart du temps avec un ruisseau qui descend de la montagne et qui vous rafraîchit très agréablement les pieds. Le paysage était superbe ; la Lévantine se déroulait au dessous de moi avec ses beaux villages, dont les habitations, neuves pour la plupart, s’étalent joyeusement au soleil, et le Tessin glissait comme un ruban d’argent dans la plaine verte. Le ciel d’un bleu intense semblait sourire aux montagnes blanches qui s’élevaient vers lui.
J’atteignis Brugnasco, qui est de tous points semblable à Madrano, sauf qu’on peut y admirer une maison peinte en rose, et j’arrivai dans un bois où je me perdis. Comme j’errais et m’égarais de plus en plus, des sons mystérieux parvinrent à mon oreille ; c’était une sorte de chanson au refrain bizarre. Je pensai avec joie que j’allais trouver quelqu’un qui m’indiquerait le chemin à suivre, et je me dirigeai du côté d’où le bruit partait. Bientôt je fus dans une jolie clairière, tout entourée de grands arbres ; un ruisseau limpide la traversait en bondissant.
Le chant qui m’intriguait continuait à résonner, et j’aperçus, assise sur une grosse pierre au bord de l’onde, une créature étrange ; ce devait être une Italienne. Je ne pus d’abord juger de sa grandeur, mais un instant après, lorsqu’elle se leva, je vis qu’elle était presque de ma taille, et je ne suis pas précisément petit. Elle avait des yeux… voyons, comment te les décrirai-je ? Tu as déjà remarqué les trois petites duchesses que je rencontre partout où je vais ?…
Je ne sais pourquoi à ce moment-là je m’engouai, toussai, me mouchai, si bien que j’en devins tout rouge. Mon maître me regardait avec un pâle sourire.
– Qu’est-ce que tu as, Andréa ? On te prendrait pour un galant qu’on entretient de sa belle ; tu n’es pourtant pas amoureux des trois signorine, j’imagine ?
Je me sentis un peu choqué ; mais avant que j’eusse pu trouver une réponse le jeune homme avait déjà repris, voyant mon mouvement :
– Ne m’interromps pas, Andréa ; je n’ai plus beaucoup de temps pour terminer mon récit : j’ai le sentiment que je suis empoisonné.
À ces mots, toute mon indignation tomba ; je le regardai plein de terreur.
– Vous voulez rire, illustrissimo !
Il haussa les épaules.
– Rire ! écoute plutôt. Pour en revenir à l’étrange créature dont je te parlais tout à l’heure, mets ensemble les six yeux des jeunes duchesses, et tu auras le rayonnement de son regard ; de plus, ses prunelles étaient d’un violet noir qui avait des reflets singuliers. Elle avait un teint brun, un peu coloré, avec de petites dents brillantes comme des perles. Son costume se composait d’une jupe rouge et noire, d’une chemisette blanche et d’un corsage noir, fermé devant par un lacet rouge ; aux pieds elle portait de ces sandales de bois fortement ferrées, comme en ont les montagnards. Sa tête était nue et semblait être rejetée en arrière par le poids de ses cheveux, sombres comme l’ébène, avec des reflets bleuâtres ; ils retombaient sur sa figure en bouclettes folles et se massaient sur la nuque en une riche torsade retenue seulement par une flèche en bois sculpté. À la taille de l’inconnue était fixé un gros bouquet de belladone en fleurs et en fruits ; elle en tenait un pareil dans l’une de ses mains, l’autre pendait négligemment dans l’eau ; la jeune fille contemplait avec attention l’écume qui jaillissait sur ses doigts.
J’hésitai un instant avant de m’approcher d’elle ; je lui trouvais quelque chose de si mystérieux.
– C’était pour sûr une jettatrice, dis-je à mon maître. Cette description m’effrayait.
Il s’impatienta :
– Ne m’interromps donc pas, Andréa, sinon je ne saurai plus dire un mot, et tu auras une chose terrible sur la conscience.
Je jurai de me tenir coi.
Il reprit la parole :
– Me décidant enfin, je portai la main à mon chapeau et dis :
– Je voudrais aller à Piora, mais je me suis égaré. Ayez la bonté de m’indiquer le chemin.
Elle leva sur moi son regard éblouissant ; je continuai :
– Savez-vous que vous jouez avec quelque chose de bien dangereux ?
– Pas pour moi, répondit-elle.
Je la regardai surpris et lui redemandai de m’indiquer la bonne route à suivre.
– Je dois moi-même aller à Piora, monsieur ; si vous pouvez attendre que j’aie fini de lier mes fleurs avec ces longues herbes, je vous servirai de guide.
Je m’assis sur le gazon ; elle semblait vouloir laisser tomber la conversation, mais je n’étais pas d’humeur à cela et repris aussitôt :
– Êtes-vous du pays, jeune fille ?
– Non, je suis Italienne.
– Comment vous appelez-vous ?
– Belladonna.
Je crus qu’elle avait mal compris ma question.
– Je ne vous demande pas le nom de la plante que vous tenez, mais le vôtre.
Elle répéta :
– Belladonna.
Puis, éclatant d’un rire métallique, elle ôta brusquement la flèche qui retenait ses cheveux, et se trouva enveloppée d’un manteau de jais bleuâtre, à peu près cette teinte que la mode nomme clair de lune, et me regardant bien en face, elle s’écria à deux reprises :
– Ne suis-je pas aussi une bella donna, moi ?
Certes oui, elle était une bella donna, si belle même que je n’en avais jamais vu de semblable.
Elle se leva.
– J’ai fini maintenant, nous pouvons aller.
Et en un tour de main elle eut relevé sa chevelure et placé la flèche au milieu.
– Alors vous vous appelez vraiment Belladonna ? lui dis-je tout en cheminant à côté d’elle.
– Mon nom t’intrigue donc beaucoup ?
Elle me tutoyait soudain avec un sans-gêne unique et ne se montrait pas du tout intimidée, tandis que je l’étais presque. Le sentier que nous suivions était délicieusement pittoresque, mais il faisait très chaud ; une soif horrible me dévorait.
– Y a-t-il un village prochain où je puisse me rafraîchir, Belladonna ?
– Oui, signor, nous allons arriver à Altanca ; là habite une vieille femme qui a été autrefois à Paris ; elle vend du vin et de la bière.
Nous croisions de temps à autre un vacher, des pâtres, des paysans qui se rendaient dans la vallée, à Airolo ou à Biasca. Ce sont de rudes gaillards que ces Suisses des hauteurs ; ils franchissent d’immenses distances pieds nus, portant deux énormes fromages sur leur dos ; ils vont d’un pas étrange et élastique qui ressemble beaucoup au trot, s’aidant un peu de leur bâton. Leurs bonnes figures franches s’illuminent en répondant au bonjour qu’on leur adresse en passant ; ils s’arrêtent volontiers pour raconter leurs petites affaires ; en moins de cinq minutes vous êtes au courant de leur vie et de leurs habitudes : vous savez combien ils ont de vaches sur l’Alpe, si ce sont de bonnes laitières, si le pâturage est gras, et bien d’autres choses encore. La plupart ont été en service à l’étranger et sont tout heureux lorsqu’on leur donne quelques nouvelles des lieux qu’ils ont autrefois habités. Ils ne paraissent pas cependant regretter la civilisation des grands centres ; l’air des montagnes et la profonde tranquillité de la vie qu’ils mènent suffisent à ces braves cœurs.
Je remarquai qu’à côté du plaisir qu’ils montraient en me répondant, une expression de terreur se peignait sur leur visage en apercevant Belladonna ; ils faisaient un signe de croix en passant à côté d’elle.
Lorsque nous arrivâmes au village, je vis plusieurs regards malveillants fixés sur la jeune fille ; l’Italienne semblait ne pas s’en apercevoir ; elle me conduisit dans une chaumière noire et basse, où je trouvai une petite vieille toute frétillante, qui, ayant découvert que je savais le français, se mit à me parler avec volubilité dans cette langue.
Ma belle conductrice était restée sur le seuil de la porte et chantait à demi-voix. Un rayon de soleil dansait autour de son élégante personne et lui faisait comme une auréole de lumière ; l’hôtesse me l’indiqua du doigt et, baissant la voix :
– Faites attention à cette créature, monsieur ; personne ne s’est encore impunément approché d’elle.
– Vous savez qui c’est ?
La vieille haussa les épaules.
– Qui pourrait le savoir ? On dit bien des choses sur son compte. Les uns prétendent que c’est malfaisant de la montagne, les autres que c’est une sorcière italienne ; mais ce qui est sûr, c’est qu’elle porte malheur. Gottardo, le petit chevrier, l’a un jour rencontrée sur la hauteur ; le lendemain, il est tombé le long d’une paroi de rochers et s’est tué. Veronica, la plus belle fille du village, l’a reçue une nuit dans son chalet ; une semaine après le chalet a brûlé, avec tous les fourrages qu’on y avait remisés et six vaches. Il y a aussi… Ah ! santa Maria !
La vieille joignit les mains. Belladonna pénétrait dans la salle et fixait son regard lumineux sur l’hôtesse.
– Pourquoi dites-vous du mal de moi, Barbara ? Est-ce ma faute si Gottardo s’entêtait à passer par des chemins où les chèvres mêmes ne s’aventuraient pas, et si un jour la touffe de rhododendrons à laquelle il s’accrochait a cédé sous lui et s’il s’est assommé ? Est-ce ma faute si Veronica comme une négligente qu’elle est, a fait du feu à côté du chalet et ne l’a pas bien éteint, de telle sorte que le vent a attisé les braises et a porté une étincelle sur le toit de chacune ? Est-ce ma faute tout cela ?
Le vieille geignait tout haut :
– Sainte Barbe, ma patronne, que va-t-il m’arriver maintenant ?
Je me levai, impatienté par ces jérémiades, payai ce que je devais et repris ma route. La végétation se transformait peu à peu ; en place des prés verdoyants, des champs de blé jaunes se dressaient de hauts mélèzes, d’abord touffus et forts, puis rabougris à mesure qu’on s’élevait. Bientôt apparut l’herbe rase et brûlée par le soleil, les petites gentianes, pareilles à des yeux bleus dans la mousse. À nos pieds grondait un torrent écumeux.
Nous marchions en silence. Belladonna tournait fiévreusement une brindille de paille entre ses doigts ; soudain elle s’arrêta :
– Est-ce que tu le crois ?
– Croire quoi ?
– Ce qu’on t’a raconté de moi.
– Je n’ai pas de raison pour le croire.
– Ah ! ils sont si méchants !
Puis tout à coup changeant de ton et m’enveloppant de son chatoyant regard :
– Tu me parais bon, dit-elle ; ils ont peut-être raison, éloigne-toi de moi ; je suis née sous une mauvaise étoile, je n’ai jamais connu mes parents ; une mendiante m’a empêchée de mourir de faim en partageant avec moi ce qu’elle recevait ; j’ai été heureuse avec elle. Après sa mort, les tristes jours ont commencé ; on m’a accusée d’avoir le mauvais œil ; j’ai été battue et maltraitée. Ma seule ressource pour vivre fut d’aller dans les bois chercher toutes sortes de plantes médicinales qu’un pharmacien complaisant m’achetait : c’est ainsi que j’ai appris à connaître la plante dont je porte le nom. Il y avait une ressemblance entre la belladone et moi : elle était belle comme moi, et comme moi méprisée et foulée aux pieds, quoiqu’elle serve à guérir ceux qui la détruisent. Un jour, lasse de la vie, j’ai voulu en finir avec elle : j’ai mangé de ces baies appétissantes. La belladone n’a pas voulu me tuer ; j’ai été bien malade, mais je me suis guérie. Ensuite, j’ai quitté mon pays pour suivre ici un vieillard et sa fille qui se montraient bienveillants à mon égard ; lui voulait travailler au tunnel, mais il est mort peu de temps après ; mon amie s’est mariée et est partie pour une contrée éloignée. Je suis de nouveau restée seule, et tout l’été j’ai vécu solitaire sur la montagne ; lorsque l’hiver viendra, il faudra m’en aller… où ? je l’ignore.
Le sentier que nous suivions dominait d’un côté une pente fort rapide ; de l’autre, il s’adossait à la montagne. Tout en cheminant, mon regard tomba sur une inscription latine gravée dans le roc. Les lettres étaient très hautes et profondément taillées ; une grande croix, également creusée dans la pierre, occupait tout le côté gauche de cet étrange monument. Je cherchai à déchiffrer le sens que présentaient ces caractères, mais tous les signes du bas manquaient, le temps les avait effacés, et la seule chose qui me parût claire c’est que ce roc devait perpétuer la mémoire d’un chrétien mort il y a quatorze cents ans et peut-être enterré là. Le nom même de cet homme était illisible.
Belladonna se tenait pensive à mes côtés ; je l’interpellai :
– Qu’est-ce que cela ?
– Mystère, répondit-elle doucement ; personne ici-bas ne peut répondre à ta question ; celui qui repose là est ignoré des hommes, il est heureux ; la nature seule pourrait dire son nom, mais elle ne le veut pas ; elle sait bien garder les secrets, la nature, et ne révèle jamais rien de ce qui lui est confié.
Nous reprîmes notre marche ; le chemin devenait de plus en plus difficile. Nous dépassâmes quelques hommes pesamment chargés qui gravissaient péniblement le rude sentier ; je leur demandai ce qu’ils portaient.
– Les provisions pour l’hôtel Piora, me répondit l’un d’eux en s’arrêtant un instant pour essuyer son visage, dont le teint avait passé au rouge brun et qui était tout couvert de sueur. « Tout ce qu’on mange là-haut et tout ce qu’on boit, sauf l’eau, il faut l’amener ainsi ».
Il me sembla que la pensée du rude labeur de ces malheureux m’ôterait l’appétit pendant mon séjour à la montagne.
Nous traversâmes ensuite un hameau composé uniquement de granges et d’étables, et qui n’est habité que pendant quelques semaines d’été. Je commençais à me sentir las ; ma compagne, au contraire, marchait d’un pas toujours plus accéléré ; sa physionomie s’éclairait à mesure que nous nous élevions. Enfin, à un contour subit du chemin, une maison blanche apparut à nos yeux. Belladonna me l’indiqua du doigt.
– Voilà l’hôtel, tu es arrivé ; adieu.
Et avant que j’eusse pu la retenir et la remercier, elle avait pris un sentier contournant une des dernières arêtes de la montagne, et disparaissait derrière un repli de terrain. Je restai quelques instants immobile, occupé à réfléchir à mon étrange aventure, puis je m’avançai vers le bâtiment que la mystérieuse créature m’avait indiqué. J’y fus cordialement reçu et installé dans une des plus belles chambres.
Lorsque je me fus rafraîchi et que j’eus écrit une carte pour te dire que j’étais bien arrivé, l’envie me prit de faire quelques pas autour de la maison pour me rendre compte des lieux ; puis j’étais poursuivi du secret espoir de rencontrer de nouveau Belladonna. Elle ne devait pas être loin ; sa magique apparition allait peut-être encore surgir devant moi.
Une fois en plein air, la magnificence du paysage qui m’environnait changea pour un instant le cours de mes pensées. Figure-toi un hippodrome gigantesque, dont le fond est rempli par un lac bleu noir et profond comme le ciel. Tout autour de grandes montagnes se profilent en sombre sur l’azur clair. On entend les sons argentins des clochettes des chèvres et ceux plus graves des bourdons des vaches, au nombre de plusieurs centaines, qui paissent tranquillement sur les pentes glissantes. Les rives du lac forment mille anses mignonnes, dont chacune est un petit Éden tapissé de rhododendrons, de mousses et d’herbes. Les mélèzes se reflètent dans l’eau claire ; les oiseaux chantent joyeusement dans leurs branches.
J’étais ravi !
Les jours suivants, je fis peu à peu connaissance avec les personnes qui se trouvaient en séjour dans l’hôtel. Elles me furent de très agréables relations ; je crois vraiment qu’on est meilleur sur la montagne que partout ailleurs, car, bien que nous eussions de longues conversations, nous ne disions jamais de mal les uns des autres. Le matin, chacun allait errer de son côté ; l’après-midi, on se réunissait devant la maison, sur la terrasse, les dames avec leur ouvrage, les messieurs avec leurs cigarettes, et on prenait le café ensemble ; quelquefois aussi nous nous arrangions pour faire de grandes courses, où chacun apportait sa part d’entrain et de provisions.
Je n’essayerai pas, mon vieux Andréa, de te raconter toute cette vie en détail ; tu n’as besoin de connaître que les quelques circonstances qui ont directement trait à l’état où tu me vois.
Un jour j’eus la fantaisie d’entreprendre seul une ascension assez longue ; je me fis bien expliquer la route à suivre et me mis en chemin, le sac sur le dos ; je marchai longtemps au milieu des grands blocs de rochers que les avalanches détachent chaque hiver des montagnes qui surplombent la vallée. L’air était d’une admirable pureté, le panorama qui se déroulait à ma vue, magnifique. Après une heure de marche, j’arrivai au lac Tom, petit réservoir un peu plus élevé que le lac Ritom, auprès duquel est situé l’hôtel. Après avoir dépassé celui-là et gravi une pente assez raide, j’en retrouvai un troisième, puis un quatrième. C’était avec un vrai plaisir d’enfant que je m’approchais de ces rives solitaires ; j’aime ces lacs des Alpes si petits et si encaissés que les tempêtes parviennent à peine à troubler leurs ondes, et si profonds en même temps. Ce sont comme les grands yeux ouverts de la montagne, yeux pareils à ceux des sirènes, qui attirent l’homme et le fascinent.





























