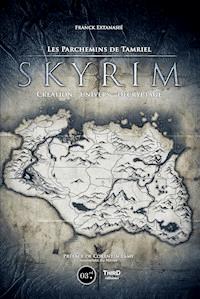
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Une fine analyse du célèbre jeu vidéo Skyrim.
Après avoir présenté en détail les plus grandes sagas sur console, Third Éditions s’engage dans l’analyse des séries mythiques du monde PC. Après
Half-Life, c’est au tour de la saga
The Elder Scrolls de passer entre les mains de Third. Cinquième épisode de la série,
Skyrim connut en 2011 un succès planétaire. Aujourd’hui encore, des millions de joueurs le pratiquent sur PC et console. À l’occasion de la sortie du
remaster, Third Editions se propose une analyse complète de ce volet.
De l’univers au gameplay, des thématiques aux conditions de création, l’ensemble du titre sera décortiqué dans cet ouvrage.
EXTRAIT
Avec les balbutiements de la 3D, qu’elle soit simulée, isométrique ou précalculée, les développeurs ont amorcé des essais sur de nouveaux styles graphiques, mais aussi des
gameplay différents pendant quinze ans, testant les limites des micro-ordinateurs tout en se formant aux nouveaux outils, en en créant parfois eux-mêmes pour répondre à leurs besoins. La série des
Elder Scrolls est née de cette évolution technologique et de l’envie de ses développeurs de s’essayer à un genre différent, le RPG en vue à la première personne. L’un des premiers jeux à avoir utilisé ce concept est l’un des ancêtres les plus vénérés du genre,
Wizardry, qui mêlait aventure à la première personne dans des univers simulant la 3D et insertion de monstres en 2D. Lorsque le premier épisode sortit en 1981, sa qualité graphique permettait de découvrir une vision plus intimiste où l’on parcourait des donjons et affrontait des monstres puissants dans une quête dont les ressorts scénaristiques importaient finalement assez peu. L’expérience se suffisait à elle-même et les racines empruntées à
Donjons et Dragons ont finalement fondé les bases du jeu de rôle occidental qui va se développer à sa suite. Catégorisé dans les
dungeon crawlers, des jeux mêlant exploration et action à la première personne, la série Wizardry se développera pour devenir une véritable référence du C-RPG, passant le flambeau à de multiples créations s’en inspirant.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Avec
Les Parchemins de Tamriel, on touche à l’essence même de la création d’un titre qui a marqué toute une génération. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré, bien au chaud, avec une choppe d’hydromel (ou de café) à portée de main et laissez le souffle épique de cette saga vous envahir l’espace d’un moment de lecture. Cet ouvrage se révèle indispensable pour tous les amoureux de Skyrim mais aussi pour les curieux. -
Blog Potion de mana
À PROPOS DE L'AUTEUR
Franck Extanasié : Journaliste jeux vidéo, tech et culture, podcaster. Taulier d'
Artofgaming.fr, animateur et staff
Radiojv.com et
Radiokawa.com, M.O.D.O.K. de
lesclairvoyants.net. Attendez ma mort pour publier le reste de ma biographie, je suis sous NDA.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les parchemins de Tamriel. Skyrimde Franck Extanasié est édité par Third Éditions 32 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 TOULOUSE [email protected]
Nous suivre : : @ThirdEditions : Facebook.com/ThirdEditions : Third Éditions : Third Éditions
Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit constitue une contrefaçon passible de peines prévues par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
Le logo Third Éditions est une marque déposée par Third Éditions, enregistré en France et dans les autres pays.
Édition : Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi Textes : Franck Extanasié Chapitre V : Rémi Lopez Relecture : Zoé Sofer Mise en pages : Julie Gantois Couverture : Bruno Wagner Couverture First Print : Jan-Philipp Eckert
Cet ouvrage à visée didactique est un hommage rendu par Third Éditions à la grande série de jeux vidéo The Elder Scrolls.L’auteur se propose de retracer un pan de l’histoire du jeu vidéo The Elder Scrolls : Skyrimdans ce recueil unique, qui décrypte les inspirations, le contexte et le contenu de ces volets à travers des réflexions et des analyses originales.
The Elder Scrolls : Skyrim est une marque déposée de Bethesda. Tous droits réservés. Le visuel de la couverture est inspiré des jeux de la série The Elder Scrolls.
Édition française, copyright 2017, Third Éditions. Tous droits réservés.
ISBN 979-10-94723-42-5
Dépôt légal : février 2017
Imprimé dans l’Union européenne par Grafo
À mon père, qui n’est jamais loin.
PREFACE
« Écoute, Corentin, je suis désolé, mais une liste de cheatcodes pour Daggerfall, ce n’est pas une préface, surtout pour un livre sur Skyrim. »
Le souvenir des mots de Mehdi résonnait douloureusement alors que je portais la paille à mes lèvres.
« Si c’est de calme dont tu as besoin, on peut te dégager un petit budget, te payer un week-end en Picardie. Ou même une semaine en Lozère si ça peut t’aider. Tiens, écoute, tu as carte blanche, OK ? Mais il nous faut cette préface à ton retour. »
Un bruit de succion un peu écœurant me sortit de ma torpeur. Machinalement, j’envoyais ma paille fureter au fond de cette noix de coco dont le lait, désormais absent, avait été astucieusement agrémenté de quelques traits d’un rhum viril, tandis que j’agitais mollement une main incertaine vers un homme qui pouvait tout à fait être Pablito, employé du Hilton de Punta Cana.
Riche idée que celle de Mehdi. Ce séjour sur les rivages caribéens m’avait effectivement apporté un repos bienvenu. Tel un improbable Jack London tropical, c’est de ce côté-ci de l’Atlantique que j’étais venu puiser l’inspiration, moins attiré par la promesse d’un climat clément que par l’idée qu’il me faudrait d’abord me perdre pour mieux trouver mon angle.
Une fois captée l’attention de Pablito, je me laissai glisser dans une chaise aussi longue que ce mois avait été court. Les palmiers ployaient sans conviction sous les coups de boutoir paresseux d’un alizé au sens de l’orientation approximatif. D’ici, l’eau semblait d’une tiédeur indécente.
Il ne me restait plus qu’une vingtaine de minutes avant que mon taxi pour l’aéroport Las Américas ne marque le début de mon trajet retour. Tous les procrastineurs vous le diront : c’est le moment idéal pour commencer à travailler.
« Qu’est-ce que Skyrim a de si spécial ? » interrogeais-je un peu abruptement Pablito qui, plutôt que de me répondre, tenta de m’expliquer pour la cinquième fois qu’il ne travaillait pas là, qu’il était directeur d’agence à la BNP de Montargis et que s’il avait bien voulu m’apporter cet ultime coco loco, il fallait vraiment que je le laisse tranquille, maintenant.
C’est pourtant à cette angoissante question que je devais trouver une réponse sans plus tarder. Vingt ans que je m’interroge. Vingt ans depuis mes douze ans et ce sujet sur Daggerfall dans l’émission de Canal+ Cyber Flash, présentée par l’envoûtante Cléo. Vingt ans que je suis obsédé par les Elder Scrolls, et en particulier par leur deuxième épisode.
Pourquoi diable ? Est-ce la liberté totale qu’il m’accordait ? Je le croyais à l’époque. À l’image du journaliste de Cyber Flash, un certain Marc Lacombe, qui expliquait ainsi qu’on y était « totalement libre ». S’ensuivait alors une description de sa première partie : après avoir volé à l’étalage et tenté de revendre le fruit de son larcin pour s’offrir un cheval, il s’était fait arrêter par la garde, jeter en prison, et débaucher, à sa sortie, par la Guilde des Voleurs.
C’est vrai. Ce genre de choses arrivent dans Daggerfall.
« J’aurais aussi bien pu devenir commerçant ou pilleur de tombes, m’acheter une maison et la meubler », énumérait à l’époque le journaliste enthousiaste.
Ce n’était pas totalement faux non plus.
Pourtant, dans Daggerfall, passé le stade de la découverte, l’intérêt de la chose se dissipait rapidement. Devenir maître d’une guilde : très bien, mais après ? Acheter une maison, pourquoi pas, mais pour quoi faire ? Une infinité de quêtes, de personnages et de villes, à quoi bon, si elles sont toutes identiques ?
Quelques mois plus tard, Fallout proposera une aventure autrement mieux gaulée, sans rien sacrifier à la liberté du joueur. En 1999, Planescape Torment nous apprendra qu’on peut (bien) raconter une histoire. Deus Ex, en 2000, fera la preuve que le jeu de rôle n’est peut-être pas, finalement, le genre le plus à même de nous permettre de... jouer un rôle. Et puis, en 2002, évidemment, il y aura Morrowind.
Et pourtant, si Morrowind, Oblivion et, donc, Skyrim sont supérieurs à Daggerfall en tout point, c’est bien lui qui continue de m’obséder. Pourquoi donc ? J’aspirais pensivement une autre rasade de rhum coco tandis qu’au loin, une paire de baleines se chamaillait sans entrain au cours de ce qui semblait être quelque jeu cétacé aux règles inconnues et probablement sexuelles.
C’est vrai que Skyrim est un meilleur jeu vidéo que Daggerfall. Il n’y a même pas photo. Plus ramassé, mieux maîtrisé, il confronte le joueur à des objectifs. Normalement, on s’y amuse même. Certainement plus que dans le très ambitieux, mais finalement très superficiel Daggerfall, dont les promesses ont la fâcheuse tendance de s’évaporer dès lors qu’on commence à les regarder de trop près.
J’en étais là de mes réflexions, quand un homme prénommé assez étrangement Patrick vint me tirer de mes rêveries. Il avait une allure sympathique et des clés à la main : c’était mon taxi. À cette idée, la panique me gagna : de retour en France, qu’allais-je pouvoir dire à Mehdi et Nicolas, eux qui avaient mis en péril la survie même de Third Éditions pour me gratifier de cette dispendieuse retraite caribéenne ?
Heureusement, les effets conjugués du rhum et du ronronnement du moteur eurent bientôt raison de mon inquiétude. Alors que j’amorçais un roupillon, je surveillais au cas où les étendues verdoyantes de la côte dominicaine. Je me demandais si les vagues se fracassaient avec la même régularité quand j’étais à Paris, si les vaches mastiquaient avec autant de détermination quand j’étais à la rédaction, si les noix de coco continuaient de pousser quand je faisais mes courses chez Monoprix.
Et pendant que ces prés s’appliquaient à défiler avec la constance tranquille dont seules sont capables les plus banales des étendues d’herbe, je compris. Elle résidait là, la beauté de Daggerfall. Pas dans ce qu’il a d’extraordinaire, mais bien dans sa banalité. Et surtout, dans l’ambition délirante et les efforts anachroniques qu’il déploie pour tenter de la rendre tangible.
Ceux qui ont fait Daggerfall le savent : il est parfaitement possible d’explorer tout ce que le jeu a à offrir en ne quittant la région de départ que le temps de quelques missions ponctuelles. On parle d’une superficie équivalente à celle de l’Allemagne, de 15 000 villes et donjons ? La réalité, c’est que 99,9 % d’entre eux ne servent littéralement à rien.
Et pourtant, l’immensité de cet espace virtuel sans intérêt donne le vertige. Aller faire un tour à la boutique de vêtements de Holwich, dans l’obscure province de Koegria, n’a aucun intérêt – et il y a d’ailleurs fort à parier qu’aucun joueur n’y ait jamais mis les pieds. Et pourtant, elle est là. Un marchand vous y attend, vous y saluera avec une des trois phrases qu’il connaît, vous invitera à consulter ses étagères achalandées aléatoirement.
Là où la plupart des jeux se contentent d’évoquer le monde paisible et ennuyeux qui continue d’exister à côté de votre quête glorieuse, Daggerfall vous laisse, si vous insistez, la possibilité de vous assurer que le monde continue d’exister sans vous. Comme un défi bravache : « vous voulez vous ennuyer ? Allez-y ! »
En assumant l’inintérêt de son univers, Daggerfall souligne en creux l’importance du destin personnel qu’on va s’y inventer. Et ça, même son génial et lointain descendant Skyrim, où chaque bicoque est une promesse d’aventure, n’aura réussi à me le faire ressentir. Oui, le vrai monde est chiant et même si je n’ai pas besoin de le vérifier, j’ai besoin de savoir que celui de Daggerfall l’est aussi pour y croire.
J’avais ma préface. Triomphant, je serrai dans ma main mon billet en business class, en adressant à Patrick un hochement de tête complice qu’il ne comprit pas.
Note de Mehdi : c’est un affreux malentendu, ces vacances sont à ta charge, Corentin.
CORENTIN LAMY
Né en Bretagne en 1984, Corentin Lamy fatigue tout le monde avec les Elder Scrolls depuis l’âge de douze ans. En 2001, il lance La Grande Bibliothèque de Tamriel, site consacré à l’univers de la série. En 2003, il tente même d’intégrer la rédaction du magazine Joystick en proposant un test de Morrowind. En vain. En 2011, il force malgré tout l’entrée de la rédac et décide unilatéralement de s’y installer pour un an, le temps de couler l’antique publication. En 2013, il co-fonde le magazine JV pour continuer de parler de Bethesda et, pour être certain de toucher même les franges les plus analphabètes de la population, lance avec des confrères le podcast audio ZQSD.fr. En 2016, il intègre finalement la rédaction du Monde. Depuis, il y milite pour la création d’une rubrique récurrente intégralement consacrée à Daggerfall. Sans succès pour le moment..
AVANT-PROPOS
Si vous lisez ces lignes, c’est que la rédaction de cet ouvrage est arrivée à son terme et qu’il vous est parvenu ; après la préface de Corentin Lamy, que je remercie pour son amitié et son aide dans la construction de ce livre, il m’appartient de vous détailler les péripéties ayant mené à sa rédaction et les raisons pour lesquelles j’ai choisi d’écrire sur ce cinquième volume de The Elder Scrolls. Cette introduction est autant une préface autobiographique que l’origine détaillée de mon voyage étrange dans le monde de l’écrit vidéoludique. Si ce sujet ne vous intéresse que peu, je vous enjoins à sauter ces quelques pages pour entrer dans le vif du sujet, en espérant que vous en apprécierez les différents chapitres.
Dans un passé lointain de mon existence, au tout début de ce que je nommerai pudiquement mon office, le RPG était roi. Nul autre genre ne maîtrisait aussi bien la narration, et le Japon dominait le secteur sur ce qui était la plate-forme de prédilection des joueurs, la console. Ma première introduction au RPG, à la fin des années quatre-vingt, fut une révélation. Le genre était technologiquement balbutiant, mais son écriture et sa capacité à faire voyager l’esprit étaient déjà ancrés dans ce qui allait devenir le sel de ma terre. L’enfant que j’étais alors tomba dans ce bouillon de culture, fasciné par sa richesse et les mondes infinis qu’il proposait. Même si je ne comprenais pas toutes les finesses de ces jeux devenus aujourd’hui des classiques, la trace qu’ils laissaient en moi à chaque nouvelle aventure contribuait à construire l’adulte que j’allais devenir.
Wizardry, Ys, et Final Fantasy étaient pour moi bien obscurs, des jeux dans une langue que je ne comprenais que grâce à la traduction d’un adulte, le père de mon voisin qui était un passionné de la première heure. Il nous fit découvrir la richesse du jeu vidéo grâce à l’import, mais aussi grâce aux premiers outils créés pour copier des jeux, comme le Game Doctor SNES, une machine que je croyais tout à fait officielle à l’époque... Pendant de nombreux week-ends et vacances, nous avons parcouru ensemble les univers incroyables que nous offraient la Super Famicom et sa jumelle européenne la Super Nintendo, me donnant toujours plus envie d’apaiser cet appétit dévorant de voyages impossibles. Lorsque je vendis ma NES pour m’offrir la petite sœur, Mystic Quest Legend venait à peine de sortir sur notre territoire, et j’eus tôt fait de dévorer égoïstement mon premier jeu en solitaire. Entre cette Super NES et ma/mon Game Boy – ne vexons pas les zélotes sur son genre, ils pourraient m’en vouloir – , ma collection de RPG s’étoffait au fil des années, me faisant aimer l’écriture de récits épiques à la sauce nippone.
Mais les années passèrent et un autre genre de jeu finit par atterrir entre mes mains, le genre à faire la Une des journaux et à effrayer les parents tranquilles qui aiment leurs chères têtes bouclées. Le jeu de rôle papier, comme une gifle main ouverte, fut une seconde révélation dans ma jeune vie en développement. Si le cinéma m’avait introduit à Conan et à Willow, le jeu de rôle me permettait de devenir ce barbare irascible ou ce magicien rusé le temps d’une partie. Goûtant à ces plaisirs alors fort décriés par les médias, qui pensaient voir leur jeunesse se pervertir dans des jeux morbides conduisant à une radicalisation sataniste, je rêvais d’allier ce que j’aimais de primal dans le jeu de rôle papier et tout ce que le RPG japonais pouvait avoir d’onirique.
Avec la bénédiction de mes parents, dont les regards attentifs ne diminuaient pas le support, je finis par me plonger dans ces deux mondes pour en découvrir les arcanes. Magic : The Gathering amincit leur portefeuille – comme pour beaucoup d’autres parents – , Donjons & Dragons, Vampire : The Masquerade et les codex de Warzone finirent de vider ce qui restait de leur budget « loisirs pour le petit ». Nous n’étions certainement pas une famille aisée et l’âge m’a fait prendre la mesure des coûts qu’entraînaient mes incandescentes passions, mais leur perspicacité quant au devenir de leur turbulent gamin me surprend encore lorsque je pense à mon adolescence.
Vers le milieu des années quatre-vingt-dix, alors que posséder un ordinateur personnel était encore un certain luxe et un luxe certain dans ma campagne natale, certains camarades eurent la bonne idée de frimer et de me faire essayer les jeux qu’ils avaient. « Monumentale erreur » comme dirait le héros qui ornait le mur de ma chambre à côté d’un Shaquille O’Neal grandeur nature, le RPG occidental et le FPS étaient réels et me tendaient les bras. Entre deux parties de Wolfenstein 3D et de Duke Nukem 3D, Ultima et Daggerfall venaient titiller mes appétits, devenus ceux d’un adolescent dont les hormones bouillonnantes ne pesaient pas lourd face à ces univers inconnus. Malheureusement, il me fallut me faire une raison et le PC familial tant attendu fut vite remisé dans les projets lointains du foyer parental, son coût et la vitesse à laquelle la technologie évoluait n’étant pas l’investissement le plus adéquat du moment.
Retournant sur mes consoles adorées, ce bon vieux RPG nippon m’offrit spectacle et inspirations pendant des années. Par la richesse scénaristique et les influences multiples qu’il retraitait pour en extraire une identité à nulle autre pareille, il comblait ce vide d’univers occidentaux auxquels je n’avais pas accès. Lisant avec assiduité les magazines dédiés au genre et amassant des montagnes de bouquins de soluces, j’aiguisais ce qui allait devenir un atavisme et un moindre talent, l’accomplissement d’un jeu en quelques jours et l’envie d’écrire sur le jeu vidéo, ses univers et ses mécanismes. Je reconnais plus que volontiers que l’humoristique expression maternelle « t’es pas rentable » était fort à propos lorsque je racontais à table que j’allais tuer le boss final de Final Fantasy VIII quatre jours après l’avoir reçu en cadeau. Cet épisode força le destin lorsque, bloqué devant l’Omega Weapon, je pris la décision d’aller demander conseil à un professionnel. L’ado culotté que j’étais prit le téléphone et alla chercher de l’aide auprès de la rédaction de son magazine fétiche de l’époque, Consoles +. La personne qui décrocha le téléphone, un certain Kael, changea à ce moment-là ma vie, d’abord en me disant que son collègue était en retard et que j’étais arrivé plus loin que lui – ce qui flatta le peu d’ego que j’avais – puis en me disant : « C’est intéressant de discuter avec toi, je te laisse mon téléphone, appelle quand tu veux ».
Cette amitié naissante se transforma assez vite en un lien étrange où, pour la première fois, j’avais l’impression que cette faim de jeux et d’univers était comprise. Durant les mois et années qui suivirent, la relation entre le jeune lecteur et le jeune rédacteur que nous étions se renforça pour devenir un improbable duo de soluceurs affamés de RPG. Chaque guide qu’il prenait créait entre nous une méthodologie stupide de double vérification où nous jouions six à huit heures à tour de rôle pour vérifier que l’un ou l’autre n’avait rien raté. L’agent de l’ombre que j’étais visait l’excellence et longues furent les nuits de relecture entre nous, autant que la taille des factures téléphoniques de son poste à feu EMAP Alpha, maison d’édition dont Consoles + était alors l’un des fleurons. De Skies of Arcadia à Grandia II en passant par Vagrant Story et Final Fantasy X, notre binôme Mytho-Renardien m’apporta la certitude que l’écrit était une composante vitale de mon existence, et le jeu vidéo un média qui me prendrait autant qu’il m’offrirait.
Après toutes ces années à dévorer des créations nippones de qualité, la Xbox arriva avec un vieux démon, ce que la PlayStation n’avait pas réellement dans son catalogue de l’époque, du RPG occidental. Fin 2002, le mastodonte de Microsoft prit place dans ma collection ; si les premières semaines furent consacrées au démantèlement complet de Myst III : Exile et au découpage massif de monstres infernaux sur Enclave, une promesse m’attendait dès que mon budget le permettrait, Morrowind. La rencontre entre nous était prévue et ardemment attendue, le décès de mon père le fut beaucoup moins. Dévasté comme tout enfant l’est par la perte d’un parent après un difficile combat contre la maladie, le seul ami qui resta auprès de moi en ces temps difficiles m’offrit maladroitement ce troisième Elder Scrolls, avec ces mots qui résonnent encore : « Ça va te changer un peu les idées, poulet ».
Tant d’années s’étaient écoulées depuis ma première rencontre avec Daggerfall, avec ce mirage dont l’univers me paraissait infini et libre de toute contrainte ; le premier contact fut rude et sans appel, cet univers était le plus incroyable de tous ceux que j’avais pu visiter, mais aussi le plus difficile à aborder sans références. Dans une spirale mêlant refus du deuil et soif absolue d’évasion et de connaissance, les heures devinrent jours, puis semaines et mois, et lorsque la réalité revint frapper avec force à ma porte, près de deux années d’errance et de négation venaient de passer. Vvardenfell était un deuxième chez-moi, ses secrets révélés jusqu’au dernier et son histoire aussi bien connue que de ses créateurs. Une console grillée d’usure et trois mille cinq cents heures d’acharnement sur un seul jeu en moins de deux ans, sans confiner à la folie, force est de constater qu’il fallait avoir un sacré grain pour revenir sans cesse sur un jeu retourné de fond en comble, simplement pour ressentir la plénitude absolue offerte par les terres nues de Morrowind. Si je ne tire aujourd’hui aucune fierté de cette période difficile de mon existence et de ce que j’étais alors devenu, elle aura conditionné l’écriture de ce livre qui, quatorze ans après le tragique événement ayant déclenché mon isolement temporaire, me permet de boucler une boucle et de tenir une promesse faite à un père qui croyait en son fils.
Revenant au monde des vivants tout en découvrant les C-RPG des années 2000 que sont KOTOR I et II, Jade Empire, Deus Ex : Invisible War ou encore The Bard’s Tale, j’avais la joie d’allier les deux univers que j’aimais autrefois, dans une exécution à la fois différente du RPG japonais et du jeu de rôle traditionnel. Lorsque Oblivion fit son entrée sur Xbox 360, éblouissant le monde par sa splendeur et ses promesses, toutes les alertes sonnèrent dans mon entourage proche. La tentation de replonger dans la suite des aventures en Tamriel et de découvrir des pans entiers d’une histoire encore inconnue me brûlaient littéralement de l’intérieur, mais il n’était pas question d’investir dans une nouvelle machine de sitôt. Enfin, c’était sans compter mon dernier parent en vie, supportrice infatigable de mes diverses errances et soutien indéfectible de mes suicidaires entreprises. Écrivant plus que de raison dans un style que je qualifierais aujourd’hui de « bordel épileptique », je pus retrouver le goût de l’écriture et de l’analyse sur divers supports, du fanzine oublié aux obscurs sites de fans désireux d’en apprendre plus sur leurs licences préférées. Internet était un fabuleux outil et la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, il me fallait y apporter quelque chose de digne, ou tant que faire se peut, de moins bordélique que mes premières œuvres post retour du Styx. La série des Elder Scrolls était devenue une licence phare que le monde louait à l’unanimité, et j’avais bien l’intention d’être capable d’écrire son histoire pour ceux qui, comme moi, n’avaient pas eu le luxe immense de se ronchier dans leur dépression pendant si longtemps.
Mes efforts finirent par attirer l’attention d’un jeune Toulousain et de son comparse qui, un beau jour de 2010, vinrent me demander ce qu’était pour moi un Final Fantasy. Avec le recul, l’honneur était totalement déplacé, je n’étais personne et n’avais pas laissé de travaux que j’estimais valables, mais je pris le courage de répondre avec une certaine idée des choses, ce qui plut à mes interlocuteurs. Je ne m’attendais pas à me retrouver publié à côté de personnages de la presse spécialisée, petit scribouillard que j’étais, mais le destin aime à prendre des chemins tortueux et voir sa pièce à parfois tomber sur la tranche. Les mois et années passèrent et le contact ne se rompit pas, avec une blague récurrente échangée lors de nos conversations : « Un jour on va le faire ce livre sur Morrowind ». Cet événement heureux, revers de la tragique pièce lancée en 2003, allait lui aussi être à l’origine de ce livre. Les deux comparses toulousains devinrent éditeurs, entrèrent chez Pix’n Love avec leur collection, puis quittèrent l’honorable maison pour fonder leur troisième bébé, celui-là même à qui vous avez eu la générosité d’acheter cet ouvrage.
Il est temps pour moi de céder la place à l’important et vous laisser parcourir ce modeste essai sur l’univers de Skyrim. Du récit de son développement aux entrailles de son lore, de l’analyse de son gameplay à sa réception par la presse et le public, ce RPG est à lui seul le fondateur d’une génération de jeux s’inspirant de ses apports au genre. Si l’analyse journalistique est une part non négligeable de cet ouvrage, le vrai cœur de ce dernier est à chercher dans l’infinie richesse du lore, de ses religions et de son histoire écrite sur des milliers d’années. Dans l’immensité des références créées par des auteurs aussi passionnés que fous à lier, j’ai tenté d’extraire une souche historique et de produire des récits cohérents qui mettent en valeur la profondeur du jeu et les multiples facettes qu’il montre et cache à chaque nouvelle partie. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir Skyrim par la lecture et le jeu, en espérant que vous y prendrez plaisir et y trouverez quelques connaissances intéressantes.
Franck
BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR :
Bercé trop près du mur par des parents férus de culture, Franck a très vite compris que tartiner était trop dur et qu’il était bon de mettre la tête directement dans ce pot de confiture. N’aimant pas trop les petites voitures, qu’il préféra vite délaisser pour la lecture, son enfance sage s’est vite transformée en parcours du combattant lorsqu’on lui mit dans les mains des comics et une C52 Videopac. Contaminé par le jeu vidéo et ses héros, c’est sous la tutelle de parents complices qu’il s’est mis à jouer à tout ce qui lui passait entre les mains. Dévorant les jeux comme on dévore des tartines, ses passions croisées le guidèrent vers les premiers magazines de presse vidéoludique, Tilt, Player One, puis Consoles +. Trouvant dans ce métier insensé l’occasion de fusionner ses appétits, c’est en croisant le chemin d’un journaliste qu’il a découvert son métier. Son jeune mentor le corrompit tellement que bien des années plus tard, après quelques études rapides, il décida de se remettre à l’écriture et de dédier son existence à parler de culture. Des fansites aux blogs en passant par d’obscurs recoins d’Internet, son chemin le mènera à la presse web et papier lorsqu’il lancera Artofgaming.fr avant de devenir pigiste pour feu Jeuvideo.fr, Third Éditions et Gamekult. Et comme ce n’était jamais assez, c’est par les podcasts sur Radiokawa et Geekzone qu’il parle à sa manière de jeux vidéo, de cinéma et de comics. Selon certains, il a aussi beaucoup trop de potes.
CHAPITRE I
CRÉATION
I.1
NAISSANCE DE BETHESDA SOFTWORKS
Avant de devenir l’un des développeurs et éditeurs les plus importants du jeu vidéo moderne, Bethesda Softworks n’était qu’une petite entreprise regroupant des ingénieurs et des chercheurs en informatique. Au début des années quatre-vingt, l’informatique voit son évolution prendre une pente ascendante et le marché du micro-ordinateur s’étendre de manière exponentielle, ainsi l’intérêt de nombreuses personnes pour ces nouveaux médias interactifs va amener à la naissance du studio. À cette époque, Christopher Weaver, alors membre de l’Institut de Technologie du Massachusetts, officie sur les nouvelles technologies de communication et ses médias physiques et conceptuels. Travaillant sur de nombreux projets en plus de ses recherches, que cela soit sur un plan technique comme la transmission de données ou d’images, le développement de nouvelles caméras permettant de créer des films interactifs ou la gestion de données facilitant les travaux de cadrage ou de montage, Weaver baigne dans cette évolution galopante. Il dirige aussi une entreprise fondée avec plusieurs collègues du MIT, Media Technology Ltd., spécialisée en recherche et développement dans les domaines de l’ingénierie.
Les travaux de Media Technology sont encadrés par les recherches menées par les différents membres de l’université, mais les champs de recherche étant vastes et variés, certains d’entre eux s’adonnent à des essais de création vidéoludique. En 1986, l’un des membres de l’entreprise, Edward J. Fletcher, demandera à son collègue Chris Weaver de jeter un œil à l’une de ses créations, une rudimentaire simulation de football américain sur laquelle il travaille. Si le jeu n’est qu’un terrain de pixels vu du dessus où s’affrontent des points de couleur, le but premier du programme n’est pas le divertissement mais la représentation technologique d’une véritable partie de football américain.
Si les premiers essais de Weaver ne sont pas concluants et le jeu peu amusant à son goût, le concept l’intéresse et il se met à travailler sur un moteur physique permettant de mieux appliquer les règles du sport au logiciel. Après quelques mois de travail, Fletcher et Weaver décident de sortir le titre, désormais nommé Gridiron ! – nom original de ce sport – grâce à une nouvelle entreprise établie comme division de Media Technology Ltd. Le but de la société est avant tout de tester le marché du jeu vidéo PC et d’expérimenter en développant divers titres, Gridiron ! se place comme une excellente opportunité de se lancer dans cette aventure. Le jeu avait désormais un nom, mais il fallait aussi en trouver un à cette nouvelle entité. Le seul venant à l’esprit de Weaver étant Softworks, malheureusement déjà pris par une entreprise similaire, son choix se porta sur sa ville de résidence, Bethesda, à laquelle il ajouta simplement Softworks pour conserver son choix initial. En cette année 1986, Gridiron ! sortit sur micro-ordinateurs Amiga et Atari ST, un premier titre édité sous la bannière de Bethesda Softworks qui allait être le point de départ d’une série de succès.
LES DÉBUTS DU STUDIO
Peu de temps après la sortie de Gridiron !, la jeune société fut contactée par Electronic Arts afin de développer pour eux un nouveau jeu de football américain, le premier titre de la licence John Madden Football. Après plusieurs rendez-vous et des présentations diverses, le studio fut engagé et l’équipe se mit au travail. Très vite, certains doutes commencèrent à inquiéter Chris Weaver et ses collègues et, quand la date de sortie de leur jeu arriva en 1988, c’est un autre produit qui sortit sur les étals, un titre ressemblant au leur mais développé et édité par Electronic Arts, sans aucune mention de leur studio. Ce John Madden Football ressemblait à leur titre, mais surtout utilisait leurs travaux sur le moteur physique ainsi que de nombreux aspects développés par Bethesda. Le studio porta l’affaire devant les tribunaux, arguant que sa propriété n’était pas respectée et accusant Electronic Arts d’avoir engagé l’équipe afin de pouvoir leur dérober leur code, demandant 7,3 millions de dollars de dommages et intérêts, ce qui représente environ 15 millions de dollars à la valeur actuelle. Si les minutes et détails du procès n’ont jamais été rendus publics, Bethesda Softworks gagna sur le plan des droits en récupérant la preuve de paternité de son code et la reconnaissance de son travail sur le titre. Désormais en froid avec le futur géant EA, mais pas démuni pour autant, le studio va se tourner vers de nouvelles créations, toujours dans le domaine du sport, mais aussi dans une certaine licence du cinéma.
Les capacités de développement du studio reposant sur un savoir-faire en matière de moteur physique et de qualité d’adaptation du sport en simulation, c’est avec le hockeyeur Wayne Gretzky que Bethesda va rebondir. Toujours en 1988, Wayne Gretzky Hockey va débarquer sur micro-ordinateurs et surprendre les amateurs du genre. Sortant sur les plus grandes plates-formes de l’époque, Mac OS, Atari ST, Commodore Amiga et DOS – qui couvrait un vaste choix de machines – , le jeu va recevoir de bonnes critiques et permettre à l’équipe de mettre en place une première série de jeux, arrivant ainsi pour la première fois sur consoles avec l’adaptation sur NES sous l’édition de THQ. Bien vite, l’équipe décrocha un nouveau contrat afin de créer sur DOS le premier jeu issu du film Terminator, révélation cinématographique de l’année 1984. Ces succès vont aussi changer un détail dans la gestion de l’entreprise, qui d’un fonctionnement en comité va tourner vers une direction unique de Chris Weaver, désormais maître incontesté. Deux ans après le début de leur aventure post Electronic Arts, Wayne Gretzky Hockey II et Terminator sortirent sur micro-ordinateurs, renforçant la présence du développeur et lui octroyant de nouvelles capacités en tant qu’éditeur, le contrat de licence de Terminator lui permettant de déléguer le développement à des tiers sur consoles. Les affaires vont continuer ainsi jusqu’en 1992 et le lancement d’un nouveau projet, un jeu de gladiateurs qui va ouvrir la voie à une toute nouvelle série qui deviendra, quelques années plus tard, The Elder Scrolls : Arena.
I.2
LE DÉBUT D’UNE SAGA
Le projet Arena tourne dans la tête de nombreux développeurs de l’équipe depuis un moment, celle-ci désire produire un jeu dans un univers médiéval fantastique, mais la vision globale de ce dernier est de concevoir un titre où se battent les gladiateurs de différentes cités pour l’honneur et le pouvoir. L’univers de Tamriel existe déjà dans la tête de Julian Lefay et de plusieurs autres membres de l’équipe, tous amateurs de Donjons & Dragons. Les bases géographiques, les noms des pays et de nombreux détails font partie du monde créé pour leurs sessions de jeu de rôle, une base solide qui leur permet d’imaginer les multiples aspects du lore facilement, sans avoir à effectuer de nombreuses recherches supplémentaires. Le jeu est mis en chantier sous la direction de Chris Weaver, qui en tant que dirigeant suprême du studio valide et modifie les idées pour coller à sa vision. Malgré tout, le concept d’origine va peu à peu dévier au fur et à mesure que les parties de l’équipe influent sur l’univers du jeu. D’un titre censé présenter des escouades de gladiateurs s’affrontant entre eux, Lefay et ses collègues vont en faire un hybride mélangeant combats en vue à la première personne, gestion d’inventaire et de statistiques issue du jeu de rôle et fonder les bases de la série. La fin du projet approchant et les distributeurs ayant été prévenus qu’un jeu de combat de gladiateurs allait arriver, c’est une semi-catastrophe que prédit Weaver. Le jeu n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’il imaginait, la partie marketing ne reflète pas vraiment le fond du titre et la réception risque d’être plus que difficile. Pour essayer de déjouer les mauvais présages, l’équipe décide d’ajouter « The Elder Scrolls » en préfixe d’Arena, arguant que le nom annoncerait une série basée sur l’univers et que si l’intérêt venait à naître, ils pourraient avoir une porte de sortie et un nouveau concurrent à Ultima, dont l’épisode Underworld est sorti en 1992.
La sortie d’Arena, en mars 1994, n’est clairement pas un succès et la prédiction de Weaver semble se confirmer. Les revendeurs ont du mal à comprendre pourquoi, d’un titre de combat nommé Arena, le produit est devenu un jeu de rôle, les visuels sèment le doute, limitant les commandes. Les retours critiques ne sont pas toujours élogieux, beaucoup mettent en avant une trop grande difficulté pour les novices du genre, mais soulignent que le jeu dispose d’un propos et d’un univers intéressants, d’un moteur très bien travaillé et de graphismes plaisants. Malheureusement, le jeu ne cesse d’être comparé à Ultima Underworld, qui dans le cœur des joueurs demeure le must en matière de C-RPG. La première année d’exploitation d’Arena va fortement troubler l’ambiance du petit studio, Chris Weaver voit un échec cuisant entacher l’aura de son entreprise et des sommes conséquentes manquer dans les caisses. À ce moment précis, personne ne pense plus à retenter l’aventure et retourne sur des développements plus pragmatiques en ravalant ses regrets. Mais au bout d’un an, la surprise frappe le studio lorsque les chiffres de ventes s’avèrent décoller sans réelle explication. Les retours très enthousiastes de joueurs ayant découvert l’univers de Tamriel ont créé un effet boule de neige grâce au bouche à oreille. Bethesda arrive à rentrer dans ses frais et commence à faire du bénéfice sur le jeu jusqu’à enfin obtenir un beau succès populaire, mais malgré tout, Weaver garde en travers de la gorge la désobéissance et la prise de risque de l’équipe de Julian Lefay et le fera payer quelque temps plus tard.
LE DUR CHEMIN DE DAGGERFALL
Après avoir été échaudé par l’aventure Arena, et malgré les nombreux courriers envoyés par les fans du jeu pour demander une suite, Chris Weaver ne veut pas démordre de son idée. Le titre est pour lui un échec, il demande trop de travail aux équipes, s’écarte du domaine de prédilection du studio et surtout n’a pas, selon sa vision, de viabilité financière sur le long terme. Après de nombreuses demandes de Julian Lefay et d’intenses négociations, il cède cependant à la requête de son développeur et le laisse continuer ses travaux sur la suite d’Arena, déjà entamée durant le développement précédent. Seul problème, l’équipe allouée au projet est limitée au maximum et doit faire avec ce qu’on lui donne. Qu’à cela ne tienne, Lefay et son équipe se mettent au travail sur The Elder Scrolls II : Mournhold, basant l’histoire en Morrowind et dans la région de sa capitale éponyme, connue en français sous le nom de Longsanglot. Les difficultés s’enchaînent et le manque de membres se fait vite sentir, ralentissant de plus en plus l’avancée du jeu. Le choix sera fait de replacer l’action du titre dans une région moins étendue, la Baie d’Illiaque, qui permettra de varier les environnements tout en maîtrisant plus facilement le déroulement du jeu. Autre problème majeur, Lefay est à la fois le leader du projet et le seul programmeur.
Même s’il bénéficie d’un assistant qui l’aide ponctuellement et du soutien de la part de certains collègues, le reste de l’équipe est majoritairement composé d’artistes et de designers qui œuvrent à concevoir un univers qui s’écarte de l’image qu’avait Arena, jugée trop proche d’Ultima Underworld. Le développement va devenir de plus en plus chaotique lorsque Chris Weaver, pressant Lefay pour qu’il sorte le jeu le plus vite possible, lui impose de changer de moteur pour utiliser le premier moteur 3D conçu par Media Technology, la maison mère de Bethesda Softworks. De son côté, son collègue et ami Ted Peterson termine toute la partie univers du jeu en officiant sur le scénario, les décors et l’univers visuel afin de créer un monde unique et ainsi imposer les bases d’une véritable série. Malheureusement, il devra quitter le projet pour se consacrer à d’autres travaux et Lefay ne pourra plus compter que sur lui-même pour effectuer le passage au nouveau moteur XnGine et programmer la totalité du titre. Supprimant énormément de features et corrigeant autant qu’il le peut les multiples bugs graphiques et physiques avec le peu d’effectifs capables de l’aider, Lefay termine le développement de Daggerfall dans une hâte qui n’a d’égale que l’incroyable pression exercée par Chris Weaver afin de sortir le jeu. Le 31 août 1996, après une course aussi effrénée qu’épuisante pour Julian Lefay et son équipe, Daggerfall sort aux États-Unis sur PC MS-DOS.
L’accueil de la presse américaine va encore une fois être mitigé et menacer la série sur les premières semaines. Développé dans la hâte malgré d’évidents besoins de peaufinage, les critiques US vont tacler le choix du XnGine, déjà dépassé par d’autres jeux en 3D comme Quake, développé par ID Software que l’entreprise rachètera bien des années plus tard, amusant retour du destin. Les multiples bugs sont aussi très critiqués, tout comme l’absence de nombreuses features annoncées avant la sortie, dénotant une fois de plus de la vitesse de développement et du manque de soin apporté aux finitions. L’univers et la qualité du scénario sont cependant salués pour leur richesse et leur originalité, effaçant un peu les reproches, mais pour de nombreux joueurs, le titre est injouable, trop grand et graphiquement passable. Rappelons-le, l’équipe de Julian Lefay est prise pour cible par la presse et les joueurs, alors qu’ils ont été forcés de changer de moteur et de presser le pas par un Chris Weaver autoritaire et sourd aux besoins du jeu. Si l’histoire rétablit enfin la vérité, en cet automne 1996 la petite troupe encaisse durement les retours. Pourtant, Lefay ne va pas se laisser faire et retrousser encore une fois ses manches pour corriger les bugs du jeu et ainsi offrir des patchs pour ses clients américains tout en préparant leur intégration pour la sortie européenne, prévue pour le 1er novembre de la même année.
Le lancement de Daggerfall sur le Vieux Continent trouvera un meilleur écho qu’outre Atlantique grâce à un premier contact privé de ses bugs majeurs, grâce aux immenses correctifs apportés durant les trois mois de décalage entre les deux sorties. D’une manière surprenante, l’Europe fera un excellent accueil au titre, notant toutefois ses graphismes moyens voire datés et la complexité de son gameplay. Si les critiques américaines étaient relativement dures, celles des pays européens s’avèrent au final plus enjouées, Didier Latil concluant son test pour Génération 4 par « Daggerfall est un des rares produits micro à pouvoir porter le titre de jeu de rôle ! » Retentant l’aventure après avoir récupéré les correctifs, les confrères américains réviseront leur jugement et salueront les qualités intrinsèques du titre, qui malgré un moteur dépassé, des retards de livraison et des finitions encore douteuses, mérite d’être salué et apprécié à sa juste valeur. Les magazines et sites Game-Revolution, Computer Games Strategy Plus et Gamespot en feront leur jeu de l’année, louant ses qualités narratives et les incroyables sensations old school d’un jeu de rôle papier. Daggerfall était enfin sauvé, The Elder Scrolls avait enfin acquis ses lettres de noblesse, mais le travail n’était pas fini pour autant. De nombreux membres de l’équipe originale ont quitté l’entreprise et Julian Lefay sait que mettre en chantier un troisième épisode n’est techniquement pas en adéquation avec ses besoins réels. Tamriel nécessite plus d’avancées techniques pour se présenter au mieux au monde, les moteurs 3D doivent encore évoluer et le moment n’est pas venu d’enchaîner sur un développement long dont il ne connaît pas l’issue. Épuisés par le travail titanesque qu’a demandé Daggerfall, Lefay et les membres de l’équipe restants vont prendre un peu de repos et travailler sur deux extensions, très vite séparées en jeux indépendants, An Elder Scrolls Legend : Battlespire et The Elder Scrolls Adventures : Redguard. Si cette idée somme toute plaisante servira de marchepied à un jeune membre de l’équipe qui deviendra le pilier des Elder Scrolls modernes, les appétits de M. Weaver, toujours à l’affût depuis sa tour d’ivoire, vont mener Bethesda Softworks à des remaniements drastiques et une tempête financière imprévue.
LA FIN D’UNE ÉPOQUE
Avec Daggerfall comme nouvel étendard, le studio dispose désormais d’une nouvelle image, mais ses bases demeurent celles posées lors de sa création, les jeux de sport. Différentes acquisitions vont venir gonfler les rangs de Media Technology afin d’élargir son champ d’action, Flashpoint Production, déjà intégré en fin 1995 comme bureau californien de la maison mère, puis XL Translab en 1997, société travaillant dans le domaine graphique et audiovisuel qui créerait les séquences vidéo des titres. Différents projets de jeux seront lancés mais n’arriveront pas à terme, le XnGine ne suffisant plus pour contrer les moteurs beaucoup plus récents de chez ID Software et consorts. Quelques titres seront néanmoins mis en route avec des technologies tierces pour une sortie en 1998 et 1999, Burnout : Championship Drag Racing, Magic & Mayhem, F-16 Aggressor et NIRA Intense Import Drag Racing.
Julian Lefay, dès les premières semaines de 1997, va se remettre au travail afin de développer avec son équipe Battlespire.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















