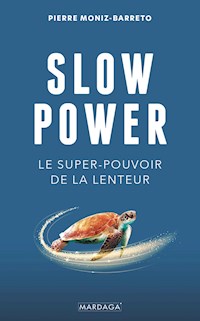
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dans une société occidentale qui se veut toujours plus rapide, Pierre Moniz-Barreto vous propose de vous poser et de prendre votre temps.
Dominée par la culture du « toujours plus, toujours plus vite », la société occidentale a fait de la rapidité et de la réactivité immédiate les conditions de la réussite. Et si nous découvrions que la lenteur est une formidable source de puissance, d’accomplissement, de réussite ?
Pierre Moniz-Barreto démontre que la lenteur, considérée à tort comme un handicap ou une tare, est une qualité et une force. Après avoir exploré le concept de lenteur et ses différentes dimensions, il propose de multiples ressources et exercices pratiques permettant de cultiver la lenteur et de bénéficier de ses bienfaits au quotidien. Invitant son lecteur à un parcours initiatique, il lève le voile sur la puissance de la lenteur : dans un indispensable équilibre fast & slow, elle s'avère être un levier de développement personnel et d’accomplissement professionnel adapté aux crises et mutations que nous traversons.
Découvrez le pouvoir de la lenteur, faites-en votre puissante alliée, pratiquez-la comme une arme de développement et d’accomplissement !
Redécouvrez les bienfaits de la lenteur dans votre vie privée et professionnelle !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pierre Moniz-Barreto est entrepreneur, auteur et conférencier. Il a cofondé en 2019 L’Académie des Intelligences Humaines où il déploie une expertise en intelligence spirituelle unique en francophonie. Diplômé d’études supérieures de commerce (ISG, Paris), il a exercé en marketing stratégique, communication institutionnelle et business développement au sein de grands groupes (Thomson, Club Med, Akzo-Nobel, etc.) Il est l’auteur de Slow Business (Eyrolles 2015) et de Se former à l’intelligence spirituelle dans le collectif Leadership et pratiques spirituelles (Collectif, EMS juin 2021).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Slow power
Pierre Moniz-Barreto
Slow power
Le super-pouvoir de la lenteur
Note de l’auteur : Dans cet ouvrage, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
« Trente, soixante, cent millions de morts, ne vous détourneraient pas de votre idée fixe : “Aller plus vite, par n’importe quel moyen.” Aller vite ? Mais aller où ?1 »
Georges Bernanos
1. Bernanos (G.), La France contre les robots, Rio de Janeiro, Comité de la France libre au Brésil, 1947.
Préface
« Ce que nous recueillons de notre vie secouée, me disait hier l’amiral G., vieux marin, c’est la tranquillité. C’est là lepremier des biens :la sérénité, l’égalité d’humeur, nous l’avons ;nous le gagnons à la mer. Nous vivons au milieu de tant de choses qui ont des caprices et qui sont si volontiers de mauvaise humeur, la mer, le ciel, la saison, le vent,les nuées, qu’il faut bien que nous ayons la paix en nous. Notrepaix, c’est notre force. Tout fait rage sous nos pieds et sur nos têtes ;nous avons notre ancre en nous-mêmes. Qu’est-ce que nous deviendrions au milieu de toutes ces choses inégales et bouleversées, si nous n’avions pas l’égalité d’âme ?Au-dehors tout ce qui fait l’agitation ;au-dedans tout ce qui fait le calme, voilà le marin2. »
Victor Hugo
C’est au souvenir de ce texte de Victor Hugo, lu il y a déjà quelques années, que m’a ramené l’évocation par Pierre Moniz-Barreto d’un navire dans la tempête comme symbole du slow power (voir le chapitre 6). La lenteur est en effet d’une incroyable puissance quand il faut tout mettre en œuvre pour éviter la panique et se concentrer sur ce que l’on peut faire, ici et maintenant, afin de franchir l’effrayante vague scélérate qui déferle vers vous en éclipsant l’horizon.
En temps de crise, tout nous incite à agir dans l’urgence, à réagir et parfois même sur-réagir, quant au contraire il faudrait sans cesse se poser la question du bon rythme. Cela demande une capacité à prendre suffisamment de recul afin de ne pas se laisser submerger par les émotions que génère le caractère angoissant de toute crise, avec son lotd’informations contradictoires, d’injonctions paradoxales, d’incertitudes, de complexité et de volatilité, désigné par ce fameux acronyme VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity; « volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté »), si souvent évoqué pour caractériser le monde complexe dans lequel il nous faut agir.
À la fois immergé et émergé dans le temps, il nous faut vivre au présent tout en étant imprégnés de nos souvenirs du temps passé et de nos interrogations sur le temps à venir. Passé, présent et futur se conjuguent dans une trilogie toute relative car étroitement liée à nos sensations, nos émotions, nos réactions et nos réflexions. Alors que le passé et le futur irriguent en permanence nos esprits, seul le présent est maîtrisable.
Dès qu’il s’agit des hommes, tout, absolument tout, sans la moindre exception, est toujours donné au présent. Aucun homme, jamais, n’a rien vu, rien entendu, rien senti, rien fait, rien pensé qu’au présent, il anticipe ce qui sera, mais il anticipe dans le présent. Il se souvient de ce qui a été, mais il s’en souvient dans le présent3.
« L’homme pressé » du XXe siècle industriel est devenu « l’homme instant » du XXIe siècle numérique : il agit de deadline en deadline, l’instantanéité s’imposant à lui alors même qu’il sait qu’il faut savoir prendre son temps pour répondre à son désir de cohérence, de profondeur et de sens. Il est heureux de constater que les humains n’ont pas tous la même vision du temps, et qu’au temps court et linéaire de l’Occident certains peuples orientaux et africains opposent une vision cyclique du temps, dans laquelle le passé, le présent et le futur évoluent ensemble : ce que j’ai fait hier et ce que je fais aujourd’hui détermine en partie ce qui peut arriver demain. Un proverbe, rappelé dans Terre des hommes par Antoine de Saint-Exupéry, résume cette vision et guide ces peuples dans leurs actions : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants4. » Voilà un bon repère quand il s’agit d’évoquer la durabilité de notre écosystème terrestre ! Ainsi, résister à la violence du temps court, à l’agitation et à la pression mais aussi à l’angoisse, suppose un travail sur soi et avec ses collaborateurs particulièrement exigeant. J’ai appris à mes dépens que le premier qui s’énerve perd la partie, car il dévoile ses failles et inquiète ses équipiers. D’où l’importance d’apprendre à bien se connaître, à déceler le moment où l’on est sur le point de se laisser prendre dans le flot des réactions. Il est alors temps de savoir « faire un pas de côté » en s’inspirant de ces deux repères majeurs : « Personne ne peut me blesser sans ma permission5 » et « On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter6 ».
C’est à ce travail que nous invite Pierre Moniz-Barreto dans son remarquable éloge de la puissance de la lenteur, en nous proposant une navigation reliant symboles, exercices pratiques, témoignages, voie sapientielle et voie spirituelle. Par cette lecture, vous découvrirez que vous pouvez atténuer vos impatiences pour mieux vous concentrer sur toutes les opportunités qu’offre l’instant présent, dès lors que l’on sait se connecter à lui, ici et maintenant, en résistant au stress de l’urgence.
Belle navigation.
Olivier Lajous7 Vice-amiral d’escadre 2S Auteur et conférencier
2. Hugo (V.), « Sagesse », Océan – Tas de pierres, Paris, Albin Michel, 1942, p. 317.
3. D’Ormesson (J.), La douane de mer, Paris, Gallimard, 1996.
4. De Saint-Exupéry (A.), Terre des hommes, Paris, Gallimard, 1939.
5. Citation attribuée à Gandhi.
6. Kant (E.), Réflexions sur l’éducation, Königsberg, Friederich Nicolovus, 1803.
7. L’amiral Olivier Lajous est l’auteur de trois ouvrages parus chez L’Harmattan : L’art de diriger (2013), L’art du temps (2015) et L’art de l’équilibre (2016).
Préambule
« À force de sacrifier l’essentiel à l’urgence, on finitpar oublier l’urgence de l’essentiel8. »
Edgar Morin
« Les personnages sont tellement conscients de ne pas arriver vivants jusqu’au bout qu’ils prennent tout le temps pour s’étudier, se regarder. Et chaque regard prend un poids et une force déterminante :la force de la survivance. Lalenteur ne vient pas par hasard9. »
Sergio Leone
La publication de Slow Business10 en 2015 a engendré une longue et surprenante série de sollicitations médiatiques et de demandes de conférences, qui m’ont amené à intervenir et à voyager aux quatre coins de la France et au-delà. Au cours des quatre années et demie qui ont suivi, l’intérêt suscité par cet ouvrage a dépassé tout ce que j’avais pu imaginer. J’ai longuement médité sur ce phénomène et je suis arrivé à une conclusion : l’intérêt de mes contemporains pour cet étrange sujet – le ralentissement efficace et la décélération performante en milieu professionnel – demandait à être vu comme un symptôme, ou plus précisément comme l’indice symptomatique d’un malaise plus vaste et plus profond. De fait, vous avez été nombreux, et bien au-delà des milieux entrepreneuriaux auxquels je m’adressais initialement, à me faire part de votre détresse face à un temps de plus en plus chargé et bousculé, à ne plus vouloir être victime du speed ambiant et de ses méfaits, à me confier votre désemparement face à l’infiltration d’une accélération omniprésente, ou face à la multiplication des injonctions court-termistes, ou encore face à l’impératif déroutant du multitasking permanent à haute vitesse. Pour nombre d’entre vous, la philosophie du mouvement slow apparaissait comme un possible antidote, susceptible de remédier à l’empoisonnement du temps. Mais les issues de secours ne vous semblaient pas clairement indiquées et bien des questions restaient en suspens. Quel chemin emprunter pour sortir de cette pressurisation temporelle ? Comment s’y prendre pour retrouver un équilibre temporel si malmené ? J’ai souvent eu du mal à apporter des réponses immédiates pleinement satisfaisantes car, en rédigeant Slow Business, je m’étais borné à faire un travail de type journalistique : une enquête sur un phénomène méconnu que je souhaitais simplement mettre en lumière sous la forme d’un état des lieux aussi objectif que possible. Par conséquent, je ne m’étais pas suffisamment impliqué personnellement : je n’avais pas vraiment mis à nu les mécanismes profonds qui œuvraient au cœur du phénomène ; je n’avais pas plongé dans le grand bain expérientiel ; je n’avais pas suffisamment rampé et creusé de mes propres mains pour saisir les racines du problème.
Au fil de mes interventions, j’ai peu à peu constaté que le phénomène ne se limitait pas aux chefs d’entreprise ou aux cadres supérieurs pressurés par leurs agendas surchargés et leurs nombreuses obligations – de toute manière, le système socio-économique dans lequel ces derniers évoluent est trop contraint et ne laisse pas de place à une philosophie du temps plus juste et plus sereine. Je pouvais essayer de leur en démontrer les vertus, mais j’avais chaque fois l’impression d’être Jean le Baptiste prêchant dans le désert : dans les milieux du business, je ne touchais véritablement qu’une portion très minoritaire de personnes dotées d’une vision plus haute et plus profonde, et d’une conscience plus ouverte. Les autres – la grande majorité – restaient enfermés dans le béton d’une réalité prétendument « contrainte », qu’ils n’arrivaient ni à remettre en cause ni à envisager sur un mode alternatif. En parallèle, et malgré le titre de mon ouvrage, l’on m’a régulièrement demandé d’intervenir auprès de divers publics et j’ai eu l’occasion de constater que le problème concernait tout le monde, y compris les professions libérales, les juristes, les fonctionnaires européens, les journalistes, les scientifiques, les étudiants, les retraités et bien d’autres publics variés. Le malaise était bien plus vaste et général. J’ai constaté que, si je voulais mieux répondre aux questionnements de celles et ceux que je rencontrais, il fallait que j’ouvre le cadre étroit du slow business.
J’ai donc fait un important retour sur moi-même et, au terme d’un long travail d’approfondissement, j’ai aperçu une pépite briller au cœur du magma. Comme si cette gemme m’avait susurré son nom, elle me dit :« Je suis l’un des secrets les plus étranges, la merveille des paradoxes, le cœur du réacteur temporel : je suis la puissance de la lenteur, je suis le slow power. »
8. Morin (E.), La Méthode – Éthique, Paris, Éditions du Seuil, 2004, t. VI.
9. Extrait d’une interview de Sergio Leone, à propos du film Ilétait une fois dans l’Ouest, tirée du documentaire Sergio Leone – Une Amérique de légende, réalisé par J.-F. Giré, Arte, 2018.
10. Moniz-Barreto (P.), Slow Business – Ralentir au travail et en finir avec le temps toxique, Paris, Eyrolles, 2015.
Avant-propos
« On n’a pas beaucoup de temps.Prenons-le !11 »
Alexandre Lhotellier
La notion de lenteur
La lenteur a mauvaise presse. Voilà plus de deux siècles que cela dure. Depuis la première révolution industrielle jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, la vitesse maximale était à la mode. À la fin du XIXe siècle, à l’occasion du chantier titanesque des chemins de fer transcontinentaux aux États-Unis, qui se réalisa sur le mode d’une incroyable course de vitesse, une croyance s’enracina : pour gagner, ilfaut être le plus rapide. Cette croyance devint l’un des principaux dogmes qui façonnèrent et dominèrent le XXe siècle et ses grandes industries. On renforça ainsi l’idée selon laquelle la lenteur est un défaut, une tare, un handicap, et qu’elle exclut de la course. La lenteur devint le propre des fainéants, des incapables, des losers. Les lents furent de plus en plus considérés comme des perdants. Pire, la lenteur ne pouvait qu’entraver la bonne marche du progrès, ralentir la croissance rapide du système et ce qui en découle : la multiplication accélérée des profits. Dès lors, les lents furent estimés comme des antisociaux, des parasites, des obstacles au progrès et à la modernité. Rien d’étonnant donc à ce que, au début du XXIe siècle, tant de personnes ressentent un sentiment de culpabilité à la simple idée d’être lent. On ne se débarrasse pas facilement de l’inertie liée à deux siècles de conditionnement et d’habitudes. Il se peut que le travail de déculpabilisation soit lui-même plutôt lent…
À la fin des années 1980, le mouvement slow food naquit sous l’impulsion de Carlo Petrini, journaliste, sociologue, critique culinaire : il rencontra un immense succès planétaire et attira plus de cent cinquante mille adhérents dans une centaine de pays. En 2004 parut In Praise of Slow (Éloge de la lenteur), traduit ensuite en plusieurs langues à travers le monde et vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires, faisant de son auteur, Carl Honoré, l’icône mondiale du mouvement slow. La lenteur commença alors à apparaître comme un antidote au speed généralisé : susceptible de ramener un peu de bien-être et d’harmonie dans le grand déséquilibre de nos existences accélérées et chahutées.
Mais le travail reste immense. En 2018, le Larousse donne de la lenteur une définition négative : « Manque de vivacité, lenteur d’esprit12. » La culture web n’y change rien et Wikipédia aggrave même le phénomène en définissant la lenteur comme : « 1) Manque de rapidité ; 2) Difficulté à imaginer et à concevoir ; 3) Manque de tonus et d’action13. » Ainsi, à l’aube du XXIe siècle, la lenteur est encore caractérisée comme un manque et l’on ne trouve aucune définition positive qui mette en avant la valeur propre de la lenteur. A contrario, il est aisé de remarquer que la rapidité, elle, n’est entachée d’aucune définition négative ; elle est décrite bien au contraire comme un avantage compétitif. Voilà donc plusieurs siècles que la lenteur est victime d’un lourd ostracisme moral qui tord notre rapport au temps et crée dans nos existences de nombreux dysfonctionnements temporels. Mais c’est justement parce que la lenteur reste profondément méconnue et incomprise, dans ses fondements et ses effets, qu’il faut – plus que jamais – rétablir sa valeur positive et redécouvrir sa puissance.
La notion de puissance
La lenteur, pour être bien comprise, doit être envisagée comme une puissance au sens antique du mot, c’est-à-dire en concevant la puissance comme une potentialité. À l’époque moderne et dans nos cultures occidentales, la notion de puissance est assimilée aux notions de pouvoir et de force. C’est une confusion que les super-héros incarnent bien. Superman et Flash voient le jour respectivement en 1938 et 1940 aux États-Unis. Les foules sont vite subjuguées par leurs super-pouvoirs au premier rang desquels figurent une force et une rapidité extrême : Flash est plus rapide qu’une balle de revolver et Superman va plus vite qu’une fusée. Il faut remarquer que ce phénomène est né au moment de la montée des fascismes et du bolchevisme, lesquels étaient fascinés par la rapidité et les courses de vitesse. C’est ensuite à travers les films hollywoodiens et les jeux vidéo que les super-héros ont envahi une bonne partie de la culture pop occidentale des XXe et XXIe siècles. Sont venus s’y ajouter de nombreux mutants, eux aussi dotés de pouvoirs exceptionnels. Plus récemment, le transhumanisme s’est greffé sur cette toile de fond culturelle en promettant de faire de nous des super-humains aux capacités modifiées, des mutants aptes à dominer le temps.
À rebrousse-poil de cette perspective qui valorise la puissance à l’état brut, la tradition aristotélicienne oppose une conception plus subtile de la puissance. Aristote l’envisage en effet comme une énergie (energeia), c’est-à-dire un mouvement considéré en son déploiement, mais il estime aussi que l’origine d’un tel mouvement est elle-même une puissance (dunamis), c’est-à-dire unepotentialitésusceptible de se réaliser, notamment grâce à l’intervention humaine. C’est bien ainsi qu’il faut penser la lenteur : une énergie en mouvement qui se déploie à partir d’une potentialité première. La lenteur est puissante parce qu’elle est un processus potentiel de déploiement dont nous devons nous saisir, afin qu’une réalité en gestation puisse se révéler et se concrétiser à terme.
La lenteur temporise, relativise, pondère les excès de pouvoir, dont l’exercice classique ne s’embarrasse pas de telles subtilités. La lenteur, moins efficace à première vue que la rapidité, est en mesure de faire la différence à condition que nous la laissions manifester sa mystérieuse puissance. Nous devons voir la lenteur comme une porte ouverte vers une énergie potentielle, mise en permanence à notre disposition, afin que ce qui doit sortir des limbes de la potentialité puisse réellement s’accomplir, et de la façon la plus adaptée qui soit. Cette vision fondamentale nous permet de comprendre que le temps est un allié si l’on ne le brusque pas et si l’on accepte que chaque chose arrive en son temps, afin de se déployer au mieux au moment le plus juste. Au-delà des caricatures, le temps lent et long est une puissance : à nous de nous y ajuster.
Vous pouvez me croire :cette sagesse temporelle est d’une grande puissance. Je l’ai vécu à de nombreuses reprises, y compris dans les circonstances les plus extravagantes. Et elle m’a souvent sorti de nombreuses impasses et situations périlleuses.
11. Lhotellier (A.), Tenir conseil – Délibérer pour agir, Paris, Soli Arslan, 2001.
12. Larousse, « Lenteur », en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lenteur/46653
13. Wiktionnaire, « Lenteur », en ligne : https://fr.wiktionary.org/wiki/lenteur
CHAPITRE 1 La ligne d’horizon : l’Équilibre fast & slow
« Le problème avec la course de rats, c’est que même si vous gagnez, vous restez un rat14. »
Lilly Tomlin
14. Tomlin (L.), Is this my country whom I am talking to ?,People, n° 26, 1977.
Fast & slow
En 2011 parut Thinking, Fast and Slow15 dont l’auteur, Daniel Kahneman, est un universitaire israélo-américain, docteur en psychologie de l’université de Californie, à Berkeley, enseignant-chercheur en psychologie comportementale à l’université de Princeton, Prix Nobel d’économie en 2002. Je ne découvris l’existence de ce livre qu’à l’occasion d’un article16 publié à propos de Slow Business, dans le magazine Sciences humaines, dans lequel Achille Weinberg rapprochait mon ouvrage des travaux de Kahneman. J’étais stupéfait qu’un journaliste si pointu associe ma modeste contribution aux travaux d’un auteur majeur dont, il me faut l’avouer, je ne connaissais alors ni les publications ni l’existence. Mais cela est accessoire. Je souhaite surtout souligner que le titre de cet essai fut pour moi une révélation majeure : Thinking, Fast and Slow (« Penser, rapidement et lentement ») ! Ce fut comme un flash. Kahneman y explique, d’une manière très dense et précise, que le cerveau humain est fait pour fonctionner alternativement en mode slow ou fast, selon les circonstances, mais que nous abusons du mode fast alors que nous ne recourons que très peu au mode slow, ce qui génère toutes sortes de déséquilibres et de complications sociétales. Néanmoins, et indépendamment de l’intérêt de ce contenu et de ses détails techniques, je m’arrêtai au titre tant il me semblait dire l’essentiel sur l’objectif ultime de la philosophie du mouvement slow.
En effet, contrairement à ce que le mot slow laisse à penser, la lenteur n’est pas la finalité du mouvement slow. Elle n’est pas un objectif, elle n’est qu’un moyen. Et le mouvement slow vise bel et bien l’équilibre entre rapidité et lenteur. La ligne d’horizon de ce mouvement est donc ce qu’il convient d’appeler l’« équilibre fast & slow ». Ce point est primordial. Mais il appartient à chaque être humain de chercher et de trouver son propre point d’équilibre fast & slow. Nous sommes tous différents : nos histoires familiales, nos personnalités, nos parcours éducatifs, nos expériences professionnelles, les cultures nationales ou régionales dans lesquelles nous avons grandi et de nombreux autres facteurs ne nous rendent pas égaux devant le temps et la façon dont on le gère. Le point d’équilibre fast & slow est donc spécifique à chaque individu, à qui il revient de bien se connaître soi-même, afin de pouvoir appréhender au mieux la question essentielle de son rapport au temps, à la rapidité et à la lenteur. Le point d’équilibre fast & slow doit donc être le résultat d’une authentique quête intérieure, et résulter des leçons tirées du cumul des expériences personnelles. Il appartient à chacun de s’en approcher progressivement et consciencieusement. Ce point d’équilibre est l’aboutissement d’une subtile alchimie personnelle qui requiert du temps, souvent des années, pour s’accomplir. Mais qu’on se rassure : le jeu en vaut la chandelle ! Atteindre ce point d’équilibre confère, peu à peu, une force vitale de première importance. Comme nous le verrons plus loin, l’équilibre est intimement lié aux principes vitaux d’alignement et de centre. Et c’est la conjugaison entre ces trois principes qui conditionne la capacité ultime à s’accomplir, laquelle est finalement reliée à la puissance de la lenteur :
– Au bout de la ligne d’horizon : s’accomplir ;
– Sur le chemin, une première étape : la recherche patiente et constante de son équilibre fast & slow ;
–Et dans cette recherche : conjuguer toujours mieux le fast & slow, de façon à créer un juste rythme.
Tempo giusto
Rechercher l’équilibre fast & slow avec constance et persévérance nous permet de faire une expérience :il peut nous





























