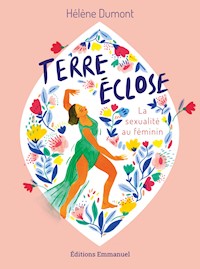
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
Dans ce livre, Hélène Dumont s’adresse aux femmes désireuses de renouer avec leur intimité pour vivre une sexualité (vraiment) épanouissante et source de communion.
À partir de son expérience auprès de nombreux couples, elle explore avec simplicité et sans fausse pudeur les questions les plus intimes telles qu’elles se posent « dans la vraie vie » : connaissance de soi, de l’autre, aléas du désir, communication, articulation féminité/maternité, douleurs et incompréhensions, jouissance...
8 chapitres, avec de nombreux témoignages, réflexions et exercices, qui aideront les femmes à retrouver dans la sexualité un lieu apaisé de joie, de partage et de ressourcement.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Mariée et mère de 6 enfants,
Hélène Dumont est conseillère conjugale et familiale et sexothérapeute. Elle tient une chronique pour le blog des Fabuleuses au Foyer depuis 2015 et anime avec Famille Chrétienne « Sex’Oh ! », un podcast sur la sexualité spécialement destiné aux femmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Conception couverture : © Maguelone du Fou
Illustration couverture : © Maguelone du Fou
Composition et maquette : Soft Office (38)
© Éditions de l’Emmanuel, 2022
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-38433-019-5
Dépôt légal : 2e trimestre 2022
Hélène Dumont
Terre éclose
La sexualité au féminin
Éditions Emmanuel
À Églantine, Marie et Anne-Claire
Touchée par la chaleur
Du silence de tes rêves
Je congédie le monde
Je respire par tes mains
Je me couvre de tes veines
Je te bois
Je deviens
Soleils rouges
Ton corps est vagabond
Trouvant l’asile
D’une terre
Éclose
Devenue femme
Je retiens la course
À tes hanches
Habillées de baisers
Je recouvre mon âme
Éveillée à ta source
Tu es mon paysage mon tempo ma cadence
Mon naufrage et ma rime ma vague et mon volcan
Mon îlot de lumière ma bouteille à la mer
Mon homme argile
Imasango, « Embastillée d’argile ».
Préface
Accéder à son intimité, c’est à la fois accéder à son identité la plus profonde et devenir capable d’une relation vraie. C’est pour cela que la sexualité est au cœur de toutes nos préoccupations. Par-delà la jouissance et le plaisir, c’est la possibilité d’atteindre un espace, un lieu où, dépouillée de tout ce qui m’encombre, je peux retrouver la fusion originelle de l’amour. Corps nus, cœurs à nu, nudité qui me rassemble, me met face à moi-même, nudité qui s’offre à l’autre telle une invitation à me connaître comme j’aimerais être connue, être rejointe, être touchée. Élan vers l’autre que j’aimerais tant rejoindre, connaître, aimer, toucher comme s’il m’était intérieur, comme s’il faisait partie de moi. La sexualité est un chemin de connaissance de soi et de l’autre.
Le verbe pénétrer signifie aussi bien l’entrée dans un espace, dans un lieu, l’entrée du sexe de l’homme dans celui de la femme, que le fait de connaître, d’entrer dans la connaissance. La sexualité réalise charnellement ce désir de connaissance intime, de retour à la source de l’être, dans la jouissance innocente et pure de l’Éden, qui nous habite tous. Mais voilà que la frustration, l’impossibilité de la rencontre, les fermetures du corps, les décalages de rythme réduisent souvent à néant ce chemin de connaissance.
Car il ne suffit pas de désirer l’ouverture pour que le corps s’ouvre, il ne suffit pas d’aimer pour accueillir en soi l’amour de l’autre. Notre sexualité est marquée par tout ce qui a façonné notre lien à l’intime. Elle traduit corporellement, relationnellement, tout le chemin que nous avons parcouru, avec ses embûches et ses manques, pour appréhender notre unicité et notre désir d’aimer.
C’est en cela que Terre éclose est un livre précieux. Il ne vient pas nous parler de la sexualité féminine comme d’un objet d’étude extérieur à nous-mêmes, il n’idéalise pas cette fusion originelle et mystique des corps et des âmes, il ne vient pas nous assommer de techniques et de remèdes pour jouir et faire jouir. Il propose un chemin pour retrouver le sens de notre intimité afin de l’ouvrir à l’autre.
« Notre corps est donc un corps ouvert, comme l’est notre biologie ; un corps transformable, un corps éducable, un corps qui peut devenir musique, un corps qui peut être libéré, un corps qui peut exprimer le plus intime de nous-mêmes » écrivait Maurice Zundel, prêtre suisse et mystique.
Hélène Dumont nous invite à réaccorder doucement notre corps et notre psyché, le conscient et l’inconscient, la parole et le geste, l’accueil et l’offrande, afin que notre corps devienne musique, afin que la rencontre des corps puisse sonner harmonieusement, singulièrement, comme la rencontre de deux instruments qui s’écoutent et s’animent pour résonner ensemble d’une musique agréable.
Elle puise dans son expérience de thérapeute de couple de nombreux témoignages des chemins parfois tortueux qu’empruntent les couples pour s’aimer, elle y puise aussi la confiance dans un chemin de guérison, de réappropriation de nos corps et de notre désir en vue de la rencontre. Elle invite à devenir conscient dans la sexualité, une conscience qui ouvre à la confiance. Elle puise dans la poésie et dans la spiritualité, non pas une échappatoire à la réalité de nos désirs manqués, mais au contraire un chemin de beauté afin de réenchanter l’amour. Sans détour, mais non sans gourmandise, Terre éclose propose de conjuguer sexualité avec créativité au cœur de notre vulnérabilité.
Claire de Saint Lager
Introduction
En découvrant le poème « Embastillée d’argile » d’Imasango, poème d’une femme déclarant son amour à celui qu’elle aime, je n’ai pu m’empêcher de penser aux femmes et aux couples que j’accompagne. Je l’ai souvent relu, à voix haute, pour le plaisir des mots, leur musique, l’érotisme qui s’en dégage. Dans ce poème, qui m’a donné l’idée du titre de ce livre, chaque mot transforme l’imperfection de nos corps en écrin de sensualité, traduit la pulsion sexuelle en élan de vie, sublime nos désirs parfois sauvages et nous ouvre les portes d’un monde invisible, que seuls les amoureux sauront percevoir dans l’intimité de la rencontre sexuelle, pénétrante, charnelle et voluptueuse. Les personnes que je reçois dans mon cabinet ne cessent d’interroger ces différentes problématiques énoncées à travers ces quelques vers. Leur sexualité est une sexualité qui se cherche, parfois qui souffre de ne pouvoir s’épanouir, sentir le désir rayonner, vivre la pénétration avec plaisir, de ne pouvoir s’ouvrir à soi, à l’autre, à la vitalité qui la caractérise.
Embastillée d’argile pourrait traduire une aspiration commune : celle de vouloir se fondre dans le corps de l’autre et de lui appartenir, tout en souhaitant devenir soi-même une ouverture, une terre éclose pour un corps vagabond, vecteur d’amour et de passion, mais, avant tout, vecteur de Vie. Éclose, comme le sont les fleurs, métaphore usuelle du sexe féminin pour l’harmonie et la délicatesse des pétales, reflétant l’anatomie de celui-ci. Argile, terre que l’on façonne et que l’on pétrit, chargée de créativité et de sensualité, lit de notre humanité. Interroger la sexualité équivaut à regarder la vie, à remuer l’existence, dans ce qu’elle a de beau mais aussi de blessant. Interroger sa sexualité, c’est vouloir (re)naître, librement et de façon consentie. C’est vouloir éclore au devenir femme.
Conseil conjugal et sexothérapie
L’espace du cabinet dans lequel j’exerce et consulte est désormais, et depuis cinq ans maintenant, uniquement virtuel. C’est ainsi depuis Madrid que j’accompagne, en qualité de conseillère conjugale et familiale et sexothérapeute, les personnes et les couples qui interrogent le sens de leur vie à deux, sous un prisme affectif, relationnel ou sexuel, que ces couples vivent en France ou à tout autre endroit du globe. Plus particulièrement présente auprès des femmes, j’ai au fur et à mesure approfondi les problématiques touchant à leur vie quotidienne, leurs préoccupations conjugales ou maternelles, ainsi que leur sexualité et leur capacité érotique.
Parler de sexualité, n’est-ce pas inconvenable ? Une question qui m’est parfois posée, et qui d’emblée interpelle. Nous parlons certes plus librement de sexualité aujourd’hui que ne le faisaient probablement les générations précédentes, mais il est encore fréquent que cela incommode. Ce qui s’y réfère reste mystérieux et excitant, et pour certains même effrayant, car relié à notre intimité, notre histoire, nos désirs, nos fantasmes également. L’accompagnement thérapeutique que je propose encourage les femmes et les couples à se décentrer, à mieux se connaître, pour parvenir à davantage de clairvoyance et de sérénité. Plus encore, il conduit à élaborer une pensée permettant de dépasser les multiples paradoxes de la relation amoureuse et l’ambivalence de la sexualité. En entretien, nous ne sommes jamais vulgaires, et rien n’est tabou. Touchées par la beauté des visages rencontrés, par la richesse de ces récits de vies ordinaires, l’authenticité des propos rapportés comme la pertinence des questionnements formulés, j’ai aujourd’hui souhaité vous les partager.
Une invitation
Ce livre s’adresse d’abord aux femmes. À celles qui s’autorisent un rendez-vous, peu anodin, avec elles-mêmes. Il faut de l’audace pour oser plonger au cœur de son intimité ; pour explorer les contours de ce corps qui est le nôtre et qui parfois nous échappe ; pour sonder ce qui nous habite et retrouver la liberté d’un érotisme sain. En apportant des repères qui peuvent être psychologiques, anatomiques, physiologiques ou relationnels, je souhaite encourager les femmes qui le désirent à renouer avec le beau et le bon d’une sexualité apaisée.
Dans ces pages, nous parlerons de nos représentations, de notre sexe de femme, de ce qui le blesse et de ce qui le rend puissant, et approfondirons les notions de désir et de plaisir. Puis nous partirons à la rencontre de l’homme pour enfin se mettre en relation avec lui.
Mon propos n’est pas de dresser un inventaire de recettes miracles. Et mon approche n’est pas spirituelle : d’autres ouvrages portent cette préoccupation. À travers ces pages, je vous raconte des histoires de femmes, chacune étayée par un regard professionnel. Leurs prénoms, leurs situations personnelles ou professionnelles, le nombre de leurs enfants ont été modifiés afin de respecter la confidentialité que requiert mon activité.
Je fais le vœu que cet ouvrage vous permette d’avancer sur votre propre chemin de vie, plus ou moins sinueux ; qu’il fasse émerger, s’il le fallait, un désir de réconciliation ; et qu’il apporte douceur et consolation à celles qui en auraient besoin. Puissiez-vous trouver des échos ou des correspondances dans un mot, une phrase, un paragraphe, et ressentir l’envie d’accueillir pleinement votre sexualité de femme afin de la faire rayonner en vous, d’une façon personnelle et singulière, sans le poids ni l’angoisse d’un discours normatif étouffant vos désirs. Puissiez-vous devenir souveraine de votre corps et des élans qui le transportent, sans culpabilité, sans honte et sans douleur, goûter à la joie de vous sentir vivante et vibrante, enfin accéder au désir de partager ce qui vous habite avec celui que vous aimez.
Au fil des mots de ce livre, que chacune puisse devenir ainsi une terre éclose !
Chapitre 1
Pour une relecture de vie sexuelle
« La sexualité est le lieu de toutes les difficultés, de tous les tâtonnements, des périls et des impasses, de l’échec et de la joie. »
Paul Ricœur, La Sexualité, la merveille, l’errance et l’énigme.
À l’écoute des personnes et des couples que je reçois en cabinet, l’évidence se fait jour que la sexualité ne peut se limiter à un ensemble de connaissances sur le corps et son anatomie, à sa dimension biologique et reproductive ou encore au seul fonctionnement du lien amoureux. Les entretiens de conseil conjugal sont des temps où s’affirme l’importance du contexte personnel et de l’histoire de chacun. La sexualité se code et se norme au gré de valeurs culturelles, sociales, morales, familiales et parfois religieuses, pensées selon les mœurs de l’époque, les avancées médicales et les évolutions juridiques. Ces valeurs colorent par la suite l’appréhension du corps, des représentations et la construction du lien à l’autre d’où pourra émerger, peut-être, la dimension érotique, convertissant la pulsion en désir. Nous n’allons jamais seul au lit : c’est toute notre histoire que nous trimballons, celle de notre pâte humaine, imparfaite, joyeuse ou blessée, mais toujours unique et digne d’être aimée.
Regarder dans le rétroviseur
Prendre le temps, ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie, de revisiter cette histoire, avec la teneur de ce qui nous a élevées, enrichies, ou encore meurtries, est un cadeau fait à soi-même. Cet exercice, autrement nommé « relecture de vie sexuelle », n’est pas un inventaire de nos frasques sexuelles ou amoureuses. C’est un processus intime de retour en soi qui permet de parcourir le passé tout en le reliant au présent, dans cet espace singulier qu’est la sexualité, avec ses zones d’ombre et de lumière. Un peu comme si nous regardions dans un rétroviseur. Il favorise le repérage de nos ouvertures et de nos fermetures au monde, qui peuvent se manifester ensuite au niveau corporel ou émotionnel, et particulièrement au niveau de notre sexe. Certaines expériences engagent l’ouverture, d’autres, plus intrusives ou traumatisantes, provoquent des fermetures, inhibent le désir, étouffent le plaisir, provoquent de la honte ou de la culpabilité.
Ce travail de déplacement pour penser son histoire, en considérant le contexte afin d’en extraire une compréhension plus fine, nous fait prendre conscience que la sexualité n’est pas le seul résultat d’un processus biologique et qu’elle ne peut se réduire à la génitalité. La sexualité nous engage dans notre individualité comme dans notre lien à l’autre.
Le consentement, dans cet exercice de relecture, est primordial. La femme doit être d’accord pour entrer dans ce type de démarche afin de se ressaisir de son histoire. C’est d’autant plus important qu’elle n’aura pu le faire avant : du fait d’une éducation stricte, empêchant l’expression des émotions et des questionnements, sous l’emprise d’une autorité abusive, ou pour d’autres raisons. Certaines femmes que j’accompagne préfèrent laisser venir leurs souvenirs ou leurs pensées spontanément, en fonction de ce qui les habite. D’autres choisissent, dans un premier temps, d’élaborer sans moi. Elles expriment ainsi le besoin de se retrouver en intimité avec elles-mêmes pour replonger dans leur histoire. Chaque femme est libre de répondre à cette proposition. La chronologie, suggérée par la relecture, n’est qu’un outil au service de la parole et de la pensée : l’occasion de faire évoluer nos jugements, de choisir la femme que nous voulons être et la sexualité que nous voulons vivre afin d’en devenir actrice et responsable.
Nous pouvons distinguer trois dimensions que la relecture permet d’explorer. Seront donc étudiées ci-après, successivement, celle du corps, celle – plus vaste – des représentations, puis la dimension relationnelle.
Mon corps, lieu de rencontre
Le corps est le lieu de la rencontre sexuelle. Pour que celle-ci devienne possible ou acceptable, il faut que ce corps existe de façon positive et non comme quelque chose de menaçant ou de dangereux. La manière dont il aura été désigné, perçu, touché et vécu participe à la construction de notre image corporelle comme à la construction de nos limites psychiques. Nommer le corps, dans les moindres détails, sans oublier ceux que l’on ne voit pas, permet de le faire exister, de le conscientiser comme corporéité. C’est lui donner une réalité charnelle qui pourra ensuite être pensée, intégrée, vécue, dite et partagée. L’absence de mots crée le vide, l’angoisse, le tabou et empêche d’exprimer ce qui pourtant nous questionne et parfois nous envahit. Nous sommes des êtres de parole : une parole qui humanise et construit tout à la fois. Durant les accompagnements, nous prenons le temps de nommer ce corps avec précision. Chaque partie, chaque organe possède un nom qui le détermine. Cette étape est incontournable pour nous aider, en tant que femme, à accéder à notre réalité corporelle, et tout particulièrement à la réalité de notre sexe, comme lieu de rencontre et de pénétrabilité.
Ce faisant, nous revisitons également la façon dont ce corps a été perçu, afin de le restaurer dans sa beauté ou dans sa dignité quand cela est nécessaire. Toute expérience blessante impliquant le corps meurtrit profondément la personne : elle abîme son estime d’elle-même et sa confiance en elle. Comment partager notre corps dans l’intimité quand l’enfance et l’adolescence ont été jalonnées d’expériences négatives ou dévalorisantes, introjectant l’idée d’un corps sale, laid ou non respectable ? Il devient alors nécessaire de revisiter les paroles, les gestes et les regards posés sur ce corps. Empreints de respect, ils participent à l’épanouissement de la personne. Inversement, s’ils sont intrusifs ou violents, ils mènent à la fermeture psychique et corporelle ; ils entravent le discernement permettant de penser de façon adéquate la notion de limite, et parfois de l’exprimer par un « non » simple mais explicite.
Marianne m’écrit : « Notre sexualité est source de difficulté. Je ne peux m’empêcher de me mettre des barrières. J’aspire à des relations paisibles et décomplexées avec mon mari. Mais dans la réalité, je freine, je ne ressens rien, je culpabilise. J’essaie de comprendre ce qui se passe dans mon corps, d’aller à sa découverte et d’apprivoiser mon sexe auquel j’ai peu prêté attention jusqu’à mon mariage. Je pense que j’ai des blocages liés à mon éducation et à des événements douloureux vécus et contre lesquels j’ai développé des mécanismes de protection très forts que je ne sais plus enlever désormais. » Marianne, jeune femme pétillante, intelligente et délicate, a 28 ans et est mariée depuis trois ans avec Gabriel. Leur vie de jeune couple est pleine de projets. Tout va bien. Tout, sauf la sexualité. Je propose à Marianne de commencer un travail de relecture. Au fur et à mesure des entretiens, nous revisitons son fil de vie. Ma présence se veut rassurante, comme pour contenir ou consoler toutes ces fois où, dans le passé, ses questions liées au corps et à la sexualité l’ont laissée désemparée et sans réponse.
Marianne a grandi dans une famille bienveillante. Pas de brutalité, pas de violence. La toilette était un moment privilégié où elle pouvait prendre le temps de flâner tranquillement. Enfant puis adolescente, elle n’a jamais manqué de vêtements. Ceux-ci étaient sobres, mais propres et de bon goût. Sa mère faisait un peu de couture et y apportait de la fantaisie. Le vêtement, quand il est soigné, donne au corps douceur et bien être, comme le fait également une bonne hygiène de vie. Prévenante, la mère de Marianne était attentive à cela pour sa fille. En revanche, de tempérament réservé, elle n’a pas su trouver les mots pour lui parler de son corps de petite fille, ni lui annoncer les transformations qu’il connaîtrait naturellement pour devenir un corps de femme.
L’été de ses 13 ans, Marianne découvre le sang de ses premières règles lors d’un séjour chez sa grand-mère paternelle. Elle est déconcertée. Elle ne sait pas très bien ce que cela signifie. Sa grand-mère est une femme envahissante à qui elle ne veut pas se confier. Le séjour d’été fait partie des incontournables auxquels elle ne peut déroger sous peine de déclencher un drame familial. Plusieurs fois, Marianne s’est retrouvée face à sa grand-mère qui était nue et qui prenait un malin plaisir à s’exhiber sous prétexte d’aller récupérer ses vêtements à la buanderie. Marianne a vécu ces rencontres comme une intrusion violente dans son intimité de petite fille. Elle détestait ce corps flapi et ne savait gérer les émotions qui la submergeaient lors de ces moments d’exhibition, entre dégoût, peur et, parfois, excitation.
De temps en temps, elle rêve encore de cette grand-mère qu’elle décrit comme une « sorcière » faisant irruption dans l’intimité de son sommeil. Se mêle à cela une profonde rancœur envers ses parents : pour elle, il leur était plus facile d’envoyer leurs enfants chez cette femme sans pudeur et sans limites plutôt que de venir eux-mêmes la visiter et ainsi affronter son indécence et son caractère impérieux.
L’absence de mots posés sur le corps dans son éducation n’a pas non plus permis à Marianne de se confier sur ce qui la pétrifiait lors de ces séjours. Même si la présence de ses frères pouvait lui servir de refuge, elle a vécu ces moments comme un manque de protection, pour ne pas dire un abandon. L’expérience de ses premières règles dans un tel contexte a laissé un arrière-goût d’amertume, lui « sapant la joie de devenir femme ». Aujourd’hui, Marianne ne peut s’empêcher de penser que le corps, le sexe, « c’est sale ou intrusif ». La sexualité la renvoie aux débordements et au manque de pudeur de sa grand-mère et provoque en elle un sentiment de désespérance. Afin de ne pas être confrontée à ces représentations désagréables, Marianne se protège en évitant les sollicitations intimes de son mari, ou en attendant passivement que l’union se passe, sans habiter son corps, ce qui l’empêche de s’investir dans une sexualité paisible et complice. Comme un bouclier, cette attitude s’interpose entre son corps et son désir, ses ressentis et son plaisir. Marianne se décrit en conflit entre sa volonté de vivre des relations sexuelles joyeuses dans les bras sécurisants de celui qu’elle aime, et ses pensées automatiques de repli ou d’écœurement, agissant comme un écran pulsionnel au moment même de la relation, ôtant à l’étreinte tout érotisme et toute saveur.
Autre femme, autre souvenir : l’année de ses 12 ans, alors que Léonie profite des joies de la baignade en Bretagne, son père l’interpelle pour lui faire remarquer sa poitrine légèrement saillante. Il lui demande de se changer immédiatement et d’abandonner son bikini fleuri de petite fille pour un maillot de bain une pièce, plus couvrant. Léonie, encore insouciante, n’avait pas pris conscience que son corps se modifiait et, plus encore, qu’il pouvait attirer remarques et regards. Même s’il se voulait protecteur, son père, par cette injonction abrupte la dévoilant à elle-même, avait manqué de délicatesse. Léonie me dit alors combien la honte l’a envahie, réduisant la puberté à un corps changeant qu’elle se doit de dissimuler pour ne pas l’exposer aux regards, principalement à celui des hommes. Aujourd’hui, ce sentiment de honte surgit parfois encore lorsqu’elle est nue et que son mari la contemple. L’empreinte du passé dévoie la pudeur naturelle de Léonie et rend difficile la relation à son intimité.
Mais tous les récits ne sont pas douloureux. Venons-en désormais à Marie. Marie a grandi dans une famille bienveillante. Elle a eu la joie de faire de la danse et un peu de violon, deux activités, dit-elle, qui lui ont permis de mettre son corps en mouvement de façon saine et épanouissante. Plus jeune, sa mère a su lui transmettre les éléments nécessaires pour apprivoiser son corps de jeune fille et peu à peu découvrir la joie d’être femme. Elle évoque à ce propos le souvenir attendrissant d’une séance de maquillage pour mettre son visage en valeur. Marie a grandi dans la confiance, et son corps a pu devenir un lieu de rencontre et d’expression amoureuse à travers la sexualité, sans danger ni honte, et sans la peur d’être entravée par le regard, les gestes ou les débordements de l’autre.
Ainsi, dans l’appréhension positive du corps émergeront les prémices d’une sexualité épanouie, pleine et sereine. Et même si toute vie est imparfaite, les souvenirs constructifs sont rarement totalement absents : ils peuvent faire office de « réservoirs » privilégiés où venir puiser de quoi dépasser ou retravailler les événements plus compliqués. L’exemple de Marianne est ici éclairant : profondément blessée par sa grand-mère, elle a néanmoins fait l’expérience d’une intimité heureuse auprès de ses parents et éprouvé un amour constant. La bienveillance de son époux réactualise ce lien de confiance possible, tout en lui permettant de dépasser ses blocages en acceptant de les travailler en thérapie.
Mes représentations, sources d’ouverture ou de fermeture
Parler du corps nous invite à revisiter plus largement nos représentations. Fruits de nos perceptions internes, elles se fabriquent dès l’enfance, puis tout au long de notre existence, à partir des relations intersubjectives vécues dans nos entourages familial et sociétal. Ces représentations sont une interprétation que chacun élabore du réel, plus ou moins déformé, mais toujours unique. Elles jouent un rôle important dans la construction de notre personne. Heureuses, elles sont sources d’ouverture à soi, à l’autre et au monde. Négatives, elles peuvent inversement devenir sources de fermeture, de tensions ou de crispations, et apparaître alors comme un frein dans la sexualité. Il est ici important de souligner que, dans une seule et même famille, les enfants ne capteront pas forcément des messages similaires. Cela tient à différents facteurs : le caractère de chacun, sa sensibilité, sa place dans la fratrie et dans l’histoire du couple, son sexe, son rapport au corps, ses rencontres…
Julie, la trentaine fraîchement passée, a horreur de la pénétration. À la question « Comment parlait-on de sexualité dans votre famille ? », Julie répond : « Maman n’était pas très à l’aise, et papa encore moins ! Nous n’en parlions pas. J’ai pu intercepter des bribes de conversation dont j’ai vite été exclue. À propos de l’une de mes tantes, il était question de Polichinelle ou de Marie-couche-toi-là. Le ton était dur et condescendant. Je savais que ma tante était montrée du doigt. Je savais aussi que nous ne devions pas coucher avant le mariage. Mais je n’en percevais pas le sens. Dans ma tête de petite fille, puis de jeune adolescente, j’ai vite assimilé que le sexe, c’était peut-être mal ou dangereux. J’ai intégré malgré moi qu’il ne fallait pas poser de questions. » Ces représentations associent la sexualité à quelque chose de flou que l’on ne peut évoquer. Elles incitent par ailleurs à penser que pour continuer d’être aimée, il ne faut pas ressembler à ceux ou celles que l’on critique. C’est ainsi que la sexualité se norme et se code, de façon implicite, entraînant chez certaines femmes fermeture et méfiance.
Inversement, il ne suffit pas de parler explicitement de sexualité pour en transmettre une compréhension heureuse. Encore faut-il que cette approche se vive dans un juste équilibre et une juste distance. Katie me contacte pour évoquer son mal-être. À 36 ans, elle ne peut s’empêcher d’entreprendre des relations avec des hommes qu’elle ne désire pas. Sa vie affective est une succession de rencontres qui ne mènent à rien. Katie est fille unique. Sa mère, née en 1955, avait tout juste 13 ans au moment des événements de « mai 68 » et en a été par la suite profondément marquée. Élevée par des parents austères, elle s’est juré d’être une mère proche de son enfant, moderne et libre quant à la sexualité. Katie a donc reçu toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de son corps et celui de l’autre. L’été de ses 15 ans, réglée depuis 18 mois, elle part en colonie. Sa mère la considère comme une femme, dont le charme fait sa fierté. Se voulant décomplexée, elle lui souhaite de bien s’amuser et de « trouver un amoureux ». Elle glisse au passage quelques préservatifs dans la trousse de toilette de sa fille, ajoutant que les flirts sont de son âge et qu’elle peut profiter de sa jeunesse, contrairement à elle, qui en a été privée. C’est ainsi que Katie découvre sa sexualité, encouragée par le désir d’une mère qui semble chercher, par procuration, à se remettre de ses propres frustrations. Et, de fait, Katie accumule les relations sexuelles : elle ne sait pas dire non. Au désir de sa mère se substitue celui des hommes, plus ou moins vieux, transformant son corps de jeune fille en objet de jouissance dont elle se sent peu à peu dépossédée. Sa mère, au courant de ces histoires, y voit l’itinéraire normal d’une sexualité qui s’essaye avant de se stabiliser. Le succès de sa fille la comble. Mais quatorze ans plus tard, Katie ne sait plus où se loge son désir. Elle rêve d’une histoire sérieuse et souhaite fonder une famille. Pour y accéder, elle devra d’abord apprendre à dire « non ». « Non » au désir de sa mère comme à celui des hommes, tout en cessant de croire que, pour aimer et être aimée, il faut « donner du sexe ».
Katie porte en elle les projections de sa mère liées à sa propre histoire dans un contexte post-soixante-huitard. L’approche de la sexualité est ainsi rarement exempte de toute croyance ou de toute idéologie. Pour la mère de Katie, être libre dans sa sexualité équivaut à jouir librement. Mais Katie se sent prisonnière d’injonctions qui semblent ne pas lui appartenir. Tant qu’elle restera figée dans le désir de sa propre mère, tant qu’elle ne s’autorisera pas à dépasser ce seul statut de « fille de… », Katie ne pourra pas devenir femme, reliée à son propre désir et à son propre corps. « L’intime ne découle pas automatiquement du social1 », nous rappelle Danièle Flaumenbaum, encore moins d’un désir qui ne nous appartient pas.
Cela nous invite à approfondir le vaste champ de la féminité. Dans son excellent podcast Ma féminité en question, Valérie de Minvielle2 nous propose de revisiter notre façon d’être femme, d’être mère et d’être au monde en interrogeant précisément nos représentations. Selon elle, ces dernières nous collent à la peau et agissent comme un vêtement qui nous serait imposé mais qui n’est pas le nôtre. À partir d’un travail de recherche sur les images féminines dont nous héritons, nous pouvons renouer avec la femme que nous sommes. Il s’agit de réaliser que, dans notre histoire, se trament d’autres histoires de femmes. De ces femmes, nous pouvons discerner quelles sont les valeurs ou les qualités que nous avons envie de garder, et celles, inversement, qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Ainsi, Valérie de Minvielle nous interroge :
Quelle femme a été ma mère, ma grand-mère, ma tante ? Quelle image avait mon père, mon grand-père, mon oncle de sa femme ou des femmes en général ? Quelle image de la féminité m’a été transmise par ces personnes de mon histoire ? À laquelle de ces femmes me suis-je identifiée ? Qu’ai-je embarqué de sa façon d’être femme ?
Pour Aude, 52 ans, mariée depuis trente ans et mère de trois grands enfants, l’image de la femme forte apparaît comme une représentation dominante de la féminité : « Dans ma famille, les femmes devaient être courageuses et respectueuses. C’était la condition pour être aimée d’un homme et reconnue par le groupe. Les femmes qui ne se bougeaient pas étaient considérées comme des paresseuses. » Cette façon de considérer la femme l’a aidée à tenir tout au long des fréquents déplacements professionnels de son mari, alors qu’elle se retrouvait seule avec ses enfants à élever. Sans se plaindre, elle s’est investie avec bonheur dans sa mission de mère et d’épouse, écoutant à peine ses envies et sa fatigue. Maintenant que ses enfants ont quitté le nid, Aude aimerait prendre un peu de temps pour elle, mais se poser dans un fauteuil la culpabilise. Les petites voix d’antan lui murmurent de rester en action, quoi qu’il arrive. La femme de devoir qu’elle a toujours été laisse peu de place à la femme de désir qu’elle voudrait devenir et qui l’autoriserait à prendre soin d’elle. Son désir lui semble illégitime. Son mari a souvent perçu cette difficulté chez son épouse, et plus particulièrement dans la sexualité, mais les résistances qu’elle mettait en place quand il évoquait le sujet l’ont dissuadé de persévérer. Aujourd’hui, sa progéniture est partie aux quatre coins de France et du monde : il y a de la place pour que ce désir émerge ! Mais apprendre à désirer n’est pas chose facile ; accueillir sans culpabilité le plaisir qui en découle, non plus.
Encouragée par son mari, Aude entame un accompagnement et commence à revisiter les images féminines de son entourage. Peu à peu, elle écoute ses petites voix intérieures afin de mettre en place des actions concrètes qui pourraient la rapprocher d’une image de femme qui lui corresponde et qu’elle aimerait habiter. De l’achat d’une ravissante chemise à l’expression d’une demande plus originale auprès de son époux – prendre ensemble des cours de danse de salon –, Aude se relie peu à peu à sa féminité, puis à son désir et au plaisir d’être femme, dans la banalité du quotidien comme dans le secret de leur vie sexuelle. La présence de son époux a joué un rôle considérable. Dans ses yeux, elle a pu lire la confirmation de ce qu’elle devenait : une femme de désir qui gardait toute sa valeur, même en se préoccupant moins du devoir qu’elle s’imposait. À 52 ans, il est toujours temps de se mettre en chemin et, contre toute attente, il y a bien souvent des lendemains qui chantent !
Ces paroles qui autorisent : « Tu seras une femme, ma fille ! »
Si la sexualité est le lieu de la rencontre des corps et de l’expression des représentations, elle se déploie sous l’effet d’une double autorisation : l’une venant de la mère, la seconde du père.
Devenir femme, auprès de sa mère
Auprès de sa mère, la petite fille pourra progressivement s’approprier une façon d’être femme, « femme et mère », deux réalités à la fois liées et distinctes, constitutives de son identité féminine. Plus nous aurons su réconcilier dans notre propre corps la joie d’être femme et celle d’être mère, plus nous pourrons transmettre à nos filles la possibilité de s’élancer dans leur vie de femme avec confiance, en faisant des choix qui leur appartiendront. Pour Danièle Flaumenbaum, « les petites filles ne peuvent rêver de devenir “maman” que si leur mère est heureuse de l’être. Elles doivent pouvoir grandir en sachant aussi que la sexualité qu’elles vivront quand elles seront grandes leur donnera beaucoup de plaisir et de forces3 ».
La mère doit alors accepter d’être dépassée, pour ne pas dire détrônée, par la jeunesse, la fougue et la beauté de sa propre fille. Laisser sa fille s’élancer dans sa vie de femme implique en effet de nombreux renoncements, comme ne plus materner, accepter de vieillir, repenser l’avenir. Du côté de la fille, devenir femme, sans culpabilité, consiste à supporter d’être possiblement plus heureuse, et d’assumer de vouloir rencontrer un homme pour déployer auprès de lui cette dimension érotique intime qu’elle ne partagera pas avec sa mère. Défi complexe, à en croire les relations parfois difficiles entre mères et filles, surtout lorsque les premières bloquent de façon subtile tout accès à la sexualité des secondes, nourrissant au passage des conflits de loyauté, des rapports fusionnels ou encore de domination. C’est exactement ce que nous dit le célèbre conte de Blanche-Neige des frères Grimm : la belle-mère, qui représente la figure malveillante de la mère, ne supporte pas de voir sa belle-fille (et donc la fille) devenir plus jolie qu’elle. Jalouse, elle ordonne au chasseur de la tuer afin de garder la primauté.
Quand cet accès au devenir femme est saboté, c’est à la fille de s’affranchir de cette autorité afin de s’emparer elle-même de la couronne pour devenir reine – c’est-à-dire femme – à son tour. C’est un peu le défi de Katie, qui doit s’affranchir du désir de sa mère pour renouer avec le sien et s’épanouir dans sa vie affective et sexuelle. Le film La Pianiste de Michael Haneke illustre cet impossible affranchissement. Isabelle Huppert y joue le rôle d’Erika Kohut, professeur de piano d’une quarantaine d’années. Vieille fille, Erika vit seule avec sa mère âgée, étouffante, incestueuse, jalouse, qui ne lui laisse aucun espace intime corporel, relationnel ou psychique. Erika ne parvient pas à se délier de sa mère. Ses tentatives d’accès à une vie de femme libre sont vaines. Cela ne peut se faire autrement que dans la violence, au travers d’une sexualité sadomasochiste qui, en définitive, finira par la perdre elle-même et la priver d’une relation amoureuse épanouie.
Devenir femme est donc un cheminement subjectif que la femme pourra vivre en fonction de ce que lui aura transmis sa propre mère, et plus largement l’ensemble de sa lignée maternelle. Une transmission heureuse suppose que ces générations de femmes aient pu recevoir ou réinterroger à leur tour l’articulation du maternel et du féminin de façon constructive. Dans ce cas de figure, un héritage positif, bien qu’imparfait, sera possible. Enfin, nos enfants ne nous appartiennent pas. Toute mère est appelée à renoncer à l’amour maternel fusionnel des premiers temps pour encourager la petite fille à devenir une adulte libre et responsable. L’adolescence illustre bien ce défi, où la jeune fille en devenir se démène pour trouver un juste milieu dans la relation à sa mère, entre la volonté de lui ressembler ou de lui plaire et celle de se séparer d’elle. La relation à la mère de la toute petite enfance devra être retrouvée et transformée, c’est-à-dire vécue autrement, pour que la jeune fille laisse grandir en elle le désir de devenir femme et d’accéder à une sexualité assumée4.
Devenir femme, auprès de son père
La seconde parole d’autorisation vient du père. Le regard du père posé sur sa fille adolescente, tout en respectant l’interdit de l’inceste – « Tu es belle mais tu n’es pas pour moi5 » – accordera de la valeur à ce féminin en devenir, autorisant de fait sa réalisation. Un regard d’admiration, d’amour et non de désir ; un regard juste, accompagné de paroles valorisantes qui permettront à l’adolescente de construire une bonne image d’elle-même. Pour Didier Lauru6 ce regard et ces paroles sont essentiels. Ils confirment « les transformations de la petite fille en jeune fille tout en respectant son autonomie » et lui donneront la garantie « que sa féminité peut se déployer ». Dans cette perspective, au regard du père succédera le regard de l’homme, sans que la jeune fille n’éprouve d’angoisse ni de culpabilité à être femme, une femme désirée et désirante.
Les entretiens de conseil conjugal mettent en lumière l’importance de ces paroles et montrent combien certaines jeunes filles devenues femmes restent abîmées par les mots dévalorisants d’un père cassant. « Papa me disait que je ressemblais à un boudin, me raconte Aurélie, pour moi, être femme était forcément humiliant, avilissant et au final enfermant. »
Cependant, nous pouvons noter de très beaux souvenirs, touchants ou inspirants. Sibylle me raconte qu’à l’occasion de ses premières règles, son père lui a offert un bouquet de fleurs printanières, lui signifiant ainsi, avec beaucoup de délicatesse, sa joie de la voir grandir et entrer dans le monde des femmes. Sibylle s’en saisit comme l’expression d’une autorisation à laisser son corps s’épanouir au gré des courbes qui le façonnent, peu à peu. Pour Pauline, c’est le souvenir de l’achat d’une belle robe le jour de ses 10 ans, puis d’une paire de boucles d’oreilles pour honorer ses 15 ans. Son corps de petite fille, puis de jeune fille, est considéré de façon positive, prêt à recevoir la beauté, à l’exprimer et à la faire rayonner.
« Être femme » est donc le résultat d’une construction progressive dépassant largement l’accès à une sexualité génitale7. Le regard, les paroles, l’amour de la mère comme du père (ou de toute personne faisant office d’image maternelle ou paternelle) ont un rôle essentiel grâce auquel chaque petite fille apprendra à devenir femme. Un processus complexe qui nous invite à cesser d’être « la petite fille de », sans perdre – ou vouloir perdre – l’amour de ceux qui nous ont transmis la vie.
Bien entendu, et heureusement, rien n’est déterminé. Chaque histoire peut être retravaillée et, au besoin, consolée ou guérie. J’aime cette très jolie phrase de Boris Cyrulnik, pleine de confiance et d’espérance : « Moi je dis que tout se joue entre 0 et 120 ans8 ! » Les rencontres que nous faisons tout au long de notre vie, l’expérience qui en découle, permettent de réviser indéfiniment le lien à soi et à l’autre, élargissant par ailleurs la richesse de l’altérité vécue dans la sexualité. La rencontre conjugale en fait partie. Je repense à Aude. Encouragée par son époux, elle a redécouvert une parcelle endormie de son être femme. Dans leur histoire, la danse est devenue un espace de rencontre possible pour qu’émerge avec délicatesse une appréhension nouvelle de la féminité, et par extension du corps et de la sexualité, sans crainte de l’autre dans sa différence.
Pour Nicole Jeammet9





























