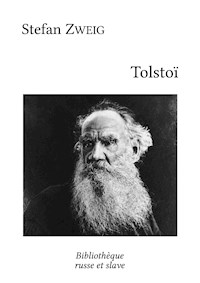
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Dans cet essai – un de ses plus accomplis – Stefan Zweig aborde la figure du géant russe aux yeux perçants, « ces yeux qui sont les plus vigilants, les plus sincères et les plus incorruptibles de notre art moderne », qui sut écrire et décrire la vie comme personne avant lui. Se penchant en particulier sur la « crise » morale qui mena cet artiste incomparable à renier son œuvre et l'art, Zweig, à la fois critique et admiratif, raconte comment le grand écrivain est devenu « un homme humanité » et sa vie une légende pour les générations futures.
Traduction intégrale d'Alzir Hella et Olivier Bournac, 1928.
EXTRAIT
Soudain, en une nuit, tout cela perd son sens, n’a plus de valeur. Le travail répugne à ce travailleur, sa femme lui devient étrangère, ses enfants indifférents. La nuit, il se lève de son lit, tout bouleversé ; il va et vient comme un malade, sans repos ; le jour, il s’assied apathique, la main endormie et l’œil figé, devant sa table de travail. Une fois, il monte l’escalier à la hâte pour aller enfermer dans l’armoire son fusil de chasse, afin de ne point tourner l’arme contre lui-même : parfois il gémit comme si sa poitrine éclatait, parfois il sanglote comme un enfant dans la chambre sans lumière. Il n’ouvre plus aucune lettre, ne reçoit plus aucun ami : ses fils regardent craintivement, et sa femme avec désespoir, cet homme brusquement assombri.
Quelle est la cause de ce changement soudain ? La maladie ronge-t-elle secrètement sa vie ? La peste s’est-elle abattue sur son corps ? Un malheur lui est-il advenu du dehors ? Que lui est-il arrivé, à Léon Nicolaïewitsch Tolstoï, pour que lui, le plus puissant de tous, soit soudain privé de joie et que le plus grand homme de la terre russe soit si tragiquement désolé ? Et voici la terrible réponse : rien ! Il ne lui est rien arrivé, ou, à proprement parler, chose plus terrible encore, ce qu’il a rencontré c’est le néant. Tolstoï a aperçu le néant derrière les choses. Il y a dans son âme une déchirure ; une fissure s’est produite en lui, fissure étroite et noire, et, malgré lui, son œil chaviré regarde fixement dans ce vide, dans ce néant sans nom, dans ce nihil et ce non-être, — cette autre présence, étrangère, froide, sombre et insaisissable, qu’il y a derrière notre propre vie, chaude et gonflée de sang, — regarde l’éternel néant derrière l’être éphémère.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Impossible de lire les pages que l'écrivain autrichien condamné par les nazis consacre à Tolstoï sans songer à la fin tragique, il y a 75 ans, de l'auteur de "La confusion des sentiments". -
AFP, Le Point
Biographie 2 en 1. Qui dit mieux ? Un vrai plaisir ! -
Sophiecal, Babelio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE - ÉTUDES —
Stefan Zweig
1881 – 1942
TOLSTOÏ
1928
Traduction d’Alzir Hella et Olivier Bournac, 1928.
© Bibliothèque russe et slave, 2019
© Alzir Hella et Olivier Bournac. Éditions Victor Attinger, Paris-Neuchâtel, 1928
Couverture : Photographie de Tolstoï.
« Il n’y a rien qui produise une aussi forte impression et qui unisse aussi impérieusement tous les hommes dans le même sentiment que l’œuvre d’une vie, et finalement toute une vie humaine. »
TOLSTOÏ, Journal,
23 mars 1894.
PRÉLUDE
« Ce qui importe, ce n’est pas la perfection morale à laquelle on parvient, mais la façon dont on y parvient. »
TOLSTOÏ,
Journal de Vieillesse.
« UN HOMME vivait dans le pays d’Uz. Il craignait le Seigneur et il évitait le mal, et ses troupeaux étaient sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents ânesses et il avait beaucoup de serviteurs. Et il était plus magnifique que tous ceux qui habitaient du côté de l’Orient. »
Ainsi commence l’histoire de Job, qui fut comblé de satisfactions, jusqu’à l’heure où Dieu leva la main contre lui et le frappa de la peste, pour qu’il se réveillât de son bien-être grossier, s’affligeât en son âme et entrât en jugement devant lui. Ainsi commence également l’histoire spirituelle de Léon Nicolaïewitsch Tolstoï, qui, lui aussi, fut plus magnifique que tous ceux de son pays et de son temps. Lui aussi, était « assis en haut », parmi les puissants de la terre, et, riche, il vivait confortablement dans sa vieille maison héréditaire.
Son corps déborde de santé et de force ; il a pu prendre comme épouse la jeune fille que désirait son amour, et elle lui a donné treize enfants. Les œuvres de ses mains et de son âme sont impérissables et brillent au-dessus de son époque : les paysans d’Iasnaïa Poliana se courbent avec vénération lorsque le puissant boyard passe au galop devant eux, et l’univers s’incline respectueusement devant sa gloire retentissante. Comme Job avant l’épreuve, Léon Tolstoï, lui non plus, n’a plus rien à désirer ; et, un jour, il écrit dans une lettre le plus téméraire des mots humains : « Je suis absolument heureux ».
Soudain, en une nuit, tout cela perd son sens, n’a plus de valeur. Le travail répugne à ce travailleur, sa femme lui devient étrangère, ses enfants indifférents. La nuit, il se lève de son lit, tout bouleversé ; il va et vient comme un malade, sans repos ; le jour, il s’assied apathique, la main endormie et l’œil figé, devant sa table de travail. Une fois, il monte l’escalier à la hâte pour aller enfermer dans l’armoire son fusil de chasse, afin de ne point tourner l’arme contre lui-même : parfois il gémit comme si sa poitrine éclatait, parfois il sanglote comme un enfant dans la chambre sans lumière. Il n’ouvre plus aucune lettre, ne reçoit plus aucun ami : ses fils regardent craintivement, et sa femme avec désespoir, cet homme brusquement assombri.
Quelle est la cause de ce changement soudain ? La maladie ronge-t-elle secrètement sa vie ? La peste s’est-elle abattue sur son corps ? Un malheur lui est-il advenu du dehors ? Que lui est-il arrivé, à Léon Nicolaïewitsch Tolstoï, pour que lui, le plus puissant de tous, soit soudain privé de joie et que le plus grand homme de la terre russe soit si tragiquement désolé ? Et voici la terrible réponse : rien ! Il ne lui est rien arrivé, ou, à proprement parler, chose plus terrible encore, ce qu’il a rencontré c’est le néant. Tolstoï a aperçu le néant derrière les choses. Il y a dans son âme une déchirure ; une fissure s’est produite en lui, fissure étroite et noire, et, malgré lui, son œil chaviré regarde fixement dans ce vide, dans ce néant sans nom, dans ce nihil et ce non-être, — cette autre présence, étrangère, froide, sombre et insaisissable, qu’il y a derrière notre propre vie, chaude et gonflée de sang, — regarde l’éternel néant derrière l’être éphémère.
Celui qui, une fois, a plongé son œil dans cet abîme indicible, ne peut plus l’en détourner ; l’obscurité envahit ses sens ; pour lui s’éteignent la lumière et la couleur de la vie. Le rire se glace dans sa bouche ; il ne peut plus rien atteindre sans sentir le froid depuis ses doigts jusqu’en son cœur frissonnant ; il ne peut plus rien contempler sans penser en même temps à l’autre, au néant, au nihil. Les objets tombent flétris et sans valeur hors de la sensibilité, qui, l’instant d’avant, était encore toute chaude ; la gloire devient la poursuite d’une fumée ; l’art un jeu de fous, l’argent une scorie jaune, et même le corps à la chaude haleine et plein de santé n’est plus que la demeure des vers ; cette lèvre à la succion noire et invisible enlève à tous les biens de ce monde leur saveur et leur douceur. L’univers frissonne de froid, lorsque, aux yeux d’un mortel, avec toute l’angoisse primitive de la créature, s’est ouvert ce néant rongeur, dévorant et noir, le « Maelstrom » d’Edgar-Allan Poë, qui emporte tout avec lui, le « gouffre », l’abîme de Pascal, dont la profondeur est plus grande que toute élévation de l’esprit.
C’est en vain qu’on chercherait à se cacher et à se dissimuler. Il ne sert à rien de qualifier de divine et de sainte cette ombre qui vous dévore. Il ne sert à rien d’essayer de masquer le trou noir avec les feuillets de l’Évangile : ces ténèbres-là filtrent à travers tous les parchemins et éteignent les cierges de l’Église ; un froid si glacial venu des pôles de l’univers ne se laisse pas réchauffer par la tiède haleine de la parole humaine. Il ne sert à rien, pour couvrir ce silence mortellement pesant, de se mettre à prêcher d’une voix sonore, à faire comme des enfants qui dans la forêt chantent pour dissimuler leur inquiétude : le néant silencieux et noir continue de planer impérieusement au-dessus de la conscience, au-dessus de tous ses efforts. Aucune sagesse ne rassérénera plus le cœur assombri de celui qui en a ressenti l’épouvantement.
Dans la cinquante-quatrième année de sa vie, de sa vie à l’action mondiale, Tolstoï a pour la première fois aperçu l’immense néant comme étant sa destinée et celle de tout homme. Et depuis cette heure-là, jusqu’à celle de sa mort, il ne fera plus que regarder fixement ce trou noir, cet intérieur insaisissable qu’il y a derrière son propre être. Mais, même lorsqu’il est tourné vers le néant, le regard d’un Léon Tolstoï reste encore d’une clarté incisive — ce regard le plus clairvoyant et le plus spiritualisé que notre temps ait connu à un être humain. Jamais un homme n’a entrepris avec une force aussi gigantesque la lutte contre l’indicible, contre l’angoisse primitive de la créature ; personne n’a opposé plus résolument au problème que le destin pose à l’homme le problème de l’humanité interrogeant son destin. Personne n’a souffert plus terriblement de ce regard vide et dévorant l’âme peu à peu, qui vient de l’au-delà ; personne ne l’a supporté d’une manière plus grandiose, car ici une conscience virile présente à la sombre interrogation de cette noire pupille le regard clair, hardi et fermement observateur de l’artiste. Jamais, pas une seule seconde, Léon Tolstoï n’a baissé ou fermé lâchement les yeux devant le tragique du destin, ces yeux qui sont les plus vigilants, les plus sincères et les plus incorruptibles de notre art moderne : par conséquent, rien n’est plus grandiose que cette tentative héroïque pour donner encore un sens créateur même à l’insaisissable et pour prêter sa vérité à ce qu’il est impossible d’écarter.
Pendant trente ans, de sa vingtième à sa cinquantième année, Tolstoï a vécu, dans la création de ses œuvres, insouciant et libre. Pendant trente ans, de sa cinquantième année jusqu’à son trépas, il ne vit plus que pour comprendre et connaître le sens de la vie, luttant avec l’insaisissable, enchaîné à l’inaccessible. Sa tâche a été facile jusqu’au jour où il s’est donné cette formidable mission : sauver, non seulement sa propre personne, mais encore toute l’humanité, par sa lutte pour la vérité. Avoir entrepris cette mission fait de lui un héros, — presque un saint. Y avoir succombé en fait le plus humain de tous les hommes.
PORTRAIT DE TOLSTOÏ
« Ma figure était celle d’un paysan ordinaire. »
UNE FACE ressemblant à une forêt : avec plus de fourrés que de clairières, obstruant tout accès à la vision intérieure. Large et flottant au vent, la barbe de fleuve et de patriarche se presse jusqu’au haut des joues, recouvre de ses flots, pour des dizaines d’années, la lèvre sensuelle et masque l’écorce ligneuse de la peau aux gerçures brunes. Devant le front se hérissent, épais comme le doigt et emmêlés comme des racines d’arbre, de puissants sourcils. Au-dessus de la tête écume, grise vague marine, la masse agitée des mèches de cheveux aux entrelacements touffus : partout se dresse l’abondance hirsute et tropicale des poils répandant à la manière de Pan cette exubérance de monde primitif. Exactement comme pour le Moïse de Michel-Ange, cette image du plus viril des hommes, le regard n’aperçoit d’abord dans la figure de Tolstoï que la vague à la blanche écume de cette gigantesque barbe de Père éternel.
Alors, pour découvrir avec l’âme la nudité et l’essence d’un visage ainsi revêtu, l’on cherche à désencombrer les traits des fourrés de cette barbe (et les portraits de jeunesse, imberbes, aident beaucoup à ce dévoilement plastique). On le fait donc et l’on est effrayé. Car, chose indéniable et incontestable, le visage de ce gentilhomme, de ce fils de l’esprit, est d’une structure grossière et n’est pas différent de celui d’un paysan. Ici le génie a choisi pour habitation et atelier une hutte basse, tachée de suie et de fumée, une véritable kibitka russe ; ce n’est pas un démiurge grec, c’est un négligent charpentier de campagne qui a tracé la demeure de cette grande âme. Tout y est lourdement raboté ; les poutres basses du front, au-dessus des minuscules fenêtres que représentent les yeux, sont à gros grain, comme du bois de refend ; la peau n’est que terre et argile, grasse et sans éclat. Au milieu de ce carré sans beauté un nez aux narines largement ouvertes, vaste et presque pareil à de la bouillie, comme aplati par un coup de poing ; derrière des cheveux embroussaillés, des oreilles informes et flasques ; entre les cavités des joues affaissées, une bouche maussade, aux lèvres épaisses : autant de traits sans spiritualité, rien que des formes ordinaires, communes et presque vulgaires.
Dans ce visage tragique de travailleur manuel, partout de l’ombre et de l’obscurité, de la trivialité et de la lourdeur, nulle part un élancement et une aspiration, un fuseau de lumière, une intrépide ascension spirituelle, comme la coupole de marbre du front de Dostoïewski. Nulle part ne pénètre une lumière, ne rayonne un éclat ; prétendre que si, c’est travestir les choses, c’est mentir : non, il n’y a là irrémissiblement qu’un visage bas et fermé ; ce n’est pas un temple, mais une prison pour la pensée, sombre et morne, sans joie et sans beauté, et, de bonne heure déjà, le jeune Tolstoï sait que sa physionomie est manquée. Toute allusion à son physique « lui est désagréable » ; il doute qu’il puisse jamais « y avoir un bonheur terrestre pour quelqu’un qui a un nez si plat, des lèvres si épaisses, et de tels petits yeux gris ». C’est pourquoi, dès la première heure, le jeune homme cache ces traits odieux derrière ce masque épais d’une barbe noirâtre, que tard, très tard seulement, l’âge argentera et rendra vénérable. Seule la dernière dizaine d’années de sa vie dissipe ces sombres nuages ; ce n’est que dans la lumière du soir d’automne qu’un clément rayon de beauté tombe sur ce paysage tragique.
Chez Tolstoï, le génie, éternellement voyageur, s’est logé, comme à l’auberge, dans une demeure basse et grossière, dans la physionomie de n’importe qui, d’un Russe quelconque, derrière laquelle on pourrait tout supposer, à l’exception de l’intellectuel, du poète, du créateur. Enfant, adolescent et homme, même vieillard, Tolstoï produit toujours l’effet d’un individu quelconque, pris entre beaucoup d’autres. Chaque costume, chaque casquette lui va bien : avec une telle face anonyme de russe sans individualité, on peut aussi bien présider une table ministérielle que se « soûlographier » dans une louche taverne de vagabonds ; on peut aussi bien vendre du pain blanc, sur la place du marché, que, revêtu de soie, comme le métropolite, à l’office de la messe, élever la croix au-dessus de la foule agenouillée ; nulle part, dans aucune profession, dans aucun costume, dans aucun lieu de la Russie, ce visage ne serait déplacé. Quand Tolstoï est étudiant, il ressemble à ses camarades comme deux gouttes d’eau ; quand il est officier, il a l’air de n’importe quel porteur de sabre, et quand il est gentilhomme campagnard, on dirait un hobereau quelconque. Lorsqu’il est en voiture, à côté de son domestique à barbe blanche, il faut interroger à fond sa photographie pour discerner lequel des deux vieux qui sont là sur le siège est le comte et lequel est le cocher ; lorsqu’une image le représente en conversation avec les paysans, si on l’ignorait, on ne devinerait jamais que ce « Lew » qui est au milieu de la racaille est un comte et qu’il est des millions de fois plus que tous ces Grégor, Ivan, Ilias et Pjotr qui l’entourent. On dirait que cet homme est à la fois tous les autres, comme si dans son cas le génie n’avait pas pris le masque d’un individu particulier, mais s’était déguisé en peuple, tellement sa figure a l’air d’être absolument anonyme. C’est précisément parce qu’il contient toute la Russie que Tolstoï n’a pas de visage particulier, mais simplement celui de l’humanité russe.
Aussi son aspect déçoit-il d’abord presque tous ceux qui l’aperçoivent pour la première fois. Ils sont venus ici de bien loin, avec le chemin de fer, et puis en voiture à partir de Toula ; maintenant, dans le salon de réception, ils attendent respectueusement le maître ; chacun s’imagine qu’il va se trouver devant un être imposant, et déjà l’esprit se le représente comme un homme de belle prestance, majestueux, avec une barbe ruisselante de Père éternel, de grande taille et de fière apparence, géant et génie en une seule personne. Déjà le frisson de l’attente pèse sur les épaules de chacun. Déjà le regard s’incline malgré soi devant la stature gigantesque du patriarche qu’il va apercevoir dans un instant. Enfin, voici que la porte s’ouvre... et, que voit-on ? Un petit bout d’homme, courtaud, entre, si prestement que sa barbe flotte, à pas menus, presque en courant ; puis il s’arrête, avec un aimable sourire, devant le visiteur surpris. De bonne humeur, la voix rapide, il s’entretient avec lui ; d’un mouvement aisé il offre la main à chacun. Et ils prennent cette main, effrayés au plus profond de leur cœur : comment ? Ce petit bonhomme aimablement réjoui, « ce leste petit père à la barbe de neige », ce serait véritablement Léon Nicolaïewitsch Tolstoï ? Le frisson qu’on avait éprouvé par anticipation devant la majesté du grand homme se dissipe et, encouragé, le regard se pose sur sa figure.
Mais soudain le sang cesse de circuler dans les veines de ceux qui le dévisagent ainsi. Comme une panthère, de derrière la jungle broussailleuse des sourcils, un regard gris a bondi sur eux. Ce regard inouï de Tolstoï, dont aucune peinture ne peut donner une idée et dont, pourtant, parle chacun de ceux qui ont un jour jeté les yeux sur le visage de l’homme fameux ! Ce regard vous cloue sur place, comme un coup de couteau, dur et brillant comme l’acier. Impossible de bouger, de lui échapper ; chacun, hypnotiquement enchaîné, doit souffrir que ce regard, curieux et douloureux comme une sonde, le pénètre jusqu’au tréfonds de son intérieur. Il n’y a pas de refuge devant lui : comme un projectile, il transperce toutes les cuirasses de la dissimulation, comme un diamant il coupe toutes les glaces. Personne (Tourguenieff, Gorki et cent autres l’ont attesté), personne ne peut mentir devant le regard pénétrant et perçant de Tolstoï.
Mais cet œil ne conserve sa dureté inquisitrice que pendant une seconde. L’iris se dégèle aussitôt, jette une lueur grise, papillonne d’un sourire contenu ou s’illumine d’un éclat doux et bienveillant. Comme l’ombre des nuages sur les eaux, toutes les variations du sentiment jouent continuellement sur ces pupilles magiques et sans repos. La colère peut les faire jaillir en un seul éclair glacial, le mécontentement peut les congeler en un cristal froid et clair, la bonté peut les ensoleiller chaudement et la passion les enflammer. Ces étoiles mystérieuses peuvent sourire sous l’effet d’une lumière intérieure sans que remue la bouche dure ; et, quand la musique les attendrit, elles peuvent « pleurer à torrents », comme celles d’une paysanne. Elles peuvent puiser une clarté dans une satisfaction de l’esprit et soudain s’assombrir tristement sous l’ombre de la mélancolie, puis se rétracter et devenir impénétrables. Elles peuvent observer, froides et impitoyables ; elles peuvent couper comme un bistouri et rayonner comme un feu de Roentgen et aussitôt après être envahies par le reflet papillotant d’une curiosité enjouée ; ils parlent toutes les langues du sentiment, ces yeux, « les plus éloquents » qui aient jamais brillé sous un front humain. Et, comme toujours, c est Gorki qui trouve pour en parler le mot le plus exact : « Dans ses yeux, Tolstoï possédait cent yeux ».
Par ces yeux, et uniquement par eux, la face de Tolstoï a du génie. Toute la force lumineuse de cet homme, qui était tout regard, est concentrée uniquement dans leur mille facettes, comme la beauté de Dostoïewski, l’homme-pensée, est concentrée dans le profil de marbre de son front. Tout le reste, dans le visage de Tolstoï, barbe et broussaille, ce n’est qu’une enveloppe, un espace protecteur pour cacher profondément la matière précieuse de ces pierres lumineuses, magiques et magnétiques, qui absorbent en elles l’univers et qui l’irradient hors d’elles-mêmes, elles qui sont le spectre le plus précis de l’univers que notre siècle ait connu. Il n’y a rien de si minuscule que ces lentilles ne puissent pas rendre visible : comme une flèche, comme le vautour fond d’une hauteur incommensurable sur une souris en fuite, ces yeux peuvent se précipiter sur chaque détail, et, cependant, ils peuvent en même temps embrasser panoramiquement tous les horizons du globe. Ils peuvent flamboyer dans les hauteurs de l’intellectualité et aussi rôder lucidement dans l’obscurité de l’âme, comme dans le royaume aérien. Ils ont assez d’ardeur et de pureté, ces cristaux étincelants, pour apercevoir Dieu dans une élévation extatique, et ils ont aussi le courage de regarder le néant, — cette tête de Méduse — d’observer attentivement sa figure qui vous pétrifie. Rien n’est impossible pour cet œil-là, sauf peut-être une chose : rester inactif, sommeiller et somnoler dans la joie calme et pure, dans le bonheur et la béatitude du rêve. Car, impérieusement, à peine les paupières s’ouvrent-elles, cet œil doit se mettre en quête d’une proie, — implacablement éveillé, inexorablement fermé à l’illusion. Il percera toute chimère, démasquera tout mensonge, anéantira toute croyance : devant cet œil de vérité tout devient nu. Chose terrible, par conséquent, si un jour Tolstoï brandit contre lui-même ce poignard gris d’acier : alors sa lame s’enfoncera meurtrière jusqu’au plus profond du cœur.
Celui qui possède un tel œil voit la vérité ; le monde et tout savoir lui appartiennent. Mais on n’est pas heureux avec de pareils yeux, — éternellement vrais, éternellement éveillés.
LA VITALITÉ DE TOLSTOÏ ET SA CONTRE-PARTIE
« Je désire vivre longtemps, très longtemps, et la pensée de la mort me remplit d’une crainte poétique et enfantine. »
TOLSTOÏ,
Lettre de jeunesse.
UNE SANTÉ foncière. Le corps charpenté pour un siècle. Des os solides et saturés de moelle, des muscles noueux, une véritable force d’ours : allongé sur le sol, le jeune Tolstoï peut d’une main soulever en l’air un lourd soldat. Des tendons élastiques : au gymnase, sans élan, il saute facilement la plus haute corde ; il nage comme un poisson, monte à cheval comme un Cosaque, fauche comme un paysan : ce corps de fer ne connaît d’autre fatigue que celle qui vient de l’esprit. Chaque nerf tendu, vibratile à l’excès, à la fois souple et résistant, une lame de Tolède, chaque sens aigu et alerte. Nulle part une brèche, une lacune, une fissure, un manque, un défaut, dans le rempart circulaire de cette force vitale, et, par conséquent, jamais une maladie sérieuse ne réussit à faire irruption dans ce corps bâti en pierres de taille : le physique incroyable de Tolstoï reste barricadé contre toute faiblesse, muré contre la vieillesse.
Vitalité sans exemple : tous les artistes des temps modernes, à côté de cette virilité biblique enveloppée d’une barbe bruissante, paysanne et barbare, ont l’air de femmes ou de freluquets. Même ceux qui l’ont égalé en puissance créatrice perdurant jusqu’à un âge patriarcal, même ceux-là ont vu leur corps vieillir et se fatiguer sous le poids de l’esprit toujours en mouvement et en chasse. Gœthe (dont l’horoscope est voisin du sien par l’identité du jour de naissance, le 28 août, et par la vision créatrice de l’univers, se maintenant également jusqu’à la quatre-vingt-troisième année), Gœthe, à soixante ans, s’est épaissi, craint l’hiver, et depuis longtemps reste assis, près de la fenêtre soigneusement fermée ; Voltaire, ossifié et ressemblant déjà à un oiseau de mauvais augure plus qu’à un homme, gratte et gratte du papier à son bureau ; Kant, roide et fatigué, va et vient, comme une momie mécanique, le long de son allée de Kœnigsberg, alors que Tolstoï, vieillard débordant de force, plonge encore, en s’ébrouant, son corps rouge de froid dans l’eau glacée, trime au jardin et, au tennis, court lestement après les balles. À soixante-sept ans, il a la curiosité d’apprendre à monter à bicyclette. À soixante-dix ans il patine agilement sur la piste miroitante ; à quatre-vingts ans il exerce quotidiennement ses muscles dans des exercices de gymnastique et, à quatre-vingt-deux ans, à un pouce de la mort, il fait encore siffler la cravache au-dessus de sa jument, lorsque, après vingt verstes d’un violent galop, elle s’arrête ou regimbe. Non, il n’y a pas de comparaison possible ; le XIXe siècle ne connaît point d’exemple d’une telle vitalité, digne des premiers temps du monde.
Déjà les branches atteignent les cieux des années patriarcales sans qu’aucune racine soit desséchée en ce chêne géant de la terre, gonflé de sève jusqu’à la dernière fibre. L’œil reste perçant jusqu’à l’heure de la mort : quand Tolstoï est à cheval, son regard curieux voit l’insecte le plus minuscule ramper sur l’écorce des arbres, et il n’a pas besoin de lunette pour suivre le vol du faucon. Il garde l’oreille fine et ses narines larges, presque animales, absorbent toute volupté ; une sorte d’ivresse saisit toujours le vieillard à barbe blanche lorsque, dans ses promenades printanières, soudain il aspire la forte odeur de fumier mêlée à la senteur de la terre qui se dégèle et il perçoit encore distinctement dans son souvenir quatre-vingts printemps du temps passé, chacun mettant son élan particulier, son premier jet de vapeurs dans ces bouffées d’un unique parfum ; la sensation qu’il éprouve est si vive, si émouvante que soudain ses paupières se mouillent.
Ses jambes nerveuses de chasseur, dans des bottes de paysan d’un poids énorme, arpentent en tous sens le sol humide ; sa main sûre n’a pas le tremblement des vieillards ; l’écriture de sa lettre d’adieux présente encore les grands traits et les jambages enfantins de ses jeunes années. Son esprit, lui aussi, se conserve aussi magnifiquement intact que ses tendons et ses nerfs : dans la conversation, il est brillant, étincelant, surpasse les autres ; sa mémoire, d’une précision effrayante, retient jusqu’aux moindres détails. Rien n’échappe à son souvenir ; aucun relief n’est émoussé ou effacé par la dure râpe des années ; à chaque contradiction la colère fait trembler encore les sourcils du vieil homme, un rire sonore arrondit sa lèvre, sa langue est féconde en images originales, le sang, toujours chaud, demande à se satisfaire. Lorsque, dans une discussion sur La Sonate à Kreutzer, quelqu’un objecte au septuagénaire qu’à son âge il est facile de renoncer à la sensualité, voici que l’œil du vieillard noueux jette des éclairs de fierté et de colère : « C’est faux », dit-il, « la chair est encore puissante, j’ai encore à lutter ».
Seule, une vitalité aussi indéfectible explique son infatigable puissance créatrice, qui ne se flétrit jamais : il n’y a pas une seule année qui soit restée stérile, dans les soixante ans de son labeur mondial. Jamais cet esprit ne se repose, cette sensibilité merveilleusement éveillée et assise ne s’endort ou ne somnole. Tolstoï, jusqu’au plein de sa vieillesse, ne connaît pas ce que c’est qu’être réellement malade ; la lassitude n’entame jamais sérieusement cet ouvrier qui travaille dix heures par jour ; ses sens toujours dispos n’ont pas besoin du coup de fouet des excitants, vin ou café, ni de s’échauffer avec de l’alcool ou de la viande ; ses sens, disciplinés, sont si sains, si joyeusement prompts à l’attaque, si élastiquement tendus et si pleins d’énergie intense que le moindre contact les fait vibrer et qu’une goutte suffit à les faire déborder. Sa massive santé ne l’empêche pas d’avoir l’épiderme sensible (comment serait-il artiste, s’il n’avait pas cette irritabilité extrême ?). Il ne faut toucher qu’avec prudence le clavier de ses nerfs essentiellement sains, car précisément la véhémence de leur réaction rend toute émotion dangereuse.
C’est pourquoi (comme Gœthe et comme Platon) il craint la musique, car elle excite trop fortement les vagues profondes et mystérieuses de son sentiment ; elle attaque trop violemment le nerf de sa passion tout gonflé du sang de sa vitalité. « Elle agit sur moi d’une manière terrible », déclare-t-il : et, en fait, tandis que sa famille est assise autour du piano, à écouter nonchalamment, aimablement, la musique, les narines de Tolstoï commencent à frémir redoutablement. Ses sourcils se contractent, en posture de défense ; il éprouve « une étrange pression au cou » et, soudain, il se détourne brusquement et gagne la porte, car les larmes jaillissent de ses yeux. « Que me veut cette musique ? » dit-il une fois, tout effrayé de sa propre victoire. Il sent qu’elle veut quelque chose de lui, qu’elle menace de lui dérober ce qu’il est résolu de ne jamais livrer ; quelque chose qu’il tient caché tout au fond de l’armoire secrète des sentiments, et, voici qu’il se produit en lui une puissante fermentation, un jaillissement qui menace de franchir les digues.
On ne sait quoi de tout-puissant, dont la force et l’outrance lui font peur, commence à s’agiter ; malgré lui, il se sent au plus profond de son être saisi par la vague de la sensualité et entraîné à la dérive. Mais il hait (ou il craint), — à cause de cette outrance, qui, probablement, n’est connue que de lui-même, — sa propre sensualité. C’est pourquoi il poursuit aussi « la » femme d’une haine d’anachorète, d’une haine qui n’est pas naturelle, de la part d’un homme sain. La femme ne lui paraît « inoffensive que quand elle est absorbée par les soins de la maternité, ou en état de modestie, ou rendue vénérable par l’âge », c’est-à-dire au-delà de cette sexualité qu’il « a ressentie toute sa vie comme un lourd défaut du corps ». De même que la musique, la femme représente pour cet anti-Grec, pour ce chrétien artificiel, pour ce moine forcé, uniquement le mal : par la sensualité, l’une et l’autre nous détournent « de nos qualités innées de courage, de fermeté, de raison, d’équité » ; comme « le Père » Tolstoï, le prêchera plus tard, elles nous conduisent « au péché charnel ». Elles « exigent quelque chose de lui », qu’il se refuse à donner ; elles touchent à quelque chose de dangereux qu’il craint de réveiller.
Il ne faut pas beaucoup d’intelligence pour deviner qu’il s’agit là d’une sensualité monstrueuse que, dans une lutte qui a duré des années, il a refoulée avec une persévérante énergie, sans réussir à l’étouffer complètement et qui, domptée, asservie, vaincue, courbée sous le fouet, reste tapie dans un coin invisible de son être, les griffes frémissantes, prête à bondir au premier moment où elle ne serait plus surveillée. La musique : voici que se détend le lien de la volonté et déjà l’ « animal » se dresse. Les femmes : voici que la meute brame et hurle, avide de sang, et secoue les barreaux de fer de la grille. Ce n’est que par la folle anxiété de moine qu’éprouve Tolstoï, par le frisson fanatique qu’il éprouve lui-même devant la sensualité saine et sereine, nue et naturelle, que l’on peut deviner cette virilité de Pan, cette ardeur au rut de l’animal humain qui est cachée en lui, et qui dans sa jeunesse se donne librement carrière en de sauvages excès (en s’adressant à Tchékoff, il se qualifie lui-même d’ « infatigable fornicateur »), pour ensuite rester emprisonnée malgré elle, pendant cinquante ans, sous la voûte des caves, — emmurée, mais non enterrée. Une seule chose dans l’œuvre strictement morale de Tolstoï révèle que la sensualité de cet homme à la santé énorme est restée toute sa vie excessive : c’est précisément sa peur de la « femme », de la tentatrice, cette peur qui fait songer aux Pères du du désert, cette peur bruyante et plus que chrétienne, qui le force malgré lui à détourner les yeux, mais qui, en réalité, n’est que la peur de ses propres appétits, apparemment sans mesure.





























