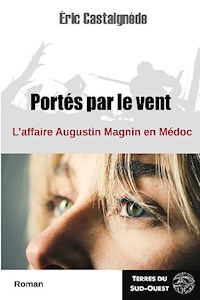Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terres de l'Ouest
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Agent de recouvrement à la solde d’un caïd du bassin d’Arcachon, noctambule patenté et joueur invétéré, Jules mène une existence solitaire et futile, entre boîtes glauques et tripots clandestins.
Au décès de son frère, victime d’un accident de la route, il fait la connaissance de Théo, son neveu, hospitalisé à La Rochelle. Peu à peu, l’oncle tisse des liens avec l’enfant et commence à s’ouvrir aux autres. À commencer par Pauline, une séduisante jeune femme rencontrée dans un bar de nuit à La Teste, et qui s’immisce dans son quotidien.
Mais les apparences sont trompeuses. Plongé au cœur d’un trafic de drogue international, Jules découvre que le décès de son frère n’a rien de fortuit, que la mère de Théo, portée disparue depuis sa naissance, est peut-être vivante et que Pauline n’est probablement pas celle qu’elle prétend être…
Tripots clandestins, bar à hôtesses, parties de Poker
no limit : tous les ingrédients sont réunis dans ce roman au cœur de la pègre oléronnaise pour donner lieu à un thriller de haute voltige.
Au milieu d’une guerre des gangs, le personnage central, se découvre avec Théo, son jeune neveu hospitalisé à La Rochelle, une famille et une raison d’avancer...
Est-il encore temps pour lui de changer de vie et de quitter ses fonctions dans l’organisation mafieuse ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Scientifique de formation, Eric Castaignède a fait toute sa carrière professionnelle à la Poste, comme cadre supérieur informatique.
Dorénavant à la retraite, il se consacre intégralement à l’écriture depuis quelques années.
Son premier roman : Portés par le vent, est publié en 2018, puis Le Mystère du Cercle de Trensacq en 2020 et enfin Un 26 aout à Arcachon en 2021.
Touche pas au Grisbi d’Oléron est son quatrième roman publié aux éditions Terres de l’Ouest.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Touche pas au grisbi du bassin
De Éric Castaignède
roman
© Éditions Terres de l’Ouest
Tous droits réservés [email protected]
ISBN papier : 978-2-494231-16-0
ISBN numérique : 978-2-494231-27-6
Crédits photographiques sur Adobe Stock : Arcachon cabanes tchanquees france travel poster city bay landscape with wooden hut atlantic coast in colored style for tourism poster print © Par OceanProd et Entrée du port de La Cotinière par © pixels_of_life.
Chapitre 1
« Dis-moi, quel âge il faut avoir pour mourir ? »
Mes yeux pleins de larmes distinguent mal son petit visage. Je les frotte pour les sécher. Lui, est sérieux et attentif. Il me touche le bras comme s’il souhaitait me réconforter, mais le froid de sa paume et de ses doigts accentue mon désarroi. Je remonte le drap sur sa poitrine jusqu’à son menton, avec d’excessives précautions. Puis je lui masse la main pour la réchauffer. Le petit me regarde, a un sourire attendrissant et posément s’étonne : « Mais je n’ai pas froid ! »
Je continue pourtant, en esquissant une grimace maladroite. Je n’ai pas de mots pour le tranquilliser, pas de paroles qui pourraient le rassurer. Je pose ma joue sur son avant-bras. Je sens la vie couler dans ses veines. Sa bouche s’étire sans qu’un son n’en sorte. De la main gauche, j’écarte une mèche de cheveux collée sur son front. Ses pupilles suivent le parcours de mes doigts. Alors, avec application, d’une voix assurée, il me dit : « Tu sais, je n’ai pas peur. » Je hoche la tête, impuissant. Je me redresse, mon cœur bat juste un peu trop vite. Depuis de longues minutes, je n’ai pas prononcé une seule phrase, incapable d’en trouver une qui saurait insuffler en lui la confiance qui me fuit. Je reste désarmé et faible, dans une posture statique. « Tu crois qu’il y a un paradis pour les enfants ? » Sa question me désarçonne totalement. La psychologue que j’ai vue en début d’après-midi a été particulièrement claire : « Ne lui mentez pas. » Ce précepte me semble moralement inapplicable et le doute me pousse à le transgresser : « Oui, sûrement. » Je perçois dans ses yeux une détresse qui ternit le peu d’éclat qui les éclairait. La naïveté de ma réponse me tétanise. Jamais je n’ai été préparé à cela. Qui peut prétendre gérer convenablement une telle situation ? Quelle erreur ai-je commise ? Une larme maintenant roule sur sa joue, atteint la commissure de ses lèvres et tombe sur le drap. De cette gouttelette unique, je n’ose pas regarder la trace laissée sur le tissu. Le mouvement de panique que j’esquisse est rapidement refréné par ses paroles, à peine audibles : « Alors, je ne le rejoindrai pas ? ».
Je suis resté à ses côtés un long moment, jusqu’à ce que ses yeux se ferment. À cinq heures du matin, au bout d’une nuit calme, juste avant que l’aube n’amène l’espoir d’un jour nouveau, il a sombré dans un sommeil profond. Son visage s’est détendu et ses joues sont devenues roses. J’ai déposé un baiser sur son front tiède. Le silence s’est emparé de la pièce. Je me suis appuyé sur le mur, tout au fond de la chambre et dans cette position, je l’ai regardé dormir.
Je suis rentré chez moi au matin. La veille, j’ai laissé mon neveu dans cet hôpital. Avant de partir, un médecin m’a dressé un bilan complet de sa situation et l’administration m’a clairement expliqué que j’étais désormais sa seule famille. J’ai protesté, sans leur préciser que pour moi ce petit était un inconnu. Son état est catastrophique. Il n’a que peu de chances de vivre. Puis, j’ai assisté aux obsèques de mon frère qui laissait ainsi un orphelin.
Chapitre 2
Mon existence est faite d’insouciance et de futilité. Je la gaspille et la dilapide en vaines occupations. Chaque réveil est difficile. Je vis la nuit, allant de boîtes troubles en tables de jeu. Mes relations ne sont pas recommandables et en aucun cas sincères. Je côtoie la lie de la société comme une fatalité. Je perds plus d’argent que je n’en gagne, le constat est effrayant et depuis longtemps le sentiment d’amour propre m’a déserté. Je n’ai pas de travail, mais quelques allocations qui me permettent, par des rentrées dérisoires, d’alimenter modestement tous les tripots clandestins de la ville. Mes compléments de revenus, sous forme de primes, sont eux confortables, je n’en suis pas fier. Ils sont basés sur la peur, la menace, la détresse ; pas la mienne, celle d’autres gens, de ceux qui pensaient qu’ils pouvaient changer leur condition en un instant. Le mécanisme est impitoyable, ils sont voués à être broyés. Ils jouent et ils perdent. Ainsi va la vie. Moi, je les chasse pour les pressurer. Ainsi va encore la vie.
Tant que je ne dis rien, respectant les consignes et effectuant la basse besogne sans médire, je suis à l’abri du besoin. Moi aussi je perds, mais mes pertes sont garanties… tant que je marche dans la combine. Mes dettes alimentent un grand compte où je suis un débiteur privilégié. Mon erreur est certainement de penser que je suis intouchable. Je le suis sûrement. La vanité m’a, là encore, depuis longtemps abandonné, mais côtoyer des puissants m’a mis à l’abri des coups.
Ce livre, en bonne place sur mon meuble et que cent fois j’ai ouvert, je ne l’ai même pas lu. Mais si j’ai déchiffré tous ses mots, toutes ses lettres, l’ensemble de ses pages, jamais je ne les ai parcourues dans l’ordre. La couverture me plaît, elle est plutôt réussie. Ce bouquin n’est pas source de loisirs, mais un outil de travail indispensable. Un fou rire nerveux me surprend. Je cache mes yeux dans ma main, conscient de l’absurdité de ma situation.
Face au bassin, le visage fouetté par une brise qui vient du large, je respire profondément. La marée montante apporte son lot de déchets. Généralement, je n’y prête aucune attention, mais aujourd’hui je suis plus réceptif. Le clapotis des vagues, maigres et courtes, chuchote en un roulement entêtant. Elles lèchent mes pieds et abîment le cuir de mes chaussures. Je m’enfonce dans le sable, mes semelles déjà recouvertes. Je m’en extirpe difficilement avec un bruit glauque de sangsue qui relâcherait sa proie. Un tapis de coquilles vides et, à dix mètres de moi, un enchevêtrement de ferrailles tordues, limitent mes pas. Au loin, Arcachon se dessine et le vent contraire nous épargne les odeurs de la cellulose du pin de Facture.
Mon esprit est en ébullition. Il lutte et ce n’est pas son habitude. Généralement je n’ai aucun scrupule à faire ce que l’on me demande, il en va de ma survie. Aujourd’hui un visage juvénile m’obsède. La lucidité absolument nécessaire à ma tâche semble m’échapper et là, je doute. Je n’en ai pourtant pas les moyens. Ma condition est de subsister en esclavage et je dois une obéissance absolue. J’ai pensé à me rebeller, mais pour quoi ou plutôt pour qui ? Je n’ai personne à protéger, ni avec qui m’enfuir.
Je ramasse un petit morceau de tuile blanchie à la chaux. Le lancer que je tente se noie après un bref sursaut. Jamais je n’ai été doué et mon record de ricochets est consternant. Mille fois j’ai lancé un caillou, mille fois j’ai été déçu. Le rond dans l’eau se referme sans gloire, je lui tourne le dos. Résigné et fataliste, la lettre au fond de ma poche, les poissons emballés dans les mains, je prends le chemin du retour. Un détour par le passage à niveau, je laisse la gare sur la gauche et par le cours de Verdun emprunte celui de la Marne. Je marche lentement, car la tâche qui m’attend est totalement loufoque, sortie tout droit d’un cerveau malade ou plutôt de celui d’un génie mal employé. Cette intelligence n’a su inventer que le mal. Triste destin ! Je le juge en silence, gardant en moi mes critiques.
Là où il ya trente ans, l’herbe et les fossés rendaient difficiles les pas, il n’y a aujourd’hui que trottoirs, feux rouges et interdictions de tourner à droite. Je les ai vus bétonner, détruire les haies, abattre la forêt et pour cette raison, je suis de mauvaise humeur. Ma maison résiste au développement de la société, pâtissant du voisinage d’habitations plus modernes et cossues. Elle tient face aux aléas du temps, elles ne sont plus nombreuses ainsi. Je n’ai l’eau courante que depuis peu. Une pompe manuelle trône éternellement dans le jardin, vestige d’une époque à laquelle je m’accroche. Je suis maintenant à deux cents mètres de chez moi, mon refuge si petit. Je n’ai en tout et pour tout que deux pièces. Une cuisine et une chambre spacieuse qui fait office de bureau et de rangements. Je suis né en ce lieu et j’y mourrai, perspective peu attrayante.
L’image de mon neveu est devant mes yeux lorsque j’ouvre le portail. Il n’y a pas la place pour un enfant ici ; un portique de jeux ne pourrait même pas tenir sur ma modeste pelouse clairsemée. Je secoue la tête pour évacuer son visage. Je ne le reverrai jamais, alors autant l’oublier.
Je traîne les pieds sur les quinze mètres qui me séparent de l’entrée. Le volet n’est qu’accessoire, il ne tient plus en position fermée que par un bout de bois qui le cale. Je le chasse d’un coup de talon et je déplie le contrevent puis l’accroche. La serrure de la porte, elle, possède une grosse clé comme on n’en fait plus. Elle s’ouvre en raclant un peu. La pièce principale peut paraître spartiate pour qui n’a connu que le confort aseptisé d’aujourd’hui. Le sol est brut, en béton. Les murs sont peints d’une couleur jaune très pâle. Une table massive en bois et trois chaises occupent le fond. À côté, un bahut renferme l’intégralité de mes ustensiles de cuisine. Un évier rugueux en pierre remplit un angle, un réfrigérateur et une gazinière complètent le tout. Un chauffage électrique moderne est mal fixé sur son socle et un poste datant de Radio Luxembourg est posé sur une étagère. Un peu sommaire, mais cela me suffit amplement. Je dépose mes clés, mon blouson, puis les poissons dans le frigo, conserve mes chaussures et me débarrasse sur la table de l’enveloppe froissée que j’avais dans la poche. Elle sent la marée. Je mesure tout le ridicule de la situation.
La première fois, je n’y ai pas cru. J’ai pensé à une blague d’initiation réservée aux nouveaux venus. Un bizutage en quelque sorte. J’ai esquissé un sourire au début, mais j’ai été immédiatement contré par le nain.
— Ça te fait rire ?
Je suis resté figé, sidéré. Derrière lui, les deux cerbères ont porté une main dans l’échancrure de leur veste. J’ai finalement bafouillé une excuse inaudible et le gnome, en s’étirant, m’a touché la joue de ses doigts boudinés avec un rictus horrible, en signe de menace. Alors il s’est reculé et posément a repris :
— Je te disais que tu recevras mes ordres par courrier, comme celui-ci.
Il m’a tendu une feuille où une succession de chiffres et de lettres figuraient. J’ai voulu la prendre, il l’a prestement retirée avec ces paroles blessantes :
— Ne touche pas, connard.
Puis il s’est assis dans un fauteuil, ses pieds ne touchaient pas le sol. Il m’a fait signe d’approcher. Je me suis exécuté, mais pas assez vite à son goût.
— Alors, tu arrives ?
J’ai accéléré mon enjambée et, stupide, je me suis planté devant lui, le dominant, attendant la suite. Il a finalement tendu son bras potelé sur sa droite, me désignant un guéridon sur lequel un livre était posé. Il a agité son index.
— Tu aimes lire, j’espère ?
La gorge sèche, je redoutais un impair de ma part. Heureusement, il ne m’a pas laissé le loisir de commettre une nouvelle erreur et aussitôt a enchaîné :
— Moi oui.
Et il a éclaté d’un rire cynique. Son hilarité calmée, il a claqué des doigts et un domestique lui a apporté un verre d’alcool qu’il a avalé d’un trait. Puis, il a laissé échapper une grimace et, la voix momentanément déformée, a expliqué :
— Sois attentif, je ne répéterai pas.
Il m’a observé durement.
— Le livre, il va te servir à déchiffrer le message. Chaque groupe sur la feuille correspond à un mot ou une lettre que tu retrouveras dans le bouquin. Le premier nombre désigne une page. Celui derrière le tiret, la ligne dans cette page et le suivant, la position du mot. Si c’est uniquement une lettre d’un mot à trouver, tu auras devant, la lettre L.
Il m’a regardé, soupçonneux.
— Tu as compris ?
J’ai balbutié un énorme mensonge :
— Oui patron.
Le nabot a souri et d’un revers de main m’a congédié. Mais, alors que j’atteignais le pas de la porte, il m’a rappelé.
— Idiot ! Tu n’as pas pris les références du livre.
Je suis revenu sur mes pas, j’ai voulu saisir le bouquin, son regard mauvais m’en a dissuadé.
— Note et tire-toi.
J’ai marqué d’une main tremblante le titre et l’auteur et sans demander mon reste, j’ai fui.
Maintenant, la feuille contenant les ordres du jour est dans cette enveloppe, posée sur ma table. Le procédé est puéril, mais depuis le temps, j’aurais dû m’y habituer. Décidément, le cerveau de ce petit homme est d’une perversité absolue. Un jour il s’est justifié.
— Je n’aime pas les mots croisés alors ce cryptage m’amuse. Pas toi ?
Ce petit manège s’est produit neuf fois l’année dernière et ma seule besogne est d’exécuter les ordres inscrits sans faillir. Ramené à l’heure de travail effectif, mon salaire est exorbitant. Mon job consiste donc simplement à attendre d’être sollicité.
Ce matin, j’ai reçu un SMS laconique : Arrivage de poissons. Je sais ce qu’il signifie. Je suis passé chez le mareyeur près du port de l’Aiguillon et, sans surprise, j’ai trouvé la lettre parmi les filets de limandes. Elle sent effectivement la marée. Tous ces stratagèmes doivent amuser mon employeur.
Déchiffrer les instructions m’occupe plusieurs heures, d’un labeur minutieux. Je sais par expérience que le délai d’exécution ne peut être inférieur à deux jours. Maintenant je prends le temps. Les premières fois, je traduisais immédiatement.
Je me prépare un repas consistant, conscient que les prochaines heures vont être longues. Une fois rassasié, je sors de la maison pour une balade apaisante. Je fais le tour de mon jardin, m’arrête au fond de celui-ci, et par-dessus la barrière en bois, attire le petit âne qui paît dans l’unique prairie préservée du quartier. Le rituel est immuable. Il quémande le morceau de sucre que je lui tends et il reste là aussi longtemps que je le décide. Une tape sur son encolure signifie la fin de notre rencontre et il s’éloigne enfin.
Je remplis mes poumons de l’air frais de cette soirée et regagne mon humble logis. Une fois le volet bloqué, je suis hermétiquement calfeutré. La cuisine est en ordre, je passe dans ma chambre qui est aussi mon bureau. Là, le changement est radical. Autant ma première pièce est fonctionnelle et austère, autant celle-ci est attrayante et moderne. Elle est harmonieusement décorée, douillette et chaude. Le sol est en plancher massif, les murs peints ou tapissés de couleurs pastel. Elle est pourvue de toutes les technologies récentes. À droite, face à la porte et tout près de la fenêtre, un imposant bureau occupe l’espace. Un siège haut en cuir et un meuble de rangement prédisposent au confort et à l’efficacité. L’arsenal bureautique est total et du dernier cri. Des photos, exclusivement du bassin d’Arcachon, ornent les murs. Le coin nuit est à mon sens propice au repos. La couette de mon lit est gonflée et emplie de plumes d’oie, mes oreillers sont moelleux. Les lumières sont réglables et disposées à souhait, la domotique règle chaque fonction. Un téléviseur à écran géant envahit le mur de gauche, un fauteuil original LC3 de Le Corbusier y fait face. Du matériel haute-fidélité réservé aux mélomanes avertis occupe l’angle contigu. Une ouverture conduit à une salle de bains de petite dimension, mais bien pensée. Il est clair que je suis fier de cet endroit. Je m’y sens à mon aise.
Malheureusement, ma soirée va être studieuse. Mon travail consiste à déchiffrer les ordres à exécuter. Ne serait-il pas plus simple de me les dicter ? Fataliste, j’étale la feuille que je défroisse et pose le livre tout à côté. Cet ouvrage est l’œuvre d’un inconnu. Il n’est pour l’instant pas encore passé à la postérité et pourtant mon patron s’en est entiché. Il en a fait son livre de référence, nécessaire pour coder ses ordres. Me le procurer n’a pas été chose aisée. À la librairie du quartier, l’employée n’a pas pris le temps de chercher. À celle du centre d’Arcachon, le titre disait quelque chose à l’employé, mais s’il l’a effectivement trouvé référencé dans ses bases, le délai de livraison annoncé m’a effrayé. Je suis parti en remerciant alors que le commerçant tentait de me retenir.
— Prenez plutôt un Musso, c’est une valeur sûre et on l’a en stock.
À l’espace Culturel du Leclerc d’Arès, le vendeur a eu l’air consterné :
— Vous n’avez pas de chance, j’ai vendu notre unique exemplaire le mois dernier.
Mais l’opiniâtreté est récompensée et j’ai finalement trouvé la perle rare à la librairie d’Andernos. Le patron a soufflé dessus pour en chasser la poussière et me l’a tendu avec un sourire radieux, content de s’en débarrasser, en annonçant le titre pour plus de certitude : Un 26 août à Arcachon. Puis il a ajouté :
— Je ne sais pas s’il est sympa, je ne l’ai pas lu. Cela vous fera quatorze euros.
La première action est de souligner avec un feutre les différents groupes : les mots en vert et les lettres notées L en rouge. Ceci donne pour le début : 20-1-7 155-17-3 96-27-1 89-21-7…
La débilité d’une telle action me désespère, mais je déchiffre, patiemment. Dans les premiers temps, je me trompais parfois, m’obligeant ainsi à recommencer de manière interminable. Maintenant je ne fais plus d’erreur. Mon œil est exercé.
Sous mes doigts, le texte prend forme. Une heure quarante plus tard, tout est au clair. Je connais la mission qui, je le pense, sera routinière et sans risque.
Le procédé est une nouvelle fois confirmé. Edmond et Dimitri, les deux costauds, me précèdent dans la place. Le patron les appelle les influenceurs. Ils s’assurent de la tranquillité du lieu et conditionnent notre cible. Celle-ci est souvent un débiteur qui peine à régler ses dettes. Alors j’interviens et encaisse ou définis un échéancier. Ma tâche est purement administrative et comptable. Toute la mécanique de l’intervention est parfaitement huilée et rarement un incident ne se produit. Aucune plainte n’a été déposée, même pour un œil poché ou un appartement retourné. Je pense que le patron a quelques appuis hauts placés, mais ce n’est pas mon affaire.
Je repousse les liasses devant moi, embrasse le livre comme de coutume et je m’étire. J’ai remarqué que plus j’allais au lit tôt, plus j’étais fatigué. Habitué des sorties nocturnes, je supporte mal l’oisiveté des soirées casanières, alors j’enchaîne les bâillements.
Au moment de dormir, l’image du petit défile sous mes yeux. Je me retourne à de nombreuses reprises dans mon lit.
La journée suivante se déroule calmement. Le travail doit être exécuté en fin d’après-midi et pour une fois, je n’ai pas à me déplacer trop loin. Une centaine de kilomètres aller-retour au maximum et vers vingt et une heures je pourrai aller jouer. Les jeux sont pour moi une source d’adrénaline. Ils sont ma drogue, même si souvent je cède au démon du cannabis. Les aléas du hasard me procurent d’autres sensations, plus puissantes. Je pratique principalement le Chemin de Fer, variante du Baccarat. Je connais toutes les tables clandestines de Gironde et ne fréquente que très rarement les casinos. Le poker a également mes faveurs, mais là, mes pertes sont souvent plus conséquentes. Je ne m’y risque que dans des salles appartenant à mon patron, où je suis connu et où mes passifs ne sont que virtuels. Ils sont honorés pour grande partie par mon employeur et notés scrupuleusement. L’ardoise est conséquente et achète ma dévotion la plus totale. La spirale est infernale, mais grisante. Chaque soir j’espère me racheter, et le plus souvent je rentre au petit matin, vidé de toutes espérances.
Dimanche, je fêterai mon anniversaire, le trente-cinquième. Chaque année je tente de me fabriquer une journée exceptionnelle, mais elles restent à mon image, ratées et décevantes. Il y a trois ans, je suis parti passer deux jours au Pays basque. Il a plu tout le temps et je n’ai quitté ma chambre d’hôtel que pour aller au commissariat porter plainte pour dégradation de mon véhicule. L’année d’après, je suis allé à Bordeaux assister à une représentation de Giselle, un ballet qui m’avait été chaudement recommandé. Après une demi-heure d’attente, nous avons vu, incrédules, l’ensemble de l’orchestre replier tout le matériel et quitter précipitamment le théâtre. Nous n’avons jamais su l’objet du désaccord, mais la représentation a eu lieu avec une bande-son de mauvaise qualité. Même les danseurs et ballerines avaient perdu leur enthousiasme et je suis parti à l’entracte. L’année dernière, j’ai assuré ; surtout ne pas prendre de risques. J’ai réservé un restaurant réputé, La Cabane à Gujan et tout s’est admirablement déroulé, enfin jusqu’au plat principal. Là, j’ai avalé une arête de poisson et l’on a dû me transporter aux urgences. Le restaurateur a été magnanime, il n’a facturé que la première partie du repas et m’a offert l’apéritif. Il a même eu la délicate attention de me souhaiter un bon anniversaire… malgré tout. Cette année, aller découvrir la planche à voile me tente énormément. Jamais il n’y a eu d’accidents, alors j’ai la sensation que je vais enfin pouvoir passer une belle journée. Le spot n’est pas loin et pourtant je n’ai jamais pratiqué. En souriant, je pense que si un rapatriement sanitaire devait avoir lieu, il ne serait pas long ni compliqué. Il faut tout anticiper !
Le rituel est en permanence le même, question d’habitude. Avant une intervention – nom sacralisé censé définir l’objet de ma mission – je m’isole sur le port de la Hume. J’aime ces instants qui précèdent l’action. Ils me donnent l’impression d’exister, d’être utile. Je ne doute pas de ma naïveté, mais j’ai la sensation de faire partie d’un collectif, d’une équipe ou tous comptent les uns sur les autres. La vacuité de mon existence se raccroche à chaque visage qui veut bien se tourner vers moi. On me fait confiance ou plutôt on abuse de moi, mais je n’ai pas le choix. Ma vie est liée au petit homme, parrain de pacotille, nabot qui, selon ses dires, fait plier les grands. Il est plein de rancœur, de haine, il est mauvais, mais il est de parole.
Je jette comme à l’habitude un bout de tuile dans l’eau. Je le vois disparaître misérablement.
La première fois que j’ai rencontré celui qui allait devenir mon patron, sa taille m’a induit en erreur. J’ai sous-estimé ses capacités de nuisance. Un soir, un homme a frappé à ma porte. Sans méfiance je l’ai ouverte toute grande. En aucun cas depuis, je n’ai reproduit cette erreur. Il était chic, digne et droit. Son regard s’est posé sur moi. Un frisson a parcouru mon échine, sans raison. J’étais tétanisé et j’attendais qu’il parle. J’ai eu alors l’impression qu’un temps infini s’écoulait. Il a eu un sourire que seuls les dominants peuvent avoir, un sourire sans empathie qui vous glace les os. Sa main droite, large et soignée s’est avancée vers moi, paume vers le haut. Ce geste se voulait sûrement rassurant et je l’ai interprété comme tel. Il s’est exprimé d’une voix posée, plutôt poliment.
— Le directeur souhaite vous rencontrer.
Devant mon air interrogateur, sinon surpris, il a hoché deux fois de la tête en signe d’approbation. Péniblement j’ai articulé :
— Où ça ?
— Venez.
Je l’ai suivi. Lorsque j’ai voulu fermer ma porte à clé, il m’a rassuré.
— Pas la peine, il est devant chez vous.
Il faisait nuit et les réverbères, bien chiches, diffusaient une faible clarté. Une voiture de forte cylindrée était garée devant mon portail. Un individu était au volant. Je me suis dirigé vers lui, mais celui qui m’accompagnait m’a tiré par la manche pour me faire changer de direction et m’a désigné une silhouette. Son geste, sans équivoque, m’a incité à la rejoindre. D’instinct, de là où j’étais, je discernai de dos une silhouette d’enfant qui fumait à grandes bouffées. J’ai été choqué par cette image. Je me suis arrêté à trois mètres de lui et il s’est retourné, le visage dans l’ombre. Il m’a parlé d’une voix d’adulte et ses mots se sont gravés dans ma mémoire.
— J’avais envie de prendre l’air, vous avez de la chance, c’est moi qui ai fait le déplacement jusque chez vous et non l’inverse. Je vais aller droit au but, vous me devez huit mille euros et vous avez trois jours pour me les rembourser.
Il a fait un pas dans ma direction et dans la pâleur des halos de lumière, j’ai distingué un homme de petite taille.
Chapitre 3
Je file maintenant vers la voie rapide que je rejoins en quelques minutes. Le paysage s’étire. J’ai reconnu mon itinéraire, la ponctualité fait partie de ma fonction et il est hors de question que je me perde. Ce soir, ma mission m’amène à Langon. Une soixantaine de kilomètres à parcourir, une formalité. La route est déserte et mon esprit s’évade facilement : mon petit neveu est là, avec l’image d’un lit trop grand pour lui. Tout est blanc autour, les murs, les portes, le plafond, les machines. Je le chasse aussitôt de mes pensées et le cercueil de son père remplace la vision du fils. Il y avait peu de monde à ses obsèques. Des inconnus, aucun visage familier qui serait remonté des temps anciens, celui où nous étions encore proches. Personne ne m’a demandé qui j’étais. Il y eut bien deux ou trois conversations à voix basse à mon encontre, mais rien qui puisse me donner envie de comprendre pourquoi j’étais ici, à enterrer un frère. De sa vie, je ne sais rien. Elle m’est étrangère et à vrai dire, elle m’importe peu. La seule trace qu’il a laissée se débat entre la vie et la mort dans un hôpital de La Rochelle. Je n’en connais pas plus. Aucune attache ne me relie à eux, ni aucune obligation. Je n’ai pas vu de veuve éplorée ni d’amis inconsolables. Le curé a été sobre, la cérémonie minimaliste, manifestement mon frère n’était pas un familier des lieux de culte. Personne n’a pris la parole pour nous laisser croire que le défunt était un homme extraordinaire. Il a été enterré avec efficacité. À peine le cercueil avait-il été posé au fond de la tombe que trois ou quatre personnes lui jetaient une poignée de terre, pas plus. Puis ils sont partis, visiblement peu attristés, accaparés par d’autres occupations. Les employés des pompes funèbres ont plié leur matériel et déjà les fossoyeurs rebouchaient le trou. J’ai improvisé un signe de croix et mis les mains dans mes poches. Constatant que personne ne me regardait, j’ai quitté le cimetière rapidement, presque honteux, mais soulagé.
La campagne girondine semble s’affoler autour de ma voiture. Je réduis ma vitesse, soucieux de respecter le Code de la route. Un jour, mon patron m’avait hurlé une de ses vérités :
— Si jamais tu te fais gauler sur la route, je te vire.
Abandonnant la dépouille de mon frère au fond de son trou, je repense alors à la suite de la première rencontre avec mon employeur. Ce soir-là, il m’avait laissé devant chez moi, avec un ultimatum irréalisable. Il m’était impossible, en trois jours, de réunir les huit mille euros que je lui devais. Le petit bonhomme, sans un regard de plus, était remonté dans sa Bentley. L’individu qui l’accompagnait s’était approché, m’avait tendu une carte de visite et avait conclu, avant de rejoindre à son tour la voiture :
— Si par malheur vous n’avez pas l’argent, appelez ce numéro.
Ces huit mille euros, j’avais mis quatre jours à les perdre sous le regard bienveillant du responsable du tripot que je fréquentais alors. J’ai appris par son intermédiaire qu’un homme haut placé et à forte influence, selon ses dires, avait racheté ma créance. Cette déconvenue et ce retournement de situation avaient eu le mérite de soigner, pour un temps hélas, mes envies de jeux. Puis, le soir de cette visite impromptue était arrivé.
Bien évidemment j’ai téléphoné. Après une longue attente, j’ai fini par parler au répondeur. Je lui ai confié mon nom, la raison de mon appel, et la nuit même, à deux heures trente du matin, on m’a rappelé avec cette entame déstabilisante :
— J’espère que je ne vous réveille pas ?
Je l’ai compris par la suite à mes dépens, quelqu’un s’amusait de moi pour me mettre en condition et c’est tout naturellement que je me suis retrouvé en présence du petit homme, un soir lugubre de novembre. Une rue sombre, une porte monumentale, un corridor pavé, un escalier majestueux, encore un couloir interminable et au bout une pièce encombrée. Balançant ses jambes dans le vide, le nain était assis ; il mangeait. D’un geste, un cerbère près de lui m’a intimé l’ordre de me taire. Tout ceci a duré trente minutes, le temps de comprendre que cette attente était calculée. J’ai eu tout le loisir d’observer cet être difforme et mal proportionné. Pas une seule fois il ne m’a regardé. Enfin, il a posé sa serviette, terminé son verre, s’est calé dans son fauteuil et s’est tourné vers moi. Longuement il m’a dévisagé. Alors un sourire est apparu sur ses lèvres et, convivial, il m’a fait signe d’approcher. Le ton affable de ses premières paroles était en désaccord avec leur sens.
— Si tu es ici, c’est que tu n’as pas l’argent.
J’ai tenté de bafouiller de vagues excuses qu’il a balayées d’un revers de bras court et potelé. Il s’est levé en sautant sur le plancher. Il a saisi un paquet de cigarettes qui s’est révélé être vide, l’a froissé et d’un geste autoritaire a tendu sa main en faisant claquer son pouce et son majeur à l’intention de son second. Servile et empressé, celui-ci lui en a fourni une. Comme dans un mauvais film noir, il a soufflé la première bouffée de fumée vers mon visage. Je n’en menais pas large, anxieux et impressionné. Les rides de son visage, parfois dissimulées par des boursouflures, le rendaient tantôt hideux, tantôt banal. J’ai accumulé beaucoup de détails malgré l’angoisse qui me tenaillait : sa cravate légèrement tachée, ses chaussures orthopédiques rutilantes, une bague massive à son annulaire gauche et encore d’autres éléments tout aussi insignifiants. Méthodiquement, il a lissé ses sourcils en fermant les yeux, puis a fortement inspiré.
— Tu me poses un problème.
J’attendais la suite, immobile. À reculons, il a rejoint son siège et d’un déhanchement grotesque, s’est hissé dessus.
— Tu sembles être un garçon intelligent, a-t-il poursuivi.
Il s’est interrompu, m’a fixé et a tempéré.
— Du moins suffisamment pour savoir où sont tes intérêts.
Il a ajouté :
— Tu en penses quoi ?
J’ai opiné du chef. Manifestement, il n’attendait pas de réponse. Il a alors pointé son index sans ongle vers moi et lentement, a repris :
— J’ai besoin d’un homme comme toi.
J’avais perdu toute contenance, prêt à défaillir. Il a tourné son doigt vers le haut et m’a fait signe d’approcher. Tremblant, je me suis exécuté. Il s’est étiré vers moi et de sa main moite et molle, il a enserré ma mâchoire. Son visage s’est collé au mien. J’ai bloqué ma respiration face à son haleine désagréable et il a articulé :
— J’ai besoin d’un collaborateur fidèle. Tu as une minute pour décider. Soit tu es cet homme-là, soit tu es mort.
Il a relâché son emprise avec violence. Je suffoquais. Il a repris son sourire carnassier et d’un geste autoritaire m’a ordonné de reculer. Une fois à distance, il m’a observé. Je ne savais que dire ni que faire. Il a ouvert la bouche et a cru bon d’ajouter :
— Ah oui, encore une chose importante : il ne te reste que vingt secondes.
Il a éclaté d’un rire sonore, puis a tapoté sur sa montre.
— Dix…secondes.
Puis d’un geste ample a écarté les bras.
— Ta réponse ?
Déjà je contourne Landiras. Un rideau d’arbres et de verdure m’accompagne. La départementale est une voie rapide et les kilomètres s’enchaînent. Je me replonge alors dans ma mission. J’aborde le pont sur le Ciron, le passe, atteins Langon et bifurque sans hésiter vers la droite, le reste n’est que leçon apprise.
Comme convenu, je me gare au début de la rue de Canteau. Ma montre indique vingt heures treize. J’ai douze minutes à patienter et j’observe les alentours pour passer le temps. À l’heure précise, la voiture d’Edmond et Dimitri, les influenceurs, me dépasse à faible allure. Le passager me fait un signe de la tête. Je ne bouge pas. Ils s’éloignent. Une nouvelle attente se prépare, mon téléphone posé sur les genoux.
Cela fait maintenant deux ans qu’à la question du petit homme, j’ai peureusement répondu :
— J’accepte, je serais votre homme.
Je n’avais aucune idée de ce dont il pouvait s’agir. Était-ce pour tuer quelqu’un ou pour simplement lui lire des histoires ? Je n’en savais rien, mais j’avais l’intuition qu’il fallait sauver ma peau. Un silence a succédé à ces échanges irréels. Je l’ai respecté, soumis pour huit mille euros. L’individu qui avait frappé à ma porte m’a pris par les épaules et m’a fait reculer. Le nain, d’un vilain rictus, m’a gratifié d’un « Dégage maintenant. »
La rue de Canteau est une allée calme et paisible. Une jeune fille se dépêche, à peine ses talons résonnent-ils sur le trottoir. Elle se hâte et je la regarde, distrayant ainsi quelques secondes. D’autres s’éternisent, finissent par s’écouler et mon combat contre le temps se gagne patiemment. Je suis payé grassement pour cela.
Une chose est certaine, mon employeur n’a que peu de considération pour ses subalternes. Rarement je l’ai entendu dire bonjour, au revoir, merci ni même bravo. Ses encouragements se résument à des liasses de billets qu’il distribue au gré de ses envies, mais après tout, l’essentiel est là. Depuis deux ans, je suis intervenu une douzaine de fois en son nom pour récupérer des sommes dues ou planifier les encaissements. Rien ne m’avait prédestiné à cela et pourtant j’honore magistralement ma fonction bien que je n’aie aucune latitude, car mon rôle est écrit d’avance. Ils payent si c’est acté ou on ratifie un prêt si le patron l’a accordé. Sinon Dimitri casse tout sous l’œil complice d’Edmond. Ces deux-là me font peur, je l’avoue. Une fois, une seule, l’intervention a mal tourné et une arme de poing sur la nuque d’un mauvais payeur a durci la négociation. Finalement, tout est rentré dans l’ordre avec deux dents cassées et une côte fêlée pour le récalcitrant.
Ce soir, la pluie menace. L’atmosphère est pesante et je remonte la vitre. Dix-sept minutes ont passé depuis que les caïds sont entrés en action. C’est à mon sens trop long. J’imagine un impondérable, écartant prudemment un problème majeur. Furtivement, l’image de mon neveu traverse mon cerveau, je la chasse pour demeurer lucide.
Chaque minute fortifie mon angoisse naissante. La facilité des dernières opérations a occulté les risques qui peuvent survenir à tout moment. Je me force à respirer profondément. Cinq minutes s’ajoutent encore, puis cinq autres. La situation est inédite. La nervosité m’envahit.
Enfin le téléphone vibre. Le SMS tant attendu arrive. Il se résume en un mot : Libre. Je peux entrer en action. Je descends de la voiture et me dirige rapidement vers le 30bis allée des Acacias. L’ordre de mission mentionne un portail vert. Je le trouve sans difficulté, il est à demi ouvert. Je me faufile dans le jardin et enfile mon masque. À chaque fois, celui-ci change. Aujourd’hui, il représente Peter Pan, la dernière fois c’était Merlin l’enchanteur. Encore une invention du patron. Dimitri m’ouvre la porte et là, je découvre une pièce en désordre. Quelques meubles sont renversés, leur contenu dispersé. Un homme est assis sur le divan, une ecchymose sur la joue droite. Immédiatement, je lui présente un document, doublé d’une reconnaissance de dette qu’il ne regarde même pas. Sa réponse est directe.
— J’ai pas d’argent.
En aucune manière, je ne peux m’apitoyer. Ma tâche est simple : prendre des garanties. Je ne qualifie pas mon travail d’abject, car ce sont eux ou moi. Ils me permettent de vivre confortablement et d’assouvir mon addiction aux jeux, mais je dois les briser et les contraindre.
— Que proposez-vous ?
Je vouvoie mes victimes par principe. Lui reste silencieux et une claque violente le fait tressauter. Sa joue gauche se marque des doigts de Dimitri. Il perd de son arrogance. La peur s’installe, elle se lit dans ses yeux. Je vis ces situations avec fatalisme, tentant de les réduire au maximum, en temps et en intensité. La feuille toujours tendue, je l’agite. Il baisse le regard et contre toute attente, se met à pleurer. Ses sanglots m’indisposent, je n’en laisse rien paraître. Une casserole d’eau lui fouette le visage et douche sa crise. Il reste hébété à nous regarder tour à tour. Dimitri a un masque de Mickey et Edmond celui de Donald. La vision de ces gaillards à têtes de héros enfantins est pathétique. Le ridicule le dispute au sordide.
La scène n’a que trop duré. Je fais un signe à mes compagnons et l’individu, terrifié, met ses mains en protection. Il pare ainsi deux coups et s’effondre en boule. Reste maintenant à trouver un arrangement. Nous avons affaire à un nouveau client, redevable d’une somme conséquente. La garantie doit être à la hauteur. Finalement, il me remet un tiers de la somme et s’engage à rembourser le solde sous un mois, résultat inespéré d’après l’ordre de mission qui prévoyait une résistance plus importante. Tout s’est idéalement passé et je m’apprête à terminer l’intervention, satisfait.
Sans un regard à mes acolytes, je quitte le pavillon en soupirant. Ceux-ci concluront l’affaire avec les menaces d’usage pour préserver la discrétion de notre venue. Simple routine et deux ou trois gifles plus tard, le calme retombera sur la maisonnée. Je regagne mon véhicule, la conscience en paix. Seule l’image du gamin dans son lit d’hôpital vient parasiter mon humeur badine. Le chemin du retour se fait à vitesse réduite.
Après la première entrevue avec mon patron et mon consentement forcé, je n’ai pas eu de nouvelles pendant deux mois. Puis un matin, il m’a convoqué. Convoqué est le terme imagé pour traduire l’ordre que j’ai reçu. Je me suis rendu à la même adresse et il était là, dans un élégant costume, bien évidemment taillé sur mesure. Cette observation aurait pu me faire rire, mais sa présence n’y incitait guère. Coiffé d’un borsalino, il avait tout du gangster. Il m’a reçu courtoisement comme on reçoit un lampiste, c’est-à-dire sans même avoir à le rabaisser, en individu de seconde zone. J’ai appris que j’étais officiellement son employé même si je ne connaissais pas encore mes attributions. Il m’a parlé salaire, chiffres qui pour moi ne correspondaient à rien de concret. Pêle-mêle, il m’a édicté quelques règles qu’il a qualifiées de simples. Je ne devais jamais discuter ses ordres ni chercher à les comprendre, et constamment appliquer les consignes.
— Tu es trop bête pour prendre des initiatives, argumenta-t-il.
Il a fait apporter une bouteille de bourbon, a servi deux verres, m’en a tendu un, a trinqué avec moi et d’un ton détaché a dit :
— C’est la première et la dernière fois que nous buvons ensemble.
Il l’a vidé d’un coup, m’a invité à en faire autant et a ajouté :
— Si tu es réglo, tu ne le regretteras pas.
La voie rapide vers le bassin est anormalement embouteillée. La soirée est bien entamée et le cas n’est pas banal. Nous roulons au pas, un accident vient visiblement de se produire. Instinctivement, je dévie ma route et m’engage sur les routes secondaires. Mauvaise idée, beaucoup d’automobilistes semblent avoir pris la même décision.
Finalement, après plusieurs détours, je range ma voiture devant chez moi. J’ai le sentiment du devoir accompli, mais je n’arrive pas à être serein ni satisfait. Le pauvre gars que l’on a un peu secoué n’y est pour rien, son existence m’importe peu et seul m’intéresse l’argent que je peux lui soutirer. Je reconnais que je suis injuste et totalement partial. Je n’accorde aucune circonstance atténuante aux mauvais payeurs, moi qui en suis justement un. Cette constatation m’arrache un sourire.
Derrière ma petite maison, sur un carré d’herbe rarement tondu, un pin a éprouvé des difficultés à grandir. Il a mis longtemps à étaler ses branches résineuses et à atteindre une taille respectable. Enfant, j’y construisais des cabanes en installant des planches sur sa ramure maigrelette. J’étais Robinson sur son île, Ivanhoé dans son donjon, Davy Crockett à Fort Alamo. J’étais plein de rêves, débordant d’imagination. Parfois, je me demande ce qu’est devenu le petit garçon d’antan. Alors il m’arrive de m’asseoir en tailleur à même le sol et de regarder jouer pendant des heures le bambin que j’étais. Je ne doute pas de son avenir radieux. Il s’amuse, encore insouciant, sans se douter que je l’observe à travers le temps, avec envie et tendresse.
Il est vingt-trois heures quarante et j’erre dans mon jardin. Comme souvent, je tente de faire un point sur ma vie. Les années ont passé, je n’ai rien construit. Pudiquement, je m’accorde toutes les indulgences du monde. Faible dans les décisions, je le suis aussi dans l’effort, car jamais au grand jamais, je n’ai eu d’objectifs tangibles. Depuis que je suis adulte, il me manque un projet, celui qui pourrait motiver mon intelligence et me permettre de m’extirper d’un terne destin. La destruction me guette, j’en suis conscient. Je jette rageusement une pigne de pin en direction des nuages. Elle atterrit au loin, au milieu du champ de derrière. Je la perds de vue, mais perçois le son mat de sa chute. Une question saugrenue tourne dans mon esprit. Mon neveu aimerait-il jouer sur mon arbre ? Les paroles dures du médecin me reviennent en mémoire : « Son pronostic vital est engagé. » Pourtant il m’a parlé. Il était blême et fatigué, il semblait faible, mais il m’a parlé.
Machinalement j’ouvre la boîte aux lettres. Depuis fort longtemps j’en ai perdu la clé. Deux factures, quatre publicités, le magazine municipal et une lettre grand format la saturent. Les factures m’indiffèrent, les publicités et le magazine rejoignent la poubelle et la lettre grand format m’intrigue. Elle est à en-tête d’une étude notariale. Je la décachette et cherche la lumière. Je suis contraint de rentrer. J’imagine que cette correspondance est en lien avec le décès de mon frère. Je souris en pensant que je pourrais hériter de lui, mais son fils est son légataire.
L’étude est installée à La Roche-sur-Yon. Le clerc de notaire, le signataire, m’invite à venir récupérer quelques affaires du défunt. Longuement, je lis et relis cette lettre impersonnelle et d’une froideur extrême.