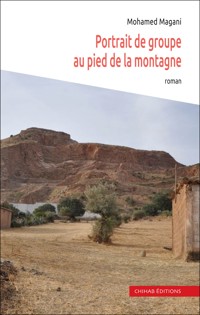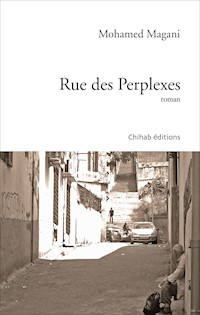Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un Etrange chagrin se veut comme reflet de l’évolution de la société algérienne depuis la décennie noire, société meurtrie dans sa chair et dans sa conscience, jusqu’aux temps présents traversés en profondeur par la quête de la moralisation du social et du politique.
Le roman s’attache aux pas d’un homme, Sefwane, dévasté par la disparition tragique de sa fille, la veille de son mariage. Les causes du drame lui échappent. Dans ses tentatives de comprendre, il se rapproche d’une femme aux convictions bien arrêtées, Rania, qui refait surface dans sa vie, et lui prête main forte dans la poursuite des hommes tenus pour responsables du malheur de sa famille, et sa détermination à prouver au monde entier que sa fortune n’a rien d’illicite ni d’amoral. Il est bien au fait des fortunes miraculeuses, fables vivantes, dont l’origine reste obscure, et de ce qui se chuchote et se colporte parmi ses connaissances et d’autres cercles plus larges. Une certaine politisation de ces fables se diffuse dans la société et pervertit les relations humaines.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Mohamed Magani est né à El Attaf. Auteur de romans (en français) et de nouvelles (en anglais), il parcourt le monde et s’inspire de ses voyages dans ses textes. Mohamed Magani vit à Alger et enseigne à l’Université.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UN ETRANGE CHAGRIN
Mohamed Magani
UN ETRANGE CHAGRIN
roman
CHIHAB EDITIONS
Du même auteur
- La Faille du ciel, roman,Enal, Alger/ Éditions Publisud, Paris, 1987.
- Esthétique de boucher, roman, Enal, Alger, 1990.
- An Icelandic dream, nouvelles, Éditions Ijtihad/Epigraphe, 1994.
- Histoire et sociologie chez Ibn Khaldoun, étude, OPU, Alger, 1995.
- Enseignement primaire, où en sommes-nous ? Etude, Éditions Ijtihad, Alger, 1996.
- Un temps berlinois, roman, Éditions Publisud, Paris, 2001, Éditions Casbah, Alger, 2014.
- Le refuge des ruines, roman, Éditions Barzakh, Alger, 2002.
- Une guerre se meurt, roman, Éditions Casbah, Alger, 2004.
- Scène de pêche en Algérie, roman, Éditions Dar El Gharb, Oran, 2006.
- La Fenêtre rouge, roman, Éditions Casbah, Alger, 2009.
- Rue des perplexes, roman, Éditions Chihab, Alger, 2013.
- Please pardon our appearance whilst we redress the window display, nouvelles, Enag, Alger, 2014.
- Quand passent les âmes errantes, roman, Éditions Chihab, Alger, 2015.
- L’Année miraculeuse, roman, Éditions Chihab, Alger, 2018.
© Éditions Chihab, 2021.
www.chihab.com
Tél. : 023 15 67 08 / Fax : 023 13 75 55
ISBN : 978-9947-39-407-6
Dépôt légal : novembre 2021
Centrée sur le mur de l’arrière-façade plongée dans une ombre immuable, pendait une outre gonflée d’eau attachée à une tige de fer. Elle suintait de gouttelettes paresseuses sur une large soucoupe en métal et à bord plat. Chiens et chats errants, oiseaux, rats, serpents et scorpions assoiffés venaient, à l’abri des regards, tour à tour se désaltérer à ce point névralgique devenu, dès les premiers jours du plein été, source intarissable par la volonté de son père, veillant au quotidien à étancher la soif de toutes les créatures de Dieu, de passage,ou connus dans les environs. Jamais, fit Sefwane,un membre de sa famille n’avait été mordu ou piqué. Cet homme mourut, pleuré par son mulet qui se détourna de l’alimentation et le suivit dans l’au-delà peu après. Sefwane jura avoir vu la bête verser des larmes.
Un mois avant le mariage de sa fille, Sefwane lui raconta ce bout de passé qui ne parlait pas de temps reculé. Le souvenir avait soudain surgi du fond des tendres années de sa propre enfance.
L’humanité du grand-père émut la fille. Il continua à égrener les souvenirs de son enfance et constata qu’ils la détendaient, lui procuraient des moments de répit devant les appréhensions et les incertitudes de sa nouvelle vie toute proche. Les souvenirs personnels épuisés, il divergea vers les contes et légendes entendus de la bouche des grands-parents, parents et adultes de la famille élargie. Les jours filaient ; il en restait à peine une dizaine avant les noces de sa fille ; elle montrait des signes d’anxiété. Sefwane songea alors à toutes ces fables contemporaines, glanées à gauche et à droite autour d’un café, parmi ses amis ou des inconnus affirmant connaître leurs protagonistes. Objets de discussions fréquentes, familières à l’issue des sanglantes années 90, ces histoires contemporaines, qui se faisaient contes de fées, se diffusaient parmi la société comme un ultime baume sur les blessures d’une décennie noire. Il commença par la suivante :
Dans un hameau perché sur un piémont, un homme et sa femme menaient une vie des plus misérables. Une cahute au toit de chaume et murs de tourbe leur servait de lieu d’habitation et un âne leur assurait la subsistance. L’homme utilisait l’animal pour le transport payant de marchandises, à la demande. Leur possession se résumait à ce moyen de survie en fait. Un soir d’avril, trois individus, armés jusqu’aux dents, vinrent donner de grand coup de pied à sa porte et le sommèrent de sortir. Se précipitant dehors, il surgit devant eux, la peur au ventre et le regard affolé. Il savait que rien de bien ne pouvait arriver de ces visites survenant à toute heure du jour comme de la nuit : elles semaient dans leur sillage tueries, terreur et misère. Il fut vite rassuré cependant ; on ne lui voulait pas de mal et on ne lui demandait pas de payer quoi que ce soit. Les trois hommes visaient son animal. Il leur fournit l’âne et son bissac dans lequel les visiteurs fourrèrent six grands sacs en plastique noir et s’évanouirent aussitôt dans la nuit tombée. Muet de peur, sans le moindre soupçon de curiosité, il s’empressa de se terrer chez lui. Informée, sa femme se posa bien des questions sur le contenu des sacs. L’homme ne put décrire que leur grand volume et les cordelettes les fermant. Il ne revit plus les trois hommes ; ils s’étaient évaporés à jamais. L’âne, lui, revint au bercail le lendemain aux premières lueurs de l’aube, avançant dans un champ de blé à l’abandon, au milieu de floraisons printanières sauvages, le bissac et les sacs sur le dos, sous le regard ahuri de son propriétaire.
Le contenu des sacs plongea l’homme et sa femme dans une profonde sidération mêlée de joie et de crainte. Des paquets de mille dinars cascadèrent des sacs renversés. L’homme et la femme eurent la sagesse d’enterrer le magot dans un trou creusé à l’intérieur de la pauvre cahute et l’oublièrent. La sécurité revenue, leur vie se transforma du rien au tout. Ils bâtirent une grande maison et achetèrent les terres aux alentours. L’âne de son côté eut droit à une grange de luxe pourvue de maintes commodités tels qu’un chauffage et un climatiseur. Il avait trimé à leur service exclusif comme bœuf et âne réunis.
Tous les autres contes merveilleux nés de la guerre civile, la contribution de l’âne en moins, mettent en évidence l’enrichissement spontanéde gens simples suivant une séquence événementielle unique. Des hommes armés se présentent chez quelqu’un, de préférence effacé, honnête et sans histoires, lui remettent des sacs-poubelles noirs bourrés de billets de banque et de bijoux, fruits du racket et de la rapine au nom de Dieu, et l’obligent à les garder jusqu’à leur retour, un jour indéterminé. Nombreux parmi les détenteurs de sacs ne reviendront plus, tués, tombés dans des embuscades ou lors d’accrochages avec les forces de sécurité. Les receleurs malgré eux ne les reverront plus. Ils garderont le silence sur le butin en leur possession et en disposeront quand le juste exercice de la patience leur paraîtra avoir atteint sa limite. Bénéficiaires d’une manne tombée du ciel, l’argent et les bijoux leur assureront une existence dans l’aisance.
La rumeur les nommait. Sefwane cita des noms à sa fille surprise d’entendre ceux de trois familles de sa connaissance, comptant des amies parmi celles-ci, mais en même temps indignée de savoir que ces dernières devaient leur fortune aux hommes de sacs et de cordes, doublés de croyants aux convictions mortelles sur les frontières infranchissables entre le bien et le mal. Le père acquiesça de la tête. Elle lui dit son bonheur d’être au sein d’une famille menant une vie confortable et dénuée de suspicion de vol ou de malhonnêteté. Sefwane secoua la tête de nouveau, le visage baignant dans un total assentiment. Il n’oublia pas de la rassurer sur son avenir immédiat : elle allait rejoindre une famille honorable, à l’abri du besoin, aisée bien avant l’avènement de la guerre civile et ses fables. L’avenir lui offrait d’exaltantes possibilités.
Sa fille, Yesma, pouvait rêver de tout ce dont une fille de dix-huit printemps pouvait rêver. Au premier chef, un futur époux, d’une année plus âgé, conciliant et ouvert à ses projets d’avenir. En accord avec lui, elle avait opté pour l’université de la vie d’abord et serait libre de reprendre ses études de biologie quand elle le souhaiterait. Un sujet la passionnait par-dessus tout : la préservation de l’abeille saharienne, l’espèce étant menacée par l’introduction de l’abeille tellienne dans son habitat naturel. Etonnante abeille saharienne ! Elle peut parcourir jusqu’à 8 km à la recherche du jujubier cependant que la tellienne peine à atteindre les 3 km. Son jujubier à elle, Yesma, ne sera pas l’argent facile, et, de son avenir sera exclue l’attente d’un âne bâté, porteur d’un trésor du plus beau conte merveilleux de la guerre civile. Son père approuva sa résolution et lui raconta la toute dernière histoire de la série des fables des temps conflictuels, celle qui les clôt, les dépouille du merveilleux et fait intervenir des puissances au-dessus des forces de l’homme. La femme d’un riche repenti monté au maquis au nom de la foi puis redescendu plein aux as et converti à l’affairisme religieusement modifié, lui demande de leur réserver un hammam à eux deux, seuls. L’argent ouvre et ferme toutes les portes. Une fois nus dans la salle chaude, elle lui demande deux cents dinars, à lui remettre sur-le-champ. D’évidence, il ne peut s’exécuter et dit ne pas avoir sa veste sous la main. La femme exigea la somme, insistant devant son mari médusé. En fin de compte, elle lui dit : « Au Jugement dernier, c’est comme ça que tu te présenteras devant Dieu. Tu n’auras rien, rien sur toi. » Ainsi, Sefwane acheva-t-il le cycle de la terreur et de la richesse associées par un rappel de la justice divine. Ce jour-là, il avait ensuite pris l’album-photos de la famille et commencé à le feuilleter, Yesma à ses côtés. De cliché en cliché, ils relevaient des détails drôles ou insolites, évoquaient leur contexte, puis Yesma posa le doigt sur une photo où elle apparaissait, un léger sourire flottant sur le visage. Pensive mais sereine, son regard pénétrant fixait un point au-delà de l’objectif de l’appareil, quelque chose d’imperceptible. Elle reposa le doigt sur la photo et dit : « Quand je serai morte, c’est cette photo que je voudrais que tu gardes de moi. »
Il n’eut pas le temps de réagir, de saisir même les propos de sa fille. Les deux fidèles amies de Yesma venaient d’arriver, à la même heure que la veille et les jours d’avant, depuis le début de l’année universitaire. Elles avaient entamé leurs études de biologie et sans doute, rapportaient-elles à Yesma les faits saillants de leur nouvelle expérience d’étudiantes. Sefwane entendaient les trois jeunes filles rire aux éclats, et personne dans la maison n’osait les déranger ou s’immiscer dans leur rendez-vous, sauf pour leur apporter gâteaux et fruits. Tandis qu’il décollait avec précaution la photo de sa fille de l’album, il nota ce jour-là un silence inhabituel dans sa chambre. Il dura trois bons quarts d’heure. A peine lui parvenait-il le murmure des voix étouffées. Les deux visiteuses réapparurent enfin et se dirigèrent vers la sortie, silencieuses et l’air grave, plutôt pressées de quitter les lieux. Yesma demeura dans sa chambre. Sefwane emboîta le pas à ses deux amies. La photo dans la poche, il entendait la faire agrandir et encadrer pour ensuite lui trouver une juste place dans le salon, ou l’accrocher à un mur du couloir. De même, il en ferait une plus petite à glisser dans son portefeuille.
Lorsqu’il revint de chez le photographe, Yesma n’avait toujours pas quitté sa chambre. Il frappa à sa porte et entendit sa fille crier presque : « Je veux rester seule ! » Indécis, il patienta devant la porte, le temps de voir sa femme lui indiquer de la main de la rejoindre dans la cuisine. Elle ne comprenait pas, fit-elle, Yesma ne voulait voir personne. Et cela, à coup sûr, devait avoir un lien avec la visite de ses deux amies. Elle refusait aussi l’entrée de sa chambre à ses deux frères. Sefwane rassembla sa famille pour une conférence au sommet : en aucun cas ils ne devaient contrarier sa fille. On était à une petite semaine de la fête et rien ne devrait transpirer du comportement anormal d’une fille en passe de se marier.
Les amies de sa fille revinrent deux jours plus tard, passèrent moins d’une demi-heure dans sa chambre puis prirent congé avec la même hâte, le visage empreint d’une sombre gravité. Yesma persistait dans son isolement, comme prise d’une soudaine envie de se dissocier de sa propre famille. Elle évitait tout contact et refusait d’ouvrir sa porte à quiconque, refusait de manger et de changer de tenue. L’éventualité du mariage suspendue, l’incompréhension amplifiée, l’inquiétude gagna la maison et oblitéra tout signe, manifestation ou indication de préparatifs d’une fête imminente. Elle installa un malaise palpable entre ses occupants et les voisins venus les aider et partager leur joie.Les deux étudiantes réapparurent une dernière fois. Les trois filles s’enfermèrent plus longtemps que lors des précédents huis clos dans la chambre. Sefwane revint chez lui peu après leur départ, le portrait de sa fille sous le bras, enveloppé dans du papier-cadeau, et une photo d’elle, plus petite, dans son portefeuille. Sa femme stoppa net sa précipitation à vouloir montrer à Yesma la grande photo encadrée. Elle le dirigea vers leur chambre, ferma la porte derrière eux et le mit au courant des derniers développements concernant le mariage de Yesma. Le visage livide de douleur, elle s’efforçait de parler avec calme. Les jambes cisaillées, Sefwane se laissa choir sur le bord du lit, au bord de l’évanouissement. Il se prit la tête entre les mains, comme pour hurler.
« Le mariage n’aura pas lieu, ni dans une semaine ni jamais », dit sa femme. L’annonce de la catastrophe, vraie ou fausse, elle la tenait des amies intimes de sa fille. L’ex-futur mari de Yesma avait pris l’irrévocable résolution de ne pas se marier, sans donner d’explication. Il avait d’abord annoncé la nouvelle à leurs deux amies communes, les étudiantes en biologie qui rendaient de fréquentes visites à Yesma. Chargées de transmettre sa décision à cette dernière, elles avaient, en premier lieu, tenté de lui faire changer d’avis, de le sensibiliser au mal qu’elle subirait, elle et sa famille. Leurs trois derniers passages chez la future mariée, elles les avaient faits en messagères engagées dans une situation d’ores et déjà tranchée par une partie, tant le jeune homme écartait toute possibilité de revenir sur sa décision. Sefwane reprit ses esprits, puis, posément, récapitula les faits comme pour convaincre une autre personne, incrédule. Sa femme lui répéta les dires des étudiantes. Elle les avait cueillies à leur sortie de la chambre et suppliées de lui expliquer pourquoi Yesma se cloîtrait, ne parlait à personne, sauf à elles. Celles-ci eurent toutes les peines du monde à lui révéler la brutale vérité, l’annulation du mariage, sans pouvoir l’expliquer.
Les deux parents quittèrent leur chambre et marchèrent droit vers celle de leur fille. Ils la trouvèrent assise à même le sol, le corps et les épaules blottis dans un coin à gauche de l’entrée. Le désespoir exsudait de son visage. Ombre d’elle-même, elle leva des yeux éteints sur ses parents. Fantôme d’elle-même, elle portait une ample robe de chambre blanche qui la drapait tel un linceul. Sefwane et sa femme l’aidèrent à se relever et l’allongèrent sur le lit. « Nous sommes au courant », dit-il. Yesma éclata en sanglots. « A quelque chose malheur est bon, dit sa mère, tu peux reprendre tes études. Tu as tout le temps pour le mariage. » « L’année est perdue », répliqua Yesma. Plus d’un trimestre s’était déjà écoulé. Ses deux frères accoururent et apprirent aussitôt le malheureux retournement de situation survenu dans la famille. Sefwane voulut savoir si quelque chose, une querelle, un événement, un malentendu, une faute, avait opposé les fiancés. « Rien, absolument rien », soutint sa fille. Un silence pesant enferma les présents dans la gêne, voulant tout dire de leur désarroi et de leur abattement. Le père se força au silence bien qu’il fût tenté d’avancer des doutes sur l’annulation du mariage puisque la famille du garçon n’avait rien annoncé de tel.
Le lendemain, dans l’heure après le petit-déjeuner, il reçut confirmation de l’impensable volte-face du garçon par la bouche de son père qui l’appela au téléphone et se confondit en mille excuses et pardons : il ne comprenait pas l’attitude de son fils, devenu du jour au lendemain farouchement hostile à l’idée du mariage. L’homme s’enquit également du sort à réserver à la dot et enchaîna sur la restitution des bijoux. Sefwane raccrocha à l’instant même et proféra un juron ; il ne voulait plus avoir affaire à lui ou à sa famille. « Les bijoux paieront le prix de l’humiliation subie », songea-t-il. Les appels à la restitution du lot de bijoux et de la dot se poursuivirent en vain, se heurtant au dédain et à l’inflexibilité de Sefwane, au bout du fil, mais surtout à celle de sa femme. Il avait du mal à admettre l’impuissance du père à influencer son fils et à le contraindre au mariage. « Famille honorable ! », où l’ex-futur marié s’apprêtait à prendre les rênes de l’entreprise paternelle. Sa fille et leur garçon se fréquentaient depuis le lycée et tout le monde connaissait leur relation discrète et les considérait comme mari et femme avant l’heure. La rupture, la veille du mariage, fut-elle l’œuvre de leur fils, ne pouvait émaner de lui seul, sans l’injonction ou le consentement du chef de famille, ou à son instigation.
Restait à savoir le pourquoi de l’annulation. Sefwane passa en revue les reproches que pourrait lui adresser le père du garçon. Les deux hommes se connaissaient et s’appréciaient, prenaient de temps à autre un café ensemble, discutaient de leurs affaires et se soutenaient au besoin, d’une manière ou d’une autre. La fusion des deux familles se précisait et se consolidait à chacune de leurs rencontres. Sollicité pour des interventions, Sefwane faisait jouer ses connaissances. Appelé à donner son avis et à arbitrer, il s’était toujours rangé du côté de son ami, sans manquer de lui révéler ses torts en aparté. Et à sa famille ? Que pouvait-il trouver à redire à son sujet ? Sefwane s’en ouvrit à sa femme qui lui dit d’oublier toute l’histoire et de penser à l’avenir de ses enfants. Il ne put se résoudre à accepter les faits et s’enferma chez lui, ruminant le funeste coup du destin qui frappait sa famille. Quand il n’était pas auprès de sa fille, essayant de la distraire, il passait le plus clair de son temps dans sa chambre, prétendument occupé à lire la masse de journaux apportés par l’un ou l’autre de ses garçons.
Penché sur les pages, il se rappelait aussi qu’il avait été enseignant de dessin au niveau du primaire, éprouvant du plaisir à guider des petites mains, dans un temps pas si reculé. Il se souvenait de ses collègues : certains avaient abandonné l’enseignement quand l’école du village était partie en fumée, d’autres s’étaient accrochés et avaient délivré leurs cours dans des baraquements improvisés. Il appréciait leur compagnie, dans une bourgade qui communiquait si peu avec le monde, dépourvue de lieux de rencontres, hormis deux cafés. Ils se confiaient leurs rêves, le sien consistant à verser dans la colombophilie, à élever des pigeons voyageurs sur le faîte de la montagne surplombant le village. Dans le cercle familial, sa fille Yesma avait un penchant pour l’abeille saharienne. Lui, deux décennies avant elle, nourrissait l’ambition de sortir son village de l’isolement grâce aux colombes. Fille et père gardaient au fond du cœur un espoir de servir une cause sans rien attendre en retour.
Première manifestation d’un camouflage social, Sefwane se cloisonnait chez lui le jour. La conspiration de l’humiliation, du silence des membres de sa famille, du regard des voisins venant aux nouvelles, le contraignit à s’enfermer. Elle avait pénétré l’air et l’eau de la maison. Il sortait le soir une heure ou deux dans une capitale où l’absence d’une vie nocturne s’accordait parfaitement avec son esprit tourmenté par la douloureuse infortune de sa fille. La gestion de ses affaires marqua un brusque arrêt : il n’avait plus le cœur à organiser des réjouissances dans la salle des fêtes lui appartenant. Au bout d’une dizaine de jours pénibles, il informa sa famille de son prochain voyage au village natal. Simple inspection de leur première maison familiale, lieu de naissance de Yesma et d’un premier garçon. Il comptait également y faire de petites réparations, s’il y avait lieu, de lui enlever toute apparence d’une maison abandonnée et d’empêcher la rouille de dévorer les verrous. La veille de son départ, il conversa matin et soir avec Yesma, s’ingéniant à la convaincre de l’accompagner. Elle resta dans l’expectative de longues heures, avant de lui déclarer son envie de demeurer à Alger et de réfléchir à d’autres chemins dans la vie. Sefwane prit ses paroles pour une attitude positive et se garda d’insister.
Se mettant à l’ouvrage dès son arrivée, il s’attaqua au ménage par le lavage et le dépoussiérage des surfaces horizontales et verticales, à l’aide d’eau savonneuse, de chiffons, de brosse et d’éponge. Il enduisit ensuite les meubles d’encaustique pour leur donner du brillant. A quatre heures de l’après-midi, il prit place dans un fauteuil et put contempler le travail accompli trois heures durant, d’une seule traite. La maison se composait du seul rez-de-chaussée, et c’est tant mieux, se dit Sefwane. Il n’aurait pas eu la force de continuer dans une habitation avec un étage ou plus, à l’instar de la plupart des nouvelles constructions du village ou d’ailleurs : toutes en R+ avec garage détourné en local commercial. Sa maison ne perdrait ni son cachet traditionnel ni les repères connus de sa famille. Il brancha la télévision et s’accorda un petit somme, l’écran invisible et le son à peine audible ayant une influence reposante sur lui depuis des années. Il attendit la tombée du soir pour sortir, et cette nouvelle habitude, il ne savait quand il allait pouvoir s’en extraire. Lors de ses retours précédents, sa coutume consistait à rejoindre le cercle de ses amis d’enfance, enseignants, employés de la mairie et de la poste, juste après le grand nettoyage de la maison. Cette fois-ci, une accablante indécision le poussait à retarder leur rencontre.
L’obscurité lissa de noir les dernières pâleurs du jour. Sefwane évita les rues familières et marchait, les pensées dominées par l’atmosphère d’abattement laissée derrière lui, à Alger. Il ne pouvait en être autrement. Le sujet du mariage annulé sourdait des murs et du plafond. Il en sera ainsi durant tout le temps à venir, craignait-il, l’épreuve que sa fille traversait avait terni une belle perspective à laquelle elle avait cru en toute innocence. Sefwane se révolta : « Yesma est jeune, moins de vingt printemps ! Il suffit de changer de quartier d’habitation à Alger pour lui faire reprendre pied sur terre. Tous les membres de sa famille doivent s’y mettre : solidaires, ils créeront la joie et l’envie de bonheur autour d’elle. L’éclipse totale de l’espoir dans sa vie n’est qu’un instant éphémère. Elle gagnera en confiance et le temps jouera son rôle de grand guérisseur ». Un instant la poitrine gonflée d’une bouffée d’espoir, il se mit à chanter la bouche fermée le long d’une rue déserte. Un air de fête, « les Compagnons de la poudre », que diffusent par haut-parleurs les salles dédiées aux célébrations de mariages, « S’hab el baroud » sur lequel dansaient sa fille et ses amies quand elles prenaient part aux réjouissances. La chanson s’éteignit à l’approche d’une épicerie, sans doute la dernière à rester encore ouverte. Sefwane voulait du fromage et des pots de yaourt. A sa grande surprise, il tomba, à l’intérieur, sur une vieille connaissance. Les deux hommes ressortirent en égrenant des souvenirs d’enfance et d’adolescence au rythme de leurs pas. Puis, l’ami du village le mit au fait de la venue d’un inconnu d’un certain âge qui s’était renseigné sur lui, avec discrétion, à peu près une quinzaine de jours auparavant. Sefwane montra un étonnement de façade, devinant tout de suite de quel inconnu il s’agissait : le père de l’ex-fiancé de sa fille, sinon de son envoyé missionné pour une tâche particulière.
La belle-famille se devait de mener à son sujet une enquête prénuptiale dans son lieu de naissance et celui de ses parents, approche classique afin de parer à toute mauvaise surprise et visant à s’assurer de la bonne réputation de l’autre parti dans la nouvelle alliance des familles. Sefwane, de son côté, était passé outre cette étape préliminaire, car la première et dernière impression sur le père du beau-fils lui avait suffi pour se forger une opinion favorable. Le second fait le concernant, cette nuit au village natal, le plongea dans une perplexité inquiète, semblable à un sommeil agité et persistant.
Selon l’ancienne connaissance rencontrée à l’épicerie, une deuxième vague des fables de la guerre civile, moins fertiles en « merveilleux », s’était répandue suite à l’apparition de l’inconnu. La rumeur quantifiait les bénéficiaires des mannes tombées du ciel qui payèrent de leur vie leur refus de rendre le magot. Dans son cas, les gens se demandaient d’où lui étaient venus les moyens d’ouvrir une salle des fêtes à Alger. Le village en comptait déjà trois, en attendant la suite. Sefwane se contenta de souligner la source cristalline de ses fonds, sans aller au niveau des détails, connus des amis et des voisins, « et de tous », se dit-il. Les révélations s’interrompirent ; l’homme rencontré à l’épicerie regarda sa montre et prit congé, pressé de regagner son foyer. Sefwane continua son chemin, persuadé de ne plus croiser d’autres connaissances en raison de la règle générale du rentrer chez soi tôt le soir. Pareillement à la capitale, villes et villages du pays s’imposaient la barrière d’une sorte de couvre-feu mental qui attend son franchissement pour tourner de fait la page de la décennie noire. Il poussa ses pas à la limite du village, tandis que, depuis des années, se formait et s’étendait le brouillard artificiel causé par la poussière des nombreuses carrières d’agrégats implantées sur une vaste dorsale de la montagne si proche.
Tout autour, les choses et les formes devenaient fluides, irréelles, se dispersaient. Sefwane atteignit les dernières bâtisses, bien au-delà de l’ancienne décharge publique creusée dans un cratère profond, au temps d’avant retenue d’eau désaltérante pour les humains et les animaux. Il retourna à l’exact endroit d’où, dans l’ombre d’un mur, une certaine nuit de l’année 2000, il avait aperçu une masse sombre avancer derrière une ombre mouvante. Il revit la scène comme le déroulement d’un film noir. L’absolu secret enclos dans les ultimes et impénétrables replis de son existence venait de prendre naissance.
Il était tard, une heure avancée de la nuit même. La forme noire rase les murs sur le côté opposé de la ruelle. Elle traîne avec peine quelque chose de lourd par terre. Clairement, elle évite, ou fuit rapidement, les points si peu illuminés pourtant par des pylônes électriques rares en bordure du village. Un moment, le pâle clair de lune ou la lumière blafarde révèlent distinctement une femme et le gros sac en plastique noir derrière elle. Ses cheveux sont lâchés sur ses épaules couvertes d’un voile blanc ouvert comme des ailes. Sans doute, considérant l’improbabilité de croiser quelqu’un à une heure si tardive, n’a-t-elle pas jugé nécessaire de se couvrir la tête et le corps. Sefwane voit une femme jeune ; elle se hâte dans la lumière et s’arrête dans le noir, sans relâcher le col du sac. Il peut se dire combien la masse noire est pénible à déplacer, tant ses efforts lui arrachent de petites plaintes sourdes.
La silhouette de la femme courbée se rapproche. Sefwane se fige, ses mains dans les poches serrent ses cuisses, comme pour empêcher son corps de trembler. La femme n’a pas conscience d’une présence qui l’observe. Elle marque une pause après avoir tiré le sac au prix d’un effort éreintant, souffle un instant et se relève pour faire le geste de serrer le voile autour de sa taille.
A cet instant précis, son regard se pose sur l’homme surgi de l’obscurité. Sefwane s’avance vers elle, elle recule de deux pas. « Ne craignez rien, dit-il, je veux simplement vous aider ». Elle demeure silencieuse, le corps raidi sur place. « Non ! Non ! », fait-elle enfin, une certaine peur panique dans la voix. « Où voulez-vous porter ça ? », insiste Sefwane. Il s’est déjà penché sur le sac et s’empare de son col en le torsadant un peu plus. Ce faisant, il constate que ce sont deux sacs, l’un dans l’autre. Elle tente, sans conviction, de le lui reprendre puis indique du doigt, résignée, la décharge publique à un jet de pierre de la dernière maison du village. Le poids du sac intrigue Sefwane. Il le traîne avec lenteur, et au bout d’une vingtaine de mètres, s’arrête pour soulager son dos. Il redresse son corps, desserrant sa main autour de la cordelette du col qui s’ouvre comme une vanne forcée. Ce qui en sort lui glace le sang : un bras humain roule à ses pieds.
Ses deux petits enfants dormaient chez ses parents, avait dit la femme. Elle dirigea Sefwane vers la cuisine et l’invita à s’asseoir. Il ne la quittait pas des yeux, comme s’il craignait pour sa vie. Sous la lumière crue de la lampe au plafond, elle lui apparut d’une splendeur inouïe, réplique de la beauté idéale à n’en point douter. Saisi d’une soudaine capacité à s’ouvrir à une passion sans limite, il se dit néanmoins qu’il se trouvait peut-être sur le lieu d’un crime. Il jeta un lent regard circulaire et nota la propreté régnante, puis s’entendit poser la question de quelqu’un de réveillé mais encore sous l’emprise du sommeil : « Par où avez-vous commencé à le démembrer ? » – « Par la nuque, bien sûr », répondit-elle. Elle fixa Sefwane dans les yeux. Son regard pénétrant lui fit l’effet d’une lame aiguë fendant sa chair. Avant de commencer le macabre récit de son meurtre commis de sang-froid, elle tint à clarifier son mobile d’emblée : elle avait tuéle meurtrier de son mari et de son jeune frère.
Elle continua. Une nuit d’un hiver rigoureux, un homme vient frapper à leur porte. Son mari et son frère, invité pour quelques jours de vacances, sortent à sa rencontre. Derrière les volets fermés de la fenêtre, elle entend son mari et l’inconnu parlementer. Le ton de celui-ci monte tout à coup, il réclame quelque chose. Elle l’entend distinctement, la voix de l’inconnu. Son timbre singulier la fait penser à un chien féroce attaché tout près de la basse-cour des voisins. Cette voix, elle s’en rappellera à jamais ; elle devient carrément hystérique. Des coups de feu retentissent. Pétrifiée, elle attend angoissée quelques secondes, puis se jette vers la porte. Son mari et son frère succombent à leurs blessures sous ses yeux, avant l’arrivée des secours réticents à répondre aux appels la nuit.
L’inconnu revient à la charge quelques mois plus tard. Il fait nuit ; elle ne lui ouvre pas et lui demande ce qu’il veut. « Un sac en plastique noir », réplique-t-il de sa voix reconnaissable entre toutes, confié à son mari. Elle ne l’a pas vu mais elle va le chercher dans la maison. Elle lui demande de revenir deux jours plus tard, à la même heure. Le matin suivant, elle envoie ses deux enfants chez ses parents,se déplace dans la grande ville voisine où elle achète le plus puissant somnifère en pharmacie et quatre grands sacs-poubelles noirs dans une quincaillerie. Les couteaux, coutelas et hache, elle en a dans sa cuisine. A l’heure H, l’assassin de son mari et de son frère se présente chez elle. Elle fait mine de ne pas le reconnaître. Ravissante en tenue suggestive, elle le fait entrer et lui sert un premier grand verre d’une bouteille de limonade édulcorée d’une bonne dose de somnifère, puis un deuxième, puis un troisième, tout en entretenant la conversation sur le sac qu’ils vont tous les deux chercher en fouillant la maison de fond en comble. Ils ont tout le temps. Le reste est une mécanique bien réglée. Il sombre dans une profonde léthargie, les bras ballants et le visage affaissé sur la table. Elle lui enfonce plusieurs coups de couteau dans le dos, visant le cœur, et entreprend de le décapiter d’abord avant de découper les parties de son corps.
Quand Sefwane l’avait surprise, elle en était à son second « voyage » en direction de la décharge publique, proche de sa maison. « L’homme est grand et pèse lourd », dit-elle en achevant le récit de son meurtre avec une confondante sérénité. Elle changea abruptement de sujet et une voix nommée mélodie emplit la tête de Sefwane. Il se contenta d’écouter encore, le regard caressant le visage lumineux de la femme. « Il mérite son sort », fit-il, les idées tendues plus vers le rêve que le cauchemar.
Un léger sourire s’ébaucha sur le visage de la femme.
Il sourit à son tour.
— Puis-je vous demander votre nom ?
Elle parut hésiter.
— Oubliez tout, oubliez cette nuit, oubliez Rania ; nous ne nous sommes jamais rencontrés, fit-elle d’un trait, le dos droit sur sa chaise, les yeux rivés sur lui.
Au deuxième jour de son retour au village, Sefwane ressentit un empressement à retrouver ses amis d’enfance comme à l’accoutumée, les uns, le matin au café, les autres, le soir après le travail. Leur cercle s’était sensiblement agrandi au fil des ans, les hommes de sa génération devenant tous plus ou moins des connaissances de longue main en réalité. La majorité était au courant de la venue de l’inconnu menant une discrète enquête sur lui et sa famille. Personne ne semblait au courant de l’annulation du mariage de sa fille et de la marche arrière du fils d’un ami. Cela évita à Sefwane d’avoir à fournir des explications sans perdre la face, sinon à en inventer les plus crédibles possible, sans en faire tiquer quelques-uns. Un petit nombre devina la raison de l’apparition de l’inconnu au village. « Normal, estimèrent-ils, s’il s’agit d’une enquête prénuptiale ». Les autres notèrent son insistance à connaître les origines de l’aisance financière de Sefwane. Sur ce point, la moitié jugea n’être pas en mesure de répondre, l’autre moitié l’attribua naturellement aux gains de la salle des fêtes. La plupart du temps, les conversations viraient sur un fait concomitant : la réapparition des deux anciens associés de Sefwane. Ils avaient quitté le village depuis longtemps, vers la même période que lui, ils y revenaient de loin en loin. Eux aussi semblaient jouir d’une vie confortable, au vu de leurs véhicules haut de gamme et de leur allure générale. Leur arrivée, le même jour, soulevait bien des interrogations.
Plus étrange, le retour de Sefwane coïncida avec une deuxième vague de fables nées dans les derniers soubresauts de la guerre civile, moins fertiles en miracles cependant. Auparavant, le ruissellement des richesses venues du ciel avait cessé et les enrichissements spectaculaires avaient intégré la normalité des choses et des miracles à peine croyables.A présent, d’épais nuages noirs survolaient certains quartiers du village dans le sillage des histoires faites contes de fées qui prenaient des tours plus sombres. L’on disait que les propriétaires des sacs en plastique noirs revenaient par groupes récupérer leurs biens, mal acquis, cela va sans dire. La rumeur circulait comme de la fausse monnaie. Elle jeta la suspicion et la méfiance entre les hommes. L’anxiété se lisait sur les visages. L’argent prit soudain la couleur du sang et l’odeur des cadavres putréfiés. La mémoire des tueries et des massacres se raviva. Y être associé, de près ou de loin, revenait à signer sa propre exclusion de la communauté du village. Des receleurs de sacs furent battus, deux ou trois perdirent la vie en raison de leur refus de les rendre, les plus coriaces émigrèrent en famille, en toute hâte, vers les grandes villes du pays avec l’espoir d’effacer leurs traces.
La synchronicité de l’annulation du mariage, de la réapparition de ses deux ex-associés et de la résurgence des comptes à rebours, rendait l’atmosphère de son retour malsaine. Sitôt les salutations et les mots de bienvenue expédiés, les propos échangés revenaient sans cesse sur les ex-associés et les menaces sournoises sur les « saigneurs » et profiteurs de la guerre civile, entendre par là, les receleurs de trésors amassés à leur corps défendant d’innocentes victimes terrorisées. Une cellule maligne ternissait les idées de Sefwane, il ne pensait plus qu’en sentiments. Peu à peu, l’envahit la nette impression de perdre, aux yeux de tous, sa considération sociale et morale, qu’on le dépouillait du respect auquel il avait droit, surtout à l’approche de la cinquantaine. De tous les côtés lui parvenaient des signaux inamicaux et désobligeants. Il vécut la journée comme une mise à l’index déguisée, une conspiration ourdie par des ennemis invisibles. Incapable d’en supporter davantage, il retourna à son domicile bien plus tôt ce jour-là. Quand il en ressortit, il alla droit chez son ami d’enfance le plus proche, habitant juste à côté.
Une touchante histoire le liait à Lekhell, ou plutôt celui-ci à sa mère. Adolescent rebelle, Lekhell refusait toute forme d’autorité. Son père le mit à la porte, ne tolérant plus son agressivité à l’égard des membres de la famille, mère, frères et sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines. A l’époque, toutes les maisons du village possédaient une cour où trônait un four à pain en argile d’où émanaient les senteurs de la pâte cuite sur un feu de branchettes et de bouse de vaches séchée. Elles embaumaient les environs, chaque coin et recoin, et incitaient les habitants à consommer le pain chaud. A l’heure du déjeuner, chassé de la maison, Lekhell errait sans but, tenaillé par la faim. Il marchait le long des façades arrière des habitations quand il aperçut la mère de Sefwane en train d’enfourner des pains ronds. Elle était seule dans la cour. Elle acheva l’opération et disparut à l’intérieur de sa maison en tirant la porte derrière elle. Lekhell attendit une demi-heure puis enjamba la petite haie de broussailles délimitant la cour et se dépêcha d’ôter au four son bouchon de terre et de tissus. Il s’empara de deux pains, referma l’ouverture et quitta les lieux sans bruit.
La mère de Sefwane imputa la disparition des deux pains à « ces gens d’ailleurs », âmes errantes ou êtres surnaturels qui lui signalaient leur existence et leur faim, jusqu’au moment où elle apprit la vérité, rapportée par son fils. Lekhell avait réintégré le giron familial et avoué son « crime » à son ami, des semaines plus tard. Au grand étonnement de Sefwane, à dater de ce jour et jusqu’à sa mort, sa mère ajoutait un sixième pain à sa fournée habituelle et le chargeait de le remettre à Lekhell à l’heure du déjeuner. Le pain quotidiennement offert, l’ami d’enfance ne l’a jamais oublié. Aussi, manquait-il rarement de l’évoquer et de le rappeler à Sefwane lors de leurs rencontres. Cette petite histoire aurait mérité de figurer parmi toutes celles relatées à Yesma. Elle savait si peu de sa grand-mère. Elle devrait inaugurer un nouveau cycle au moment où sa fille vivait les affres de l’annulation de son mariage. Suivront d’autres, complémentaires des contes, fables et événements accordant une large place aux femmes, femmes courageuses, femmes généreuses, femmes égales des hommes dans le bonheur et la souffrance. Sefwane songea à acheter un pain rond traditionnel dans la première boulangerie et à l’offrir à Lekhell, ce qui serait une demande implicite d’anecdotes et d’événement connus de ce dernier au sujet de sa mère. « Chasseur d’histoires » : son nouveau rôle de père se profilait dans les profondeurs de son cœur blessé.
Au lieu d’acheter le pain, il demanda à son ami, sitôt en sa présence, s’il avait chauffé le four de sa maison aujourd’hui. Lekhell comprit l’allusion, serra très fort Sefwane dans ses bras et le fit entrer sans tarder. Tous deux savaient que les fours traditionnels appartenaient au passé désormais. Lekhell pourrait jurer qu’il n’en restait plus un seul au village. Retenu à dîner avec insistance, Sefwane put finalement aborder les sujets de l’heure dont il avait eu des échos dans la journée. En son for intérieur, le sentiment d’être l’unique cible de la rumeur grandissait. Il craignait qu’elle ne salisse à jamais sa réputation et son honneur. Le lien de cause à effet avec « l’affaire » de sa fille gagnait en évidence, alors que Lekhell paraissait insister sur la simultanéitéde l’arrivée de l’inconnu en quête d’informations et le retour du merveilleux qui, antérieurement, n’avait tué personne, mais incitait maintenant au crime dont sera coupable, sous appellation officielle, le « terrorisme résiduel ». Sefwane détestait l’idée d’une relation quelconque avec l’islamisme affairiste et autres fraternités de croyance en un Dieu argent prospérant sur l’entassement de cadavres. La rumeur abondait en révélations macabres, atteignant un niveau de détails comparable au pic des atrocités que les « saigneurs » de la guerre faisaient subir à leurs victimes au cours de la décennie noire. Bien plus, elle élargissait la liste des contes de l’horreur dans la bouche de Lekhell et ne semblait point en arriver au bout. Curieuse époque, fit-il, où les parenthèses d’enchantement s’ouvrent et libèrent l’odeur du sang.
Les richesses dérivées des fables nourrissaient un imaginaire collectif en piteux état et mettaient en lumière le désarroi et l’inquiétude de Sefwane. Le propos de son ami embrassait leur époque, effaçait la frontière entre passé et présent, dessinait des perspectives crépusculaires. Lekhell se mit à énumérer les victimes de leurs connaissances auxquelles Sefwane se surprit intérieurement à ajouter le prénom de sa fille. L’annulation du mariage de Yesma lui semblait remonter à sa naissance qui se trouve être aussi le point de départ de sa fortune, frappée de suspicion à présent. En aucune manière il ne chercha à détourner le sujet, ce qui poussa Lekhell à se répéter plus d’une fois, ou en tout cas à trouver de nouveaux mots à ses dires. Peu à peu, ses intuitions négatives trouvaient confirmation dans les silences même de son ami. Sefwane les saisit comme une incitation à s’expliquer, à démentir le semblant de fable que l’on tissait à son sujet.