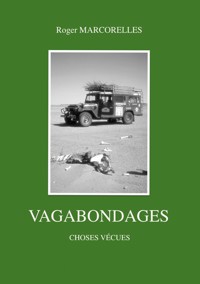Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cet auteur enthousiaste se souvient avec humour et émotion de sa jeunesse d'après-guerre en Occitanie, à l'aube d'un siècle de transformations sociétales irréversibles. Il nous dépeint avec talent et passion son apprentissage de la vie dans un cadre provincial peuplé des souvenirs de ses ascendants. Son récit est émaillé de nombreux témoignages insolites ou étonnants qui ont marqué son existence et alimenté une curiosité insatiable. Il nous fait le tableau d'une éducation d'une autre époque, à l'aube d'un monde nouveau voué à un modernisme sans appel. À travers un chapelet d'anecdotes vécues, il développe en esthète le récit savoureux de ses premières prises de risque jusqu'aux canulars de sa vie d'étudiant d'avant mai 68.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Note de l’auteur.
Bien qu’il ait toujours été classiquement convenu que l’histoire d’une vie ne pouvait se raconter que de manière chronologique, j’ai essayé de respecter autant que possible cette tradition au début mais j’ai dû m’en affranchir pour certains chapitres afin d’assurer une meilleure lecture en regroupant quelques thèmes plus généraux.
Chaque chapitre de cette collection d’anecdotes peut donc se lire séparément et dans le désordre sans en altérer la compréhension.
REMERCIEMENTS
À Étienne et Paulette, mes parents qui m’ont appris à vivre avant qu’il soit trop tard et que je n’ai pas assez remercié
TABLE DES MATIERES
UNE JEUNESSE DU SIÈCLE DERNIER
AUX ORIGINES
Aux origines
Mon monde contemporain
Arrivé au bon moment
Escalade périlleuse
Premier bon mot
Première angoisse
Découverte de l’électricité
Les galoches
Les Annamites
L’odeur de la Salmson
UNE ENFANCE SÉTOISE
Vision d’apocalypse
Autres temps, autres mœurs
Les odeurs de maison
Prisonniers de l’armoire
Le carton à découper
Déjà contestataire
Le trottoir
Les balancelles
Les charrettes longues
Les baraquettes
Mises à mort
Le seau hygiénique
Le fantôme
Naissance d’un doute
Le lait maternel
Douce France
Communication non verbale
Pas vu, pas pris
La promenade du dimanche
Tableau d'honneur
La quête à la messe
Terreur muette
L’appel des profondeurs
Les dauphins
Bêtise humaine
Escapade sur le toit
Les peilharots
La menace du Gabès
Le bagne d’Aniane
Le service militaire
Paul Valéry contre Victor Hugo
Les closcs
L’odeur de sainteté
Le bateau d’Étienne
Périls en mer
Mon regret éternel
UNE JEUNESSE MONTPELLIÉRAINE
De Sète à Montpellier
La parenthèse du Pompidou
L’occitan de mon enfance
Racanel le justicier
Le miracle de la télévision
Le vin des Molinier
La valse des étiquettes
Le mur de la peur
Le massacre des rats
Mes incisives
Les carrières de la citadelle
La rampette de l’esplanade
Le chemin des écoliers
Le collège Michelet
Le chiotte des profs
Le petit train de Dubout
Le goût des jardins défendus
Aux origines du camping
Débuts sous la terre
La durée du temps
Fêtes gitanes
Les cardeurs de matelas
La plage de la Corniche
Chez Pépé Alexandre
Chasse à l’étang
Noyer le phare
L’argent de poche
Fuite par les toits
Le cambrioleur
Pulsion
L’accident d’avion
La pendule
Le poste à galène
La bande du Plan Cabanes
Premier sevrage
PREMIERES PERIPETIES AVENTUREUSES
Les parachutistes en herbe
Les jeunes explorateurs
L’aqueduc de nuit
Le conseil de révision
Le stand de tir du père Vida
Le taureau piscine
Poil au menton
Madame Z
Ma Mémé s’en est allée
Deuxième sevrage
L’Algérie ratée
Les ratonnades
L’O.A.S.
Manitas et l’Aragon
Règlement de compte
PLAISANTERIES D'ETUDIANTS
Le folklore de l’atelier
Le vol du balustre
À la poursuite du beau
Bizutages
Nuit au resto-U
La façade Louis XIII
Le bateau du concierge
La bombarde
Les malheurs de Ducon
Victimes collatérales d’un génocide
Les culottes de la grosse Bertha
Un squelette au SAMU
Débordements au Lac des Rives
MA VIE PARISIENNE
Entre Montpellier et Paris
Voyage de tout repos
L’auto-stoppeuse
La roue de ma Katchevo
Le convoi militaire
Le sharpy en charpie
Camping au quartier latin
Le ventre de Paris
Les égouts de la capitale
L’aventure des catacombes
La seconde vie de Suzy
L’écrivain Russe
Le piano de l’École
La craie sur le trottoir
La maquette du diplôme
AUX ORIGINES
Aux origines
Aussi loin que je puisse remonter dans le temps par la pensée, contrairement à Spinoza, j’ai toujours cru qu’au commencement était le « Rien », un gigantesque « Rien », un « Rien » dont l’énormité serait incontournable. Pendant la longue période où je n’étais encore qu’en devenir dans les limbes, avant que ma mère ne m’expulse en marquant ainsi le début de mon histoire, il existait forcément une préhistoire, ma préhistoire. Lorsque je découvris le principe indiscutable de causalité je compris que ce quelque chose d’avant mon début, c’était la saga de mes ancêtres. J’en étais l’issue et très provisoirement le dernier maillon. C’est ce que m’apprenait la généalogie. Lorsque j’ai vu le jour, les dizaines et les dizaines de pères de mes pères m’avaient déjà précédé sur plusieurs centaines au moins de générations. J’étais consterné d’apprendre que je n’étais pas tout neuf. Je n’étais que la terminaison temporaire d’une très longue série d’adaptations successives à un environnement fluctuant et la plupart du temps hostile.
Lorsque, émerveillé, je suis apparu à la lumière, c’était beaucoup trop tard pour faire leur connaissance. Ils avaient, dans leur grande majorité, disparu depuis longtemps de la surface de la terre sans laisser aucune trace. Et pourtant, j’étais là, moi, le fruit de leurs étreintes. J’étais l’aboutissement d’une longue chaîne de caractères dont chacun d’eux m’avait laissé quelques zygotes en héritage génétique. J’étais le résultat achevé d’un véritable mesclun de spermatozoïdes dont l’agencement m’échappait et les origines dépassaient mon entendement.
J’ai très rapidement eu une idée de ce que pouvait être l’infini lorsque je me suis livré au calcul de mes ascendants potentiels. À raison de deux personnes, un père et une mère, pour créer un individu, elles-mêmes précédemment générées par quatre autres personnes qui avaient été engendrées à leur tour par huit ancêtres, puis seize et ainsi de suite, prenait forme la réalité d’une suite mathématique en pyramide inversée qui n’avait plus rien d’abstrait. En faisant le calcul à rebrousse-poil et à raison d’une génération en moyenne tous les trente ans, le nombre de mes ascendants doublant à chaque génération, on arrivait ainsi au nombre astronomique de mille milliards d’ancêtres pour chacun d’entre nous du temps de Charlemagne. À une époque où la fourmilière mondiale ne dépassait pas 300 millions d’individus selon l’estimation des historiens compétents ; c’était impossible ! Il y avait un truc ! Certains étaient forcément comptés plusieurs fois et constituaient ce que les généalogistes ont appelé des implexes. La seule conclusion à en tirer, c’est qu’à notre niveau nous étions obligatoirement tous des cousins plus ou moins éloignés issus d’un ancêtre commun.
Toute ma jeunesse, je me suis intéressé à l’archéologie, à toutes les manifestations d’activité humaine laissées sur le terrain par tous ceux qui, j’en étais sûr maintenant, étaient de ma lointaine famille. Lorsque j’avais en mains un artefact néolithique, j’en comprenais l’usage et la nécessité comme si c’était ma propre survie qui devait en dépendre. C’était en fait la vérité car si mon ancêtre n’avait pas survécu, ne serait-ce que le temps d’être apte à copuler et à se reproduire, je ne serais pas là aujourd’hui. Quelle chance !
Cette réflexion se perdant dans les méandres infinis d’un passé difficile à toucher du doigt, j’ai choisi, en vieillissant, de ne m’intéresser qu’aux plus proches de moi, ceux pour lesquels je pourrais trouver des traces plus tangibles de leur passage sur terre. Qu’avais-je reçu en héritage de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils ont vécu ?
En remontant d’archives en archives j’ai réussi à retrouver leurs traces inscrites dans les registres de l’état civil puis dans ceux des paroisses et chez les tabellions des lieux où ils avaient existé. J’ai même avec une grande émotion déchiffré la signature maladroite de leur nom au bas des actes de ceux qui n’étaient pas complètement illettrés. En remontant les échelles du temps, j’ai vu ainsi défiler des familles entières de paysans et d’artisans essentiellement de souche rurale. J’ai su de quels villages ils venaient, dans quelles conditions ils s’étaient mariés et avec qui. J’ai appris à quel âge ils mouraient et parfois de quoi, quels malheurs avaient fondu sur eux en emportant des quantités innombrables d’enfants en bas âge et de femmes en couches. J’ai retrouvé leurs testaments donnant avec précision leurs dernières volontés de chrétiens, leurs actes de vente et de donation, les contrats de mariage qui énuméraient leur petit patrimoine et décrivaient l’état des trousseaux des jeunes promises. J’ai touché du doigt leur vie quotidienne. C’était comme si je les avais vus de mes propres yeux.
Avec cette machine à remonter le temps, j’ai franchi allègrement l’époque de la Révolution française pour entrer dans l’ancien régime et fouiller le tout début du XVIIème siècle quand Louis XIII n’était encore qu’un enfant régenté par sa mère. Au-delà, vers l’amont, je cherche encore car les sources des familles modestes sont de plus en plus difficiles à dénicher.
J’ai pu ainsi déterminer avec certitude que les derniers que j’ai connus vivants, c’est à dire mes grands-parents descendaient tous de familles rurales méridionales. J’étais donc un pur produit occitan, j’aurais pu être labellisé bio. Du côté de ma mère les origines étaient lozériennes et catalanes et du côté de mon père aveyronnaises et héraultaises. Tous étaient issus de hameaux et de villages de campagne et la plupart de leurs parents étaient cultivateurs, ou tout simplement avaient exercé l’obscure profession de brassier ou de journalier, ceux qui n’avaient qu’à louer la force de leurs bras à la journée suivant les opportunités saisonnières. Les exceptions d’une catégorie sociale plus élevée étaient rares. Parmi les métiers exercés j’ai trouvé aussi quelques dynasties de boulangers et de maçons ou plâtriers, parfois de maréchaux-ferrants. Les femmes elles, lorsque leur activité était précisée, étaient dites ménagères ou cultivatrices. Les plus évoluées pouvaient être domestiques, lingères ou même repasseuses, quelquefois couturières.
Cette plongée dans l’histoire de mes racines m’a autorisé à être content de mon sort et à apprécier les progrès humains et sociaux accomplis jusqu’à moi. Elle n’est pas si lointaine que cela l’époque où la plupart des femmes de ma famille non seulement n’avaient pas appris à écrire mais n’avaient droit à la parole que le jour où, devenues veuves, elles dictaient leur testament après avoir donné la preuve de leur asservissement à la religion. Mais tout n’est pas à jeter. À voir comment vivaient mes ancêtres j’ai pris de bonnes leçons de patience, de bon sens et de sobriété.
Et puis un jour, accidentellement, j’ai réussi à franchir un cap dans ce déroulement de l’histoire à contre-courant. Je ne sais pas pourquoi ni comment avait eu lieu cette mésalliance mais je me trouvais confronté en 1724 à un ancêtre tailleur d’habits à Saint Guiraud ayant épousé une « de Lauzières » de Corneilhan descendante perdue de plusieurs longues lignées de noblesse française. J’en étais donc issu par les textes, la réalité des alcôves pouvant être toute autre comme chacun s’en doute. Et c’est là que s’est déclenchée une ouverture subite. J’étais passé de la petite histoire locale à la grande histoire nationale. Les généalogies nobiliaires ont l’avantage d’avoir été étudiées et triturées par de nombreux historiens à partir de traces écrites dont ne bénéficiait pas le vulgum-pécus. La remontée des branches se fit alors comme autrefois quand je grimpais aux arbres, avec agilité. Je vis alors défiler les Adhémar de Grignan, les de Monteils, les d’Argental, les Baderon de Maussac, les de Grave pour remonter jusqu’au haut moyen-âge du temps des Guilhem de Clermont-Lodève puis des Capétiens, des Francs, des Huns des Wisigoths et des Mérovingiens. Parmi eux de nombreuses célébrités telles que Charles de Herstal dit plus simplement Charles Martel, Hugues Capet, Galla Placidia et son père Théodose empereur des romains.
J’en passe et des meilleurs me prouvant ainsi que l’immense puzzle sur lequel je m’étais modestement penché me prouvait que mes calculs statistiques du début étaient exacts. Parvenus au XXIème siècle, tous nos contemporains ne sont plus qu’une immense et unique famille.
Mon monde contemporain
J’ai débarqué dans l’Histoire en cours de route et la marche du monde n’a pas été affectée pour autant. Elle a été aussi bancale après, qu’avant. Protégé par le cocon familial dans lequel je baignais quotidien-nement, j’ai commencé petit à petit à prendre conscience qu’au-delà de cette bulle de confort, il existait tout un monde étranger. Autant qu’il m’en souvienne, ma première notion de ce monde extérieur s’est focalisée autour de la guerre. Bien qu’au début cette notion ait été encore un peu abstraite pour moi, elle servait de référence à la survenance de tous les évènements. Ils étaient étalonnés en « avant » « pendant » ou « après » la guerre. Et encore ne s’agissait-il que de « la dernière ». J’appris un peu plus tard qu’il y en avait eu trois successives contre un même ennemi : l’ogre allemand.
Les comptines des cours de récréation, qui ont été mes premières chansons apprises par cœur, ne faisaient qu’exalter un patriotisme aveugle en même temps qu’elles distillaient une haine du « boche ». Dès l’école maternelle elles nous inculquaient l’idée que nous étions les meilleurs. Les ennemis de la France n’étaient que des métèques indignes. Les histoires récurrentes que me racontaient mes grands-parents dès mon plus jeune âge étaient celles des affrontements les plus récents et les plus proches. Elles relataient essentiellement les exploits des maquis qui avaient fleuri dans les montagnes autour du lieu où je suis né. Une guerre contre la guerre en quelque sorte. En tout cas, il en ressortait nécessairement une moralité selon laquelle les Français étaient l’instrument vengeur du bon droit.
Dans les premières images des journaux qui me tombaient sous les yeux, je voyais peu de scènes de ruines et de désolation ; je ne les découvris que par la suite. Ce que je parvenais confusément à comprendre, c’est que des hommes noirs en redingote et chapeau haut de forme qui s’appelaient des hommes politiques, s’étaient réunis quelques années avant que je ne sorte du néant, pour décider que les autres devaient mourir en leur déclarant la guerre dans l’enthousiasme général de la population. Bon, c’est pas tout à fait comme ça que ça s’est passé peut-être, mais c’est en tout cas ce que j’en ai retenu ! Et puis il y eut un déluge de fer et de feu mais j’étais alors encore bien à l’abri dans les gonades de mon père.
Les faits marquants du monde dans lequel je venais de mettre les pieds, se situaient donc dans le registre des conflits armés qui secouaient la planète. C’est ainsi que j’entendis parler ensuite de l’Indochine (1946-1954) comme d’un lointain pays de cauchemar où des gens tout jaunes et aux yeux bridés se faisaient un plaisir d’inventer des supplices plus sordides les uns que les autres. On n’avait pas attendu l’invention d‘Internet pour que les Fake-news se propagent à bon train. Puis il y eut la Corée, presque en même temps (1950-1953), mais là nous n’étions pas partie prenante et puis ça se déroulait encore plus loin. Nous n’étions que spectateurs ou presque pour la bonne raison que l’émoi suscité par l’Indochine avait déjà submergé l’opinion publique jusqu’à la saturer. Elle se sentit moins concernée par ce conflit étranger. À peine la Corée avait-elle été coupée en deux que les « évènements » d’Algérie montraient leur nez et faisaient parler d’eux dès mon entrée au collège pour nous occuper au point d’occulter le début de la guerre du Viet-Nam où les Américains s’embourbèrent de 1955 à 1975.
Bref, le monde situé au-delà de mon horizon immédiat n’était fait que de plaies et de bosses. J’étais encore incapable de me douter que tous ces déploiements de force, de haine et de violence n’étaient d’aucune utilité pour résoudre les problèmes qu’ils étaient censés régler dans le sang. Cela, je ne l’ai compris que beaucoup plus tard en m’intéressant aux leçons à tirer de l’Histoire. En somme, toute ma jeunesse, j’ai été persuadé par l’exemple que la guerre était un passage obligé car seul le combat armé avait la vertu de résoudre les antagonismes, même au prix fort, comme nous l’avait appris ce brave La Fontaine avec son loup et son agneau.
Il aura fallu des dizaines d’années et plusieurs changements de génération pour que mes contemporains comprennent que l’état de guerre n’est un état ni normal, ni obligé. Et je me demande encore si tout le monde l’a bien compris ! C’est à désespérer de la nature humaine qui dans son ensemble confond toujours les moyens à mettre en œuvre avec les buts à atteindre. C’est dans cette marmite que je suis tombé en venant au monde.
Arrivé au bon moment
J’étais fier comme un paon le jour où j’ai découvert cette magnifique coïncidence de dates. Si mes calculs sont exacts, né un 14 novembre 1942, j’ai été conçu à Lodève neuf mois plus tôt soit le 14 février 1942, jour de la Saint Valentin. Je n’étais donc pas le fruit du hasard mais le résultat d’une heureuse combinaison de circonstances. C’est chaque année le premier jour de beau temps au sortir de l’hiver, celui qu’ont toujours choisi les oiseaux pour commencer à s’apparier. C’était aussi le cas de mon père qui venait d’être libéré depuis le 3 septembre précédent du camp de concentration de Bockholt en Westphalie. En tant que prisonnier de guerre, son hiver à lui, avait consisté à passer deux ans de captivité en Allemagne dont les derniers mois en section disciplinaire pour avoir été repris après deux évasions. Les cinq mois qui suivirent sa libération lui avaient été nécessaires pour se remettre d’une santé chancelante mise à mal par les restrictions alimentaires qu’il avait subi dans les camps. Il pesait 35 kilos à son retour de chez les teutons. J’ai retrouvé au dos d’une photo de famille, les annotations de l’évolution de sa reprise de poids notées scrupuleusement jour après jour par ma mère.
Pour qu’il puisse physiquement tenir le coup pendant son enfermement, elle lui faisait parvenir de temps à autres un colis d’engrais phosphaté, qu’on utilisait alors pour engraisser les cochons, judicieusement dissimulé dans des boites de savon en poudre. Les surveillants allemands, obnubilés par l’hygiène et les maladies laissaient passer ces colis sans se douter qu’ils pouvaient avoir un véritable usage nutritionnel. Ses aventures vécues en captivité, qu’il a eu souvent l’occasion de me raconter par la suite, lui avaient forgé une mentalité à l’épreuve des balles. Tous ses souvenirs de l’aspect sordide de cette période subie de force s’étaient peu à peu estompés pour ne laisser la place qu’au seul côté anecdotique ou humoristique de ces situations souvent dramatiques.
Ma mère, elle, toute jeune institutrice sortie en 1935 de l’École Normale d’Instituteurs de Montpellier, occupait son premier poste dans l’Éducation Nationale en remplacement à l’école secondaire de Lodève. Après deux guerres mondiales et en ces temps d’incertitude, c’était combler de joie ses parents que d’entrer dans un corps de fonctionnaires. Leur rencontre, m’ont-ils dit, s’était faite dans une cantine populaire où les quelques célibataires étrangers à la localité se retrouvaient pour déjeuner ensemble tous les jours à midi. Mon père, après avoir travaillé chez Ferté-Boissier à Montpellier, dans une usine qui fabriquait des lits d’hôpital, venait d’entrer à Lodève à l’usine de filature Teisserenc et Harlachol et exerçait alors la profession de dessinateur industriel. Auparavant il avait pendant un an prêté main forte à son père à la pâtisserie familiale de Frontignan, place du monument aux morts (de la guerre précédente). Il en gardera toute sa vie une certaine passion pour la cuisine.
Mariés à Sète en août 1938 et lui, mobilisé dès septembre 1939 pour partir au front trois ans après la fin de son service militaire dans les chasseurs alpins, leur vie de tourtereaux avait été de courte durée. Juste le temps de communiquer à ma mère son amour pour la montagne à l’occasion d’un voyage de noces dans le Briançonnais, sur les lieux de ses aventures militaires. Ma naissance allait attendre pendant quatre ans encore avant de pouvoir être envisagée
Escalade périlleuse
Jusqu’à quand peut remonter ma mémoire ? Mes parents ont quitté la ville de Lodève pour venir habiter à Sète alors que je venais tout juste d’avoir quatre ans. Et pourtant, je vois très nettement encore quelques images de ma vie à cette époque antédiluvienne. Avec le temps, certaines photos ou certains récits peuvent servir de support à une carence de mémoire et aller jusqu’à donner l’illusion du vécu en direct. Moi, il me reste des images fortes d’instants palpables comme une série d’éclairs que je serais incapable de remettre dans un ordre chronologique précis mais qui se sont immortalisés avec une précision incroyable. Ce sont pour la plupart des instantanés très nets liés à des sensations fortes qui ont dû impressionner ma sensibilité naissante. Je n’ai donc plus que quelques fragments d’images dans mon souvenir mais j’ai si souvent entendu raconter certaines anecdotes par mes proches que je n’ai jamais perdu l’impression de ce que j’avais réellement vécu.
Mon père qui était chasseur comme tout homme digne de ce nom à cette époque d’après-guerre, possédait un furet qui l’aidait à traquer les lapins jusqu’au fond de leurs terriers. Cet animal carnassier et cruel vivait dans une cage mais était pour moi l’équivalent vivant d’une peluche que j’arrivais à cajoler en toute impunité. La bête sauvage et le petit d’homme étaient unis par une complicité animale qui dépassait tout l’entendement de mes proches. J’étais le seul à pouvoir le toucher sans me faire mordre. Un jour où je jouais avec lui dans l’appartement, il s’est échappé et a sauté se mettre dans la galerie du buffet Henri II de la cuisine. J’essayais de le suivre en grimpant sur les barreaux de ma chaise haute placée à côté puis progressais à quatre pattes sur la galerie d’où il s’enfuit en sautant sur le rebord de la fenêtre ouverte toute proche. Il faut dire que nous habitions au 20 rue Basse, au deuxième étage sur le quai. C’est à ce moment-là que ma mère est entrée dans la cuisine et s’est figée en me voyant prêt à passer à mon tour sur l’appui vertigineux de la fenêtre. Avec une lenteur mesurée, pour ne pas me communiquer sa frayeur, elle s’est approchée de moi pour me récupérer de justesse. Quand elle se remémorait cet instant elle affirmait que cette traversée de la cuisine en quelques pas avait été la plus longue randonnée de sa vie.
Premier bon mot
Je crois avoir hérité de mon père un certain amour de la dérision qui peut même aller chez moi jusqu’à l’autodérision. Dans ma petite tête d’enfant, je croyais que tous les coups pouvaient être permis pourvu qu’ils fassent rire. Sans comprendre tout à fait le sens de certaines histoires, je voyais les grandes personnes se gondoler à l’écoute des pépites des fins de repas de fêtes. Les adultes de la génération de mes parents avaient un vocabulaire infantilisant lorsqu’ils s’adressaient aux larves qu’étaient les petits enfants. C’est avec force simagrées et mimiques qu’ils voulaient comiques et à l’aide de papouilles sur le cou ou sur le ventre qu’ils me traitaient fort affectueusement de voyou de bandit ou de canaille. C’était pour eux attendrissant et ce vocabulaire détourné aimablement de son sens véritable, était pour moi celui de l’enfance en l’absence de tout élément trivial de comparaison.
Fort de cet enseignement, je décidais malencontreusement un jour d’en faire de même alors que les circonstances ne s’y prêtaient absolument pas. Ma courte expérience de la vie ne m’avait pas encore apporté un minimum de faculté de jugement. C’était un dimanche en période de campagne électorale et le maire sortant de Lodève, qui tenait absolument à sa réélection, avait mis son plus beau chapeau et pratiquait avec délectation sur l’esplanade le « toque-manettes » auprès des passants qui, bien entendu, le connaissaient tous de réputation. Arrivé devant mes parents et après les formules d’usage en la circonstance, ma mère se tourne alors vers moi et me demande : « Tu dis bonjour à monsieur le Maire ? »
- « Bonjour canaille ! » lui rétorquais-je innocemment en croyant faire un bon mot.
Première angoisse
Mon vécu me permet aujourd’hui d’affirmer qu’il y a une vitesse subjective d’écoulement du temps qui est à coup sûr exponentielle en fonction de notre âge. J’en ai pour preuve l’attente interminable que j’ai subie à l’âge de trois ans.
Le modeste appartement que mes grands-parents maternels occupaient pendant la fin de la guerre était situé en face de celui de mes parents, de l’autre côté du pont. C’était pour ainsi dire ma deuxième maison. La cuisine paysanne servait alors à la fois de séjour et de salle à manger. La notion même de « séjour » n’existait pas encore. Dans une maison, il y avait toujours quelque chose à faire qui rendait inutile un endroit spécialisé consacré à rester assis. Pour toutes les activités, la table de la cuisine faisait largement l’affaire.
Cette pièce, était équipée d’une immense cheminée campagnarde au linteau de bois qui sentait la suie. Elle occupait dans sa totalité tout un côté de cette large pièce. Sur son manteau trônait, hors de portée, le fusil de chasse de mon grand-père, braconnier invétéré. Le foyer était carrelé de terres cuites vernissées au motif brique et bistre en diagonale comme on en voyait partout à cette époque autour des éviers en pierre et sur certaines façades de boucherie pour y exposer le gibier. La faïence blanche était très peu répandue et je suppose qu’elle devait être considérée comme un luxe inouï réservé aux gens de la ville. Le Formica n’avait pas encore fait ses ravages dans nos campagnes.
Lorsqu’on n’y faisait pas de feu, un grand voilage d’un tissu à fleurs aux motifs géométriques un peu art-déco orange et bleu la fermait tel un rideau de théâtre afin d’éviter les retombées d’air froid dans la maison. J’entends encore la musique métallique que faisait le coulissement des anneaux de laiton sur la tringle de fil de fer tendu. Quand un bruit identique me surprend maintenant, l’image de ce rideau se projette une fraction de seconde à l’intérieur de mon front. De même, la porte palière qui ouvrait directement dans cette cuisine était doublée d’une lourde tenture isolante. Ces deux rideaux étaient effrayants pour l’enfant que j’étais car je les croyais susceptibles de dissimuler quelque chose. Quelque chose ou quelqu’un. Celui de la cheminée cachait pour moi tantôt le mystère du père Noël, tantôt la peur que tous les gosses portent en eux d’un quelconque père Fouettard embusqué dans l’attente d’une intervention justicière.
En cette période de restrictions de toutes sortes, pépé et mémé, n’avaient pas pu se procurer de lit d’enfant. Lorsque je dormais chez eux, pépé ouvrait le tiroir du bas de la commode et avec des draps repliés comme matelas, en faisait une couchette à ma taille. Je ne savais pas qu’elle était Louis-Philippe cette commode ; je ne l’ai su que beaucoup plus tard. Mais depuis l’âge de trois ans, j’en ai gardé un souvenir visuel impérissable. C’était du merisier verni, massif pour la lourde moulure galbée du haut qui m’impressionnait tant. Son odeur faite de poussière domestique et de draps frais imprégnés de fleurs séchées de lavande, m’est restée au fin fond des fosses nasales, là où elles atteignent le cerveau. Soixante-dix ans plus tard, je peux encore aller l’y chercher ! Car de ces trois tiroirs superposés qui se coinçaient tout le temps à l’ouverture, celui du bas m’était acquis. C’était le nid de ma résidence secondaire.
Je profitais des après-midi où mes parents m’avaient confié à la garde de ma grand-mère pour explorer déjà tout ce qui était à ma portée. Je n’avais pour tout horizon que des pieds de table, de chaises et des dessous de lits. Je trouvais souvent refuge dans une cabane grillagée entre les barreaux d’une chaise avec sa toiture de paille. Saisi soudain par une envie irrépressible de grimper, j’allais voir un jour ce qui pouvait se passer au-dessus du toit de mon abri. Une fois sur le siège, je découvrais une solide échelle de bois constituée par les barres cintrées de son dossier. En forçant un peu, mes gesticulations m’avaient fait passer la tête, tournée sur le côté, entre ces lattes. Ne pouvant aller plus loin, j’essayais de la retirer, sans résultat. Je restais coincé. J’étais comme un singe la main prise dans une noix de coco. Ma tête était passée tournée sur le côté mais ne voulait plus se retirer en position droite, comme un bouton de duffle-coat. Au retour je me trouvais coincé derrière les oreilles par les lames de bois du dossier.
Affolement de ma grand-mère qui se sentait plus que jamais responsable de ma sécurité. L’immeuble était vidé de ses habitants : tous au travail, personne pour l’aider. Impossible de sortir pour appeler du secours : « Et s’il venait à s’étrangler... ? » Ne voulant en aucun cas risquer de me faire le moindre mal, elle avait capitulé après quelques tentatives infructueuses de dégagement. Rien à faire ! Contraint de regarder en bas, je ne voyais que les pieds affolés de mémé qui tournaient autour de ma chaise dans un mouvement anarchique et perpétuel. Jen’entendais que ses soupirs découragés. Elle ne pouvait décemment pas me ramener à la maison avec une chaise autour du cou. Il n’y avait plus qu’à attendre la sortie de l’usine et l’arrivée de mon grand-père qui lui, saurait trouver une solution pour me sortir de ce piège. C’est ce qu’elle tentait de m’expliquer pour me faire patienter dans cette position d’où je n’avais pour tout horizon que les pavés de tomettes rouges du sol de la cuisine.
Un bruit de pas. En me tordant le cou, je tournais désespérément la tête vers la porte d’entrée, attendant de voir la poignée intérieure pivoter. Oh, que je la vois encore cette porte à deux vantaux avec ses panneaux moulurés, ses baïonnettes en fer et sa poignée en porcelaine noire luisante ! Elle était doublée d’un épais rideau destiné à isoler l’appartement de l’air froid. J’ai dû la voir s’ouvrir dix fois dans mon imagination avant qu’elle ne s’ouvre réellement à l’arrivée du sauveur. À chaque pas dans l’escalier de l’immeuble, un espoir étincelait. « C’est pépé Félix qui arrive, il va te tirer de là ! » C’était lui ? Non, il n’était pas encore cinq heures. Pourvu qu’il rentre tout de suite, qu’il ne rencontre pas une connaissance avec qui discuter en route ? Toutes ces interrogations formulées à voix haute étaient censées me faire patienter mais provoquaient l’effet inverse en ravivant ma contrariété. Tout à coup, un pas lourd qui devait certainement être le sien, sur les marches grinçantes de l’escalier de bois, s’arrêtait sur le palier, là, derrière la tenture de l’entrée, puis repartait dans les étages. À chaque espoir, je me tordais le cou pour regarder ce rideau cramoisi qui allait enfin bouger sous la poussée de pépé. C’est là l’évocation qu’il m’en reste : les tomettes du sol, le tissu du rideau et la vision imaginée de lourdes chaussures de travail sur les marches de l’escalier.
Et tout à coup, en une seconde : la tornade ! Le battant qui s’ouvre en poussant le rideau. Son regard étonné du premier instant se transforme instantanément en farouche résolution. Il se précipite vers moi ses grosses mains en avant. Ces mains qui pour moi étaient et resteront le symbole de la puissance contenue. Plus tard, à Rome, dès que je vis celles du Moïse de Michel-Ange à l'église Saint-Pierre-aux-Liens, je sus que c’étaient les mêmes. Va-t-il me flanquer une beigne ? Les grosses mains de pépé s’élancent vers moi. Fermant les yeux, prêt à tout, j’entends soudain le craquement sec du bois. Il avait saisi les barreaux et les brisait comme des allumettes sans prendre le temps de comprendre ce qu’il s’était passé ni de poser la moindre question à ma grand-mère debout auprès de moi. Je me trouvais aussitôt sur ses genoux, assis sur une chaise sans dossier et désormais bancale. Cet emprisonnement précoce m’avait fait toucher du doigt ce qu’est l’attente, pendant laquelle l’impuissance vous réduit à la patience obligée. C’était déjà une première porte ouverte à la méditation.
Découverte de l’électricité
Dans cette même cuisine, un autre événement formateur devait avoir lieu un peu plus tard. Sur le mur en retour à gauche de l’imposante cheminée, un évier en pierre dont ma hauteur de mioche ne m’a jamais permis de voir la face supérieure, venait jouxter une fenêtre ouvrant sur l’arrière de la maison, du côté de la colline. C’est probablement lors d’une fin de repas, j’entends dans le lointain le ronron des quatre adultes qui bavardent autour de la table. Moi, me dressant le plus possible sur la pointe des pieds j’essaie de voir mon petit bateau en celluloïd flotter dans la cuvette en émail posée sur une petite table devant la fenêtre. Ce produit hautement inflammable, a servi encore longtemps à la fabrication de jouets d’enfants avant d’être interdit. Dès qu’il s’éloigne de moi, de l’autre côté de la mer, sa voile échappe à ma vue remontante et je tourne autour du meuble pour tenter de l’attraper. Tout à leur discussion, mes parents ne s’occupent pas de mon jeu. Je les entends deviser tranquillement pendant mes expériences de navigation. Cramponné à la table, j’ai le nez au ras du plateau. C’est pourquoi certainement cette image reste profondément associée pour moi à l’odeur rance familière du tiroir de ce guéridon où mon grand-père range le morceau de couenne qui lui sert à graisser les lames de couteau pour les préserver de la rouille. L’inox n’a pas encore fait son apparition dans les cuisines modestes.
Chaque fois que mon regard se détourne de la surface des flots, il vient se poser sur un objet ostensible et obsédant fixé au mur, dans l’angle, sous la fenêtre : une magnifique prise de courant en porcelaine blanche, brillante. D’autant plus rutilante que ses deux petits trous sont cernés de douilles de laiton jaune du plus bel effet. Elle me fascine surtout par sa dimension mystérieuse puisqu’il qu’il m’est bien sûr défendu d’y toucher. Ses deux trous noirs côte à côte me regardent comme des yeux ; ils m’hypnotisent.
Quelle idée me traverse subitement la tête en prenant conscience que j’échappe à l’attention des adultes ? C’est le moment idéal pour braver l’interdit et les toucher de mes deux doigts mouillés en même temps. La secousse cinglante et incompréhensible qui suit, en un éclair, a fixé dans mon esprit l’image de cette cuisine mieux que ne l’aurait pu faire une photographie au flash. Quand je reprends conscience, c’est pour voir au plafond les visages blêmes et défaits de mes parents penchés sur moi. Pas la peine de sermon moralisateur, j’avais obtenu immédiatement la punition que méritait ma transgression. Je n’avais plus besoin de comprendre, j’avais ressenti dans ma chair la raison de l’interdit.
Les galoches
Je n’en ai personnellement jamais porté de ces lourdes chaussures montantes en cuir à semelles de bois cloutées dont étaient munis la plupart des écoliers à peine plus grands que moi à Lodève. Cet accessoire intermédiaire entre le sabot et le soulier équipait souvent les élèves du canton juste après la guerre. C’étaient les chaussures des enfants de paysans des écarts qui arrivaient tous les jours à l’école par les chemins pierreux à travers la garrigue. C’est surtout de leur bruit que je me souviens, des clous qui grinçaient au contact des pavés de basalte de la chaussée et du roulement de leur cavalcade à l’heure de la sortie. Mais surtout de la menace de ma mère quand après m’avoir sermonné pour avoir tapé du pied dans un caillou avec mes jolis kneps tous neufs, m’avait dit : « si tu recommences, je t’achèterai des galoches à la place ! »
Je me voyais mal avec ces grolles tous terrains d’une tonne à chaque pied, dont les clous grinçaient au contact des pavés de basalte de la chaussée, je préférais nettement mes sandales souples. Les galoches de bois étaient pour moi le symbole même de l’agressivité depuis que j’avais vu des bandes de galapiats parcourir en équilibre et en martelant des pieds le parapet du quai en pierre qui dominait la Soulondres. Ils passaient à grand bruit devant l’atelier de Cance, le forgeron et la résonance de leurs semelles de frêne arrivait au passage à couvrir le bruit de l’enclume. Il est vrai que personne n’était encore sensible aux agressions sonores comme c’est malheureusement devenu le cas deux générations plus tard. Ils avaient fini par creuser deux ornières profondes à l’endroit de leur passage dans le grès tendre du revêtement. Deux sillons qui se trouvaient exactement à hauteur de mes yeux de petit enfant.
Quelques années plus tard, de retour sur mon passé, je les ai cherchées ces cannelures parallèles dont l’image avait marqué mon enfance, mais elles avaient disparu. La vieille banquette de pierre tout usée par les galoches avait laissé la place à un mur en béton sur lequel ne résonnait plus aucun écho des semelles de bois cloutées. Ces traces du vécu des écoliers de ma génération ne témoignaient plus de la vie passée. Le passé était définitivement passé.
Les Annamites
Une autre image forte de ma prime jeunesse me fit comprendre beaucoup plus tard que le racisme pouvait puiser ses sources négatives dans une volonté de méconnaissance de l’autre. À Lodève avaient été plus ou moins parqués dès leur démobilisation quelques régiments « indigènes » qui étaient venus se faire décimer à nos côtés pour nous aider à combattre la présence allemande sur le sol français. En attendant que la Patrie reconnaissante ne trouve les moyens de les renvoyer chez eux à l’autre bout du monde, ils avaient été intégrés comme travailleurs civils à des occupations locales. Ici, nous avions hérité d’un régiment d’Annamites que l’on occupait à l’entretien des différentes filatures textiles qui tentaient de reprendre leur activité.
Ces gens d’un aspect physique inhabituel et qui ne parlaient pas le moindre mot de français ni encore moins de patois occitan, ne se déplaçaient qu’en groupes d’une même ethnie et les avis sur leurs us et coutumes allaient bon train. Ces commentaires de « bons français » m’ont été rapportés plus tard par mes parents qui les avaient entendus et en étaient restés d’abord amusés puis profondément choqués. Pour moi, il ne reste que l’image de ce régiment annamite aux chapeaux tronconiques défilant en file indienne à travers les rues en soulevant d’interminables points d’interrogation dans ma petite tête. Ces gens n’étaient vraiment pas comme tout le monde. Leurs petits yeux et leurs visages inexpressifs faisaient supposer et dire le pire sur leur cruauté imaginée, leurs habitudes culinaires certainement anthropophages et leurs coutumes de sauvages. Sans en être témoin, j’ai entendu raconter alors, qu’une vieille femme voyant défiler un régiment de Sénégalais du plus beau noir, s’était alors écriée stupéfaite “ Et dé qué mangea aquel mounde ? ”
Ma mère en avait une tout autre impression depuis que plusieurs d’entre eux s’étaient intéressés à l’enfant que j’étais et avaient tenté de lui communiquer une sensibilité attendrissante à mon sujet. Elle me raconta, plus tard, qu’un jour où elle me promenait, gros bébé blond et joufflu, dans ma voiture d’enfant, l’un d’eux, sec et parcheminé qui nous suivait silencieusement depuis un moment se rapprocha d’elle la main tendue avec ce sourire énigmatique si particulier des Asiatiques. Elle n’avait pas peur, aucune agressivité ne leur était reprochée, ils étaient la gentillesse même. Arrivée à proximité, elle vit qu’une pièce de monnaie brillait au bout de ses doigts. Aie ! Par quelle méprise l’avait-il prise pour une femme à vendre ? Mais non, c’est à moi qu’il tendait son présent avec force sourires, courbettes et salamalecs dans une langue aigrelette inconnue. Puis il me mit la piécette dans la main et s’en alla à reculons, plié en deux, avec toujours ce sourire inextinguible.
L’odeur de la Salmson
C’était la première voiture de mon père, du moins je le suppose. En était-il le propriétaire avant ma naissance ? Je ne l’ai jamais su. Il l’avait très certainement achetée d’occasion car j’ai appris plus tard que ce modèle au pare-brise vertical datait de 1932. C’était donc un outil d’avant-guerre. Mon plus vieux souvenir de cette redoutable caisse se situe au Cap d’Agde. Je vois très bien la voiture, comme un cube noir, stationnée en position dominante en haut d’une falaise tout aussi noire elle aussi qui plonge dans la mer. J’ai entre trois et quatre ans. Nous avons probablement fait cette excursion depuis Lodève pour rendre visite à mes grands-parents à Sète et nous les avons promenés jusqu’ici car leur seul moyen de déplacement, en l’absence de leur gendre, se limitait aux cars départementaux. Dans cette période qui suit immédiatement la fin de la guerre ce n’est pas tout le monde qui possède une automobile. Bientôt les chansons de Charles Trenet vont glorifier cette avancée sociale.
Le soir arrive, c’est l’heure de rentrer. Il faut que je remonte à contrecœur dans cette maudite voiture. Je tourne autour sans me décider à franchir la portière arrière ouverte. Dès que je m’en approche, l’odeur d’essence qui imprègne ses coussins me soulève le cœur. Je vois très bien de chaque côté de sa malle arrière suspendue comme un coffre de voyage, les compas latéraux de capote qui brillent au soleil couchant. Je suis partagé entre deux sentiments antinomiques. Je me sens fier que mes parents aient une voiture mais je suis navré de devoir y monter. Pour les petits déplacements du dimanche autour de Lodève, pas de problème, je n’ai pas le temps de me sentir mal. Je suis même ravi de tenir le volant, assis sur les genoux de mon père. Mais quand je sais que la route va être longue, elle représente pour moi l’arrivée inévitable de malaises qui vont me faire vomir un peu plus loin sur le bas-côté. J’en suis déjà sûr avant même d’y monter.
À ma hauteur, entre les deux grandes roues à rayons qui me fascinent, la longue étagère du marchepied extérieur me tend les bras et m’invite à monter mais dès que je grimpe dessus me voilà de nouveau agressé par cette nauséeuse odeur d’essence qui remplit tout l’intérieur de la cabine. Je ne peux pas m’y résoudre tout seul.
Pourtant, lorsque mon père s’arrête dans un garage pour prendre du carburant à la pompe, je ne vois pas d’un œil désagréable cette grande colonne rouge munie de deux réservoirs en verre en partie haute et qui cligne tantôt d’un œil tantôt de l’autre pour nous délivrer le précieux liquide jaune dont un pompiste à casquette manipule alternativement le levier. Ce spectacle magique revêt plus d’importance à mes yeux et me fait oublier l’odeur écœurante des vapeurs d’essence qui s’en dégage et me prend à la gorge.
Je croyais ces souvenirs enfouis à tout jamais lorsque je suis tombé un jour sur un carton à chaussures rempli de vieilles photos parmi lesquelles je me suis reconnu, fier comme Artaban, juché à califourchon sur le bouchon de radiateur de cette horrible usine à gaz de Salmson.
UNE ENFANCE SÉTOISE
Vision d’apocalypse
En octobre 1946, dans une France enfin en paix, mes parents décident de regagner leur port d’attache et ma mère demande son affectation à Sète pour être au plus près de tout le reste de sa famille. La nôtre est réduite à trois personnes car ma sœur Lili, née entre-temps, a été laissée à Lodève sous la garde de mes grands-parents maternels.
Fort heureusement car l’appartement réquisitionné dans lequel nous devions loger, à l’angle de la rue du théâtre, est déjà occupé par une autre famille. Devant les atermoiements d’une administration débordée qui ne parvient pas à nous caser, ma mère se cabre et prend le taureau par les cornes en décidant d’occuper de force les locaux de l’école Lakanal où elle vient d’être nommée. Je me souviens nettement de cette période par l’inconfort brutal dans lequel s’est déroulé notre quotidien. Je vois très bien encore ces pans de murs à la lourde maçonnerie de pierre à moitié écroulée qui se découpent sur le ciel et entre lesquels nous campons sommairement. L’école a été bombardée le 25 juin 1944 et n’a pas encore été reconstruite. L’escalier qui menait au premier étage qui a disparu, ouvre maintenant dans le vide. L’entêtement de ma mère pour forcer la municipalité à nous loger décemment n’a d’équivalent que l’ingéniosité de mon père à nous installer le moins mal possible dans ces ruines en attendant l’attribution d’un logement plus digne.
Cette faculté de mon père à tout remettre en cause sans désespérer et à repartir à zéro sans aucune amertume ni aucun regret devait être la conséquence d’une mentalité forgée durant ses deux années de captivité dans les camps allemands alors qu’il venait tout juste de se marier. Durant toute sa vie par la suite, je l’ai vu rebondir sans jamais se laisser abattre par quoi que ce soit. J’ai toujours eu l’impression que cette capacité de résilience faisait partie intégrante de sa nature et j’étais fier d’avoir hérité de ce trait de caractère.
Lorsque je considère cette période de ma vie, les images remontent en moi dans le désordre. Elles sont comme une projection de diapositives qui se succèdent les unes après autres sans avoir forcément de liens entre elles. C’est chaque fois un tableau différent. De ce semblant d’appartement aménagé entre des pans de murs, je vois des pièces à ciel ouvert protégées de la pluie par de simples bâches et les nombreuses tentures destinées à remplacer les portes arrachées de leurs gonds par le souffle des bombes. Notre lieu de vie a tout d’un campement de réfugiés dans des ruines. Le seul bâtiment en bon état que nous fréquentons une fois par semaine dans le quartier est celui des bains douches municipaux à quatre pas de là sur l’esplanade.
Pour libérer l’école ainsi que sa bonne conscience, la mairie nous installe alors provisoirement à l’hôtel pendant deux mois puis réquisitionne l’appartement du 8 avenue Victor Hugo où loge désormais toute la famille reconstituée avec mes grands-parents maternels et ma sœur Lili enfin redescendus des Cévennes. Le sentiment qui me reste de cette apparente vie de désolation n’est absolument pas négatif, bien au contraire. J’en garde comme une empreinte bien ancrée la certitude qu’il ne sert à rien de se lamenter et que finalement tout est possible en restant actif et inventif.
Autres temps, autres mœurs
Je crois que mon plus lointain souvenir de notre vie dans notre nouvel appartement est celui du bain hebdomadaire dans la baignoire en zinc. La cérémonie se déroulait dans la cuisine. Chaque fin de semaine je m’y préparais en voyant les casseroles d’eau supplémentaires mises à chauffer sur la cuisinière à charbon puisque sa réserve d’eau incorporée n’avait pas une contenance suffisante pour cette opération. Mon père allait chercher sur la terrasse où elle était entreposée, une baignoire artisanale en plaques de zinc soudées, de forme oblongue, aux deux extrémités arrondies et la posait sur la table au centre de la cuisine. Le remplissage se faisait sous sa haute surveillance car mélanger de l’eau froide du robinet avec l’eau bouillante pour obtenir la bonne température était d’une technicité de spécialiste. Pendant qu’il opérait, ma grand-mère était chargée de nous déshabiller ma sœur et moi, puis selon le rituel c’était ma mère qui nous lavait au gant chacun à une extrémité de cette bassine. C’est au cours de l’une de ces opérations que je pris enfin conscience que les petites filles n’étaient décidément pas faites comme tout le monde.
La cuisinière en fonte à feu continu était le seul chauffage de l’appartement. Les petites cheminées de ville à feu de bois qui se trouvaient dans l’angle de chaque chambre avaient été condamnées par mon père non pas à cause du père Noël mais parce qu’il les trouvait anecdotiques et malsaines. L’hiver il fallait tenir fermée la porte de la cuisine longtemps à l’avance pour que la chaleur ne quitte pas la pièce avant que nous ne soyons dans le bain. Après un récurage en règle nous restions emmitouflés dans de grandes serviettes devant l’exhalaison de la porte du four ouverte où se trouvaient les briques émaillées destinées à réchauffer nos lits le moment venu. Instants délicieux. Devant le rayonnement lénifiant du fourneau, je voyais encore les efforts surhumains développés par le déménageur qui l’avait monté au premier étage sur son dos, marche après marche, avec une sangle autour du front.
À quelque temps de là que je suis incapable de chiffrer en mois ou en années, mon père, toujours innovant, entreprit des travaux de modernisation en aménageant une vraie salle de bains sur la terrasse couverte qui donnait dans le puits de lumière de l’immeuble. C’est vrai que jusqu’alors chacun faisait sa toilette devant l’évier en ciment de la cuisine, seul point d’eau de la maison. Trois générations sous un même toit imposaient l’établissement d’un tour de rôle. C’est ainsi qu’entrant par mégarde dans la cuisine, je découvris un jour que le chignon que ma grand-mère portait éternellement en forme de tresse enroulée à l’arrière de sa tête était fait d’une très longue chevelure grise qui lui couvrait entièrement le dos comme celles des sorcières.
C’était aussi l’époque où la vie ménagère devint un Art à part entière et mon père ne résistant pas aux sirènes du modernisme installa un chauffage au gaz dans la salle à manger qui dès lors ne fut plus réservée aux seuls repas de famille marquants mais devint un espace de vie quotidien. Sur la cheminée de marbre conservée et servant de console il installa même un magnifique aquarium de sa fabrication avec tout un mécanisme sophistiqué de filtration et d’oxygénation à fines bulles des 110 litres d’eau qu’il contenait.
Il n’était pas seulement à la page mais précurseur dans tous les domaines qui relevaient du bricolage. Tel ce jeu d’échecs entièrement en plexiglas qu’il avait fabriqué le jour où j’avais perdu quelques-uns des vieux pions en buis tourné qui me servaient de petits soldats. Il y tenait pourtant à ce vieux jeu qu’il avait hérité de son père. Je n’avais le droit d’y toucher que lorsque j’étais alité ou malade. Après un bon bouillon à l’ail de ma grand-mère, il installait alors une planche en travers de mon lit sur laquelle je faisais avancer mes deux armées ennemies, les blancs et les noirs.
Les odeurs de maison
Rien n’est plus évocateur d’un lieu que son odeur. J’ai, comme certainement beaucoup d’autres personnes, une mémoire olfactive très forte. Les senteurs ont pour moi le don magique de convoquer les souvenirs. Au fin fond de mon cerveau se trouvent enfouies toutes les odeurs des lieux où j’ai vécu. Et chacune d’entre elles est reliée à une image précise qui lui correspond. Après l’odeur musquée des meubles cirés de la salle à manger de l’appartement de Lodève et celle âpre de suie et de soude tempérée par l’odeur douceâtre de la soupe de poireaux de la cuisine de mes grands-parents, c’est dans une plus riche palette que baignent mes souvenirs de l’appartement de l’avenue Victor Hugo à Sète.