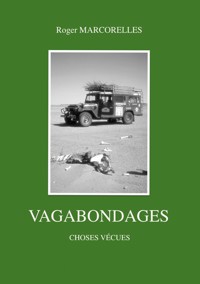
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La plupart des voyageurs ne voient que ce qu'ils s'attendaient à voir et tentent d'éviter les surprises et les imprévus alors que c'est là que se trouve le piment du voyage. Roger Marcorelles poursuit ici le récit des évènements exceptionnels, bons ou mauvais, qui ont jalonné ses vagabondages à travers le monde. Il nous entraîne avec lui dans ses pérégrinations au Sahara, au Mali, au Tchad, en Inde, en Argentine, au Yémen, en Haïti et ailleurs. Être bloqué dans un endroit perdu et inconnu, loin de chez soi, par des problèmes de mécanique récalcitrante, de rébellion armée ou d'autorisations administratives stupides, voire par un environnement hostile ou un séisme, lui ont permis de vivre une multitude d'évènements inattendus et de croiser une foule de personnes intéressantes avec qui il n'aurait jamais eu aucun contact si tout s'était déroulé selon ses prévisions. C'est là qu'il s'est rendu compte que le véritable enrichissement apporté par le voyage était plus que tout la rencontre et la compréhension de l'autre. Vivre ne consiste-t-il pas tout simplement à se confronter en permanence à l'altérité ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
BURKINA FASO
GUIDE TOURISTIQUE ET CULTUREL
Editions du Pélican – Vilo – 2004
UNE JEUNESSE DU SIÈCLE DERNIER
CHOSES VÉCUES Tome 1
Éd. BoD. - 2022
AVENTURES INSOLITES – MONTAGNE SPELEO CANYONS
CHOSES VÉCUES Tome 2
Éd. BoD - 2023.
VAGABONDAGES
CHOSES VÉCUES Tome 3
Éd. BoD - 2024
REMERCIEMENTS
A tous mes amis aujourd’hui disparus avec qui j’ai eu la chance de découvrir le monde hors des sentiers battus.
TABLE DES MATIERES
Voyage ou voyage ?
Un autobus nommé Désir
YOUGOSLAVIE ET GRECE :
Le vampire des Balkans
Les poux d’Istanbul
Minarets et coupoles
Josette
Difficultés de la langue grecque
La chouette d’Athéna
Le moine des météores
Kalinikta
Prisonniers de Tito ?
Le début de la fin
MAROC :
L’essence du guerrier
L’architecte et la nature humaine
Alerte au Cap Malabata
Plongée de nuit au Grottes d’Hercule
Un taf de kif à Azrou
Taouz, le bout du bout
Prémonition
ALGERIE :
Premier pied en Algérie
Le ruisseau des singes
Embuscade sur les hauts plateaux
Les cimetières Mozabites
Réception chez Abd el Aziz
Piste d’El Goléa
En pane chez Boris
Le Tadémaït
D’In Salah au tropique du Cancer
Tamanrasset
L’Assekrem
La caméra et le sous-préfet
Cambriolage au Caïd de Bou-Saada
Deuxième pied en Algérie
Automne à Médéa
Le culbuteur de Ghardaïa
Nuit blanche algéroise
Vol intérieur d’Air Algérie
Le marché mozabite de Beni Isguen
Retour dans la mouise
De nouveau chez Boris
Pause à Tam
Guy Barrère
Djanet
Tassili des Ajjers
Perdus dans le Ténéré
Le banquier algérois
YEMEN :
Le Yémen entre deux révolutions
Les derniers vols d’Air Djibouti
RETOUR AU MAROC
Réveillon des mille et une nuits
Les tentes caïdales
L’attentat de Marrakech
L’ALGERIE RETROUVEE
Racisme ordinaire
Mon futur beauf
Des larmes de joie
Saïd à l’aéroport d’Oran
Les cartouches de Spit
Transfert de dinars
Escale à Tamanrasset
Les retrouvailles d’Hassi-Messaoud
Il y a de l’orage dans l’erg
Le rendez-vous d’Essendilène
La tasse du légionnaire
TUNISIE :
Le village-club
Inondations dans le sud Tunisien
LIBYE :
L’absolu
Planté à Sebha
EGYPTE :
Quitter Louxor
MALI :
Premières impressions africaines
Le vautour de la mosquée de Djenné
Vol de passeport
Coup de chaleur à Kayes
Morphine à Bamako
L’animal d’Ansongo
MAURITANIE
L’infirmier
Peau d’âne
Formalités
Oualata
BURKINA FASO :
Expédition en Haute-Volta
Le coup de frein de Boromo.
« Gagner l’enfant»
GUINEE :
Mutinerie sur les mines de diamants
TCHAD :
Bagarre à N’Djamena
L’étape
Le lupanar de Moussoro
Les restes d’une guerre
Faya-Largeau
La caravane du Natron
Chasse à la gazelle
Nuit sur le reg
Zouar
Rébellion au Tibesti
Le trou au natron
Vol au-dessus du volcan
Au fond du trou
Chez Falmata
Vent de sable
Magie noire
MADAGASCAR :
Le rêve de Robinson
ETATS-UNIS
La fournaise
Atterrissage à New-York
RAHJASTAN :
Mariage surprise
ARGENTINE :
Quand le tango m’a pris aux tripes
Ma première mirada
Un dimanche à San Telmo
La Boca
HAÎTI :
La choucoune de Dady
Déchoucage de Baby Doc
Robert Anglade
Flic ou truand?
Jardin sur mer
Trafic de cocaïne
Vers l’Ouest
Jérémie
Naufrage du Neptune
La loi du marché
La rivière Glace
Le séisme de 2010
Port au Prince après l’apocalypse
Le Manoir des Lauriers
La fin de Bob
TABLE DES MATIERES
VAGABONDAGES
Voyage ou voyage ?
C’est la pulsion d’assouvir une curiosité dévorante qui au début a motivé ma passion du voyage. Le désir d’accéder à une connaissance profonde du monde. J’ai toujours eu une appétence naturelle à aborder les mondes différents du mien. J’étais mû par une volonté d’admirer de nouveaux paysages, de considérer avec intérêt tout ce que l’histoire avait semé sur mon chemin. Je pense avoir été un peu formaté dans ce sens lorsque j’étais enfant par les premiers voyages effectués en compagnie de mes parents. Pour ma mère il ne pouvait y avoir de déplacement qui ne soit pas motivé par un but culturel : apprendre, apprendre, apprendre. C’était peut-être sa vocation d’enseignante qui prenait le dessus. Nos vacances en famille étaient émaillées par une multitude de visites guidées. Pas une église, pas un château, pas un musée n’a été laissé de côté. Elle devait estimer qu’elle aurait manqué probablement à tous ses devoirs en ne nous entraînant pas dans son sillage. Après une telle mise en orbite, je ne pouvais que poursuivre ma trajectoire une fois débarrassé de ma fusée porteuse : l’emprise parentale. Ça devait certainement correspondre aussi à mes aspirations personnelles car, pas une fois avant mon émancipation, je n’ai été tenté de me rebeller contre ces habitudes acquises. Mes chromosomes eux-mêmes avaient été sérieusement conditionnés.
Pendant des années j’ai trouvé mon contentement dans cette façon de voir le monde. Cependant, je trouvais que le terme de partir en voyage incluait une notion de fuite. Cette expression était redoutable par la façon qu’elle avait d’inclure l’idée que l’acte permettait d’échapper à un quotidien considéré comme contraignant et négatif. L’expression d’aller en voyage me convenait beaucoup mieux par la volonté positive d’atteindre quelque chose que l’on ne connaît pas encore mais que l’on sait pertinemment digne d’intérêt. C’était aller vers la rencontre d’un paysage ou d’un évènement. Et puis un jour j’ai découvert à travers mon expérience ce que c’était qu’être en voyage. C’était un état, un changement total d’état d’esprit, un déconditionnement, un désir de vivre au présent ce que vivent les autres au contact du hasard des rencontres. En contrepoint de tout cela, j’ai toujours exécré l’expression prétentieuse de ces trop nombreux touristes qui avaient fait un pays, comme si celui-ci n’avait jamais existé avant qu’ils n’y arrivent.
Je me souviens surtout de la première fois où j’ai été subitement envahi par cette sensation nouvelle d’être plongé dans le bain et d’y être pleinement. Nous sommes au fin fond d’une ruelle de la médina de Marrakech, sur une placette étroite encombrée par des éventaires de commerçants. Avec mon ami Pierre, nous sommes obligés d’attendre là, je ne sais plus pour quelle raison mais le fait est que nous ne savons pas combien doit durer notre attente. En bons touristes que nous sommes tous les deux, nous avons déjà mitraillé de nos appareils photographiques tout ce qui passe à notre portée. Les gosses nous collent comme des mouches mais nous savons qu’il n’y a rien de plus normal ici. Au bout d’un temps certain, la fatigue de rester debout au soleil nous gagne et nous rangeons nos objectifs dans nos sacs pour nous asseoir par terre dans l’ombre d’un mur. Immobiles, nous observons l’activité de la rue. Les enfants ne s’intéressent plus à nous, ils nous lâchent pour poursuivre ailleurs leurs harcèlements. Les commerçants que nous ne braquons plus redeviennent naturels et finissent par ne plus nous voir. Et là, avachis comme des sacs, à force de regarder autour de nous sans juger, sans intervenir, nous prenons conscience que, comme eux, nous faisons partie intégrante du décor, nous nous y fondons. Le sentiment d’altérité s’est estompé pour finir par disparaître. Toute cette alchimie s’est faite progressivement comme une lente glissade sur un sol argileux. Nous sommes réduits au rang d’humains, comme les autres le sont aussi. Nous sommes, tout simplement.
Par la suite, en maintes occasions, il m’a été donné de me trouver dans des situations qui me faisaient pleinement sentir ce verbe être dans toute sa splendeur. C’était le cas lorsqu’un imprévu ou une contrariété venait se mettre en travers de mes prévisions. Au lieu de la considérer comme un obstacle à franchir coûte que coûte en l’abordant de front avec ma mentalité spontanée ainsi que l’aurait fait n’importe qui, je m’étais rendu compte dans bien des cas que mieux valait s’adapter aux circonstances et suivre tranquillement le chemin indiqué risque à partir dans l’imprévu. « Contre mauvaise fortune, bon cœur, » aurait dit ma grand-mère. Car c’est là que se trouvait le véritable attrait du voyage, la situation qui permettait à chaque seconde d’innover et de ne pas tomber dans la routine. Loin du prévisible ou du préfabriqué, de ne pas voir systématiquement que ce que l’on s’attendait à voir, de dévier vers d’autres horizons tout aussi intéressants, bref de vivre au présent.
Être bloqué dans un endroit perdu et inconnu à l’autre bout du monde par de bêtes raisons de mécanique récalcitrante, l’attente d’autorisations administratives stupides, voire par un environnement hostile, m’a permis de rencontrer puis de connaître une multitude de gens intéressants avec qui je n’aurais jamais eu aucun contact si tout s’était déroulé selon mes prévisions. La plupart des voyageurs ne voient que ce qu’ils savent déjà. C’est dans ces moments que je me suis rendu compte que le véritable enrichissement apporté par le voyage était plus que tout la rencontre et parfois la tentative de compréhension de l’autre, de celui qui fait son quotidien de ce qui fait nos vacances. Vivre ne consiste-t-il pas tout simplement à se confronter à l’altérité ?
Un autobus nommé Désir :
Mais que faisons-nous dans cet immense parc de véhicules réformés ? Des allées entières où des autobus et des poids lourds de toutes sortes sont rangés côte à côte à perte de vue. Nous les inspectons en détail en cherchant l’exemplaire qui cadrera parfaitement à nos besoins. Ce n’est pas tant leur état mécanique qui nous soucie mais plutôt leurs potentialités à devenir habitables.
Jeune couple, dès qu’avec Sylvie, notre envie de bourlinguer est devenue possible sans trop perturber notre vie courante, plus rien ne nous a retenus et surtout pas les problèmes matériels. Voyager serait à notre portée sans tomber dans le système touristique banal habituel des hôtels et des restaurants de toute façon trop chers pour nous. Nous avons immédiatement opté pour la formule la plus sûre et la moins onéreuse : celle du fourgon habitable. Pour une somme modique nous avons acheté d’occasion à une entreprise de livraison de laitages, notre première camionnette, un J7 Peugeot que nous nous sommes empressés d’aménager pour le rendre vivable : isolation, cuisine, couchettes, rangements intérieurs. Nous pourrons ainsi être chez nous partout, nous arrêter où bon nous semble ou presque au cours des nombreuses pérégrinations que nous avons l’intention d’effectuer. Et nous l’avons fait ! Notre enthousiasme a été tellement communicatif que plusieurs de nos amis ont choisi eux aussi ce style d’existence néonomade.
Nous avons fait partie des pionniers d’un nouvel art de vivre permettant le voyage sans plus de frais que si nous étions restés à la maison. Il faut dire que le camping-car n’ayant pas encore obtenu droit de cité ni même envahi les campagnes comme aujourd’hui, tout nous était encore permis. Nous nous sommes accordés à titre exceptionnel et temporaire des droits impossibles à concéder à la foule qui, quelques années plus tard, a suivi notre exemple. Trop tard pour elle ! Les candidats étaient devenus trop nombreux et les petits coins de nature secrets que nous avions découverts sont devenus des espaces forains surpeuplés. Les mentalités aussi avaient changé. Autant l’écoute du silence était religieuse chez les premiers adeptes de cette formule, autant le besoin de bruit et de musique souvent inadaptée au site est venu remplacer le pépiement des oiseaux pour les suivants.
Plus moyen désormais de limiter nos déplacements pour de vulgaires questions d’argent. Nos seuls frais inhabituels étaient occasionnés par notre consommation de carburant pour changer de lieu. Dès lors, tous les horizons nous demeuraient ouverts. Après avoir sillonné le Maroc avec un couple d’amis, nous avons décidé de voir les choses en grand et nous sommes partis, Sylvie et moi, avec la prétention de traverser le Sahara d’Alger à Tamanrasset. Beaucoup de kilomètres certes mais en Algérie en 1973, le litre d’essence ne coûtait que 40 centimes de franc le litre. C’est à cette occasion que nous avons compris que les capacités du véhicule étaient le premier gage de notre réussite. La mécanique de notre J7 n’a pas résisté à l’état des pistes et nous l’avons ramené en France après avoir remplacé le moteur et démonté tout ce qui était à fleur du sol, au niveau du châssis y compris le réservoir d’essence. Le c d’essai en camping traditionnel chemin du retour s’est fait avec le capot moteur ouvert dans la cabine et le tuyau d’alimentation du carburateur plongé dans un jerrican coincé entre les jambes. Fumeurs s’abstenir !
Une fois l’habitude prise, il nous est devenu impossible de résister au besoin progressif de faire mieux et le véhicule suivant a été un SG 2 Saviem, un peu plus gros mais surtout beaucoup plus robuste. Celui-ci nous a transportés en Grèce et en Turquie à plusieurs reprises. Nous avons même envisagé d’atteindre l’Iran si les conditions sanitaires nous l’avaient permis (voir : « les poux d’Istambul »)
Ces voyages en famille nous étaient devenus tellement faciles que nos filles avaient rallié à elles plusieurs autres enfants de nos amis qu’elles auraient bien fait suivre dans leurs bagages. Mais il était difficile d’emporter tout ce monde avec nous pour de grands déplacements. C’est pourquoi, nous avons décidé d’y réfléchir et d’étudier la question de plus près. Nous avons alors échafaudé le rêve d’acquérir un véritable autobus et de faire un Tour de France en guise de galop d’essai. Après tout pourquoi pas ? C’est la raison pour laquelle nous nous sommes mis en chasse et avons entamé nos recherches dans les milieux spécialisés des poids lourds et des transports en commun. Les idées, ce n’est pas ce qui nous a manqué ! Toute la famille s’y est mise, chacun avait son mot à dire. Les plans d’aménagements intérieurs nous ont occupés pendant des mois, allant même jusqu’à parvenir à être primés à de véritables concours d’idées organisés par des revues de camping. Notre imagination se projetait déjà dans l’utilisation de ce véhicule idéal équipé de tout le confort possible qui nous permettrait de répondre aux chants des sirènes et de vivre en autonomie complète dans des milieux pas trop hospitaliers. Quel agréable casse-tête !
Mais petit à petit ont surgi des obstacles qui n’étaient pas que matériels. Notre rêve s’émoussait sur des blocages administratifs, des difficultés réglementaires, des normes de sécurité, des assurances obligatoires, l’organisation d’un entretien mécanique permanent, l’obtention d’autorisations indispensables, les exigences des autotités étrangères, tant et tant de paperasses si nous voulions parvenir à vivre notre désir. La bureaucratie nous a eus à l’usure. Dès que nous avions franchi un cap, un autre se dessinait à l’horizon, inaccessible. Où était la part de poésie dans tout cela ? C’était la première fois de ma vie que je me sentais envahi par le découragement. Devant l’ampleur de la tâche nous avons rangé notre songerie devenue chimérique au rang des beaux souvenirs en gardant toutefois l’inoubliable certitude que cet autobus utopique nous avait transportés sur de magnifiques chemins de rêve.
YOUGOSLAVIE - GRÈCE - TURQUIE
Le vampire des Balkans :
Avant d’opter pour la formule « camionnettte » un petit galop d’essai nous avait confronté aux premières difficultés du voyage libre. Septembre 1969. J’ai obtenu mon diplôme d’architecte en février de l’année précédente et pas pris un seul jour de congé depuis. Le besoin d’évasion se fait de plus en plus pressant. N’y tenant plus, à la fin de l’été, ma femme et moi, partons avec un couple d’amis en direction de la Yougoslavie. Le maréchal Tito règne encore sur cette fédération soviétique triste et démunie de tout mais nous sommes particulièrement curieux de connaître comment ça se passe du côté du rideau de fer. Avec Marie Hélène et Michel entassés à quatre dans ma petite Renault 4, nous chargeons tout notre matériel de camping de manière à pouvoir circuler en toute indépendance.
Halte quasi obligatoire à Venise que nous ne connaissons pas encore avant d’entamer la traversée surprenante des forêts Slovènes où vivent encore des ours à l’état sauvage, nous a-t-on raconté. C’est dire si nos choix d’emplacements de camping sont problématiques. Nous cherchons toujours à ne pas être trop éloignés d’un établissement humain, ferme ou village, sans pour cela nous installer trop près et susciter la curiosité des autochtones que notre présence rend suspicieux. Les premiers contacts que nous tentons avec eux se heurtent à la barrière de la langue. Le serbo-croate n’est pas un langage facile pour les Latins que nous sommes. Malgré le manque de repères slaves nous parvenons tout de même à reconnaître et à apprendre la vingtaine de mots nécessaires pour ne pas paraître idiots ni passer pour des Allemands. Ce sont les seuls touristes à atteindre leurs plages sans essayer de communiquer autrement que dans leur langue. Notre étonnement est grand de constater qu’en Bosnie et à Sarajevo en particulier la profusion des minarets nous donne l’impression d’avoir déjà atteint la Turquie. Nous sommes plongés dans les prémices d’un Orient de carte postale : hommes enturbannés, moutons à la broche mis à cuire sur les trottoirs. Campaniles et minarets se tendent d’un même élan vers le ciel. Nous ignorions jusque-là que les signes extérieurs de l’empire ottoman s’approchaient si près de chez nous.
Et par ailleurs nous constatons les carences d’un empire soviétique qui nous semble en cours de décomposition. Magasins d’État aux étagères vides, produits démodés, méfiance institutionnelle, on a l’impression que tout le monde surveille tout le monde. Ce ressenti de malaise généralisé se confirme pour nous le jour où, dans la rue d’une grande ville, nous sommes abordés discrètement par une femme qui nous suivait depuis un moment avec prudence. À notre étonnement elle nous déclare dans un mauvais français que son mari, qui a travaillé autrefois en France, désire nous parler. Il est grabataire et avant de mourir il aimerait bien une dernière fois pratiquer notre langue. Sur sa demande, nous la suivons à vingt mètres en arrière jusqu’à l’entrée d’un immeuble où elle s’engouffre sans nous attendre. Nous la retrouvons dans l’escalier et elle nous ouvre un appartement sombre aux rideaux tirés. Son vieux mari est là, dans l’ombre, assis au fond d’un lit vieillot, une tentative de sourire illumine un peu son visage. Il nous serre les mains à tous les quatre comme s’il voulait nous posséder et nous déclare que dès qu’il a appris que des Français traînaient en ville, il a aussitôt envoyé sa femme à notre recherche. Il sait qu’il n’en a plus pour très longtemps et il éprouve un plaisir immense à nous avoir à ses côtés, lui qui au retour d’une émigration de dix ans à Paris s’est retrouvé mis au ban de la société par le pouvoir politique. Il tient à tout prix à nous dire à quel point il considère la France comme le pays de la liberté. Cocorico !
La grande route de 1500 kilomètres qui traverse tout le pays de l’Italie à la Grèce n’est rapidement plus goudronnée et devient une piste poussiéreuse en travaux permanents. Dès que nous quittons ce grand axe, nous nous trouvons sur un réseau de pistes forestières sans trop d’indications quant à leur destination. Un soir où nous roulons à l’intérieur des terres montagneuses des Balkans en quête d’un endroit où passer la nuit, au détour d’un virage, une image à contre-jour s’impose à notre vue. Sur un fond de coucher de soleil se découpe la silhouette romantique d’un berger debout appuyé sur une haute canne qui lui arrive au menton, son chien à côté. Il porte une grosse moustache de brigand, un calot brodé, et ses pieds sont chaussés de souliers aux pointes retournées en crosse. Avec les quelques mots que nous connaissons et surtout par gestes, nous lui signifions que nous cherchons un pré pour planter notre tente. Il nous fait alors signe de le suivre et, à petits pas, nous amène à cinq cents mètres de là jusqu’à sa maison, une masure couverte de chaume dont la fumée de l’âtre s’infiltre à travers la paille du toit. Dans la nuit tombante il nous fait signe de nous installer tout contre son mur et nous fait comprendre que plus loin serait dangereux à cause des bêtes sauvages. Ici ce ne sont pas les ours mais les loups que nous devons craindre.
À peine notre toile tendue sous son œil curieux, il nous engage à entrer chez lui où sa femme a déjà installé quatre couverts sur une longue table de bois éclairée par deux lampes à pétrole. Nous avons beau réfuter l’invitation en prétextant toutes sortes d’arguments que nous ne sommes pas en mesure de lui expliquer clairement lorsqu’il nous fait comprendre que son fils, Obren Govedariçe, étudiant à l’université, va arriver et qu’il parle français. L’argument finit par nous convaincre.
Ce repas, je m’en souviendrai toute ma vie. En tant qu’éleveurs ils ne disposent que de laitages : laits caillés de brebis et de vache à divers stades de fermentation, fromages frais et fromages secs avec pour toute boisson un lait de chèvre encore chaud qu’ils viennent de traire pour nous. Comme si ce régime ne suffisait pas pour assouvir notre appétit, ils nous coupent de grosses tranches d’un pain rustique qu’ils nous proposent de tartiner de beurre. Marie Hélène qui ne supporte pas les laitages est sur le point de défaillir et pour ne pas les vexer, me refile en douce plusieurs fois sa part dans mon assiette. Difficile de leur échapper, ils sont tellement contents de nous honorer que l’homme et sa femme auxquels est venue s’ajouter une grand-mère sortie de l’ombre, sont debout derrière nous et nous remplissent les assiettes au fur et à mesure que nous les vidons. Ce cauchemar sympathique prend fin lorsque la porte s’ouvre enfin sur un grand gaillard, le fils annoncé, qui se précipite vers nous les mains tendues en avant en prononçant ces mots : « Bonjour ! Comment allez-vous ? » Notre réponse le laisse interloqué, c’est tout ce qu’il sait dire en français et nous ne sommes pas sûrs qu’il en connaisse la signification. La conversation se termine dans un baragouinage de gestes indescriptibles et nous prétextons de la fatigue du voyage pour nous retirer sous la tente. Évidemment, le lendemain matin le petit-déjeuner est du même acabit que le dîner et c’est nos quatre ventres pleins que nous quittons nos hôtes dans un rôt.
Dans les splendides bouches de Kotor, une merveille de la nature, s’incruste la vieille ville vénitienne qui sera dans quelques années ruinée par un séisme. Elle retient tellement notre attention que nous nous laissons piéger par l’arrivée de la nuit. Plus question de trouver un lieu de campement, il nous faut chercher un hôtel. Nous n’avons pas le choix, il n’y en a qu’un et nous apprenons qu’il est géré par le gouvernement. C’est ce qui explique certainement son état de délabrement. Les jardinières du hall qui n’ont plus vu de fleurs depuis belle lurette sont désormais remplies de mégots et servent de crachoir. Personne à l’accueil. C’est après avoir fureté dans l’arrière-boutique que nous trouvons un employé qui daigne écouter nos explications. Des chambres disponibles, oui, il y en a mais il nous faudra porter nos bagages et faire le ménage car les fonctionnaires employés par l’état n’ont pas vocation à être au service de la clientèle. Bien entendu l’ascenseur ne fonctionne plus et demain matin pour le petit-déjeuner il nous faudra nous-même descendre à la cuisine faire chauffer notre café. Qu’il est discret le charme du communisme !
Quelques étapes plus loin, nous sommes dans le Montenegro et comme tous les soirs, le scénario se renouvelle, il nous faut trouver un coin où dormir. Nous sommes en pleine forêt, dense, noire. Voilà plus d’une heure que la nuit est tombée. Les phares éclairent les profondes ornières que nous tentons d’éviter et de chaque côté un mur végétal nous interdit toute sortie. Pas un seul champ accueillant en vue lorsque tout à coup la palissade de sapins se transforme en pans de bois. Nous venons d’entrer dans un village. Aucun éclairage public à part quelques faibles loupiotes détourant des fenêtres. Les rares personnes encore dehors nous regardent passer d’un œil torve et la parole que nous tentons de leur adresser ne reçoit aucun accusé de réception. Aucune agressivité mais une indifférence totale. C’est le flop ! Nous baignons dans une ambiance qui nous rappelle celle du film « le bal des vampires ». Au bout de la longue rue, la piste monte et dans un virage apparaît une clairière, la première depuis des dizaines de kilomètres. Ne sommes-nous pas trop près du village pour nous y installer ? Les gens si apathiques que nous venons de rencontrer ont dû entendre la voiture s’arrêter. Ils savent que nous sommes là. Nous nous sentons éminemment vulnérables à toute agression mais la fatigue a raison de nous. Tant pis, nous nous arrêtons.
Il a plu dans la journée, les hautes herbes sont dégoulinantes d’eau. Ce ne sont pas les conditions idéales pour planter le camp et nous nous couchons un peu inquiets tout de même. Par mesure de sécurité nous avons mis nos femmes au centre de la tente et les hommes de chaque côté, séparés de l’extérieur par la mince toile bleue. Le sommeil a du mal à venir, nous devons rester vigilants. Ces villageois nous ont fait vraiment très mauvaise impression. À tel point qu’à deux reprises, une fois Michel, une fois moi, nous sortons de la tente et balayons le champ d’un jet de torche circulaire autour de nous. Rien !
Nous finissons par nous endormir pour être brutalement réveillés par une secousse terrible. La tente est violemment secouée comme si quelqu’un tentait de l’arracher. Le temps de comprendre qu’un gros oiseau de nuit avait tenté de se percher sur notre faîtière sans y parvenir et Michel et moi nous braquons mutuellement la lampe dans la figure. Ah, nous sommes beaux tous les deux ! À moitié sortis de nos duvets, Michel tient dans sa main un énorme couteau à cran d’arrêt pointé en avant et moi la machette qui nous sert à couper le bois. Sans nous le dire pour n’affoler personne, nous nous étions armés en cachette avant de nous coucher. Cette nuit-là nous avons failli croire aux vampires.
Les poux d’Istanboul :
C’est notre premier voyage en Grèce avec Gilbert et Nicole, un autre couple d’amis. Et quelle première ! Sans préjuger de nos capacités, nous avions programmé une longue expédition vers l’orient avec nos six enfants. Pour cela, nous avons aménagé intérieurement notre fourgonnette avec tout le confort spartiate que nécessitent les grands déplacements. Gilbert, convaincu par notre façon de voyager, a aménagé lui aussi très rapidement un antique Peugeot J7 aux performances quelque peu amorties. Il est vrai que nos habitudes de déjà vieux campeurs nous permettent de vivre dehors sans problème majeur. Mais dans ces pays lointains et avec de jeunes enfants, désormais mieux vaut avoir une possibilité de repli à l’abri d’une tôle que d’une toile. Notre projet a l’ambition après avoir franchi la Turquie, d’atteindre l’Iran à travers l’Arménie et le Kurdistan qui, comme chacun le sait, ne sont pas encore de véritables nations mais vont le devenir sous peu. Et pourquoi pas, si tout va bien, d’atteindre l’Afghanistan. Un doux rêve !
Pour préparer notre épopée, Nicole a pris quelques cours de grec à la fac et nous sommes munis de tous les glossaires des pays que nous allons traverser. Pendant le trajet d’approche, tous les soirs, avant de coucher les enfants nous avons notre petite leçon commune de langues vivantes en commençant dans l’ordre par l’italien et le Serbo-Croate. Nous devons retenir dix mots courants tous les jours et pouvoir nous les faire réciter mutuellement à brûle-pourpoint dans la journée du lendemain. Ce petit exercice quotidien doit nous permettre de ne pas voyager comme des idiots et d’avoir un minimum de contact avec les gens que nous allons rencontrer. Bonjour, au revoir, merci, s’il vous plaît et les noms de quelques ingrédients nécessaires à notre survie tels que : eau, pain, lait, beurre, viande, et autres trucs indispensables ont été vite enregistrés y compris en farsi, langue pour laquelle nous n’avons aucun repère culturel.
La traversée de la Yougoslavie de Tito est très pénible. Il y faut apporter une attention soutenue à la conduite. Les routes sont mal signalées, mal entretenues et sillonnées par des automobilistes turcs suicidaires à la recherche de la vitesse à tout prix. Nous finissons par atteindre la côte grecque de Macédoine aux environs de Kavala où nous dégotons un coin tranquille pour nous poser près du petit port de Néa-Karvali. C’est la détente ! Un terre-plein qui domine la plage à proximité d’une guinguette isolée où nous sommes accueillis très gentiment par les taverniers. Ils nous proposent de nous installer comme chez nous. Cet accueil chaleureux dans un cadre de bord de mer va nous permettre de nous reposer des fatigues de la route.
Le soir même nous sommes invités par un groupe de pêcheurs à nous joindre à eux pour boire le traditionnel ouzo et, l’ambiance aidant, à danser le sirtaki entre hommes. Ils sont tenaces, nous avons beau essayer de résister en prétextant maladroitement la fatigue puis la présence des enfants pour nous tenir à l’écart, rien n’y fait. Même pas la barrière de la langue. Dès le troisième verre déjà nous parvenons à nous comprendre par gestes et onomatopées (tiens un mot grec !). À tel point que Gilbert emporté par cet enthousiasme communicatif continue de boire et de danser avec ses nouveaux amis bien après que nous soyons partis nous coucher dans nos camions.
Au petit jour, on tambourine sur ma carrosserie. C’est l’un des pêcheurs d’hier soir qui cherche « Zilbert ». Je crois comprendre qu’il lui a proposé de l’emmener à la pêche avec lui ce matin. Je le conduis vers le camion voisin où l’intéressé a toutes les peines du monde à ouvrir un œil torve. Ce n’était pas une promesse d’ivrogne. Gilbert dans un semi-coma et croyant tout comprendre du grec moderne a dû accepter sa proposition sans en avoir vraiment conscience. Il me raconte qu’il a passé la soirée à essayer de payer sa tournée sans y parvenir car à chaque invitation l’un des pêcheurs l’avait précédé sans qu’il s’en aperçoive le considérant comme son invité. Lorsqu’il comprend la situation, il me propose d’y aller à sa place et se rendort. Cet accueil amical inattendu ébranle nos habitudes de voyageurs. C’est bien joli de voir du pays, d’admirer des monuments et des paysages, mais nous prenons conscience que toucher du doigt une telle chaleur humaine est bien plus émouvant.
C’est avec cette conviction que le lendemain nous reprenons la route vers la Turquie. En traversant la frontière entre deux rangées de chars d’assaut, nous apprenons qu’un gisement de pétrole vient d’être découvert en mer dans des eaux dont la territorialité se dispute entre les deux pays, ennemis centenaires. Après 48 heures de quiétude passée avec les pêcheurs, nous retrouvons la tension tenace des mauvaises routes parcourues par des chauffeurs kamikazes. Peu avant d’arriver à Istanbul, un ralentissement nous permet de voir dans toute son horreur le spectacle d’un autobus partagé en deux dans le sens de la longueur couché sur le côté gauche du talus avec, tout autour, des silhouettes allongées sous des draps blancs. Nous apprendrons plus loin que, sur cette bande roulante étroite, ni le chauffeur du car ni celui d’un poids lourd venant en sens inverse n’avaient voulu céder sa place au milieu de la chaussée. Ce tableau traumatisant pour nos enfants nous pousse à trouver un lieu d’arrêt où nous serons en toute sécurité. Ce soir nous ne resterons pas dans la nature mais nous installerons notre camp dans un véritable terrain de camping aménagé.
Le « Londra-Camping » nous accueille à peu près normalement si ce n’est que des travaux sur le réseau le privent d’eau potable. Devant l’insécurité qui nous paraît être de mise dans ce nouveau pays, c’est moindre mal. Nous décidons de laisser là nos véhicules peu pratiques et d’utiliser les taxis pour visiter la ville. Une capitale étrange où se côtoient la magnificence des opulentes mosquées et le délabrement de quartiers populaires sordides, où s’imbriquent le marbre le plus fin et le pan de bois le plus pourri. C’est sans arrêt le passage d’un étonnement à un autre dans des gammes de sensations diamétralement opposées. La circulation anarchique et incompréhensible des véhicules nous confirme que nous avons fait le bon choix en prenant les taxis qui, de plus, sont d’un prix très modeste. Il ressort de cette ville une atmosphère d’agression sonore permanente.
Mais un matin, en allant me dégourdir les jambes dans les allées du terrain de camping, je croise un employé poussant une brouette qui transporte un chien mort. Je le suis du regard et je le vois ramasser un peu plus loin le cadavre d’un deuxième chien puis d’un troisième. Probablement une épidémie ! C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Fuyons cette terre Ottomane !
En plus de çà, Yvan se plaint de maux qui présentent tous les symptômes des oreillons. D’un commun accord nous convenons qu’exposer nos enfants à de tels risques n’est pas raisonnable et que la poursuite de notre périple risque de devenir une véritable galère pour eux. Mieux vaut faire marche arrière et revenir en Grèce où nous savons bénéficier d’un accueil autrement bienveillant.
De retour en Grèce, à Alexandroúpolis, nous nous précipitons dans la première pharmacie pour faire vacciner Yvan. Par bonheur, il se trouve que l’apothicaire bafouille un peu de Français. Nous déchargeons toute cette tension accumulée ces derniers jours en lui racontant la cascade de nos déconvenues ce qui provoque chez lui un effet hilarant ; « C’est bien fait pour vous, nous dit-il dans un français correct, il fallait rester en Grèce, les Turcs sont des sauvages. » Et il ajoute : « En plus de ça, je remarque que vous ramenez de bons souvenirs. Vos enfants ont leurs têtes couvertes de poux. Et les poux turcs sont coriaces ! »
Minarets et coupoles :
Istamboul, passage obligé au carrefour de toutes les civilisations. Ville à la légendaire silhouette de sept collines boursoufflées de coupoles et hérissées de minarets se découpant en couchers de soleil pompiers sur les eaux glauques de la Corne d’or. Grand bazar de merveilles alliant la pacotille au grandiose, vitrine des promesses de l’Orient, refuge de romanciers orientalistes qui en ont raconté les charmes mystérieux. Ville interlope aux mille et un dangers, que de polars a-t-on imaginé dans ses ruelles grouillantes et sinueuses aux façades de bois, d’un urbanisme aléatoire ?
Sur le délabrement d’aujourd’hui, on a peine à superposer l’image des tapis volants. Et pourtant tout est là, trop de saleté et trop de richesse se côtoient. Les fastes de Byzance percent la croûte des turqueries contemporaines.
C’est au XVI° siècle, alors que sur le trône des sultans Ottomans, régnait le magnifique Soliman, que la ville adoptait son profil de toujours. Constantinople était enterrée dans les citernes souterraines de Yérabatan, Byzance survivait encore dans l’or des mosaïques de Saint Sauveur et de Sainte Sophie et Istamboul naissait des mains de l’architecte le plus génial de l’histoire de l’humanité.
Il avait nom Sinan. Il était janissaire et par conséquent d’origine étrangère à l’Islam. On le disait Grec ou peut être Arménien, fils d’esclaves chrétiens remarqué pour ses qualités et enlevé à 21 ans pour servir dans la garde du sultan, avant que ne débute son destin glorieux d’architecte de la cour.
C’est comme chef du génie militaire qu’il fit ses premières armes en construisant des ponts et des fortifications. Mais c’est en édifiant la mosquée d’Alep en 1536 que ses qualités le signalèrent comme un homme de talent. Il avait déjà 50 ans et il commençait alors une carrière de bâtisseur de mosquées qui durera encore 45 années et le verra construire 335 bâtiments.
Jamais, de mémoire d’architecte, une vie professionnelle ne fut aussi bien remplie. C’est lui et quelques-uns des 250 élèves qu’il forma durant son exercice, qui façonnèrent le profil de cette capitale, sublime porte de l’Orient. Sinan ne s’est pas contenté d’imiter le modèle de Sainte Sophie de 1000 ans plus ancien à qui il voua une admiration sans borne. Il est arrivé à en assimiler la conception et à la faire évoluer en conjuguant toutes les composantes stéréotomiques, toutes les combinaisons possibles de coupoles de demi-coupoles, trompes et pendentifs. En Europe, à la même époque, c’est l’état d’esprit de la Renaissance. N’oublions pas que le grand Sinan était contemporain de Michel ange, Vignole et Palladio.
On dénote à l’évidence dans les plans de ses mosquées une application essentielle de la théorie pythagoricienne des carrés tournant dans un cercle. Le volume intérieur unique est agrandi au maximum visuel pour tendre vers le cube, volume parfait, par l’adjonction de demi-coupoles étagées en cascades. Vu de l’extérieur l’effet d’ascension pyramidale est saisissant. Un tel génie du volume surprend encore de nos jours.
Plus la forme concave est légère et plus la forme convexe qui lui correspond est pesante ; impacts opposés d'une même enveloppe. À la lourdeur extérieure de cet empilage de mamelons que constituent les coupoles, il oppose, trait de grâce et de génie, un espace vide plus important encore, l'espace imaginaire délimité par les minarets. L'équilibre est alors satisfait. Cet espace virtuel est tout ; supprimez les quatre crayons pointés vers le ciel et les dômes non contrariés disparaissent dans la silhouette urbaine générale. Magnifique illustration d'une complémentarité tendant à l'harmonie.
Istamboul dont les murailles romaines puis ottomanes contenaient quelques 500 000 habitants, musulmans juifs et chrétiens, bien que progressivement modernisée, présente toujours l'aspect global de cette ville de bois chaotique qu'elle a longtemps été avec laquelle les seuls grands édifices bâtis par les sultans forment un contraste total. La plupart du temps édifiées sur des lignes de crête, les silhouettes des mosquées se découpent toujours sur le ciel depuis les principaux points de vue et participent intensément à l'image magique de cette cité.
Josette :
C’est à ce même Londra-camping d’Istanboul que nous avons fait la connaissance d’un chauffeur de poids lourd de Cournonterral planté là depuis une semaine dans l’attente de recevoir des pièces mécaniques de dépannage. C’est en voyant sa plaque d’immatriculation 34, du même département que nous, que nous avons sympathisé. Peut-être qu’en France nous ne lui aurions même pas adressé la parole mais j’ai l’impression que l’empathie augmente au fur et à mesure que la distance qui nous sépare du nid s’allonge. Bien nous en prit car cet homme, par une coïncidence étrange, me permit de faire un petit retour en arrière dans mes souvenirs.
Familier de la route d’Orient, il ne faisait plus étape désormais que dans des lieux sûrs comme ce Londra-camping connu de tous les routiers, de façon à se regrouper avec d’autres poids lourds faisant la même route. Ils pouvaient ainsi se surveiller mutuellement depuis qu’il s’était fait voler les roues arrière de sa remorque en traversant la Turquie lors d’un voyage précédent. Endormi dans la cabine du tracteur il ne s’était rendu compte de rien. Ce n’est qu’au matin, en faisant sa tournée de vérification pendant que le moteur chauffait, qu’il avait découvert que ses trains jumelés droit et gauche avaient chacun été délesté de ses roues extérieures. Son essieu arrière avait été posé proprement sans bruit ni secousse sur un tas de cailloux.
Des anecdotes de sa vie de transporteur routier international, il en avait à raconter, et il en vint à nous parler de Josette, la célèbre Josette, l’incontournable Josette connue de tous les routards et bédouins de Syrie, d’Iran d’Afghanistan et d’ailleurs. Dans un fulgurant flash-back je revis instantanément l’imposante Josette. Mais oui, je l’avais connue moi aussi !
Mon père, qui avait travaillé à l’aménagement touristique des caves de Roquefort m’avait emmené à plusieurs reprises manger dans son restaurant aveyronnais préféré chez Andrieu à Saint Georges de Luzençon. Pendant que les parents s’affairaient aux cuisines, Josette, la fille de la maison, servait les clients en salle et en terrasse. Une véritable Madelon, imposante de taille et de rondeurs qui n’hésitait aucunement à donner gaillardement la répartie aux remarques salaces des chauffeurs routiers attablés. Certains venaient de loin et brûlaient même les étapes parfois pour avoir le plaisir d’arriver ici à l’heure de l’apéro et avoir la faveur de taquiner Josette qui était devenue à force une légende vivante régionale.
Et puis un jour : plus de Josette, envolée ! Elle avait disparu du décor. Mon père n’eut aucun mal à apprendre qu’un routier l’avait enlevée à sa famille pour l’emmener on ne sait où. Seul, de temps à autre, quelque routard de passage donnait de ses nouvelles qui venaient de l’autre bout de l’Europe. En son absence, le restaurant dépérissait, les transports internationaux ne s’arrêtaient plus à St Georges. Fin du retour en arrière.
Et là, je la retrouve dans la bouche de ce camionneur qui me raconte la suite de son histoire. Libérée de la tutelle parentale, Josette avait passé son permis poids lourds dès 1967 et était entrée au service d’une compagnie de transport de bois avec son premier Berliet. Ensuite elle avait augmenté son rayon d’action et convoyé des primeurs sur l’Angleterre au volant d’un Mercedes puis était entrée chez Méditir, où sa principale activité était la messagerie sur la Grèce. En 1972, ce fut le début de la grande aventure du Moyen-Orient. À la suite d’une intervention chirurgicale, elle s’était un peu calmée pour ne plus faire que des livraisons de carburant à Saint-Flour. Mais le temps lui semblait long, très long et les grands espaces lui manquaient. Alors en 1976, elle intégra l’entreprise Calsat à Rodez et au volant d’un Volvo puis de nombreux Mercedes tractant des citernes alimentaires et d’hydrocarbures, elle sillonna à nouveau les routes d’Europe et plus particulièrement de Grèce et de Turquie. Son passage ne passait inaperçu nulle part. Grâce à la cibi, ce tout premier réseau social du monde, tous les camionneurs savaient où et quand rencontrer Josette à l’étape pour des retrouvailles toujours bien arrosées. Elle n’avait rien perdu parait-il de ses habitudes d’acorte tavernière.
Un jour, notre interlocuteur, qui faisait lui aussi la même route en sens inverse, voit son camion rouge arrêté en plein désert de Syrie. Du plus loin qu’il l’aperçoit, la solidarité légendaire des hommes de la piste lui intime de lui porter secours. Arrivé à proximité, il constate qu’un groupe de Bédouins à quatre pattes est en train d’examiner attentivement et en silence ce qu’il se passe sous le camion. Se penchant à son tour, il découvre Josette, en tenue ultralégère, couchée sur le dos, en train de purger un carter d’huile récalcitrant. Toute à son affaire, elle ne s’était pas sentie observée par tout ce petit monde qui se rinçait l’œil sur ses rondeurs mises à nu. Furieuse, elle se lança dans une longue vocifération des injures arabes les plus adaptées à la situation mais le temps de s’extraire de sa position, les nomades étaient déjà en train de disparaître à l’horizon en courant pour échapper à sa vindicte. Elle était devenue l’Aveyronnaise la plus célèbre du petit monde de la route d’Orient.
Difficultés de la langue grecque :
Un autre apothicaire grec allait être le jeu d’une anecdote savoureuse à raconter plus tard à la veillée à nos petits-enfants. Gilbert, très discret sur le sujet, me demande un jour de l’accompagner dans une pharmacie de Thessalonique car il n’est pas sûr, me dit-il, de maîtriser suffisamment bien la langue pour se faire comprendre du « pharmakopoios. » En tâchant de l’aider, je voulais surtout éviter de l’entendre prononcer les phrases toutes prêtes de son « lexikon » de voyage qui sont parfois complètement hors sujet. Dans son empressement à vouloir communiquer et se faire comprendre il serait capable d’employer à tort et à travers certaines formules sorties de leur contexte.
Il lui était déjà arrivé de semer la panique un soir dans une taverne de pêcheurs sous l’effet d’une trop forte dose d’ouzo. Il avait répété à qui voulait l’entendre une phrase apprise par cœur dans son manuel du parfait touriste. C’était la réponse d’une réceptionniste d’hôtel qui à la question : « avez-vous des chambres ? » avait répondu à son client : « j’en ai deux sur le devant et trois sur le derrière. » Phrase qu’il prononçait parfaitement pour s’entraîner à avoir une bonne élocution et répétait à tout bout de champ dans n’importe quelle circonstance. Cette fois, il était à jeun et avait emporté avec lui son minidictionnaire de dialogues préfabriqués.
Nous entrons dans une officine vieillotte où, dès la porte refermée sur la sonnaille métallique qui vient de signaler notre intrusion, nous échappons aux bruits de la rue et de la circulation. C’est toujours préférable de s’expliquer maladroitement dans le silence qu’au milieu de la rumeur publique et des klaxons. Le magasin est vide de clientèle, tant mieux ! Un homme est là, seul. Gilbert qui a bien révisé sa leçon, s’approche de lui et à voix basse lui demande s’il avait bien des « profylaktika ». L’homme lui sourit et le fait répéter. Peut-être qu’il n’a pas très bien prononcé le mot qui correspond en français à préservatif. Qu’à cela ne tienne, il se saisit du dictionnaire, l’ouvre à la page marquée et pose son doigt sur le mot écrit en caractères cyrilliques cette fois. L’homme se penche, lit, et lui adresse un sourire entendu. Oui, il a compris. À sa façon de plisser les yeux et de lui adresser un regard coquin, je vois bien qu’il est sur la bonne longueur d’onde mais il ne bronche pas pour autant. J’ai assisté à toute la scène et je pense que la communication est bien passée mais le potard reste toujours planté là. Je m’apprête à m’approcher d’eux pour tenter de comprendre son absence de réaction quand le pharmacien en blouse blanche sort de son arrière-boutique, les lunettes sur le front, se place derrière son comptoir et tend une fiole à l’interlocuteur de Gilbert. Dans son application à bien vouloir se faire comprendre sur un sujet aussi délicat, il s’était adressé à un simple client entré avant lui dans le magasin et qui attendait l’arrivée de l’apothicaire.
La chouette d’Athéna :
La route est longue et c’est très tardivement que nous atteignons Corinthe, fourbus. Tous les enfants dorment déjà dans les camions. Où allons-nous atterrir pour passer cette nouvelle nuit au pays des Dieux ? La lune est pleine et la nuit claire. C’est alors que l’idée saugrenue me vient de profiter de la situation pour rendre une visite nocturne au tombeau d’Agamemnon ce héros homérique, chef des Achéens. Le contexte se prête au mystère. Il se trouve en pleine campagne à Mycènes et la nuit les guides qui accompagnent les touristes seront chez eux. En effet, le parking de la colline de Panagista est désert. Je connais le site pour l’avoir déjà visité. Le petit sentier de maquis qui y mène est bien interdit par un grillage métallique mais en le contournant à l’opposé de l’entrée nous trouvons la partie affaissée par manque d’entretien que nous cherchons. Pour l’instant nous n’avons pas besoin de nos lampes, la lune suffit à éclairer les cailloux du chemin. Je suis parti avec Sylvie, Nicole et nos quatre aînés. Gilbert que l’antiquité n’intéresse que moyennement a accepté de garder les plus petits aux camions.
À part le crissement des cailloux sous nos pieds, le silence est complet et nous parlons même à voix basse comme si quelqu’un risquait d’être le témoin de notre intrusion. Les enfants sont conscients d’avoir bravé un triple interdit. D’abord celui d’être dehors en pleine nuit dans un endroit inconnu. Ensuite, celui de frauder en pénétrant sur un site protégé sans autorisation. Enfin de se trouver dans un endroit où peuvent rôder les âmes des héros antiques dont nous leur avons raconté les exploits pour agrémenter leur voyage. Ils jouent le jeu et c’est à pas de loup que nous abordons la longue flaque de lumière du corridor d’entrée luisant sous la lune. L’impression est saisissante. Nous avançons, hésitants entre ces deux immenses murs cyclopéens, dans ce couloir rectiligne qui entame la colline comme un coup de sabre géant. Nous parcourrons très lentement les 36 mètres de l’espace à franchir à découvert jusqu’au porche d’entrée, tous nos sens en éveil. Les enfants se tournent de tous côtés pour ne rien laisser échapper à leurs yeux émerveillés. On sent planer l’ambiance tendue d’une attente de découverte. Là-bas, au fond, la porte monumentale surmontée de son triangle de décharge nous invite à nous approcher. Ses deux piédroits inclinés délimitent la zone noire du caveau, cette haute voûte ogivale de quinze mètres bâtie à l’intérieur de la montagne. Avant de franchir le dernier pas entre le monde des vivants et le monde des morts, nous nous arrêtons un instant sur le seuil pour allumer nos lampes.
C’est à ce moment précis qu’un énorme hurlement lugubre retentit au-dessus de nous, nous pétrifiant sur place. Amplifié par la voûte, il résonne un long moment des deux côtés, à l’intérieur et à l’extérieur de la crypte, suivi du frottement soyeux des ailes d’un grand-duc qui gicle par l’orifice triangulaire en s’éloignant vers la lune dans une longue plainte. Les enfants, toujours en état d’émerveillement n’ont pas compris la réalité de la situation. Ils sont glacés d’effroi, prêts à croire que tous les êtres de la mythologie grecque n’attendaient que ce signal de la chouette d’Athéna, pour surgir de ce noir intense. Impossible de les faire avancer d’un pas de plus vers l’intérieur. Nous reviendrons demain au grand jour pour démystifier l’endroit et leur faire admirer la puissante architecture de cet ouvrage de 3 300 ans d’âge.
Le moine des Météores :
Nous pénétrons maintenant au cœur de la Thessalie car c’est là que se trouve l’un des paysages les plus étonnants qu’il m’ait été donné de voir et je tiens à y retourner. Les Météores sont un de ces endroits privilégiés où l’on se sent à sa juste place : plus haut que la nature et juste au-dessous des dieux. L’origine de leur nom en dit long sur l’impression qu’ils donnent : méta-aéro : suspendu en l’air !
D’énormes rochers se dressent vers le ciel pour former un décor fantastique. De splendides blocs gris aux formes arrondies surgissent du sol pour former un ensemble unique en son genre. C’est un univers minéral altier mais doux, impressionnant et malgré tout accueillant. Cette grandiose architecture naturelle, imposante, a dû de tout temps attirer les ascètes en quête de sérénité. Les crevasses de ces montagnes ont servi de refuge à ces hommes au sein même de la terre-mère et au contact de sa nudité. Le spectacle tranquille de ces masses pachydermiques a favorisé certainement l’évasion de leur esprit dans sa recherche de l’absolu vers ces hauts lieux où demeurent les forces spirituelles.
C’est ainsi que dès le IX° siècle avant J.-C., des ermites de provenances diverses sont venus se fixer aux Météores et s’y intégrer. Indépendants, isolés, ils s’accrochent sur les falaises, à flanc de rocher ou dans des abris creux aménagés sommairement. Certains parviennent à gravir ces mastodontes de pierre et s’installent sur leur dos. De cette époque des vestiges subsistent encore, véritables nids d’aigle agrippés aux parois et réutilisés pendant des siècles. Ces alvéoles de pierre peu profondes sont prolongées par des plateformes de bois en encorbellement sur le vide, soutenues par des structures squelettiques de poutres et de branches. C’est un véritable défi aux lois de la pesanteur et de la résistance des matériaux. On les dirait collées au rocher sur plusieurs étages successifs. Là-dessus, des huttes rudimentaires de planches abritaient la vie quotidienne de ces adeptes de la solitude. Des échelles de bois judicieusement articulées leur assuraient une liaison avec le sol dix à trente mètres plus bas. L’essentiel de leurs maigres besoins était monté à la poulie à l’aide de cordages. Dans le ciel et le vent ils vivaient là leur foi contemplative.
Comment les premiers moines grimpeurs sont-ils montés là-haut ? Nul ne le sait ! Aucune trace, aucun document, ne permet de reconstituer cette première ascension sur les rochers vierges. Les historiens en sont réduits à des hypothèses : grands arbres aujourd’hui disparus, cerfs-volants, mâts d’escalade, etc. La seule certitude que nous ayons c’est qu’ils l’ont fait et qu’ils l’ont bien fait. La plupart de ces plateformes encore visibles sont aujourd’hui inaccessibles de par la vétusté de leurs échelles de bois et de corde. Pourtant les pièces noueuses de bois dur, assemblées intelligemment sont bien là, enfoncées par des coins dans des trous creusés au bon endroit dans la roche, avec une économie de moyens considérable. La foi qui habituellement déplace les montagnes, leur aurait-elle donné des ailes ? Mystère !
De ces tanières où ils étaient perchés, ces audacieux anachorètes charpentiers descendaient chaque dimanche assister à la messe qu’ils ne pouvaient célébrer eux-mêmes dans la petite église de Doupiani qui subsiste encore aujourd’hui. Au cours de ces rassemblements, ils eurent alors conscience « qu’un frère aidé d’un autre frère était comme une ville fortifiée ». Il en naquit la première commune monastique des Météores qui portait le nom de cité : « Cité de Stagi ». Et c’est aux alentours de l’an 1350 que s’organisèrent les différentes cénobies qui commencèrent alors la construction d’importants monastères sur les différents rochers de ce microcosme. Six d’entre eux sont parvenus intacts jusqu’à nous et quatre sont encore utilisés par les communautés orthodoxes d’hommes ou de femmes.
Ils se visitent maintenant aux heures qui ne troublent pas les activités monastiques et c’est bien entendu dès dix heures du matin la ruée des cars de touristes dont le contenu se précipite à l’assaut des escaliers taillés dans le rocher. Ils vibrent comme des ruches jusqu’à cinq heures du soir, où le dernier autobus reparti vers la ville proche de Kalambaka, ils retrouvent enfin l’apaisement qui leur est dû.
Nous avions bien compris que pour ressentir véritablement l’ambiance de recueillement qui doit être la leur, c’est en dehors de ces moments qu’il faut y venir. En y montant à pied, le soir, par un de ces anciens sentiers encore utilisés sur lesquels on rencontre des tortues vagabondes. On y voit petit à petit rougir au soleil couchant les façades rigides d’Agios Nikolaos et de Roussanou pour arriver à la tombée de la nuit devant la grande tranchée qui nous sépare du couvent de Warlaam et du Grand Météore. Là, nous écoutons dans le calme du soir, les voix sereines des moines entonner les chants orthodoxes d’une gravité et d’une résonance extraordinaires. Au petit matin, dans la fraîcheur d’un soleil cru, s’incrustent les petits bruits familiers du réveil du couvent : une porte qui grince, des pas tranquilles sur le rocher, une poulie qui crie, un appel discret, une cloche, des voix et enfin des chants. Tous ces sons coulent doucement, sans agressivité et permettent de goûter un peu de la saveur de leur quotidien. Mais ce charme sera rompu dès l’arrivée des premières voitures et des premiers visiteurs.
Cette année-là nous avons passé la nuit dans nos camions stationnés en bord de route au pied du monastère d’Agios Nikolaos car j’avais appris que c’est celui qui abrite les plus belles fresques murales du XV° siècle. Malheureusement il est désaffecté et seul y monte chaque jour un pope chargé de le faire visiter aux rares touristes assez sportifs pour grimper jusqu’à lui.
Justement le voici qui arrive ! Un triporteur pétaradant s’arrête devant nous et de sa benne descend en retroussant sa soutane, un gros pope ventru et barbu à souhait. Le conducteur l’aide à décharger quelques cartons de bière au bord de la route et repart dans un nuage de fumée. Nous sommes ses premiers clients. Nicole, qui a pris quelques cours de grec à Montpellier, se charge de lui expliquer notre souhait de visiter le monastère dont il a la garde. Mais apparemment, il ne s’intéresse pas à son discours et se précipite vers moi pour me serrer dans ses bras et me souhaiter la bienvenue. Il nous fait comprendre que nous pouvons l’aider à transporter ses colis jusqu’en haut. Il confie à Nicole un carton sous chaque bras puis m’agrippe par la manche et m’entraîne dans le petit sentier escarpé aux emmarchements sculptés dans la roche qui conduit au monastère. Je saisis un paquet moi aussi mais il me le fait poser en m’expliquant que la « gynéca » s’en chargera.
Et nous gravissons, bras dessus bras dessous, l’escalier scabreux qui conduit jusqu’à la porte bardée de fer qui constitue l’unique entrée du monastère. La tour du « vrizoni » avec son treuil et son filet pendu dans le vide ne sert plus aujourd’hui si ce n’est qu’à compléter le décor. Au-dessus de nous de grands balcons de bois suspendus sur les façades sont sans doute des réminiscences de ces plateformes vertigineuses des premiers ermitages solitaires. Il fait déjà chaud et mon moine transpire à grosses gouttes. Je me retourne de temps à autre pour apercevoir Nicole, derrière nous, qui peine à porter ses colis mais à chaque fois il me prend le bras et me montre le chemin devant nous.
Aussitôt la porte franchie, il m’entraîne vers le sanctuaire qui contient les célèbres fresques, objets de ma curiosité et ferme la porte à clé derrière nous. Il est tout rouge et souffle comme un bœuf. Puis il me prend amicalement par l’épaule et me raconte en les montrant du doigt toute l’hagiographie présente sur les murs et les voûtes. Il oublie complètement que je suis incapable de comprendre un traître mot de ses explications techniques. C’est vrai que ces fresques sont admirablement conservées mais j’ai un autre souci concernant son comportement envers moi. Un doute m’habite lorsqu’il me fait signe d’approcher pour voir le magnifique panorama d’une fenêtre basse dans l’embrasure de laquelle il m’a précédé. C’est juste au moment où je dois m’accroupir que mon doute devient une certitude et que je lui signifie mon refus d’un geste significatif. Il repart alors du côté opposé pour ouvrir la porte à Nicole qui tambourine et ne comprend pas pourquoi nous l’avons laissée dehors. Déconfit et furieux d’avoir échoué dans sa tentative d’aventure sentimentale, nous le voyons passer en trombe devant nous et disparaître dans les couloirs. Nous ne le reverrons plus.
Mon histoire pourrait s’arrêter là mais elle a une suite. À l’automne suivant, à Montpellier, je prends un auto-stoppeur à bord de ma voiture. Il s’agit d’un homme très cultivé qui m’apprend qu’il voyage sans cesse pour assurer la liaison entre différentes communautés religieuses. Il est moine bénédictin et rentre d’un séminaire œcuménique en Grèce dans le cadre d’un rapprochement entre les églises catholique et orthodoxe. Et nous en venons, bien sûr, à parler de la Grèce où je me trouvais encore deux mois auparavant. Je lui avoue mon admiration inconditionnelle pour les monastères des Météores quand il me questionne :
« Mais vous, en tant qu’architecte, vous devez connaître celui d’Agios Nikolaos, il est très peu fréquenté car les cars de touristes ne s’y arrêtent pas, alors que c’est celui qui possède les peintures murales les plus intéressantes ».
Je lui explique alors que j’ai pu bénéficier d’une visite particulière en compagnie de son gardien. Après une seconde d’hésitation il me déclare d’un air malicieux :
« Et vous n’avez pas eu de problème avec lui ? ».
Devant l’embarras de ma réponse, il poursuit :
« Eh oui, nous le savons, nous avons dû l’isoler là car il avait du mal à s’intégrer avec les frères des autres monastères. Que voulez-vous c’est un garçon qui déborde d’affection ! »
Kalinicta (Bonne nuit)
Nous roulons cette fois sur un chemin caillouteux qui longe la rive nord du golfe de Corinthe. Avec cette chaleur, nos deux camionnettes soulèvent un nuage de poussière qui doit être visible depuis l’autre rive. C’est Gilbert qui a choisi cette voie pour satisfaire notre besoin maladif de fuir les sites trop touristiques. Avec les difficultés de cette piste cahoteuse, nous sommes assurés de n’y rencontrer que des autochtones de la plus pure souche. Un vieux panneau de bois nous a indiqué un port qui ne figure même pas sur la carte et qui, comme de nombreux autres endroits en Grèce, porte le nom d’Aghios-Nikolaos.





























