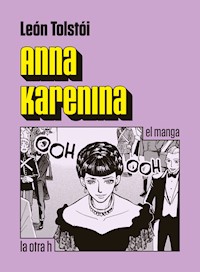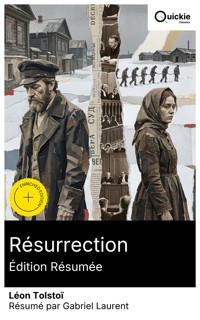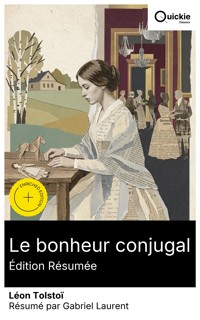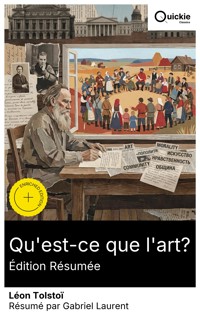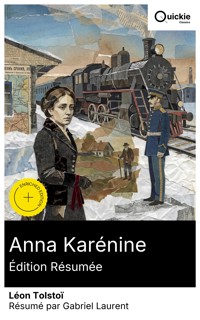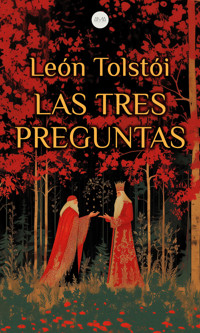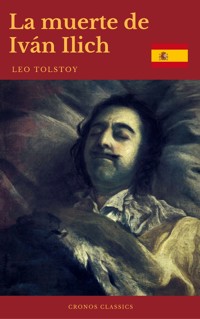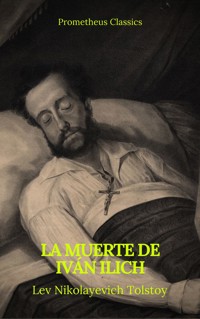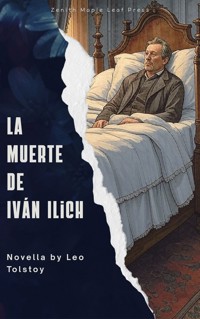Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Récit d'un voyage mouvementé de Russes égarés dans " le territoire des Cosaques du Don, près de Novotcherkask ", sous une tempête de neige, la nuit. L'ouvrage comprend aussi : (1) Le petit cierge, (2) Histoire vraie, (3) D'où vient le mal, (4) Le filleul, (5) Les deux vieillards, (6) Le grain de blé, (7) Les pêches, (8) Lucerne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une tourmente de neige
Une tourmente de neige-Une tourmente de neigeLe petit cierge – Conte de PâquesHistoire vraieD’où vient le malLe filleul – Légende populaireLes deux vieillardsLe grain de bléLes pêchesLucernePage de copyrightUne tourmente de neige
Léon Tolstoï
-Une tourmente de neige
I
Vers sept heures du soir, après avoir bu du thé, je quittai le relais. J’ai oublié son nom, mais c’était, je m’en souviens, dans le territoire des Kosaks du Don, près de Novotcherkask.
Il commençait déjà à faire nuit lorsque, me serrant dans ma chouba et m’abritant sous le tablier, je m’assis à côté d’Aliochka dans le traîneau. Derrière la maison du relais, il semblait qu’il fît doux et calme. Quoiqu’on ne vît pas tomber la neige, pas une étoile n’apparaissait, et le ciel bas pesait, rendu plus noir par le contraste, sur la plaine blanche de neige qui s’étendait devant nous.
À peine avions-nous dépassé les indécises silhouettes de moulins dont l’un battait gauchement de ses grandes ailes, et quitté le village, je remarquai que la route devenait de plus en plus malaisée et obstruée de neige. Le vent se mit à souffler plus fort à ma gauche, éclaboussant les flancs, la queue et la crinière des chevaux, soulevant sans répit et éparpillant la neige déchirée par les patins du traîneau et foulée par les sabots de nos bêtes.
Leurs clochettes se moururent. Un petit courant d’air froid, s’insinuant par quelque ouverture de la manche, me glaça le dos, et je me rappelais le conseil que le maître de poste m’avait donné de ne point partir encore, de peur d’errer toute la nuit et de geler en route.
— N’allons-nous pas nous perdre ? dis-je au yamchtchik.
Ne recevant pas de réponse, je lui posai une question plus catégorique :
— Yamchtchik, arriverons-nous jusqu’au prochain relais ? Ne nous égarerons-nous pas ?
— Dieu le sait ! me répondit-il sans tourner la tête. Vois comme la tourmente fait rage ! On ne voit plus la route. Dieu ! petit père !
— Mais dis-moi nettement si, oui ou non, tu espères me conduire au prochain relais, repris-je ; y arriverons-nous ?
— Nous devons y arriver… dit le yamchtchik.
Il ajouta quelques paroles que le vent m’empêche d’entendre.
Retourner, je ne le voulais pas ; mais, d’un autre côté, errer toute la nuit, par un froid à geler, en pleine tourmente de neige, dans une steppe dénudée comme l’était cette partie du territoire des Kosaks du Don, cela manquait de gaieté.
De plus, quoique, dans cette obscurité, je ne pusse pas bien examiner le yamchtchik, je ne sais pourquoi il me déplaisait et ne m’inspirait pas la moindre confiance. Il était assis au milieu du traîneau ; sa taille était trop haute, sa voix trop nonchalante, son bonnet, un grand bonnet dont le sommet ballottait, n’était point d’un yamchtchik ; il stimulait ses chevaux, non point à la manière usitée, mais en tenant les guides dans les deux mains et comme un laquais qui aurait pris la place du cocher ; et surtout ses oreilles qu’il cachait sous un foulard… Bref, il ne me plaisait guère, et ce dos rébarbatif et voûté que je voyais devant moi ne me présageait rien de bon.
— Pour moi, dit Aliochka, il vaudrait mieux retourner ; il n’y a rien d’amusant à s’égarer.
— Dieu ! Petit père ! vois-tu quelle tourmente ? On ne voit plus trace de route. Ça vous aveugle les yeux… Dieu ! Petit père ! grognait le yamchtchik.
Un quart d’heure ne s’était pas encore écoulé, lorsque le yamchtchik arrêta ses chevaux, confia les guides à Aliochka, retira gauchement ses jambes de son siège, et, faisant craquer la neige sous ses grandes bottes, se mit en quête de la route.
— Eh bien ! où vas-tu ? Nous nous sommes donc perdus ? lui criai-je.
Mais le yamchtchik ne me répondit pas ; il détourna son visage pour l’abriter du vent qui lui frappait dans les yeux, et s’en alla à la découverte.
— Eh bien ! quoi ? as-tu trouvé ? lui dis-je, lorsqu’il fut de retour.
— Rien ! me répondit-il brusquement, avec une impatience nuancée de dépit, comme s’il avait perdu la route par ma faute.
Et, glissant lentement ses grandes jambes dans sa chancelière, il disposa les guides dans ses moufles gelées.
— Qu’allons-nous faire, maintenant ? demandai-je lorsque nous nous fûmes remis en route.
— Et que faire ? Allons où Dieu nous poussera.
Nous recommençâmes à courir du même petit trot, tantôt sur la croûte glacée qui craquait, tantôt sur la neige qui s’éparpillait et qui, en dépit du froid, fondait presque aussitôt sur le cou. Le tourbillon d’en bas allait toujours en augmentant, et d’en haut commençait à tomber une neige rare et sèche.
Il était clair que nous allions Dieu savait où, car, après un quart d’heure de marche, nous n’avions pas rencontré une seule borne de verste.
— Eh bien ! qu’en penses-tu ? fis-je au yamchtchik. Arriverons-nous jusqu’au relais ?
— Auquel ? Nous regagnerons celui que nous venons de quitter, si nous laissons les chevaux libres ; ils nous ramèneront. Quant à l’autre, c’est peu probable, et nous risquons de nous perdre.
— Eh bien ! retournons alors, dis-je, puisque…
— Retourner, alors ? répéta le yamchtchik.
— Mais oui ! mais oui ! retourner.
Il rendit les brides, et les chevaux coururent plus vite.
Quoique je n’eusse point senti le traîneau tourner, le vent changea ; bientôt, à travers la neige, nous aperçûmes des moulins.
Le yamchtchik recouvra un peu d’énergie et se mit à causer.
— Il n’y a pas longtemps, disait-il, c’était aussi par une tourmente, ils venaient de l’autre relais, et ils se virent obligés de coucher dans les meules… Ils ne furent rendus que le matin… Il est heureux encore qu’ils aient trouvé des meules, car autrement ils se seraient tous gelés : il faisait un froid !… Songez que, malgré les meules, un d’eux s’est gelé les pieds et qu’il est mort en trois semaines.
— Mais à présent, le froid est supportable, il fait plus doux, fis-je : on pourrait peut-être aller.
— Doux, oui, il fait doux, mais la tourmente !… Maintenant que nous lui tournons le dos, elle nous semble moins terrible, mais elle fait rage toujours. On pourrait l’affronter avec un coullier ou quelque autre, parti à ses risques et périls ; car ce n’est pas peu de chose que de geler son voyageur : comment pourrais-je répondre de Votre Honneur ?
II
En ce moment on entendit derrière nous les clochettes de plusieurs troïkas : elles nous eurent bientôt rejoints.
— C’est la cloche des coulliers, dit mon yamchtchik, il n’y en a qu’une seule de ce genre au relais.
La cloche de la première troïka rendait en effet un son remarquablement joli. Le vent nous l’apportait très clairement, pur, sonore, grave et légèrement tremblée. Comme je l’appris par la suite, c’était une invention de chasseur : trois clochettes, une grande au milieu, avec un son qu’on appelle cramoisi, et deux petites, choisies dans la tierce. Cet accord de tierces et de quinte tremblée qui résonnaient dans l’air était d’un effet singulièrement saisissant et d’une étrange beauté au milieu de cette steppe solitaire et désolée.
— C’est la poste qui court, dit mon yamchtchik, quand la première troïka fut à côté de nous… Et dans quel état se trouve la route ? Peut-on passer ? cria-t-il au dernier des yamchtchiks.
Mais celui-ci stimula ses chevaux sans répondre.
Les sons de la cloche s’éteignirent brusquement, emportés par le vent, aussitôt que la poste nous eût dépassés.
Sans doute mon yamchtchik éprouva quelque honte :
— Et si nous allions, barine ? me dit-il. D’autres y ont bien passé. Et d’ailleurs leur trace est toute fraîche.
J’y consens ; nous faisons de nouveau face au vent, et nous glissons en avant dans la neige profonde. J’examine la route par côté, pour ne point perdre la trace laissée par les traîneaux de poste.
Pendant deux verstes, cette trace apparaît visiblement ; puis je ne remarque plus qu’une légère inégalité à l’endroit où ont mordu les patins.
Bientôt il me devient impossible de rien distinguer : est-ce la trace des traîneaux ? Est-ce tout simplement une couche de neige amoncelée par le vent ? Mes yeux se fatiguent de cette fuite monotone de la neige sur les arbres, et je me mets à regarder droit devant moi.
La troisième borne de verste, nous la voyons encore, mais la quatrième se dérobe. Et, comme auparavant, nous allons dans le vent et contre le vent, à droite et à gauche, nous égarant si bien, que le yamchtchik prétend que nous sommes fourvoyés à droite, moi je soutiens que c’est à gauche, tandis qu’Aliochka démontre que nous tournons le dos au but.
À plusieurs reprises nous nous arrêtons. Le yamchtchik dégage ses grands pieds et part à la recherche de la route, mais sans succès. Moi-même je me dirige du côté où je pensais la retrouver ; je fais six pas contre le vent, et j’acquiers la certitude que partout la neige étend ses blanches couches uniformes, et que la route n’existait que dans mon imagination.
Je me retournai : plus de traîneau.
Je me mis à crier : « Yamchtchik ! Aliochka ! » mais je sentais que ces cris, à peine sortis de ma bouche, le vent aussitôt les emportait quelque part dans le vide. Je courus à l’endroit où j’avais laissé le traîneau : il n’était plus là. J’allai plus loin, rien. Je rougis de me rappeler le cri désespéré, suraigu, que je poussai encore une fois : « Yamchtchik ! » tandis que le yamchtchik était à deux pas. Il surgit tout à coup devant moi, avec sa figure noire, un petit knout, son grand bonnet incliné sur le côté, et me conduisit au traîneau.
— Estimons-nous heureux qu’il fasse doux, dit-il ; car s’il gelait, malheur à nous !… Dieu ! Petit père !…
— Laisse aller les chevaux, ils nous ramèneront, dis-je en remontant dans le traîneau. Nous ramèneront-ils, eh ! yamchtchik ?
— Mais sans doute.
Il lâcha les guides, fouetta trois fois de son knout le korennaïa, et nous partîmes au hasard. Nous fîmes ainsi une demi-lieue.
Soudain, devant nous, retentit le son bien connu de la clochette de chasseur. C’étaient les trois troïkas de tout à l’heure, qui venaient maintenant à notre rencontre ; elles avaient déjà rendu la poste, et s’en retournaient au relais, avec des chevaux de rechange attachés par-derrière.
La troïka du courrier, dont les grands chevaux faisaient sonner la sonnette de chasseur, volait en tête. Le yamchtchik gourmandait ses chevaux avec entrain. Dans le traîneau du milieu, maintenant vide, s’étaient assis deux autres yamchtchiks, qui parlaient gaiement et à voix haute. L’un d’eux fumait la pipe ; une étincelle qui pétilla au vent éclaira une partie de son visage.
En le regardant, je me sentis honteux d’avoir peur, et mon yamchtchik eut sans doute la même impression, car nous dîmes tous deux en même temps : « Suivons-les ! »
III
Sans même laisser passer la troisième troïka, mon yamchtchik tourna, mais si gauchement qu’il heurta du brancard les chevaux attachés.
Trois de ceux-ci, faisant un saut de côté, rompirent leur longe et s’échappèrent.
— Vois-tu ce diable louche, qui ne voit pas où il conduit… sur les gens ! Diable !… cria d’une voix enrouée et chevrotante un yamchtchik vieux et petit, autant que j’en pus juger d’après sa voix et son extérieur, celui qui conduisait la troïka de derrière.
Il sortit vivement du traîneau et courut après les chevaux, tout en continuant de proférer contre mon yamchtchik de grossières et violentes injures.
Mais les chevaux n’étaient pas d’humeur à se laisser prendre. Un instant après, yamchtchiks et chevaux avaient disparu dans le blanc brouillard de la tourmente.
La voix du vieux retentit.
— Wassili-i-i !… amène-moi l’isabelle, car autrement on ne les rattra-a-apera pas !
Un de ses compagnons, un gars de très haute taille, sauta du traîneau, détacha et monta un des chevaux de sa troïka, puis, faisant craquer la neige, disparut au galop dans la même direction.
Nous, cependant, avec les deux autres troïkas, nous suivîmes celle du courrier qui, sonnant de sa clochette, courait en avant d’un trot relevé, et nous nous enfonçâmes dans la plaine sans route.
— Oh oui ! il les rattrapera, dit mon yamchtchik, en parlant du vieux qui s’était jeté à la poursuite des chevaux échappés… S’il ne les a pas encore rejoints, c’est que ce sont des chevaux emballés, et ils l’entraîneront à tel endroit que… il n’en sortira pas !
Depuis que mon yamchtchik trottait derrière la poste, il devenait plus gai et plus expansif ; et moi, n’ayant pas encore envie de dormir, je m’empressai d’en profiter.
Je me mis à le questionner : d’où venait-il ? qui était-il ? J’appris bientôt qu’il était de mon pays, du gouvernement de Tonia. C’était un serf du village de Kirpitchnoïé. Le peu de terre qu’il y possédait ne rapportait presque plus rien depuis le choléra. Il avait deux frères, le plus jeune était soldat. Ils n’avaient de pain que jusqu’à la Noël, et travaillaient comme ils pouvaient pour vivre. Le cadet, marié, dirigeait la maison. Quant à mon yamchtchik, il était veuf. Chaque année, il venait de leur village des artels de yamchtchiks. Lui n’avait jamais auparavant fait ce métier, et c’était pour venir en aide à son frère qu’il s’était engagé à la poste. Il vivait là, grâce à Dieu, pour cent vingt roubles en papier par an, dont cent qu’il envoyait à sa famille… Cette vie lui conviendrait assez : « Seulement, les coulliers sont trop méchants, et le monde est toujours à gronder par ici. »
— Pourquoi donc m’injuriait-il, ce yamchtchik-là ? Dieu ! Petit père ! Est-ce que je les lui ai fait partir exprès, ses chevaux ? Suis-je donc un brigand ? Pourquoi est-il allé à leur poursuite ? ils seraient bien revenus tout seuls. Il fatiguera ses chevaux et se perdra lui-même, répétait le petit moujik de Dieu.
— Qu’est-ce donc qui noircit, là-bas ? demandai-je en remarquant un point noir dans le lointain.
— Mais c’est un oboze. Voilà comment il fait bon marcher, continua-t-il quand nous arrivâmes plus près des grandes charrettes, couvertes de bâches et roulant à la file… Regarde donc, on ne voit pas un homme, tous dorment. Le cheval intelligent sait lui-même où il faut aller ; rien ne le ferait dévier… Et nous aussi, fit-il, nous connaissons cela.
Le spectacle était étrange, de ces immenses charrettes, entièrement recouvertes de bâches, et blanches de neige jusqu’aux roues, et qui marchaient toutes seules. Dans la première charrette seulement, deux doigts soulevèrent un peu la bâche neigeuse ; un bonnet en sortit quand nos clochettes résonnèrent auprès de l’oboze.
Un grand cheval pie, le cou allongé, le dos tendu, s’avançait d’un pas égal sur la route unie ; il balançait, sous la douga blanchie, sa tête et sa crinière épaisse ; quand nous fûmes à côté de lui, il dressa l’une de ses oreilles que la neige avait obstruée.
Après avoir roulé une demi-heure, le yamchtchik se tourna vers moi.
— Eh bien ! qu’en pensez-vous, barine ? Marchons-nous bien droit ?
— Je ne sais pas, répondis-je.
— Le vent soufflait d’abord par ici, le voilà maintenant par là… Non, nous n’allons pas du bon côté, nous errons encore, conclut-il d’une voix tout à fait tranquille.
On voyait que, malgré sa peur, il se sentait pleinement rassuré – en compagnie la mort est belle – depuis que nous allions en nombre ; et puis, il ne conduisait plus, il n’avait plus charge d’âmes.
C’était de son air le plus calme qu’il relevait les erreurs des yamchtchiks, comme si la chose ne l’eût pas du tout regardé.
Je remarquai effectivement que parfois la troïka de tête m’apparaissait de profil, tantôt à gauche, tantôt à droite ; il me parut même que nous tournions sur un petit espace. Du reste, ce pouvait être une pure illusion de mes sens ; c’était ainsi qu’il me semblait parfois que la première troïka montait ou descendait une pente, alors que la steppe était partout uniforme.
Au bout de quelque temps, je crus apercevoir au loin, sur l’horizon, une longue ligne noire et mouvante, et bientôt je reconnus clairement ce même oboze que nous avions dépassé. La neige couvrait toujours les roues bruissantes, dont quelques-unes ne roulaient plus ; les gens dormaient toujours sous les bâches, et le premier cheval, élargissant ses narines, flairait la route et dressait l’oreille comme tantôt.
— Vois-tu comme nous avons tourné sur place ? Nous voici revenus au même point, dit mon yamchtchik mécontent. Les chevaux des coulliers sont de bons chevaux, ils peuvent les fatiguer ainsi sans but, tandis que les nôtres seront certainement fourbus, si nous marchons de la sorte toute la nuit.
Il toussota.
— Retirons-nous donc, barine, de cette compagnie.
— Pourquoi ? Nous arriverons bien quelque part.
— Où donc arriverons-nous ? Nous allons passer la nuit dans la steppe… Vois comme cela tournoie !
J’étais surpris que, bien qu’ayant visiblement perdu la route et ne sachant plus où il allait, le yamchtchik de tête, loin de rien faire pour se retrouver, poussât des cris joyeux sans ralentir sa course, mais je ne voulais pas les quitter.
— Suis-les ! dis-je.
Mon yamchtchik obéit, mais en stimulant son cheval avec encore moins d’entrain qu’auparavant ; et il n’engagea plus de conversation.
IV
Cependant la tourmente devenait de plus en plus forte. D’en haut la neige tombait aussi, sèche et menue. Il commençait, semblait-il, à geler ; un froid plus vif piquait le nez et les joues ; plus fréquemment, sous la chouba, s’insinuait un petit courant d’air glacé, et bien vite nous nous serrions dans nos fourrures. Parfois le traîneau heurtait contre de petites pierres nues et gelées, d’où la neige avait été balayée.
Comme j’en étais à ma sixième centaine de verstes sans m’être arrêté une seule fois pour coucher, et bien que l’issue de notre fourvoiement m’intéressât fort, je fermai les yeux malgré moi et je m’assoupis. Une fois, en ouvrant la paupière, je fus frappé, à ce qu’il me sembla d’abord, par une lumière intense qui éclairait la plaine blanche ; l’horizon s’était élargi, le ciel bas et noir disparut tout à coup ; je voyais les raies blanches et obliques de la neige tremblante ; les silhouettes des troïkas de l’avant apparaissaient plus nettement. Je regardai en haut, les nuages semblaient s’être dispersés, et la neige tombante couvrait entièrement le ciel.
Pendant que je dormais, la lune s’était levée ; à travers la neige et les nuages transparents, sa clarté brillait, froide et vive. Je ne voyais distinctement que mon traîneau, mes chevaux, le yamchtchik et les trois troïkas ; dans la première, celle du courrier, se tenait toujours, assis sur le siège, un seul yamchtchik qui menait au trot rapide ; deux yamchtchiks occupaient la seconde, lâchant les guides et se faisant un abri de leurs caftans, ils ne cessaient point de fumer la pipe, à en juger d’après les étincelles. On n’apercevait personne dans la troisième troïka ; le yamchtchik dormait évidemment au milieu.
Lorsque je me réveillai, je vis pourtant le premier yamchtchik arrêter ses chevaux et se mettre en quête de la route.
Nous fîmes halte. Le vent grondait avec plus de violence ; une masse effroyable de neige tourbillonnait dans l’air.
La lueur de la lune, voilée par la tourmente, me montrait la petite silhouette du yamchtchik qui, un grand knout à la main, sondait devant lui la neige, puis, après des allées et venues, se rapprochant du traîneau dans l’obscure clarté, se remettait d’un bond sur son siège ; et de nouveau j’entendis, dans le souffle monotone du vent, les cris aigus du postillon et le tintement des clochettes.
Toutes les fois que le yamchtchik de la première troïka partait à la recherche de la route ou de meules, une voix dégagée s’élevait du second traîneau ; c’était l’un des deux yamchtchiks qui lui criait à tue-tête :
— Écoute, Ignachka ! on a tourné trop à gauche, prends donc à droite !
Ou bien :
— Qu’as-tu donc à tourner sur place ? Cours sur la neige telle quelle, et tu arriveras pour sûr.
Ou encore :
— Va donc à droite, à droite, mon frère ! Vois-tu là-bas ce point noir ? c’est sans doute une borne.
Ou :
— Peut-on s’égarer de la sorte ? Pourquoi t’égares-tu ? Détèle donc le pie et laisse-le aller en avant, il te ramènera certainement sur la route, et cela vaudra beaucoup mieux.
Quant à dételer son propre cheval, quant à chercher lui-même la route par la neige, il s’en serait bien gardé ; il ne mettait même pas le nez hors de son caftan. Et lorsque, en réponse à un de ses conseils, Ignachka lui cria de passer devant, puisqu’il savait de quel côté se diriger, le conseiller riposta que, s’il avait eu avec lui des chevaux de coullier, il serait en effet allé en avant et qu’il aurait certainement retrouvé la route, « tandis que mes chevaux, ajouta-t-il, ne marcheraient pas en tête pendant la tourmente : ce ne sont point des chevaux à cela ».
— Alors ne m’ennuie pas davantage, répondit Ignachka, en sifflant gaiement ses chevaux.
Le second moujik, assis dans le traîneau avec le conseilleur, n’adressait pas une seule parole à Ignachka et ne se mêlait en rien de cette affaire, bien qu’il ne dormît pas encore, à en juger par sa pipe inextinguible et par la conversation cadencée et ininterrompue que j’entendais pendant les haltes. Il racontait un conte.
Une fois seulement, comme Ignachka s’arrêtait pour la sixième ou septième fois, il manifesta son dépit de voir interrompre le plaisir de la course.
— Eh ! lui cria-t-il. Qu’as-tu à t’arrêter encore ? Crois-tu qu’il veut trouver le chemin ?… Une tourmente, on te dit ! À cette heure, l’arpenteur lui-même ne découvrirait pas la route. Il vaudrait mieux aller tant que nos chevaux nous porteront. Faut espérer que nous ne gèlerons pas jusqu’à la mort. Va toujours.
— C’est cela ! Et le postillon qui, l’an dernier, a gelé jusqu’à la mort ? répondit mon yamchtchik.
Celui de la troisième troïka dormait toujours. Une fois, pendant un arrêt, le conseilleur le héla :
— Philippe ! Eh ! Philippe !
Et, ne recevant pas de réponse, il remarqua :
— Ne se serait-il pas gelé ? Ignachka, tu devrais aller voir.
Ignachka, qui trouvait du temps pour tout, s’approcha du traîneau et secoua le dormeur.
— Voilà dans quel état l’a mis une seule bouteille de vodka… Si tu es gelé, dis-le alors ? fit-il en le secouant de plus belle.
Le dormeur poussa un grognement entrecoupé d’injures.
— Il vit, frères, dit Ignachka, qui revint prendre sa place en avant et de nouveau fit trotter ses bêtes, et même si rapidement que le petit cheval de gauche de ma troïka, sans cesse fouetté sur la croupe, tressautait souvent d’un petit galop maladroit.
V
Il devait être à peu près minuit, lorsque le petit vieux et Wassili revinrent avec les chevaux. Comment avaient-ils pu les rattraper, au milieu d’une steppe dénudée, par une tourmente aussi sombre ? C’est ce que je n’ai jamais pu comprendre.
Le petit vieux, agitant ses coudes et ses jambes, trottait sur le korennaïa. Il avait attaché à la bride les autres chevaux. Quand nous fûmes de front, il recommença à injurier mon yamchtchik.
— Vois-tu ce diable louche ? Vrai !
— Eh ! oncle Mitritch ! cria le conteur du second traîneau. Es-tu vivant ? Viens près de nous.
Mais le vieux était trop occupé à dévider ses injures pour répondre. Lorsqu’il lui sembla que le compte y était, il s’approcha du second traîneau.
— Tu les as donc rattrapés ? lui demanda-t-on ?
— Et comment donc ? Certainement !
On le vit abaisser sa poitrine sur le dos du cheval, puis il sauta sur la neige, courut au traîneau sans s’arrêter et s’y laissa tomber en enjambant le rebord.
Le grand Wassili reprit, sans mot dire, sa place dans le traîneau de tête avec Ignachka et l’aida à chercher la route.
— Est-il mal embouché ! Dieu ! Petit père !
Longtemps, longtemps nous glissons sans nous arrêter à travers ces déserts blancs, dans la clarté froide, transparente et vacillante de la tourmente. J’ouvre les yeux, toujours ce même bonnet grossier et ce dos couverts de neige, et cette même douga basse, sous laquelle, entre le cuir des brides, se balance, toujours à la même distance, la tête du korennaïa, avec sa crinière noire que le vent soulève à temps égaux d’un seul côté.
Par-delà le dos, à droite, apparaît toujours le même pristiajnaïa bai, à la queue nouée court, et le palonnier qui frappe régulièrement le traîneau. En bas, toujours la même neige fine que les patins déchirent, et que le vent, qui la balaye obstinément, emporte toujours de mon côté. En avant, courent toujours les mêmes troïkas. À droite et à gauche, tout est blanc, tout file devant les yeux.
C’est en vain que l’œil cherche un objet nouveau : pas une borne, pas une meule, rien, rien. Tout est blanc partout, blanc et immobile. Tantôt, l’horizon paraît indéfiniment reculé, tantôt il se resserre à deux pas. Tantôt un mur blanc et haut surgit subitement à droite et court le long du traîneau, tantôt il disparaît pour reparaître à l’avant ; il fuit, il fuit et de nouveau s’évanouit.
Regardes-tu en l’air, il te semble voir clair au premier moment, et qu’à travers le brouillard les petites étoiles scintillent. Mais les petites étoiles s’enfuient plus haut, plus haut, loin de ton regard, et tu ne vois plus que la neige qui tombe sur ton visage et sur le col de ta chouba. Immobile et uni, le ciel est partout clair et blanc, sans couleur.
On dirait que le vent change de direction. Tantôt soufflant de face, il remplit les yeux de neige ; tant soufflant de biais, il rabat rageusement sur la tête le col de la chouba, et, comme par moquerie, en soufflette le visage ; ou bien il chante par-derrière dans quelque fissure. On entend les craquements légers et continus des sabots et des patins, et le tintement mourant des clochettes, alors que nous glissons dans la neige profonde.
Parfois, quand nous allons contre le vent, quand nos traîneaux courent sur la terre gelée et nue, nous distinguons nettement le sifflement aigu d’Ignat, et les trilles de la sonnerie qui s’allient à la quinte tremblée ; cette musique égaie tout à coup la morne solitude, puis, redevenant uniforme, accompagne, avec une justesse insupportable, un motif, toujours le même, qui malgré moi chante dans ma tête.
Un de mes pieds commençait à se geler ; lorsque je me tournais pour me couvrir mieux, la neige, tombée sur mon col et sur mon bonnet, me coulait dans le dos et me faisait frissonner ; mais en somme, dans ma chouba attiédie par ma propre chaleur, je ne souffrais point trop du froid, et je me laissais aller au sommeil.
VI
Images et souvenirs défilaient rapidement devant moi.
« Le conseiller, qui crie toujours du second traîneau, quel moujik doit-ce être ?… Il doit être roux, fort, les jambes courtes, pensé-je, et semblable à Fédor Philippitch, notre vieux sommelier… »
Et je revois aussitôt l’escalier de notre grande maison, et cinq dvorovi qui, marchant péniblement, traînent un piano avec des serviettes. Je revois Fédor Philippitch qui, ayant retroussé les manches de son veston en nankin, porte une pédale, court en avant, ouvre les portes, pousse, tire par la serviette, se faufile entre les jambes, gêne tout le monde et, d’une voix affairée, ne cesse de crier :
— Tirez de votre côté, les premiers ! C’est bien cela, la queue en l’air… en l’air ; passe-la donc dans la porte, c’est cela !…