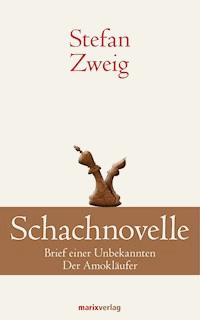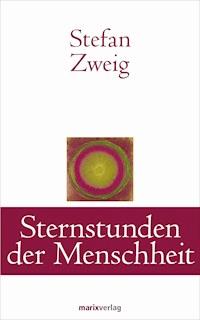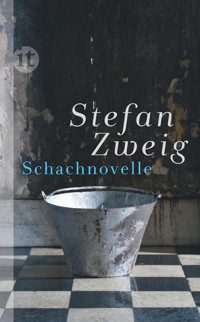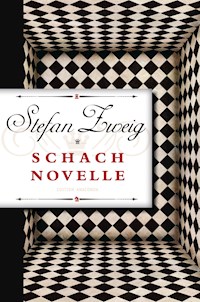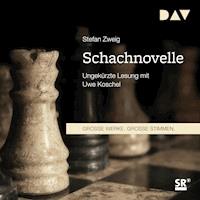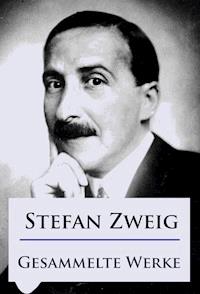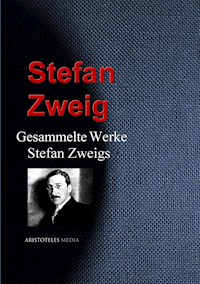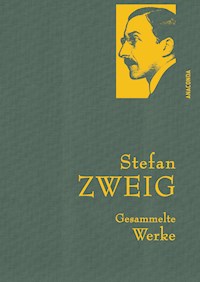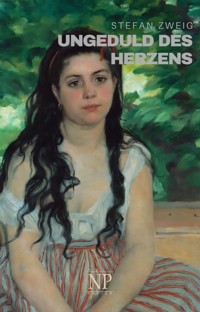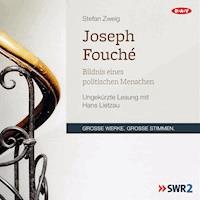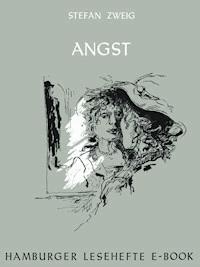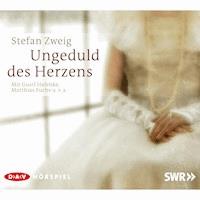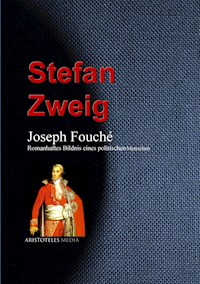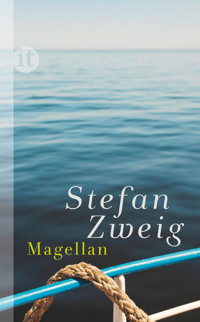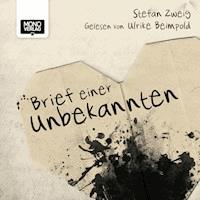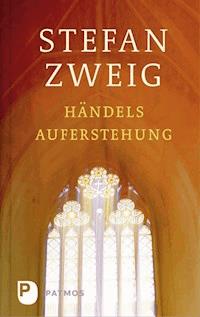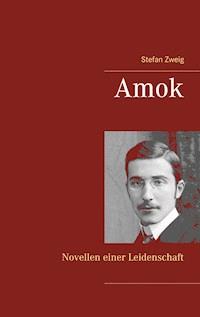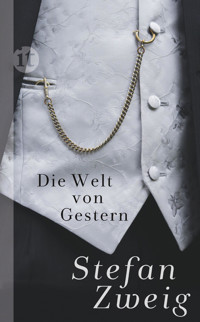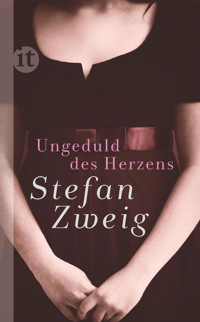Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au début du siècle, une petite pension de Monte-Carlo. Grand émoi chez les clients de l'établissement : l'épouse d'un des pensionnaires, Mme Henriette, est partie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature sans moralité. Il ne trouve comme alliée qu'une vieille dame anglaise sèche et distinguée, Mrs. C. Elle lui raconte, au cours d'une longue conversation qui constitue le cœur du récit, un épisode de sa jeunesse dont les feux mal éteints ont été ranimés par cette aventure.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ami de Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Romain Rolland, Richard Strauss, Émile Verhaeren,
Stefan Zweig a fait partie de l'intelligentsia juive viennoise, avant de quitter son pays natal en 1934, à cinquante-trois ans, en raison de la montée du nazisme. Réfugié à Londres, il y poursuit une œuvre littéraire, de biographe (Joseph Fouché, Marie-Antoinette, Marie Stuart) mais surtout d'auteur de romans et nouvelles :
Amok,
La Pitié dangereuse,
La Confusion des sentiments,
Le Joueur d'échecs. Dans son livre testament,
Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, Zweig se fait chroniqueur de cet « âge d'or » de l'Europe, et analyse ce qu'il considère comme l'échec d'une civilisation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Zweig
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME
– 1927 –
INTRODUCTION
Au début de 1942, la radio de Paris nous annonçait que « l’écrivain juif Stefan Zweig venait de se donner la mort au Brésil » – nouvelle reproduite le lendemain en trois lignes par les journaux nazis de la capitale. Et ce fut ensuite le silence complet sur ce grand et noble écrivain qui avait acquis en France une renommée égale à celle de nos meilleurs auteurs.
*
Stefan Zweig était né à Vienne, où il fit ses études, le 28 novembre 1881. À vingt-trois ans, il était reçu docteur en philosophie et obtenait le prix de poésie Bauernfeld, une des plus hautes distinctions littéraires de son pays. Il avait alors publié une plaquette de vers et une traduction des meilleures poésies de Verlaine, écrit des nouvelles et une pièce de théâtre.
Mais il jugeait « que la littérature n’était pas la vie », qu’elle n’était « qu’un moyen d’exaltation de la vie, un moyen d’en saisir le drame d’une façon plus claire et plus intelligible ». Son ambition était de voyager, « de donner à son existence l’amplitude, la plénitude, la force et la connaissance, aussi de la lier à l’essentiel et à la profondeur des choses ». En 1904, il était à Paris, où il séjourna à plusieurs reprises et où il se lia avec les écrivains de l’Abbaye, Jules Romains en particulier, avec qui, plus tard, il devait donner la magnifique adaptation du Volpone que des dizaines de milliers de Parisiens eurent la joie de voir jouer à l’Atelier et dont le succès n’est pas encore épuisé aujourd’hui. Il rendit ensuite visite, dans sa modeste demeure du Caillou-qui-Bique, en Belgique, à Émile Verhæren, dont il devint le traducteur et le biographe. Il vécut à Rome, à Florence, où il connut Ellen Key, la célèbre authoress suédoise, en Provence, en Espagne, en Afrique. Il visita l’Angleterre, parcourut les États-Unis, le Canada, le Mexique. Il passa un an aux Indes. Ce qui ne l’empêchait pas de poursuivre ses travaux littéraires, sans effort, pourrait-on penser, puisqu’il dit quelque part : « Malgré la meilleure volonté, je ne me rappelle pas avoir travaillé durant cette période. Mais cela est contredit par les faits, car j’ai écrit plusieurs livres, des pièces de théâtre qui ont été jouées sur presque toutes les scènes d’Allemagne et aussi à l’étranger… ».
Les multiples voyages de Zweig devaient forcément développer en lui l’amour que dès son adolescence il ressentait pour les lettres étrangères et surtout pour les lettres françaises. Cet amour, qui se transforma par la suite en un véritable culte, il le manifesta par des traductions remarquables de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, de son ami Verhæren, dont il fit connaître en Europe centrale les vers puissants et les pièces de théâtre, de Suarès, de Romain Rolland, sur qui il fut un des premiers, sinon le premier, à attirer l’attention des pays de langue allemande et qui eut sur lui une influence morale considérable.
Ardent pacifiste, type du véritable Européen – ce vocable qui devait servir les appétits les plus monstrueux, cacher les crimes les plus effroyables – Zweig avait été profondément ulcéré par la guerre de 14-18. En 1919, il se retirait à Salzbourg, la ville-musée « dont certaines des rues, dit Hermann Bahr – connaisseur et admirateur, lui aussi, des lettres françaises – vous rappellent Padoue, cependant que d’autres vous transportent à Hildesheim ». C’est à Salzbourg, l’ancienne résidence des princes archevêques, où naquit Mozart, qu’il nous envoyait ses messages appelés à faire le tour du monde, ces œuvres si vivantes, si riches d’émotions et de passion et qui ont nom, entre autres, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, – dont Gorki a pu dire qu’il lui semblait n’avoir rien lu d’aussi profond, – Amok, La Confusion des Sentiments, La Peur…
En moins de dix ans, Zweig, qui naguère n’avait considéré le travail « que comme un simple rayon de la vie, comme quelque chose de secondaire », publiait une dizaine de nouvelles – la nouvelle allemande a souvent l’importance d’un de nos romans – autant d’essais écrits en une langue puissante sur Dostoïewski, Tolstoï, Nietzsche, Freud, dont il était l’intime, Stendhal, Marceline Desbordes-Valmore, etc., qui témoignent de la plus vaste des cultures et permettent d’affirmer que tous ont trouvé en lui un biographe à leur mesure. Puis, suivit la série de ses écrits historiques, où il acquit d’emblée avec son Fouché l’autorité que l’on confère aux maîtres.
*
Hélas ! Hitler et ses nazis s’étaient emparés du pouvoir en Allemagne, les violences contre les réfractaires s’y multipliaient. Bientôt l’Autriche, déjà à demi nazifiée, serait envahie. Zweig part pour l’Angleterre et s’installe à Bath, dans le Somerset. Mais depuis l’abandon de la souriante demeure salzbourgeoise, son âme inquiète ne lui laissait pas de repos. Il parcourt de nouveau l’Amérique du Nord, se rend au Brésil, revient en Angleterre, fait de courts séjours en Autriche, où les nazis tourmentent sa mère qui se meurt, en France… Et la guerre éclate. Je l’entends encore au début de 40, à l’hôtel Louvois, quand nous préparions la conférence sur sa Vienne tant aimée qu’il donna à Marigny, me dire avec angoisse – lui qui ne voulait pas ignorer les plans d’Hitler, les préparatifs de toute l’Allemagne : « Vous serez battus. » Et quand les événements semblent lui donner raison, c’en est fait totalement de sa tranquillité. Il voit répandues sur l’Europe les ténèbres épaisses qu’il appréhendait tant. Il quitte définitivement sa maison de Bath et gagne les États-Unis où il avait pensé se fixer. Mais l’inquiétude morale qui le ronge a sapé en lui toute stabilité. Le 15 août 1941, il s’embarque pour le Brésil et s’établit à Pétropolis où il espérait encore trouver la paix de l’esprit. En vain. L’auteur d’Érasme, qui ressemblait par tant de côtés à l’humaniste hollandais, n’est du reste pas un lutteur. Le 22 février 1942, il rédige le message d’adieu ci-dessous :
« Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j’éprouve le besoin de remplir un dernier devoir : adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m’a procuré, ainsi qu’à mon travail, un repos si amical et si hospitalier. De jour en jour, j’ai appris à l’aimer davantage et nulle part ailleurs je n’aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l’Europe, s’est détruite elle-même.
« Mais à soixante ans passés il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d’errance. Aussi, je pense qu’il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde.
« Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux. »
Stefan Zweig
Pétropolis, 22-2-42
Le lendemain, Stefan Zweig n’était plus. Pour se soustraire à la vie, il avait recouru au gaz, suicide sans brutalité qui répondait parfaitement à sa nature. Sa femme l’avait suivi dans la mort.
A. H.
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME
Dans la petite pension de la Riviera où je me trouvais alors (dix ans avant la guerre1), avait éclaté à notre table une violente discussion qui brusquement menaça de tourner en altercation furieuse et fut même accompagnée de paroles haineuses et injurieuses. La plupart des gens n’ont qu’une imagination émoussée. Ce qui ne les touche pas directement, en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau, n’arrive guère à les émouvoir ; mais si devant leurs yeux, à portée immédiate de leur sensibilité, se produit quelque chose, même de peu d’importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. Alors ils compensent, dans une certaine mesure, leur indifférence coutumière par une véhémence déplacée et exagérée.
Ainsi en fut-il cette fois-là dans notre société de commensaux tout à fait bourgeois, qui d’habitude se livraient paisiblement à de small talks2 et à de petites plaisanteries sans profondeur, et qui le plus souvent, aussitôt après le repas, se dispersaient : le couple conjugal des Allemands pour excursionner et faire de la photo, le Danois rondelet pour pratiquer l’art monotone de la pêche, la dame anglaise distinguée pour retourner à ses livres, les époux italiens pour faire des escapades à Monte-Carlo, et moi pour paresser sur une chaise du jardin ou pour travailler. Mais cette fois-ci, nous restâmes tous accrochés les uns aux autres dans cette discussion acharnée ; et si l’un de nous se levait brusquement, ce n’était pas comme d’habitude pour prendre poliment congé, mais dans un accès de brûlante irritation qui, comme je l’ai déjà indiqué, revêtait des formes presque furieuses.
Il est vrai que l’événement qui avait excité à tel point notre petite société était assez singulier. La pension dans laquelle nous habitions tous les sept, se présentait bien de l’extérieur sous l’aspect d’une villa séparée (ah ! comme était merveilleuse la vue qu’on avait des fenêtres sur le littoral festonné de rochers), mais en réalité, ce n’était qu’une dépendance, moins chère, du grand Palace Hôtel et directement reliée avec lui par le jardin, de sorte que nous, les pensionnaires d’à côté, nous vivions malgré tout en relations continuelles avec les clients du Palace. Or, la veille, cet hôtel avait eu à enregistrer un parfait scandale.
En effet, au train de midi, exactement de midi vingt (je dois indiquer l’heure avec précision parce que c’est important, aussi bien pour cet épisode que pour le sujet de notre conversation si animée), un jeune Français était arrivé et avait loué une chambre donnant sur la mer : cela seul annonçait déjà une certaine aisance pécuniaire. Il se faisait agréablement remarquer, non seulement par son élégance discrète, mais surtout par sa beauté très grande et tout à fait sympathique : au milieu d’un visage étroit de jeune fille, une moustache blonde et soyeuse caressait ses lèvres, d’une chaude sensualité ; au-dessus de son front très blanc bouclaient des cheveux bruns et ondulés ; chaque regard de ses yeux doux était une caresse ; tout dans sa personne était tendre, flatteur, aimable, sans cependant rien d’artificiel ni de maniéré. De loin, à vrai dire, il rappelait d’abord un peu ces figures de cire de couleur rose et à la pose recherchée qui, une élégante canne à la main, dans les vitrines des grands magasins de mode, incarnent l’idéal de la beauté masculine. Mais dès qu’on le regardait de plus près, toute impression de fatuité disparaissait, car ici (fait si rare !) l’amabilité était chose naturelle et faisait corps avec l’individu. Quand il passait, il saluait tout le monde d’une façon à la fois modeste et cordiale, et c’était un vrai plaisir de voir comment à chaque occasion sa grâce toujours prête se manifestait en toute liberté.
Si une dame se rendait au vestiaire, il s’empressait d’aller lui chercher son manteau ; il avait pour chaque enfant un regard amical ou un mot de plaisanterie ; il était à la fois sociable et discret ; bref, il paraissait un de ces êtres privilégiés, à qui le sentiment d’être agréable aux autres par un visage souriant et un charme juvénile donne une grâce nouvelle. Sa présence était comme un bienfait pour les hôtes du Palace, la plupart âgés et de santé précaire ; et grâce à une démarche triomphante de jeunesse, à une allure vive et alerte, à cette fraîcheur qu’un naturel charmant donne si superbement à certains hommes, il avait conquis sans résistance la sympathie de tous. Deux heures après son arrivée, il jouait déjà au tennis avec les deux filles du gros et cossu industriel lyonnais, Annette, âgée de douze ans, et Blanche qui en avait treize ; et leur mère, la fine, délicate et très réservée Mme Henriette, regardait en souriant doucement, avec quelle coquetterie inconsciente les deux fillettes toutes novices flirtaient avec le jeune étranger. Le soir, il nous regarda pendant une heure jouer aux échecs, en nous racontant entre-temps quelques gentilles anecdotes, sans nous déranger du tout ; il se promena à plusieurs reprises, assez longtemps, sur la terrasse avec Mme Henriette, dont le mari comme toujours jouait aux dominos avec un ami d’affaires ; très tard encore, je le trouvai en conversation suspecte d’intimité avec la secrétaire de l’hôtel, dans l’ombre du bureau.
Le lendemain matin, il accompagna à la pêche mon partenaire danois, montrant en cette matière des connaissances étonnantes ; ensuite, il s’entretint longuement de politique avec le fabricant de Lyon, ce en quoi également il se révéla un causeur agréable, car on entendait le large rire du gros homme couvrir le bruit de la mer. Après le déjeuner (il est absolument nécessaire pour l’intelligence de la situation que je rapporte avec exactitude toutes ces phases de son emploi du temps), il passa encore une heure avec Mme Henriette, à prendre le café tous deux seuls dans le jardin ; il rejoua au tennis avec ses filles et conversa dans le hall avec les époux allemands. À six heures, en allant poster une lettre, je le trouvai à la gare. Il vint au-devant de moi avec empressement et me raconta qu’il était obligé de s’excuser, car on l’avait subitement rappelé, mais qu’il reviendrait dans deux jours.
Effectivement, le soir, il ne se trouvait pas dans la salle à manger, mais c’était simplement sa personne qui manquait, car à toutes les tables on parlait uniquement de lui et l’on vantait son caractère agréable et gai.
Pendant la nuit, il pouvait être onze heures, j’étais assis dans ma chambre en train de finir la lecture d’un livre, lorsque j’entendis tout à coup par la fenêtre ouverte, des cris et des appels inquiets dans le jardin, qui témoignaient d’une agitation certaine dans l’hôtel d’à côté. Plutôt par inquiétude que par curiosité, je descendis aussitôt, et en cinquante pas je m’y rendis, pour trouver les clients et le personnel dans un état de grand trouble et d’émotion. Mme Henriette, dont le mari, avec sa ponctualité coutumière, jouait aux dominos avec son ami de Namur, n’était pas rentrée de la promenade qu’elle faisait tous les soirs sur le front de mer, et l’on craignait un accident. Comme un taureau, cet homme corpulent, d’habitude si pesant, se précipitait continuellement vers le littoral, et quand sa voix altérée par l’émotion criait dans la nuit : « Henriette ! Henriette ! », ce son avait quelque chose d’aussi terrifiant et de primitif que le cri d’une bête gigantesque, frappée à mort. Les serveurs et les boys se démenaient, montant et descendant les escaliers ; on réveilla tous les clients et l’on téléphona à la gendarmerie. Mais au milieu de ce tumulte, le gros homme, son gilet déboutonné, titubait et marchait pesamment en sanglotant et en criant sans cesse dans la nuit, d’une manière tout à fait insensée, un seul nom : « Henriette ! Henriette ! » Sur ces entrefaites, les enfants s’étaient réveillées là-haut et en chemises de nuit elles appelaient leur mère par la fenêtre ; alors le père courut à elles pour les tranquilliser.
Puis se passa quelque chose de si effrayant qu’il est à peine possible de le raconter, parce que la nature violemment tendue, dans les moments de crise exceptionnelle, donne souvent à l’attitude de l’homme une expression tellement tragique que ni l’image, ni la parole ne peuvent la reproduire avec cette puissance de la foudre qui est en elle. Soudain, le lourd et gros bonhomme descendit les marches de l’escalier en les faisant grincer, et avec un visage tout changé, plein de lassitude et pourtant féroce ; il tenait une lettre à la main : « Rappelez tout le monde ! » dit-il d’une voix tout juste intelligible au chef du personnel. « Rappelez tout le monde ; c’est inutile, ma femme m’a abandonné. »