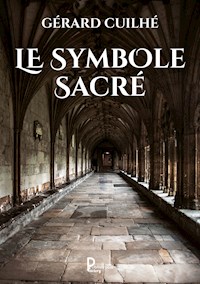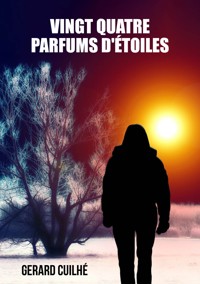
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vingt quatre. Vingt quatre nouvelles telles les heures d’un cadran qui s’égrènent en une journée somme toute banale. Ces regards croisés, plongés dans les vertiges lointains d’infini galactique…anodins ? En sommes nous certains ? Chaque trajectoire de vie trace un chemin personnel de doutes et d’interrogations. Autant de points lumineux qui scintillent dans une mer d’étoiles. Jean le poilu dans sa tranchée... Socrate au fond de sa geôle... Jupiter le chien de la maison... Tous gardent l’espoir. Pupilles d’espérance, magnifiques sphères terrestres, ces yeux se lient enfin aux profondeurs et à la beauté de leur mère, la voûte étoilée. Universalisme.....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gérard Cuilhé
Vingt quatre Parfums d’Etoiles
A MARIE
Il faut toujours viser la lune, car même en casd’échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde
Nous sommes comme des livres. La plupart des gensne voient que notre couverture, la minorité ne lit que l’introduction,beaucoup de gens croient les critiques.Peu connaîtrons notre contenu. Emile Zola
Un jour, il ne me restera plus que le silence pour teparler. Nos âmes suspendues aux étoiles regarderont nos corps s’éloigner. Dans la mort résonnera encore le battement de t’aimer. John Joos
Si tu fais un vœu, c’est parce que tu vois tomber uneétoile. Si tu vois tomber une étoile,c’est parce que tu regardes le ciel. Si tu regardes le ciel, c’est parce que tu crois encore à quelque chose. Bob Marley
ALBERT
Bataille de la Somme ( 01/07/1916 - 28/11/1916 ) - Ville d’Albert - Le 10 juillet.
Le front ne progressait pas. Les forces allemandes, moins nombreuses mais mieux entraînées, résistaient vaillamment aux assauts répétés des troupes britanniques venues en renfort épauler l’armée française. Quelques semaines auparavant, la bataille de Verdun s’était révélée comme une véritable saignée humaine pour les deux camps: peu importait le prix, il avait fallu garder les positions. Le bilan s’avérait effroyable - 350 000 morts, sans que l’on puisse désigner, à l’issue, le nom d’un vainqueur ou d’un vaincu. La « boucherie » de Verdun, ou plutôt ce qui restait de la ville et ses environs, demeurerait gravée à jamais dans la mémoire collective. Les officiers supérieurs, loin des lignes de front et des scènes de combat, avaient transmis des ordres intransigeants aux conséquences dramatiques en matière de vies humaines. Une partie de la jeunesse française et allemande était épuisée par d’interminables attaques et contre-attaques dans les profondes tranchées - nouvelle guerre de position inventée pour ce conflit.
Les généraux respectifs voyaient une unique stratégie pour vaincre, une guerre d’attrition, qui ferait pencher la balance en leur faveur. La « chair à canon » ne constituait pas un élément à prendre en compte, seule la victoire importait. Les valeurs de prestige de la patrie ne se réduisaient pas à un calcul mathématique de soldats tués mais plutôt à des positions prises sur l’ennemi. L’éclat et le panache des combattants seraient les qualités de tous ceux tombés au champ d’honneur qui, plus tard, deviendraient des héros nationaux. Les morts seraient ainsi honorés d’un grade supérieur, une médaille appropriée, une citation, une gravure sur de la pierre... On leur devrait biença.
Depuis le premier juillet, la bataille de la Somme succédait donc à celle de Verdun. Quarante kilomètres de frontau total, dans le département de la Somme (80), à l’est d’Amiens, à proximité des communes de Roye et d’Albert.
Pour la première fois depuis le début de la guerre, les troupes franco-britanniques devraient combattre un ennemi commun. L’empire de sa Majesté, subodorant un conflit long, avait drainé des renforts venus des empires coloniaux australiens, néo-zélandais, sud-africains et indiens. Vu l’éloignement géographique, ces derniers placés en réserve attendaient « l’épreuve du feu » sans réellement en connaître les modalités.
Le commandement anglais – le général Douglas Haig, réticent à servir sous les ordres français des généraux Foch et Joffre, tiendrait une position de tranchée longue de vingt kilomètres entre Maricourt et Bapaume. Uniquement des soldats anglais.
Le tronçon entre Maricourt et Lassigny, de même distance,revenait aux forces françaises, exclusivement.
Le 1er juillet 1916, les forces britanniques, peu au fait de cette nouvelle guerre des tranchées, entrèrent en action avec la ferveur exacerbée d’une jeunesse prête à en découdre. En une journée, elle subit une perte de 20 000 hommes (un dixième des effectifs en France), 30 000 blessés, par le seul fait d’officiers incompétents recrutés trop jeunes, sans expérience et trop ambitieux...
Au sein des deux camps, dès le début des hostilités, un constat émergeait: la bataille de la Somme serait plus meurtrière que Verdun.
***
Jean vient de regarder sa montre à gousset en argent, cadeau de son père avant son départ pour le front du nord de la France. Il est 23 h 20. Des deux côtés des tranchées, malgré l’obscurité, des tirs incessants tiennent en alerte les veilleurs qui doivent anticiper l’intention de l’ennemi. Toutes les nuits, les deux camps posent des barbelés pour entraver une éventuelle progression des troupes adverses. Les tireurs d’élite sont positionnés dans des endroits stratégiques pour éliminer ceux qui s’aventurent dans ce no man’sland.
Aux premières chaleurs de l’été, l’odeur est insoutenable. Des cadavres et des lambeaux de corps jonchent le sol entre les premières tranchées vouées à l’attaque, les deuxièmes à la réserve et les troisièmes, au repos et au ravitaillement. D’étroits boyaux et des passages disséminés les relient entre elles. La nature crayeuse des deux berges de la rivière Somme où se trouve leur position a permis un creusement suffisamment profond sans l’aide d’étais. Seul le sol qui a tendance à retenir l’eau a nécessité la pose de caillebotis en bois qui malgré tout, n’empêchent pas l’eau d’arriver à mi-cheville. Les rats y nagent et pullulent, gavés de chair humaine. Les officiers ont donné des instructions strictes pour laisser en l’état les cadavres à ciel ouvert afin que les soldats ne deviennent pas des cibles faciles à atteindre. Ils ont aussi ordonné de faire feu sur les ambulanciers et les porteurs de civières, non armés, chargés de récupérer les blessés. Des deux côtés, les gémissements et les cris de secours de ceux qui sont tombés percutent les consciences. Juste avant de mourir, beaucoup appellent leur mère...
Jean, caporal, fait partie de la 6e armée Fayolle, de la 3e division et de la 8e brigade d’infanterie. Il a été affecté aux transmissions et, comme d’autres dans leurs fonctions, tient à jour le journal officiel des événements marquants de la brigade. Son lieutenant Albert Pomes vérifie ses écrits, interdisant de mentionner le faible moral des troupes et certaines « incohérences » du commandement qu’il n’a pas à relater. La censure est généralisée.
***
Pendant dix jours, les gardes durent quotidiennement huit heures dans les premières tranchées, les plus risquées, dix jours également dans les secondes suivis de deux ou trois jours de repos à l’arrière. Lors d’une attaque d’envergure, tous les soldats sont réquisitionnés.
C’est son premier jour dans cette tranchée qu’ils ont perdue, regagnée et perdue à nouveau dans un cycle sans fin. En réalité, ils n’ont pas gagné un mètre dans cette guerre de positionnement et d’usure. La technologie française des obus français des canons de 75 mm s’est heurtée aux mitrailleuses allemandes tout aussi meurtrières. Les deux armées ont innové avec des mortiers modernes, des crapouillots, des obusiers à munitions à fragmentation qui ne font toujours pas la différence excepté multiplier le nombre de blessés. Même si l’usage de gaz à base de chlore ou de phosgène reste anecdotique, chaque soldat est maintenant équipé d’un masque.
Les hommes tombent comme des mouches. A la veille d’un assaut, une mort rapide est « envisagée », l’agonie telle qu’ils la connaissent, restant un cauchemar. Les désertions ainsi que les troubles psychologiques ne sont pas rares. Simples ouvriers ou paysans, ils ont tué, tueront ou se feront tuer. Cela, ils évitent de l’aborder dans les lettres envoyées aux familles. S’ils demeurent des hommes, ils ne sont plus les mêmes: chacun est conscient de l’obligation de tuer, induite par la guerre, mais également les ordres reçus d’achever les moribonds ennemis, nuance majeure à prendre en compte. La guerre est un crime permis organisé. Pour certains, si cette vie est abîmée, un possible au-delà pourrait leur être restreint: on ne se soustrait pas à ses péchés mortels comme aux commandements Sacrés - tu ne tueras point - devant le Tout-Puissant.
***
04 h 00. Jean est fatigué malgré une nuit calme. Ils sont une vingtaine comme lui à surveiller par-dessus le parapet(1). Un soldat lui apporte une soupe chaude et occupe son poste momentanément.
Jean pose son fusil Lebel muni d’une baïonnette, puis range à terre son casque Adrian. Il garde près de lui ses trois chargeurs de dix cartouches chacun, son couteau de combat et deux grenades à main. Hélas, les vols sont courants.
Appuyé à la paroi sèche de la tranchée, il apprécie ce moment privilégié où le temps semble suspendu dans un bref répit de paix. Ses yeux se dirigent vers l’arc de la voie lactée et plus précisément vers la Grande Ourse, la « grande casserole », l’un des astérismes les plus connus de l’hémisphère nord. Son grand-père lui a enseigné le positionnement de la Grande et de la Petite Ourse et lui a expliqué les phases lunaires, cruciales pour la taille et le travail de la vigne. Ils sont vignerons de père en fils, à Arsac dans le Médoc (33), au nord-ouest de Bordeaux. La propriété de trente-cinq hectares demande beaucoup d’efforts afin d’obtenir un vin recherché par les Anglais amateurs de qualité. Désormais, son père et sa mère gèrent, du mieux qu’ils peuvent, le domaine viticole. A soixante-dix ans, le grand-père est trop âgé pour travailler. Cinq mois auparavant, son frère aîné Joseph, vingt-quatre ans, est mort à Verdun laissant au domaine une épouse et un fils, Francis, d’à peine deux ans...
A vingt-et-un ans, Jean n’est pas un bel homme. Il le sait. Dans les bals autour d’Arsac, les filles rechignent à danser avec lui sous le prétexte qu’il est trop maigre, qu’il possède un grand nez et que ses oreilles sont décollées. S’il est devenu solitaire et légèrement aigri, il a gardé cette gentillesse et ce sourire qui font de lui ce qu’il est: un homme simple et serviable.
Ses yeux se perdent dans la lueur de toutes ces étoiles dont il ignore le nom. Ses pensées se portent vers d’autres lumières, les yeux verts de Léa, l’épouse de son frère décédé, qu’il a rencontrée le mois dernier lors d’une permission de dix jours. Ensemble, ils ont partagé douloureusement le souvenir commun de Joseph, époux attentionné et frère respectueux. Le petit Francis lui ressemble tellement.
Contre toute attente, Jean s’est permis de proposer à Léa, jolie fille, de l’épouser et d’élever ensemble l’enfant sur la propriété. Pas un mariage d’amour, un mariage de circonstance, il a été clair, lucide, franc. Les sentiments viendront peut-être plus tard. Elle a demandé à réfléchir. A condition de survivre à cet enfer...
Quelques jours auparavant, Léa a écrit à Jean. Elle l’attendra. Les sentiments viendront, elle en est persuadée. Elle l’implore de rester en vie, de ne prendre aucun risque.
La lettre désormais contre son cœur, les yeux de Léa brillent au firmament de ce ciel immense où naît enfin un espoir, un chemin, un but. Deux étoiles d’amour.....
Il observe autour de lui. Tout n’est que désolation, ravage, catastrophe. L’air empuanti est saturé d’odeur de cadavres, d’excréments, de pourriture. Les premières images de cinéma viennent de faire leur apparition, filmant ceux que l’on appelle désormais « les poilus », c’est-à-dire des hommes virils et courageux.
(1) Bande de terre élevée devant la tranchée avec un rôle de veille tandis que le parados est juste derrière, plus haut, pour protéger des éclats d’obus.
A cette idée, Jean sourit: le cinéma ne montrera jamais le « détail » des poux qui envahissent chaque poil et chaque cheveu, les puces innombrables qui démangent constamment, le manque total d’hygiène et les maladies vénériennes attrapées dans les BMC (Bordel Militaire de Campagne) à l’arrière du front à Amiens. Le cinéma ne relaiera jamais les odeurs putrides des feuillées, fosses d’aisance recouvertes de planches en bois percées, où chacun défèque sans intimité dans ces tinettes de fortune. Recouvertes régulièrement de chaux, vidées puis brûlées avec de l’essence, les émanations prégnantes d’odeurs méphitiques sont une abomination. Le cinéma ne filmera jamais les secondes avant l’assaut où les hommes, grisés par le vin, tremblent de tous leurs membres, se font dessus, prient pour que ce soit l’autre qui prenne la balle ennemie, celle qui arrêtera tout...
06 h 00 : la relève est là. Le soleil apparaîtra bientôt tout comme les myriades de mouches qui n’auront de cesse de harceler les combattants.
Mais Jean est satisfait: aujourd’hui, à Albert, il est vivant et demain sera un autre jour. Dans son cœur, les yeux de Léa continuent de briller telles deux sphères célestes posées sur un ciel sans nuages. Ces deux étoiles dont il connaît le nom le mèneront bien plus tard, il ne le sait pas encore, jusqu’au jour de l’armistice où il écrira dans un dernier message sur son cahier de communication* :
11 novembre 1918 – 23 h50
Au cinquante-deuxième mois d’une guerre sans précédent dans l’histoire, l’armée française, avec l’aide de ses alliés, a imposé la défaite à l’ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant quatre années de combats ininterrompus l’exemple d’une sublime endurance et d’un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l’ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de quatre mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande, la contraignant, ainsi, à demander la paix.Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités acceptées par l’ennemi, l’armistice prend effet aujourd’hui à onze heures.
Fermé pour cause de « victoire », paroles du Maréchal Pétain après la rédaction de ce dernier message.
***
Été 1928. Médoc.
Silencieuses et attentives, la Grande et la Petite Ourse surplombent ce soir le territoire girondin, ses vignes et ses raisins encore verts. Dans le jardin de la maison à Arsac, Francis joue au ballon avec ses deux demi-sœurs Denise et Lucie, sous le regard maternel de Léa. Jean est encore occupé dans les vignes et rentreratard.
Elle observe: les deux jolies fillettes pleines de vie affrontent leur frère dans un match où il les laissera gagner, comme d’habitude.
Même légèrement décollées, les oreilles des deux sœurs ne nuisent en rien à la finesse de leurs traits. La chance a voulu qu’elle ait trois beaux enfants, un mari aimant, un époux disparu, absent, mais tellement présent...
A quelques pas, une petite pièce de monnaie tombée à terre brille du faible éclat du rayonnement lunaire: elle s’en saisit et l’essuie aussitôt. En contemplant le bel équilibre et l’élégance des enfants, Léa découvre un message lié à cette pièce: elle l’interprète à sa façon.
Côté pile, l’attrait physique demeure l’illusion trompeuse de regards intéressés.
Côté face, la pureté des cœurs, force de l’âme invisible, en est la révélation.
Surprise et contre toute attente, ce soir, Léa découvre également un autremessage propre à Jean, à ce qu’il a enduré quelques années auparavant, et à ce qu’il est, maintenant.
Côté face, ce soir à Arsac.
Côté pile, hier à Albert.
A Armand, 24 ans, mon ancêtre tombé en 1918 sur le front Belge, pour la Liberté et pour la France. A mes grands parents Jean etLéa.
« La paix, si jamais elle existe, ne repose pas sur la crainte de la guerre, mais sur l’amour de la paix. » JulienBenda
*Cahier de communication réel, propriété de l’auteur. Rédacteur inconnu.
Mille et unpas.
5 juin 2018. En Terre de France...
Au fil des kilomètres, le corps s’était endurci. Oubliées les crampes redoutées et les «ampoules» qui martyrisent les pieds; loin maintenant l’anxiété de connaître l’échec et à l’issue, l’obligation de rebrousser chemin, vaincu par un physique mal préparé et un moral défaillant. Les trois cents premiers kilomètres resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Rien ne le destinait à faire la Via Podiensis, cheminqui relie Le Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle, long de mille cinq cent trente kilomètres. Voie mythique et même mystique pour certains. Le doute l’avait accompagné dès les premières villes étapes de Saugues et de Nasbinals. La fatigue avait pris le relais entre Estaing et Espalion. A Conques et Figeac, la pluie s’était ensuite invitée et, avec elle, de lancinantes douleurs musculaires. Mille fois, il pensa prendre son portable caché au fond du sac à dos, l’allumer et appeler pour mettre fin à cette souffrance, totalement inutile. Mille et une fois, son regard se porta sur la prochaine forêt, le village d’après, l’autre route, le futur point d’eau. Depuis quelque temps, éloigné de toute pratique sportive, il payait ainsi un léger embonpoint dû à une certaine négligence physique.
Mais, à cinquante ans, comme d’habitude, Jean-Pierre assurait. Il irait au bout sans faiblir. Par défi, juste par défi. Pas pour son entourage et sa famille qui ne comprenaient pas sa décision inopinée de « faire le Chemin». Pas plus que son directeur et ses collègues de bureau, surpris que lui, conseiller en patrimoine immobilier, consciencieux, collaborateur efficace et volontaire, impose d’autorité à la banque plus de deux mois de congés sans solde. Sans négociation. Tous avaient acquiescé par surprise comme par respect. Restaient quelques regards entendus… Il s’en moquait. Le chemin serait sa parenthèse, sa transgression de vie, son pas de côté, ce pur moment de folie sublimée où en l’espace d’une poignée de secondes, chacun sait que toute décision prise est irréversible.
Ce dimanche 15 avril, jour de son anniversaire, Jean-Pierre se remémora ce basculement, ce choix, sa «sentence». Seul dans le pavillon d’un quartier huppé du sud-est de l’agglomération d’Auxerre (89), proche des berges de la rivière Yonne, il venait de finir de dîner. Son épouse, infirmière de nuit, assurait une garde dans une clinique privée proche du centre-ville. Ses deux filles étudiantes à Paris, l’une en droit commercial l’autre en ingénierie informatique, venaient tout juste de l’appeler de leur portable.
Le grand miroir du salon lui renvoya une image à laquelle il ne s’attendait pas. Il y vit un homme quelconque, sans relief, fade et vieillissant. Comment en était-il arrivé là ? pourquoi ce questionnement? Sa santé était bonne, les membres de sa famille le chérissaient, il possédait des amis et était reconnu, dans sa profession, pour ses qualités intrinsèques.
Devant le reflet, il médita longuement, s’observa, se toisa sans complaisance et se sentit soudainement faible, en état de manque tel un drogué privé de ses substances hallucinatoires. Soit le reflet était propre au miroir et il fallait y souscrire, soit ses yeux acceptaient difficilement cette silhouette décidément peu agréable. L’air lui manqua: il sortit aussitôt dans le grand jardin frais plongé dans une totale obscurité afin de se sentir rapidement mieux. Curieusement, ses bras devenus lourds glissèrent le long de son corps.
Contre toute attente, il leva la tête vers la voûte étoilée, ce qu’il ne faisait jamais. Ses yeux marron-vert se marièrent à la clarté des étoiles, scintillantes ce soir-là de mille feux. Il interrogea du regard les profondeurs absolues, les nébuleuses lointaines et les galaxies inaccessibles.
L’Homme questionna le Cosmos. La verticalité fit le reste.
Une étoile filante glissant vers le sud lui apporta la réponse. Tout n’était que matière et direction. Lui, poussière d’étoile, devait quitter le mode statique et se mettre en mouvement vers un horizon, une destination dont il ignorait tout. Faire cela au moins une fois dans sa vie. Une brise soudaine caressa son visage, invitation céleste à aller de l’avant.
Le ciel venait de parler. A 20h30 ce jour-là, le chemin commença.
***
En ce début de mois de juin, aux alentours de 16h00, Jean-Pierre pénétra dans le village de Saint-Jean-Pied-de-Port (64) sous une chaleur étouffante et un ciel menaçant d’orages en soirée. Les Pyrénées s’offraient à lui, ses plus hauts sommets recouverts d’une neige immaculée. Les assauts d’un été encore trop chaud mettraient bientôt fin à cette couverture de glace d’une rare beauté.
Ses yeux se remémoraient encore les terres volcaniques du Velay, le massif granitique de la Margeride, les hauts plateaux désolés de l’Aubrac, la vallée verdoyante du Lot, les causses arides du Quercy et enfin les riches coteaux Gascons. Tout n’était que succession de paysages, de panoramas, de forêts profondes révélant des sons et des odeurs d’un paradis perdu d’une genèse biblique.
Son état physique relevait de l’exceptionnel. Sollicité, son corps répondait à l’instant dans un désir inassouvi de poursuivre encore et encore.
Un miracle… Jamais il n’aurait cru devoir se refréner, voire se faire violence pour s’imposer des haltes, des arrêts afin de se reposer et se désaltérer. Trente cinq kilomètres par jour, quelles que soient les conditions climatiques. Les étapes se succédaient à un rythme de marche quasiment parfait.
Seul bémol, l’affluence des marcheurs toujours plus nombreux, plus groupés, plus bruyants, moins ancrés dans une notion de spiritualité pourtant dévolue aux pèlerins. Jean-pierre les fuyait pour mieux les retrouver le soir dans les hôtels et auberges jacquaires autour de repas quelquefois trop arrosés.
Dès le départ, il s’était astreint à une abstinence d’alcool, de nourriture riche, évitait l’abus de sucre, de sel et les excès en tous genres. De paroles aussi. Le résultat ne s’était pas fait attendre: neuf cents kilomètres parcourus en trente cinq jours, huit kilos de moins sur la balance, un visage basané par le soleil, un corps rajeuni et surtout un mental defer…
Sa bulle de confort oubliée, il se montrait fier d’avoir laissé le trio diabolique Netflix-Canapé-Portable sans rien regretter. Lui, totalement agnostique, se retrouvait à prier dans les chapelles, les églises et aussi les cimetières, lieux privilégiés pour remplir sa gourde d’eau fraîche. Une question le tarauda à de nombreuses reprises: faut-il croire pour prier? La notion de spiritualité voire de religiosité nécessite-t-elle de vouloir croire, ou, à l’inverse, croire sans vouloir ? A Saint-Jean-Pied-de-Port, était-il un marcheur, un randonneur ou bien un pèlerin ?
Il traversa le pont enjambant la Nive et se dirigea vers l’église Sainte Eulalie élevée au XII siècle. Devant le portail roman bien conservé, il posa son sac et s’assit contre un des murs frais du porche. Touristes et pèlerins envahissaient l’espace sacré, l’empêchant de savourer pleinement un repos amplement mérité. Il saisit quelques bribes de conversation de marcheurs obnubilés par l’attestation et la mise à jour du «Credencial», carnet du pèlerin délivré à chaque étape permettant d’obtenir, à l’arrivée à Santiago, la tant recherchée «Compostela», titre nominatif du statut de pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Lui n’en avait cure, le chemin demeurait intérieur, sans témoignage ou attestation d’aucune sorte.
Certains sacs à dos arboraient fièrement et ostentatoirement la coquille caractéristique afin que personne ne doute de l’authenticité spirituelle de son propriétaire… représentation symbolique de l’ego…
***
Ainsi, Jean-Pierre décida que, dans de telles conditions, cette première partie du chemin ne pouvait le satisfaire. Le marcheur de jour laisserait la place au marcheur de nuit. Il poursuivrait ainsi en Espagne, vers les sites de Ronceveaux et d’Ostabat, jusqu’à la destination finale. Le jour, il sommeillerait dans les villes étapes sans suivre les découpages standardisés et les itinéraires conseillés par les guides. Il dormirait quand les gens marcheraient et inversement. Sa rencontre avec lui-même suffirait largement.
Il se munit de lampes de poche rechargeables.
Les cent premiers kilomètres furent difficiles mais la pleine lune lui facilita la tâche. En l’absence de paysages à découvrir, dans la solitude de la nuit, les fonctions vitales de Jean-Pierre se dévoilèrent. Il frémit en sentant les battements de son cœur, le souffle de ses poumons, une acuité différente, une nouvelle perception des sons, une révélation de fragrances émanant de la terre hispanique.
Au-delà de ce corps d’homme, il perçut enfin la vibration première, la pulsation et le souffle de vie qui animent le vivant. La verticalité, la transcendance de la terre mère vers l’infini de la voûte étoilée lui sauta aux yeux. La tête dans les étoiles, perdu dans les rêveries d’un flâneur marcheur solitaire, il s’imagina suivre une route similaire à celle des mages de la Bible qui, deux mille ans avant lui, arpentaient les routes d’Orient, guidés par une lueur magique, une étoile flamboyante. Eux aussi s’étaient mis en marche vers l’inconnu.
A dix kilomètres de Santiago, à quatre heures du matin, son regard embrassa la ville sainte et ses lumières. Il posa son sac à terre et s’assit en tailleur à même la terre. Il sourit au monde.
Une étoile filante griffa le ciel d’occident.
Restaient les derniers kilomètres à effectuer. Il prendrait son temps.
Jean-Pierre n’avait pas fait Le chemin. Le chemin venait de Le faire.
Maintenant,il savait.
A Alexandre Arna., mon frère de cœur, et à tous lesmarcheurs qui savent que marcher est une succession de déséquilibres........
« Si tu n’arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop marche. Si tu penses mal, marche encore. » JeanGiono
« Un homme qui ne marche pas ne laisse pas de traces. »Georges Wolinski
Apocalypse
Une jungle luxuriante recouvre chaque parcelle de terre de hautes herbes, de fougères immenses, d’arbres et arbustes de différentes tailles dont certains regorgent de fruits de toutes les couleurs à la saveur quelquefois sucrée. Ceux-ci, aussitôt tombés à terre, sont récupérés par de petits mammifères qui se hâtent de les emporter dans les nids pour en faire profiter leur progéniture. Ceux qui s’avèrent être trop pourris sont mangés sur place par des milliers d’insectes voraces, pressés eux aussi d’en faire profiter leurs larves.
Figuiers, magnolias, platanes, pins et ginkgos recouvrent uniformément les collines et vallons peu élevés, traversés de nombreux ruisseaux alimentant des lacs peu profonds où le bleu du ciel se mélange à la couleur turquoise de ces miroirs d’eau. Nul ne sait qui est le reflet de l’autre.
Grâce à des conditions climatiques parfaites, une chaleur constante modérée, des pluies abondantes et une absence d’hiver, la vie explose de tous côtés. Sur terre et dans les airs, tout n’est que vrombissement et bourdonnement d’ailes, cris et chants d’animaux, bruits multiples d’une légion de créatures vivantes unies par ce même souffle devie.
***