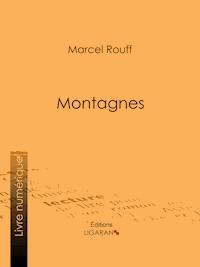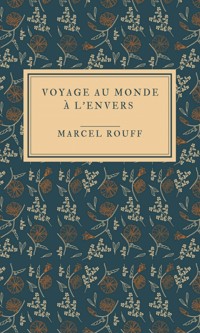
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Il fallait que les évolutions de cet individu fussent bien curieuses pour qu'elles aient détourné mon attention de ces troublantes baigneuses qui, en maillots collants noirs, nous exposaient, à la faveur du bain, les ultimes secrets de corps magnifiques dont le tango quotidien et vespéral nous avait déjà révélé les attitudes les plus pâmées. À mes côtés, au haut de l'escalier qui conduit au sable, Moreau-Deblasco ne les quittait pas une seconde de l'œil. Je dus le tirer par la manche : — Toi, le Bottin de cette plage, peux-tu me dire quel est cet original qui cueille des palourdes et pêche des crevettes avec une énorme serviette en cuir de vache sous le bras ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Rouff
VOYAGE AU MONDE À L’ENVERS
1920
CHAPITRE PREMIER
Il fallait que les évolutions de cet individu fussent bien curieuses pour qu’elles aient détourné mon attention de ces troublantes baigneuses qui, en maillots collants noirs, nous exposaient, à la faveur du bain, les ultimes secrets de corps magnifiques dont le tango quotidien et vespéral nous avait déjà révélé les attitudes les plus pâmées. À mes côtés, au haut de l’escalier qui conduit au sable, Moreau-Deblasco ne les quittait pas une seconde de l’œil. Je dus le tirer par la manche :
— Toi, le Bottin de cette plage, peux-tu me dire quel est cet original qui cueille des palourdes et pêche des crevettes avec une énorme serviette en cuir de vache sous le bras ?
Moreau-Deblasco, qui vivait dans l’unique espoir, jusqu’à ce jour déçu, que la lutte opiniâtre engagée entre les formes bien accusées et les maillots trop collants se terminerait au désavantage de ces derniers, ne parut pas ravi d’être dérangé, mais me répondit cependant avec courtoisie :
— C’est le capitaine aviateur L’Herbaudière. Un pauvre garçon !… Le conseil de guerre aurait mieux fait de l’envoyer se soigner plutôt que de briser sa carrière.
— Quoi, affaire de trahison ?
— Pas le moins du monde. Désertion temporaire… et inexpliquée. On étudiait la ligne aérienne qui devait relier la France à ses possessions d’Australie. C’était la deuxième année de la guerre. L’Herbaudière, trois palmes, s’il vous plaît, désigné pour tenter l’expérience, un des premiers parvint jusqu’en Nouvelle-Calédonie. Il fut fêté, acclamé, même redécoré, je crois, par sans-fil. Après trois semaines de séjour dans l’île, il prit le retour et… disparut pendant un an et demi. Il y avait belle lurette qu’on ne parlait plus de lui, que l’aviation avait offert à sa mémoire un service solennel, que sa fiancée s’était mariée et que son héritage était partagé, quand un beau jour, il débarqua au Cap, à pied, mourant de faim et de soif, en haillons, racontant une histoire à dormir debout. Les médecins ont, malgré tout, conclu à sa responsabilité, les ânes, alors que le pauvre diable ne se souvenait même plus de ce qui lui était arrivé ; aujourd’hui même il ne se le rappelle pas encore. Il a accueilli en riant aux éclats, lui, l’honneur et la passion militaires faits hommes, le jugement terrible qui le frappait ; il mène depuis lors une vie ridicule, inoffensive et déraisonnable où la serviette qui vous a frappé joue le seul et unique rôle. Un pauvre fou, je vous le répète.
Aussitôt, des greniers de mon inconscient où sommeille un monde de futilités et de choses indifférentes surgit le souvenir endormi de cette aventure. Ma mémoire est surtout visuelle ; je vis vaguement devant mes yeux des entrefilets de journaux, des articles, des dépêches où s’étalaient le nom de L’Herbaudière, le récit de sa disparition, puis plus tard la nouvelle de son retour surprenant, de son procès ; mais je vis surtout, avec une netteté complète, cette fois, une scène de revue dans le décor d’un cabaret fumeux, scène semée de stupides jeux de mots : « Vous n’avez plus l’air beau d’hier », où l’on rapprochait, avec les sous-entendus et les équivoques indispensables, la disparition de l’aviateur de celle d’une princesse italienne. Les deux escamotés se retrouvaient sur une île déserte où ils passaient une année de parfait amour, occupés uniquement à s’aimer et à se le prouver ; pour terminer, quelques couplets sentimentaux ; la jeune femme, on ne sait trop pourquoi, enlevait soudain sa robe et l’aviateur sa combinaison, et tous les deux entamaient une chaloupée sauvage, tandis que des phares d’avion, mués en yeux démesurés de vieux marcheurs, roulaient leurs gigantesques prunelles. Cette fantaisie échevelée, je la voyais avec la même intensité que si j’eusse encore été au spectacle et je me sentis tout à coup saisi, en retrouvant dans mon souvenir ce résidu idiot de la vie parisienne, d’une curiosité surexcitée et, pour ainsi dire, trépidante de connaître le héros en chair et en os de cette équipée encore mystérieuse. Cette disparition d’une année, ce retour inattendu à la civilisation, cette arrivée pédestre et lamentable dans une ville de l’Afrique du Sud, ce procès qui n’avait point pénétré le secret de l’aventure, les éclats de rire du condamné ne me fournissaient pas l’ombre d’une hypothèse. Cet homme, qui, devant mes yeux, pêchait la crevette, chargé d’une lourde serviette de cuir, devenue l’unique préoccupation de sa vie, toutes ces circonstances, pour le moins bizarres, qui laissaient parfaitement indifférent le cerveau d’un snob comme Moreau-Deblasco, devaient inévitablement solliciter l’imagination d’un homme qui fait métier d’écrire, alors que le principal protagoniste d’un mystère aussi troublant et l’initiateur de l’emploi de l’avion dans l’amour se présentait à mon obsession professionnelle en une si curieuse posture.
Maniaque, ce L’Herbaudière l’était peut-être. Fou, assurément non. Je l’aurais certifié de loin et au premier coup d’œil. J’avais autrefois, au temps où je poursuivais des études philosophiques et psychologiques, assez fréquenté les aliénistes et leurs bouquins pour me rendre compte que ses gestes, que je suivais attentivement, n’avaient ni cette précision immuable et obstinée, ni ce désordre et ce manque de coordination qui révèlent l’une ou l’autre forme du déséquilibre mental.
Moreau-Deblasco m’entraîna.
— Venez prendre un porto-flip et une bouchée aux crevettes. Si ce pauvre toqué vous intéresse, je vous le présenterai à la première occasion. Il fréquente assez régulièrement le bar du golf.
C’est à cet endroit, le lendemain, que je fis connaissance avec L’Herbaudière, juché sur un haut tabouret, le coude appuyé sur l’inévitable serviette déposée sur le comptoir.
Évidemment le capitaine n’était pas de relation très aisée. Ce n’était ni un grincheux, ni un aigri, ni un irascible. Il ne contredisait point, il ergotait encore moins. Il était doux, peu loquace, irréprochable, correct. Il me fallut plusieurs entrevues pour me rendre clairement compte de ce qui m’agaçait tant dans sa fréquentation : son éternelle rêverie. Oh ! ce n’était pas une rêverie mélancolique, indécise, vague, nonchalante. Il ne suggérait nullement l’envie de le consoler. Non. Il laissait inexorablement tomber entre lui et son interlocuteur une sorte de méditation interne pleine de suffisance et d’une nuance d’insolence. Il vous regardait fixement, le menton dans la main, il vous écoutait, mais ses yeux, poursuivant une vision intérieure, étaient pleins d’un regard qui disait exactement : « Va toujours, mon bonhomme. Quand on a vu ce que j’ai vu, quand on sait ce que je sais, tout ce que tu pourras me raconter n’a guère d’intérêt ». On avait, en lui parlant, l’horripilante sensation de lui raconter éternellement des choses sans importance et de se heurter à une supériorité inaccessible. Chose curieuse, malgré cette disposition singulière d’esprit, il recherchait le monde, fréquentait les salles de danses, les spectacles, les halls de casinos et d’hôtels, mais il semblait ne s’intéresser au spectacle que par une sorte de comparaison qu’il roulait dans sa tête. Il étudiait les êtres et les choses avec une curiosité détachée, d’une inexprimable impertinence, et comme s’il eût été hors de la société humaine.
Énervé, excédé, j’étais, malgré tout, attiré vers lui. Je le cherchais sur la plage, sur la route, à la pâtisserie, au thé-tango, chez le coiffeur, partout enfin où il fréquentait. Je ne décrirai pas par le menu toutes les alternatives que subirent nos relations, ni les différents états psychologiques qu’il provoqua en moi. Toujours est-il qu’il finit par me témoigner quelque sympathie, quand mon obstination à le rencontrer lui eut fait comprendre que je me formais sur lui une opinion différente de celle de ses autres contemporains. Il n’était plus en effet, dans cette villégiature bretonne, le raseur isolé qu’on redoute et qu’on évite, depuis que je m’entêtais, à l’encontre des autres baigneurs, à rechercher assidûment sa compagnie.
Maintenant que je connais l’intimité la plus secrète de l’âme de cet homme et son extraordinaire histoire, que j’ai sous les yeux, en écrivant, le manuscrit de son incroyable odyssée, je retrouve la minute où, pour la première fois, il y fit une allusion voilée, si voilée que, dans l’ignorance où j’étais alors, je ne la remarquais même pas et que je la mis simplement au compte d’un cerveau étrange, tourmenté à la fois par des lieux communs philosophiques et par les aventures utopiques qui hantent certains aviateurs, sans m’y arrêter plus longtemps que la seconde même où il l’énonça au cours de la conversation. J’étais étendu sur le sable, je regardais… tout et rien, comme on fait à la mer quand on livre sa pensée à la monotonie sacrée des vagues et qu’on la laisse naviguer entre l’absence de tout sujet précis et des considérations nécessairement banales, puisque tout a été dit sur l’Océan éternel. L’Herbaudière vint sans façon s’étendre auprès de moi et sans s’enquérir si, ce jour-là, je ne recherchais pas à mon tour la solitude ; quoique fort poli, il s’était, en effet, affranchi de nombre de conventions oiseuses. Il posa sa serviette entre nous deux, cette serviette dont, pendant des nuits, j’avais essayé de deviner le précieux contenu, cette serviette dont il ne m’avait jamais parlé même fugitivement.
— Vous regardiez là-bas, me dit-il, en montrant de la tête l’horizon.
— Oui, j’ai des désirs de voyages. J’irais volontiers voir ce qui se passe de l’autre côté de cette ligne.
— Peuh ! cher Monsieur, ces pays-là, ce n’est pas la peine…
— Ces pays-là, peut-être… Mais je ne parle pas nécessairement de l’Amérique, qui est en face de nous, je parle des Indes, de la Chine, de l’Asie, de cette Asie insondable…
Il fit un geste dégoûté et me jeta un de ses regards ironiques et supérieurs.
— Pas intéressant. Tous ces braves Asiatiques, à quelques nuances près, pensent comme nous. On a beaucoup écrit sur leur âme, sur leurs conceptions… Ce n’est pas si compliqué qu’on veut bien le dire, allez : vivre, aimer, mourir… Ces trois mots renferment la grande obsession de toute la terre connue.
Et, en m’offrant une cigarette, il se lança dans une dissertation fort intéressante, ma foi, sur l’habitude de fumer et les différentes qualités de tabacs.
Je puis fort bien préciser le jour où il conçut pour moi cette sympathie, d’abord bien timide et très réservée qui finit pourtant par se transformer en une réelle amitié. Ce fut le 3 août 1918, à midi moins vingt ; je me souviens fort bien de l’incident. Je lui déclarais que j’étais un adversaire résolu de la civilisation. Je revenais des rochers du Prioré sur lesquels j’avais, toute la matinée, relu un volume de Rousseau ; je le tenais encore à la main, quand je le rencontrai devant l’Hôtel des Fleurs, et cette édition, reliée en veau fauve, fut l’origine de la discussion qui devait faire de nous deux amis profondément unis. En entendant énoncer mon énergique profession de foi, il me regarda comme il ne m’avait jamais regardé, sans que son ironie si spéciale passât dans ses yeux. Encouragé, je poursuivis sans respect pour le grand Voltaire :
— Il faut être parfaitement idiot pour soutenir que celui-ci – je frappai sur le Contrat social – a prétendu nous réduire à marcher sur les mains et à brouter l’herbe des prés. Mais il avait cent fois, mille fois raison, l’homme au bonnet arménien ! Le monde est enfermé dans une contradiction insoluble, une erreur fatale et irréparable. Le but, le seul but auquel aspire l’humanité est le bonheur. Et le progrès inéluctable, impitoyable, est la négation même de ce bonheur. Le premier homme qui s’est étendu sur un lit de feuilles au lieu de se coucher sur la terre a-t-il accompli un geste à rebours ? Je ne sais, mais je sais bien que, depuis, toute la réalisation matérielle de la civilisation a marché à contre-sens du bonheur auquel tendent les hommes. Et ils sont aujourd’hui profondément malheureux, tous, tous, avec les diverses nuances que comportent les diverses civilisations, mais tous, entendez-vous, jusqu’aux nègres les plus reculés de l’Afrique qui se sont mis en route sur la voie fatale de leurs aînés…
— Tous ?… En êtes-vous bien certain ? me demanda-t-il sur un ton étrange…
— Le Progrès est la loi fatale et il est la source de tous nos vices, de toutes nos souffrances, de toute notre angoisse ! Sortez de cette impasse, si vous pouvez.
— Êtes-vous bien sûr que ce soit impossible ? répéta-t-il sur le même ton.
— Vous êtes étonnant. Connaissez-vous un seul peuple sur la terre qui ait pu détourner ou modifier la marche douloureuse de ce maudit Progrès ?
Il me regarda profondément, mais cette fois avec son expression de commisération et d’ironie où passait pourtant comme un attendrissement. Il remonta sa serviette sous son bras et ne me répondit pas. Je comprends, aujourd’hui, ce que, ce jour-là, j’ai remué en lui.
À Paris, durant l’hiver, je le vis presque chaque jour. J’allais chez lui. Il venait chez moi. Il arrivait l’air distrait, me tendait la main sans prononcer un mot, prenait une cigarette sur mon bureau, s’installait dans un fauteuil et rêvait. Souvent, après un long silence, il me posait des questions imprévues et qui me révélaient le point où il en était de la longue méditation qu’il avait mentalement poursuivie.
— Croyez-vous qu’il existe un peuple au monde qui ait vaincu l’amour ?
Ou encore :
— Quel étrange problème que celui du désir !…
Alors la scène grotesque de la revue montmartroise me remontait brusquement à la mémoire : l’aviateur en rupture de civilisation avec sa dulcinée d’occasion sur leur île lointaine. Sa disparition, son procès, qui naturellement, et sans que j’aie jamais osé lui en parler, alimentaient ma constante curiosité, le ravalaient soudain à n’être plus que l’acteur d’une banale fugue sentimentale dont l’avion seul rehaussait de son piment de nouveauté la vulgarité coutumière. Je le regardais tout à coup saisi de l’inquiétude de perdre et de gâcher mon temps à interroger ce sphinx dont le secret d’alcôve se réduisait probablement à un paquet de lettres, érotiques et romantiques sans doute, qu’il trainait en maniaque dans son horripilante serviette. Puis, soudain, alors que visiblement il avait poursuivi dans le silence où il s’était replongé la même pensée dont il ne m’avait laissé entrevoir que quelques bribes, il me posait une nouvelle question qui déroutait de nouveau mes suppositions blessantes.
— Croyez-vous qu’un Çakya-Mouni ou un Jésus, survenant aujourd’hui, pourrait persuader l’humanité de l’erreur, du contre-sens de sa civilisation et la déterminer à rebrousser chemin ?
Et tout à coup, arraché à son obsession muette, possédé d’un subit enthousiasme, il développait ses idées, qui correspondaient si bien aux miennes, avec une force de conviction invincible, en les appuyant d’arguments absolument inédits et imprévus, que ni moi, ni aucun contempteur de notre monde n’avions encore conçus.
Il ne soupçonna jamais que la sincère affection que je lui avais vouée, et qu’une vie presque commune fortifiait chaque jour, faillit plusieurs fois sombrer dans l’exaspération que provoquait presque quotidiennement en moi son inséparable, son abominable serviette. La vue sempiternelle de ce meuble – car elle était d’un poids visiblement considérable – arrivait parfois à me mettre les nerfs dans un état où ils peuvent nous dicter les plus déplorables décisions. Il l’emportait sous son bras au bar, au spectacle, aux courses, en excursion, dans nos réunions d’amis. Je l’ai vue sur ses genoux aux Français et à la Scala, sur notre table chez Larue, sur son oreiller quand je le surprenais au lit. Elle était devenue pour moi une obsession telle que j’ai passé de longues heures d’insomnie à tenter de deviner son contenu et même, je l’avoue, à méditer sur les moyens de la dérober un instant.
Devenu à mon endroit tout à fait amical et affectueux, il ne me l’a jamais confiée, ne fût-ce que vingt secondes, pour enfiler par exemple son pardessus. Une fois j’essayai, avec mille précautions, de lui parler de cette énorme charge qu’il n’abandonnait jamais sous aucun prétexte. Il me répondit sur un ton sec et péremptoire qui m’interdit désormais toute envie de recommencer ma tentative. Je compris qu’il ne fallait point aborder ce chapitre. Mais je compris aussi que je ne supporterais point très longtemps encore de vivre en face de ce mystère de cuir jaune, dont mes yeux obsédés connaissaient tous les grains, tous les défauts, tous les plis et toutes les nervures.
Au début de l’été, je lui proposai de parcourir à pied, avec moi, les Alpes Valaisannes, d’en franchir quelques cols, d’en gravir les principaux sommets, d’y flâner en quelques vallées, en bivouaquant autant que possible, en campant en plein air ou dans les cabanes des clubs.
— Votre proposition me convient tout à fait, mon cher ; j’ai besoin d’exercice et de vie simple. Je suis bon marcheur – et son sourire suffisant était une allusion voilée à son arrivée pédestre de jadis dans la ville du Cap, alors qu’il surgissait on ne sait d’où ; – quant à l’altitude… j’ai été en avion recordman de la hauteur… c’est vous dire que je ne crains pas vos quatre mille mètres.
J’eusse été profondément heureux de l’avoir comme compagnon de randonnées, n’eût été la perspective de contempler en même temps, inexorablement, pendant ce mois de villégiature, sa fameuse serviette.
Aussi quelle fut ma joyeuse surprise le matin où nous quittâmes Sion ! Il était en tenue de course, le rücksac lourdement chargé aux épaules, la corde roulée aux courroies, d’aplomb dans ses chaussures ferrées, le piolet à la main, parfaitement libre de ses mouvements. Son abominable serviette avait enfin disparu. Je le constatai avec satisfaction, sans risquer la moindre remarque ; je sentais bien que l’observation que j’eusse pu faire aurait jeté une ombre, une gêne sur l’ivresse grave et saine qui s’offrait à nous sous forme d’une route où crépitait un soleil d’allégresse et qui s’élevait entre les vignobles, disparaissait dans la profonde vallée, entre les flancs verts et sombres des montagnes, le long de la chute monotone, mais fraîche, d’un torrent romantique et bondissant. Je ne vous dirai pas quel charmant compagnon de campagne alpestre je trouvai en L’Herbaudière, quelles qualités d’énergie, de calme, de gaieté je découvris avec ravissement en ce néophyte de l’alpinisme. Infatigable et impavide, il réussit avec moi, du premier coup, les sommets les plus scabreux, la Dent Blanche, entre autres, dont il aima les arêtes vertigineuses pour ce qu’elles lui rappelaient les jours héroïques de ses chevauchées aériennes. Au bivouac, à la cabane, il était inlassable, aux casseroles, au feu, à la corvée d’eau. Il était expert à mijoter des plats succulents avec les maigres ressources de conserves que nous transportions. Et surtout, son âme délicate sut, sans éducation préalable, en face de la gloire éternelle de la haute montagne, trouver, pour adorer sa grandeur, l’orgueil de l’humilité. Point d’exclamations de boutiquier parisien. Le silence passionné où l’éclat des yeux seuls élève une prière fervente d’émerveillement. Il regardait ces murs gigantesques de rocs, humides de sources secrètes, ces glaciers durs et beaux comme des mondes morts, ces cimes qui semblent, d’un élan immobile, s’élancer à la conquête du ciel et s’arrêter, impuissantes et rageuses, encore trop près de la terre ; il contemplait cet univers de splendeur avec un recueillement religieux et angoissé.
L’événement imprévu se produisit aux derniers jours de notre voyage. Nous venions, un à un, d’enlever tous les sommets des Aiguilles Dorées et nous avions quitté, assez tard dans la matinée, la cabane d’Orny pour gagner Chamonix par le col du Chardonnet et Argentière. Nous avions, sans encombre, franchi la Fenêtre de Saleinaz et taillé le couloir glacé qui conduit à la dépression entre le Chardonnet et le Tour Noir. Nous descendions vers le glacier d’Argentière, le long du glacier du Chardonnet, difficile cette année-là, car la glace dure était à vif, dépouillée par les chaleurs persistantes de toute neige. La carcasse même du glacier, sur laquelle nous avancions lentement, était incrustée d’une carapace de débris de pierres qui rendait précaire et illusoire le taillage des marches sur les pentes. Nous cheminions quand même, encordés, L’Herbaudière en avant. Arrivés à l’endroit où l’on prend ordinairement la moraine, nous nous aperçûmes qu’étant partis un peu trop tard de notre gîte, nous risquions fort d’y être bombardés par des débris de rocs qui, libérés de leur gangue de glace par le soleil, descendaient continuellement des flancs de l’Aiguille. Nous résolûmes donc de continuer, malgré la difficulté de la descente, par le glacier lui-même. C’est ainsi que nous nous approchâmes des bords de la grande rimaye qui sépare le glacier du Chardonnet du glacier d’Argentière. Elle était peu commode à franchir en cette année de sécheresse. Démesurément large, très profonde, elle avait, je l’avoue, un aspect rébarbatif et désagréable. Entre les deux éperons rocheux qui limitaient la vue à droite et à gauche de l’espace où nous étions parvenus, pas un pont de neige, si fragile fût-il. Rien. Il fallait forcer le passage. Comment ? Je n’en savais rien. Je considérais seulement comme un avantage certain que la lèvre sur laquelle nous arrivions surplombât, et de haut, le bord d’Argentière. J’en étais là de mes réflexions préliminaires, quand j’entendis tout à coup un grand cri accompagné du bruit froufroutant d’un corps qui glisse sur une surface glacée. Je ressentis à mon poignet, où, fort heureusement, j’avais enroulé la corde, une tension, puis un choc, puis un serrage douloureux. Aussitôt, d’ailleurs, je fus invinciblement entrainé d’un mouvement continu, assez rapide, que je retardais de mon mieux, mais bien inefficacement, en me raidissant, en m’agrippant à des cailloux qui finissaient toujours par sauter hors de leur enchâssement de glace, en râclant les clous de mes souliers contre des aspérités. Par bonheur, il y avait entre L’Herbaudière et moi plus de vingt mètres de corde. J’approchais néanmoins, et plus vite que je ne l’eusse voulu, de la crevasse. Ni lui ni moi ne poussions un cri. Pas un bruit dans ce blanc désert lumineux de haute montagne, rien que le froissement des débris qui glissaient avec moi, sous moi, contre moi, et allaient plonger dans l’abîme. Oh ! je n’ai revu ni ma jeunesse, ni ma vie, comme l’écrivent les romanciers qui n’ont jamais passé par là. Deux idées seulement, deux idées fixes, plantées dans ma cervelle : Je vais tomber, je ne veux pas tomber. En quelques secondes je m’aperçus qu’il n’y avait aucun espoir ; rien ne pouvait plus arrêter ma chute. Nous étions perdus tous les deux. La seule pensée un peu philosophique qui, en un éclair, traversa mon angoisse fut celle-ci : Dans une minute, la vie va continuer sans que nous y participions plus jamais… on va devenir des choses sans nom… et pour toujours !… Je crois bien, autant qu’on peut préciser les détails de pareilles circonstances, que ce fut à cet instant même que j’aperçus, presque au bord de la crevasse, un bloc de granit extrêmement déchiqueté qui paraissait profondément et solidement enfoncé dans la masse glaciaire. Immédiatement je conçus que mon piolet, qui n’avait pas pu mordre, en dépit de mes efforts, dans la glace même, pourrait peut-être s’accrocher aux aspérités de la pierre. Je le lançai contre le roc, au jugé presque, et soudain je n’eus plus que la sensation d’être coupé en deux par la corde qui tirait rudement de tout le poids de L’Herbaudière, suspendu dans le vide ; mais j’étais arrêté, arrêté dans une situation assez précaire, les deux pieds au-dessus du gouffre, cramponné au manche de mon piolet, dont je sentais l’acier grincer et glisser lentement contre la pierre.
— Je tiens pour quelques secondes, criai-je. Tâchez avec le bout de votre soulier de tailler une petite encoche dans la paroi et de vous y appuyer !
— Je ne peux pas ! mon sac est trop lourd. Il me tire.
— Essayez de défaire les attaches. Laissez-le tomber…
— Vous êtes fou, mon cher ami. J’aime mieux tomber avec lui…
— Mais vous nous tuez tous les deux…
— Coupez la corde, je vous en supplie. Vous avez bien un couteau, quelque chose. Laissez-moi, coupez, coupez.
— Non, votre sac…
Une voix effrayante, folle, péremptoire, ardente, presque joyeuse :
— Ma serviette est dedans !
Je sentis qu’il n’y avait pas à discuter, que j’userais en vain mes forces. Je n’avais d’ailleurs pas le temps d’insister. Je commençais, jouant le tout pour le tout, à me tirer péniblement le long du manche de mon piolet. Quand je pus accrocher deux doigts à une des aspérités rocheuses, l’acier de la pioche allait définitivement sauter hors de la prise. La catastrophe avait tenu à un quart de seconde. Le reste… Arcbouté à ce granit solide, je halais la corde de mes bras brisés par l’émotion. Je vis d’abord les deux mains de mon compagnon s’agripper sur la glace du bord, son bras se tordre pour un rétablissement, sa figure livide apparaître. Un instant après, il était assis à mes côtés. Pas un mot. Nous tremblions. Nous allions sangloter. D’un coup nous vidâmes ce qui restait d’eau-de-vie dans les gourdes… et nous nous endormîmes.
Les premières roseurs sur l’Aiguille Verte annonçaient le soir quand nous nous mîmes à remonter la pente du Chardonnet. Nous n’avions pas échangé une parole. En marchant, ou plutôt en traînant mes jambes brisées et lasses sur cette glace que le crépuscule tout proche teintait d’un gris perle adorable, je roulais dans ma tête des pensées qui n’avaient rien d’amène pour mon compagnon. Désormais, et malgré les apparences auxquelles je m’étais laissé prendre si longtemps, le problème était pour moi résolu. Je m’étais dupé moi-même. L’Herbaudière était un simple fou, un de ces fous dont le dérangement cérébral ne se manifeste que par une idée fixe, par quelques expressions bizarres et dont toute l’existence est, en dehors de ces symptômes limités, parfaitement normale. Et j’étais plus fou encore que lui de m’être embarqué avec un insensé qui n’avait pas hésité une seconde à sacrifier nos existences pour une serviette probablement bourrée de vieux journaux.
À sept heures environ, nous arrivâmes au pied de la moraine. Je m’arrêtai, j’étendis ma couverture, je sortis les conserves, la lampe à alcool. L’Herbaudière, sans mot dire, s’en alla parmi les pierres couper des tiges de rhododendrons. Nous allumâmes un feu. Il fit fondre de la neige. Étendu, accoudé sur son sac qu’il n’avait pas ouvert, il remuait avec une branche le brasier qu’il fixait obstinément de ses yeux hallucinés, remplis d’une vision lointaine. Jamais la magnificence céleste du jour qui meurt dans les hautes Alpes n’avait moins attiré mon attention. Ni la fraîche douceur des premières brumes qui rôdent et se balancent et s’accrochent au chaos des arêtes, ni les blancheurs éteintes des lumières qui enlacent et bercent les glaciers, ni le ciel qui ne semblait plus être qu’une cendre bleue très pâle où les processions de cimes se profilaient comme des ombres, ni l’inexprimable charme de l’apaisement qui descend ne sollicitaient mes pensées encore frémissantes d’émotion et surtout remuées de colère. L’Herbaudière ne regardait rien, ne mangeait pas, ne buvait pas. Il rêvait. Dans l’isolement de ce monde formidable, il n’y avait plus qu’un indifférent et un ennemi.
Depuis longtemps, dans la nuit, la palpitation brillante des étoiles et le dialogue muet des sommets sombres avec les mondes du ciel étaient seuls vivants. Soudain L’Herbaudière, s’appuyant sur son coude, s’assit. Il dénoua lentement les petites cordes qui fermaient son rücksac, il en écarta la coulisse, il en tira sa serviette. Puis il me tendit la main.
— Mon ami… commença-t-il avec une réelle émotion, vous m’avez sauvé la vie en risquant la vôtre. M’avez-vous rendu un fameux service ? Je n’en sais rien. Mais je sais bien que vous avez accompli, et avec quel courage, votre devoir d’homme. À votre place, j’aurais sans hésiter coupé la corde qui me reliait à un être que j’eusse jugé fou et qui m’entraînait à la mort… Ne protestez pas. Je vais vous en remercier d’une singulière manière : en vous confiant le secret qui a bouleversé ma vie, secret dont vous avez l’obsession, je le sais, depuis la première minute où vous m’avez connu et qui va bouleverser la vôtre aussi, hélas ! Pour la dernière fois, en cet instant où je vous parle, vous avez considéré le monde d’un œil paisible et d’un cœur calme. Vous allez bientôt comprendre mon sourire. Désormais le même passera sur vos lèvres. Vos années de joie sont terminées. Je suis résolu à vous infliger cette souffrance pour deux raisons. D’abord parce que ce tête à tête avec la mort m’a convaincu que je n’avais pas le droit de disparaître demain peut-être en emportant avec moi ce que je sais. Nul plus que vous n’est digne de le savoir avec moi. Ensuite, surtout, – et à ce moment sa voix se fit plus grave, ses yeux semblèrent fouiller ma pensée, – je ne puis pas supporter l’idée que pour vous, que j’aime maintenant mieux que moi-même, je ne suis qu’un pauvre fou, qui a joué votre existence sur une lubie de son cerveau détraqué. Maintenant vous pouvez refuser. Il ne tient qu’à vous.
Je fis, sans réfléchir, un signe pour affirmer que j’acceptais. Ce fut un réflexe, et pourtant, je dois l’avouer, au moment même où j’accueillais ainsi la confidence persistait en moi le soupçon que je me trouvais en face d’un de ces détraqués habiles à dissimuler, par une sorte de raffinement de leur déséquilibre, la réalité de leur maladie. Mais une curiosité surexcitée par un an d’hypothèses et d’attente ne se récuse pas. L’Herbaudière réfléchit un instant comme s’il hésitait encore. Puis il reprit, sans que je comprisse bien à quelle pensée correspondait ces mots qu’il s’adressait à lui-même :
— Non, je n’ai pas le droit… Le manuscrit que vous allez trouver là, ce que je vais vous livrer, j’exige, vous entendez bien, j’exige que vous en gardiez le secret et la hantise pour vous tout seul… jusqu’à ma mort. Faites-vous un cœur capable d’affronter la terrible amertume de ce qui aurait pu être. Je considère que j’ai votre parole. Si, moi vivant, l’on connaissait ce récit, j’ai peur, j’ai peur de moi-même… Peut-être pourrais-je à mon insu laisser échapper quelques indications, bien que moi-même je sois trop dans le vague pour fournir un itinéraire précis. Mais je sais quand même. Je ne veux pas que, par ma faute, une humanité qui a trouvé la formule du bonheur soit exposée à subir l’assaut de notre monstrueuse civilisation. Ce n’est pas moi qui indiquerai jamais ce que je me rappelle de la route de ce monde bienheureux à notre prodigieuse aberration. Mais quand je serai enfin affranchi de la torture de ne pas être né sur la terre bénie, là-bas, publiez les pages que je vais vous remettre. Peut-être… Peut-être pourront-elles un jour tomber sous les yeux d’un homme qui courbera son front sur leur vérité et se relèvera… prophète. Peut-être inspireront-elles un de ces grands conducteurs de nations qui trouvera en elles les éléments de sa force pour arrêter nos continents sur la voie de folie où ils s’engouffrent en chantant. Peut-être le convaincront-elles que l’on peut recommencer ?