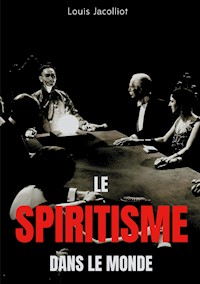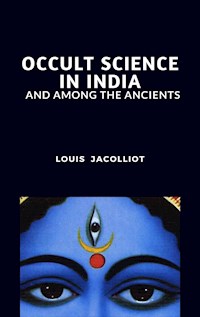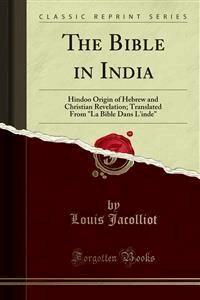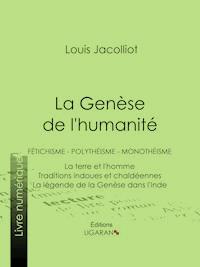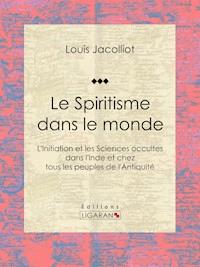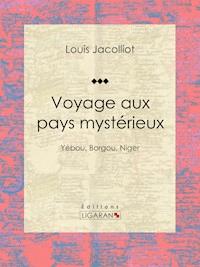
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "En quittant Gato pour accomplir la partie la plus longue et la plus périlleuse de notre voyage, la caravane réunie par le capitaine Edward Adams était composée de la manière suivante : Simpson, premier-maître de la Sarah et Tom Hopkins son second, à l'avant-garde. C'étaient des hommes sur lesquels on pouvait absolument compter, ils avaient sous leurs ordres cent des guerriers béniniens qu'Adams avait obtenus de l'oba d'Ouéni (roi de bénin)."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335034936
©Ligaran 2015
Départ de Gato. – Le village d’Akou. – La danse au Bénin. – Obi-Kofou. – Les grands mondes. – La récolte du miel. – Le résultat de l’abolition de la traite à la côte d’Afrique. – Un sacrifice humain. – La fête de l’Igname. – Orgies nègres. – Les traditions génésiaques au Bénin. – Aroué et lolouc (dieu et le diable). – Qu’est-ce que le Fétichisme ? – Les gangas (prêtres). – Mœurs, traditions et droit coutumier. – L’esclave maître de sa vie. – Le jugement de dieu par le poison. – Arrivée à Imbodou. – La Foire. – Kadour et Kaïd. – Margarita Regina Beniniana. – Surpris par un caïman. – Le marché aux esclaves. – L’Angleterre ne faisant abolir la traite des noirs que pour s’en attribuer le monopole. – Asylum for the liberated Africans. – Ce que vaut la philanthropie anglaise. – Missionnaires et Prédicants. – Nos sociétés de géographie et les voyageurs de commerce anglais. – Quand donc la France reprendra-t-elle sa politique coloniale.
En quittant Gato pour accomplir la partie la plus longue et la plus périlleuse de notre voyage, la caravane réunie par le capitaine Edward Adams était composée de la manière suivante : Simpson, premier-maître de la Sarah et Tom Hopkins son second, à l’avant-garde. C’étaient des hommes sur lesquels on pouvait absolument compter, ils avaient sous leurs ordres cent des guerriers béniniens qu’Adams avait obtenus de l’oba d’Ouéni (roi de Bénin), À l’arrière-garde Kennedy et Spiers, quartiers-maîtres, qui ne le cédaient à leurs camarades ni en fidélité, ni en courage. Ils commandaient également à une troupe de guerriers au nombre de deux cents environ. Au centre, les porteurs, à demi courbés sous le poids des marchandises, étaient attachés par dix de front, maintenus dans cet ordre par les guerriers qui, armés d’un énorme rotin (sorte de jonc très abondant sur les rives du Formose), circulaient autour du troupeau humain, comme les chiens de berger autour d’une bande de moutons, et frappaient à tour de bras sur les traînards. C’étaient des esclaves loués pour la circonstance et les soldats du roi d’Ouéni auraient cru déroger en les traitant autrement que des bêtes de somme. Puis suivaient, avec entière liberté d’allures, M. Jims, notre mulâtre cuisinier, toujours de plus en plus fier de descendre de l’illustre famille des Défossés, et près de lui son négrillon Charly, qui conduisait le petit âne acheté à Gato pour porter nos provisions fines, le coffre à médicaments et nos munitions ; l’Irlandais Patrick, type de gaieté et de bonne humeur, que le capitaine avait attaché à nos personnes, et qui était en perpétuelle discussion avec Jims. Zennah et Kanoun, les doux jeunes esclaves noires, dont le chef d’Arobo nous avait fait cadeau, faisaient partie de ce groupe. Obi-Ourano, second fils du vieux chef notre ami, qui n’avait pas voulu nous quitter, Isidore le Khroumane, loué à Dakar, comme un interprète, Lucius Crezulesco, le jeune Roumain que nous avions recueilli à Dakar, le capitaine et moi, nous nous trouvions tantôt en tête, tantôt à l’arrière-garde, selon l’inspiration ou l’attrait du paysage.
Sans compter les guerriers d’Ouéni qui nous faisaient escorte et les esclaves porteurs, dont j’aurai fort peu à m’occuper, comme on va le voir bientôt, notre petite troupe se composait de vingt et une personnes, seize Américains et Européens, et cinq indigènes, dont deux femmes et un enfant, le négrillon Charly.
Pour les lecteurs à qui la première partie de ce voyage serait inconnue, je dois dire que le capitaine Edward Adams n’était pas un explorateur poussé dans le bassin du Niger par le désir de rectifier une erreur de géographie, mais un de ces hardis pionniers du commerce qui, en se rendant dans des contrées non encore exploitées, arrivent en une seule campagne à ramasser une fortune qu’ils n’acquerraient pas en vingt ans de cabotage à la côte. Il avait apporté à bord de la Sarah, charmante goélette admirablement aménagée pour ce voyage, toute une cargaison de carabines à répétition, de révolvers et autres marchandises qu’il se proposait d’échanger avec les populations des royaumes de Yébou, de Borgou et du Haoussa, sur le Niger supérieur.
La Sarah avait jeté l’ancre dans la rivière de Formose, en face du village de Gato, où elle était restée sous les ordres d’un officier, le master Georges Oldham. À l’aide de riches présents, Adams avait obtenu du roi d’Oouéni, ou Bénin, comme portent nos cartes, trois cents guerriers pour l’escorter, et le chef de Gato lui avait loué ses esclaves pour porter les marchandises.
Nous n’avions, Lucius et moi, aucun intérêt commercial dans l’entreprise ; simples passagers à bord de la Sarah, nous devions conserver, pendant la longue exploration qui commençait, la qualité de voyageurs libres.
Toute la caravane pouvait se fier aveuglément à la troupe de guerriers béniniens chargés de nous présenter aux différents rois et chefs du Yébou et du Yarribah, et au besoin de nous défendre, car comme garantie de leur fidélité, dix personnes de la famille royale avaient été livrées en otage à bord de la Sarah. Ce système de caution est très en usage à la côte de Guinée et dans l’intérieur, et les engagements ainsi consacrés sont de part et d’autre scrupuleusement exécutés. Chaque Béninien savait que s’il nous laissait arriver la moindre mésaventure par sa faute, il s’exposait non seulement à avoir la tête tranchée, mais encore à faire vendre tous les membres de sa famille comme esclaves.
Enfin, comme dernier renseignement utile à rappeler, on se souvient que les derniers ordres du capitaine Adams à Georges, le master, officier de confiance qui naviguait avec lui depuis plus de quinze ans et commandait la Sarah pendant notre absence, étaient ceux-ci :
« Tu iras mouiller ce soir à Arobo (première station du Formose), le lieu est plus salubre. Si dans un an, jour pour jour, nous ne sommes pas rentrés, si aucune nouvelle de nous ne t’est parvenue, descend le fleuve jusqu’à l’Owaré, pénètre dans le Niger et remonte aussi loin que tu pourras. Si la nouvelle de notre mort arrive jusqu’à toi, retourne en Europe avec la Sarah dont je te fais cadeau ; si tu n’entends rien dire de nous, attends, car il est impossible que toute cette expédition soit massacrée sans que les riverains du Niger ne finissent par le savoir. »
Comme on le voit, en matière de précaution, tout le possible avait été fait, et l’opinion d’Obi-Ourano, notre ami, était que la protection de l’oba d’Ouéni serait assez puissante pour nous défendre dans le Yébou et le Yarribah… Dans le Borghou et le Haoussa, c’était moins sûr, le roi de Bénin n’y étant point assez connu pour qu’on pût redouter sa vengeance. Dans ce cas, nous devions faire appel à nos armes perfectionnées, au maniement desquelles les Béniniens devaient être exercés pendant la route. Cent cinquante carabines, révolvers, bien manœuvrés, ne devaient pas craindre une petite armée, et lorsque Adams parlait de la possibilité d’un engagement, sur le Niger supérieur, il se frottait les mains et disait avec son flegme de Yankee :
– Oh ! si nous avons la bataille, ce sera une magnifique puff (réclame) pour mes armes.
Le soir de notre premier jour de marche, nous campâmes près d’une petite ville du nom de Akou. D’après ce que nous affirma Obi-Ourano, ce lieu est un des plus commerçants de tout le Bénin, à cause de sa proximité du fleuve. Je remarquai que les maisons étaient toutes construites avec le raphix vinifère.
Cet arbre (raphia vinifera), de la famille des palmiers, foisonne dans cette contrée où il rend les plus grands services ; il est de grandeur moyenne et ses feuilles à folioles épineuses atteignent souvent huit à dix pieds de longueur. Les régimes de fruits sont également très grands : j’en ai vu qui avaient un développement tel qu’un seul homme ne pouvait que difficilement les porter.
Le tronc de cet arbre bienfaisant sert à former la charpente des habitations, et les feuilles disposées artistement en plusieurs faisceaux, après qu’on a tourné les folioles d’un seul côté, sont placées alternativement, et entassées comme les bottes de paille dont se servent les couvreurs de chaume en Europe. Elles composent les côtés et la couverture, et deviennent très solides par la précaution qu’ont les indigènes d’attacher ces folioles avec des lianes pour que le vent ne les soulève pas. Ces sortes de cases forment de bons et solides abris contre les pluies et les ardeurs du soleil ; mais en même temps elles servent de repaire à des quantités de gros rats, de vipères et de couleuvres, lesquelles, du reste, donnent sans cesse la chasse aux rats. Pendant la nuit que nous passâmes à Akou, le chef du village fit mettre à notre disposition plusieurs des cases les plus confortables du village, mais il nous fut impossible d’y reposer tranquillement, à cause du bruit singulier que rats et vipères, les uns se sauvant, les autres poursuivant, firent jusqu’au jour dans les feuilles sèches de la toiture qui n’était guère élevée de plus de sept à huit pieds au-dessus du sol. Plusieurs fois même, à la lueur des lampes de terre dont on avait garni ces habitations en notre honneur, nous aperçûmes les corps luisants et noirâtres des trigonocéphales qui se glissaient précipitamment entre deux paquets de feuilles ; et nous ne pouvions nous empêcher de frissonner un peu, en songeant à la morsure presque toujours mortelle de ces animaux.
Cependant, comme je pus m’en convaincre par la suite, ces terribles hôtes vivent tranquillement dans les toitures des cases, sans être un danger sérieux pour les habitants ; je n’ai jamais entendu dire, en effet, qu’un seul indigène eût été mordu dans sa maison. C’est autre chose dans les champs de sorgho, de millet et de canne à sucre, que le noir parcourt pieds nus ; il ne se passe de jour qu’il n’y ait quelques victimes.
Avant d’employer le tronc du vinifera pour se construire un abri, l’indigène l’exploite pendant plusieurs mois en vin de palme ; il retire de cet arbre, par des incisions, une liqueur grisâtre qu’il nomme boudhou. Cette boisson n’est pas aussi douce que le vin de palme ordinaire que l’on retire de l’elœïs guinensis, mais les nègres la préfèrent de beaucoup, parce qu’elle contient une plus grande quantité d’alcool, et que, eu égard à la petite taille de l’arbre qui la donne, ils peuvent la recueillir sans fatigue. L’elœïs atteignant jusqu’à quatre-vingt-dix et cent pieds de hauteur, et l’incision pour obtenir la liqueur devant être faite au sommet de l’arbre, à la naissance du bouquet de feuilles qui le couronne, on conçoit que ce soit un véritable travail pour l’indigène que de monter au sommet de l’arbre, soir et matin, pour remplacer les calebasses pleines par des vides.
Les fruits du raphia vinifera servent aussi à faire une boisson dont les nègres sont encore plus friands que de celle obtenue naturellement. Chaque mois ils ramassent de grandes quantités de ces fruits, et après les avoir dépouillés de leur enveloppe écailleuse, ils laissent fermenter les amendes, et en retirent une liqueur plus colorée et plus savoureuse, qui se garde plus longtemps et les enivre comme ferait l’eau-de-vie.
Tout autour d’Akou, le terrain nous parut des plus fertiles, les ananas, les bananiers, goyaviers, manges, oranges, citrons, melons, pastèques et giraumons de toutes espèces, y poussaient sans culture et les rues étaient envahies, par le pourpier doré, l’épinard sauvage, la brède des créoles, l’oseille, et une foule de légumes du pays dont nous ne connaissions pas encore l’usage, mais qu’Obi-Ourano nous affirma être fort bons.
Chaque maison possédait un jardin entouré d’un rempart naturel, formé par le rotang (calamus secundiflorus), arbuste de la famille des palmiers qui s’élève tout au plus à la hauteur de dix à douze pieds. À l’aide des fortes épines qui garnissent l’extrémité de ses feuilles, il s’accroche à tous les corps environnants. Les feuilles mêmes qui pendent jusqu’à terre s’entortillent entre elles, de manière que chaque arbuste forme à lui seul un buisson impénétrable à toute espèce de gros animaux ; tout au contraire il sert de barrière et de rempart naturel aux termès, fourmis, guêpes, oiseaux et rats palmistes qui se réfugient sous son ombrage impénétrable pour échapper à leurs nombreux ennemis ; on ne saurait s’imaginer à quel point ce genre de clôture donne un aspect pittoresque à chaque case et par suite au village entier.
Des liens de parenté unissaient le chef du district d’Akou à la famille d’Obi-Ourano et nous dûmes à cette circonstance d’être reçus avec une magnificence toute royale. Du manioc, des patates et de petits cochons rôtis furent distribués à profusion à tous nos hommes, ainsi que des calebasses pleines de boudhou, ce qui ne tarda pas à les mettre en belle humeur. Dès que l’Africain est content, il faut qu’il danse, qu’il saute, qu’il crie, jusqu’à épuisement. La fête n’est complète que quand suant, haletant, poussant des sons inarticulés, il ne lui reste que juste la force d’aller se jeter dans la rivière ou l’étang le plus voisin, d’où, après une immersion de quelques secondes, il sort pour aller dormir sous un arbre, ou dans un coin de l’espèce de véranda – quatre piquets surmontés d’un toit de feuillage – qui précède sa case.
La danse au Bénin, composée de sauts brusques, sur un rythme monotone, au son de rondelles de cuivre qu’on frappe les unes contre les autres, est bien l’exercice le plus violent, le travail le plus pénible que je connaisse. Le musicien, si l’on peut donner ce titre à celui qui dirige la danse, frappe d’abord lentement et avec mesure ses deux morceaux de métal l’un contre l’autre ; les danseurs le suivent. Peu à peu ils s’animent les uns les autres, en poussant des interjections gutturales ; bientôt c’est à qui frappera et sautera le plus vite. Les noirs finissent pas rouler pêle-mêle dans la poussière ; le dernier qui résiste est salué par les hourrahs frénétiques de la foule. Si un danseur parvient d’aventure à lasser le musicien, l’enthousiasme de l’assemblée ne connaît plus de bornes ; le vainqueur, quel qu’il soit, reçoit un mouton en cadeau ; on conçoit que celui qui n’a qu’à faire entrechoquer ses rondelles de cuivre, doit le plus souvent remporter ce prix ; aussi le présent du mouton est-il considéré comme son salaire habituel.
Tous nos gens prirent part à cette infernale sauterie, et le chef, à notre considération, voulut bien prêter le tambour placé à la porte de son palais, et sur lequel un esclave annonce, d’après le nombre de coups qu’il frappe, le rang des visiteurs de distinction.
Ce tambour, que les obas et les obis, les rois et les chefs, ont seuls le droit de posséder, d’après les usages du pays, comme un signe de leur autorité, n’est prêté pour les danses publiques que lors de la plus grande fête de tout le Bénin, la fête de l’Igname, qui a lieu à l’époque de la maturité de cette plante précieuse, qui tient lieu de pain à presque toutes les populations des côtes de Guinée et de l’intérieur. Cette circonstance ne contribua pas peu à nous relever dans l’estime des habitants d’Akou, car en dehors du cas que nous venons de citer, le tambour de l’obi ne paraît en public que quand le roi d’Ouéni vient visiter la contrée.
Après avoir contemplé pendant quelques instants le curieux spectacle que nous offraient les deux ou trois cents noirs des deux sexes qui se trémoussaient à qui mieux mieux sur la place principale du village, nous nous rendîmes au palais de Kofou – c’était le nom du chef – où un souper nous avait été préparé. J’étais fort disposé à y faire honneur, pourvu que les mets fussent présentables, car la chaleur du jour avait été telle que c’est à peine si, au dîner qui avait eu lieu à cinq heures, comme à bord, j’avais eu la force de prendre un peu de potage et quelques fruits.
Pour que mes lecteurs ne soient pas étonnés de me voir parler de potage dans le bassin du Niger, et à la suite d’une caravane en marche, je crois qu’il est utile de donner, dès le début de notre excursion, quelques indications sur notre manière de vivre.
Je suis persuadé que j’ai dû ma santé, pendant mes longues pérégrinations autour du monde, d’un côté à la régularité de mes repas, aux heures fixées : chasses, études, travaux, j’ai toujours tout arrêté pour manger, estimant qu’il n’y a aucune crânerie à se donner migraines, névralgies, gastrites, etc., par l’irrégularité avec laquelle on répare les forces de sa nature physique, et d’un autre côté à l’habitude que j’ai contractée, sous tous les climats, sous toutes les latitudes, de faire du potage, je devrais plutôt dire de la soupe, le début obligé de tous mes repas. Les herbages, les légumes, les volailles, le gibier, le poisson et le mouton si abondant dans presque toutes les contrées de l’Afrique, donnent le moyen de varier ce mets à l’infini ; en y ajoutant sous les tropiques un piment ou deux, il est aussi digestif que rafraîchissant.
Le capitaine Adams, qui m’appelait en plaisantant le commissaire aux vivres, agent victualler, me laissait la direction absolue de notre nourriture, aussi avais-je formé notre cuisinier, l’honorable Jims, à des habitudes de régularité et d’hygiène gastronomique dont tout le monde se trouva bien tant que les fièvres pestilentielles du Niger ne vinrent pas décimer notre troupe.
La première de toutes les précautions à prendre, dans les contrées équatoriales, consiste à ne jamais se mettre en marche le matin à jeun. Aussi, au lever du soleil, le jeune Charly, que Jims avait dressé à cet effet, faisait-il son entrée, sous les abris de feuillage qu’on établissait chaque soir, ou dans nos cases quand nous logions dans un village, apportant aux Américains leur café, dont pour rien au monde ils ne se seraient passés et que, grâce à un innocent stratagème, je pus leur conserver pendant toute notre excursion, et à Lucius et à moi un bol de bouillon dans lequel, en guise de pain, on avait fait cuire du riz, du maïs concassé, ou des menues graines empruntées à ces innombrables variétés de millet et de sorgho qui couvrent les plaines de l’Afrique centrale.
À moins d’empêchement majeur, la caravane s’arrêtait à dix heures pour déjeuner ; le soir, à cinq heures, au déclin du jour, on dînait au campement choisi pour la nuit.
Je viens de dire que j’avais conservé aux Américains leur café pendant tout le voyage ; ma recette est bien simple. Le jour où M. Jims vint m’annoncer que la provision de café diminuait, je fis ajouter, par parties égales, de l’orge grillé à ce qui restait, et quand ce mélange fut épuisé, l’orge continua à jouer si bien le rôle de café, que nos hommes ne s’en aperçurent pas. Je croyais à une simple plaisanterie bonne pour des matelots habitués à boire n’importe quoi sous le nom de café : quel ne fut pas mon étonnement de reconnaître, après avoir goûté à cette boisson, que non seulement l’illusion était possible, mais encore que le café d’orge était vingt fois préférable aux horribles mixtures où règne la chicorée, que l’on nous sert à Paris dans les établissements de second ordre.
Nous fîmes honneur au repas que Kofou nous offrit dans la grande case réservée à l’oba d’Ouéni quand il venait visiter la contrée, et je dois dire en toute sincérité que les mets qui nous furent présentés n’étaient pas trop indignes d’un palais européen. On nous servit d’abord différentes espèces de poissons grillés ; je n’eus qu’à me faire apporter quelques citrons et des graines de malaguette ou poivre du pays pour leur faire une sauce qui les rendit délicieux. On nous apporta ensuite un mouton entier rôti avec une sorte de couscous de blé dans lequel on avait introduit une certaine quantité de noix de coco râpée qui lui donnait un goût étrange. C’est le plat national du Bénin et du Yébou ; nous nous y habituâmes peu à peu et finîmes par le trouver excellent. Plusieurs variétés de bananes, des ananas, des oranges, des sapotilles et des papayes composèrent notre dessert. Quelques bouteilles de tafia que le capitaine emprunta à nos provisions achevèrent de mettre tout le monde en bonne humeur, et je pus constater que le vieux Kofou considérait l’aloughou (rhum), ainsi que tous ses compatriotes, du reste, comme la plus précieuse denrée que les Européens aient apportée dans leur pays.
– Les grands mondes, chez les blancs, me fit-il dire par Ourano qui nous servait d’interprète, doivent boire de l’aloughou toute la journée.
Par boire, il entendait se griser ; le noir ne commence à trouver qu’il a bu que quand il ne peut plus se tenir.
Je ne vis jamais d’Africain plus étonné que quand je lui eus fait répondre que, chez nous, les grands mondes ne buvaient pas d’aloughou ; après m’avoir considéré quelques instants en silence, il finit par secouer la tête d’un air d’incrédulité et tendit sa calebasse. Nous le traitâmes comme un grand monde africain en la remplissant jusqu’au bord ; elle tenait certainement plus d’un litre : il eut la force de la vider trois fois sans en paraître incommodé.
L’expression de grand monde, généralement adoptée par les noirs de cette côte, depuis Sierra-de-Leone jusqu’au Gabon, indique dans son sens exact un homme qui n’a pas besoin de travailler de ses mains pour vivre. Cette qualification, ambitionnée par tous les noirs comme un titre de noblesse, s’applique à une foule de gens, depuis l’homme libre jusqu’au roitelet, mais on ne saurait prétendre à ce titre de grand monde si l’on ne possède au moins une femme, une case, un petit champ et un esclave.
Quand nous nous retirâmes dans nos cases pour prendre un peu de repos, le gros tambour de l’obi roulait toujours ses sons plus lugubres que gais, et les habitants d’Akou, dont le nombre s’était augmenté, depuis que le bruit des réjouissances avait gagné la campagne, continuaient à danser en notre honneur.
Il n’y a pas de fête complète, au Bénin, sans des sacrifices humains, et nous apprîmes le lendemain que deux esclaves avaient été égorgés et leur sang répandu à terre devant les portes de nos cases pour nous rendre propices les esprits qui président aux voyages heureux.
Au petit jour, je me levai pour aller observer de près quelques-uns des sujets les plus intéressants de la flore de la contrée que je n’avais fait qu’apercevoir la veille. Je fus obligé pour sortir d’enjamber les corps de Zennah et de Kanoun. Suivant leur habitude, nos deux fidèles négresses, enroulées dans la pièce d’étoffe qui leur servait de pagne le jour et de moustiquaire la nuit, dormaient dans l’intérieur et en travers de la porte de notre chambre.
Le sol des environs d’Akou est à peu près le même que celui d’Arobo et de Gato. Peu élevé au-dessus du fleuve, il est inondé chaque année, et le terrain noirâtre et comme tourbeux, toujours humide, est couvert de la plus belle végétation. J’y distinguai l’anthoclesta aux feuilles énormes et presque spatulées, diverses espèces de naucléa, des calamus, de magnifiques elœïs, des mertensia, des aroïdes à grandes et larges feuilles, et quantité de poivriers sauvages. L’uvaria æthiopica se montrait également avec une grande abondance dans ces parages : c’est l’arbre le plus commun de cette partie de l’Afrique, je l’y ai rencontré jusqu’au Niger supérieur. Il est très estimé des nègres à cause de son fruit aromatique qui fait entre eux l’objet d’un commerce très étendu ; les caravanes du haut Niger en portent de grandes quantités dans le Haoussa, le Bournou, et jusqu’au Soudan et au Dar-Four. Il est connu en France sous le nom de poivre de Guinée des droguistes. Ces fruits sont réunis plusieurs ensemble sous un réceptacle globuleux porté à l’extrémité d’un long pédoncule ; les graines sont renfermées dans une pulpe sèche, très aromatique ; c’est cette pulpe desséchée qui constitue un condiment des plus agréables, elle a à peu près ; la saveur du raventsara, ou quatre épices de Madagascar.
Je me promenais depuis près d’une heure, glanant d’ici, de là, d’incomparables richesses pour mon herbier, lorsqu’à l’extrémité d’un petit enclos, une vieille négresse, que je rencontrai m’offrit des galettes de maïs et un rayon de miel ; je goûtai à ce dernier, et le trouvai supérieur à tous ceux dont j’avais mangé jusqu’à ce jour. C’était la première fois que je voyais du miel ; depuis notre entrée dans le Bénin ; je demandai à la brave femme d’où venait cette récolte. – Manpata ! Manpata ! me répondit-elle, et comme je lui faisais comprendre que je n’en tendais pas sa réponse, elle me fit signe de la suivre. Elle me conduisit au fond de son enclos et me montra un arbre magnifique, d’une hauteur d’environ cent vingt pieds, que je reconnus être le Parinarium excelsum. Quel ne fut pas mon étonnement, en l’examinant, de voir toutes ses branches garnies de ruches. C’est par milliers depuis que j’ai pu observer ce genre d’installation, en usage dans tout le Yébou et le Borghou.
Cet arbre gigantesque a cela d’extraordinaire qu’il est, pendant toute l’année, couvert d’une grande quantité de petites grappes de fleurs blanches qui, par leur odeur délicieuse, attirent un nombre prodigieux d’abeilles.
Pour retenir les abeilles sur cet arbre, sel nègres suspendent aux branches des ruches de paille très bien faites, enduites de bouse de vache pour en chasser les insectes. Les abeilles s’y précipitent avec empressement et les ont bientôt garnies de rayons.
Pour recueillir le miel, les indigènes emploient un moyen bien simple : le soir, quand les abeilles sont toutes rentrées, munis de chiffons et d’une longue corde attachée autour de leur corps, ils montent sur l’arbre ; arrivés auprès des ruches, ils en bouchent les ouvertures avec les chiffons, détachent la corde de leur ceinture, la passent autour d’une ruche en la liant fortement à une des extrémités, et la descendent avec précaution ; un de leurs compagnons reste au bas de l’arbre, la reçoit. On fait la même opération pour toutes les ruches, puis on les porte à l’écart ; on fait brûler à l’entour de la bouse de vache à demi sèche seulement, ce qui produit une épaisse fumée. On arrache alors le bouchon qui ferme l’ouverture, on enlève l’enduit qui couvre la ruche, la fumée pénètre à travers la paille, et les abeilles en sortent précipitamment.
Le noir le plus adroit, placé près d’un grand feu et muni d’un couteau, détache proprement les rayons de miel et les passe à son voisin qui les nettoie et les dépose dans une grande calebasse. Un troisième entretient le feu et la fumée de façon que tout se termine avec une parfaite sécurité. Le miel est emporté à l’instant, et chaque ruche est replacée sur l’arbre après avoir été enduite de nouveau.
Les abeilles, qui ne sont qu’engourdies, rentrent dans leurs ruches au lever du soleil.
J’achetai de la négresse quelques rayons de miel qu’elle m’enveloppa fort proprement dans des feuilles de bananier, et je repris lentement le chemin du village, dont je m’étais écarté de près de deux milles.
Le temps était splendide, le soleil qui commençait à monter à l’horizon avait complètement dissipé l’humidité de la nuit ; quand j’avais commencé ma promenade, toutes les feuilles d’arbres, toutes les pétales de fleurs, étaient couvertes de perles de rosée ; en moins de rien chaque goutte d’eau s’était évanouie sous l’action de la chaleur ; les perruches, les merles métalliques, les bengalis africains, les boulbouls, et toute une armée d’oisillons gazouillaient sur les tiges des cannes à sucre, dans le feuillage des arbres, dans les buissons de lianes, tandis que les rats palmistes et les écureuils noirs jouaient entre eux en passant de branche en branche, poursuivis parfois par ce petit singe gris de Guinée, si pétillant de malice, qu’ils avaient troublé, sur un baobab ou un khaya senegalensis, dans la grave occupation de son déjeuner.
Sur le seuil des demeures, les jeunes béniniennes au torse nu, à la poitrine bien plantée, étaient occupées à traire de petites vaches aux cornes recourbées, et le liquide nacré s’élançait en sifflant dans une calebasse dont la surface se couvrait d’une mousse appétissante.
Je n’ai jamais su résister à un spectacle aussi engageant ; pour quelques cauris je reçus la permission d’approcher mes lèvres d’un des vases pleins de lait et je m’abreuvai à longs traits de la bienfaisante boisson, au grand ébahissement de toutes ces belles filles qui, comme c’est l’usage dans ces contrées, n’usaient du lait qu’à l’état de caillé, ou après l’avoir fait aigrir à l’aide de certains herbages.
Je pus constater que les noirs d’Akou étaient très riches en bestiaux, bœufs, vaches, chèvres, moutons, cochons, mais tout cela est d’assez petite taille. Ils cultivent presque tous le riz, le mil, le maïs, le coton, et diverses espèces de légumes ; quelques-uns se livrent à la chasse et à la pêche. Leur village comme tous ceux, du Bénin, est très peuplé ; chaque case contient de douze à quinze individus : père, mère, enfants et petits-enfants vivant tous pêle-mêle. Les cases sont construites en bambous et roseaux serrés, fixés à des poteaux qui s’élèvent à cinq ou six pieds au-dessus du sol, et supportent une couverture en paille de forme conique. Chaque case, pour les habitants ordinaires, ne consiste qu’en un rez-de-chaussée de six à quinze pieds de diamètre, où l’on entre par un trou carré tout bas, unique ouverture de la case ; l’intérieur est rarement divisé en plus de deux compartiments, n’ayant pour tous meubles que des espèces de claies recouvertes de nattes qui servent de lit. Sur l’arrière se trouve une petite cour, entourée d’une clôture très serrée dans laquelle on fait la cuisine.
La nourriture favorite des Béniniens est une espèce de pâte de millet, qu’ils nomment sanghou, et qui n’est en résumé qu’une espèce de couscous.
Les femmes chargées de ce soin pilent d’abord le millet dans des troncs d’arbre creusés en forme de mortier, puis elles dégagent la farine du son à l’aide d’un petit van circulaire fait avec les tiges minces et flexibles d’un roseau. Elles retirent ainsi deux sortes de farine, l’une qui comprend la partie la plus grossière et la moins blanche est cuite à la vapeur dans un vase en terre ; la préparation est alors sèche et granuleuse et sert à faire le couscous, avec un assaisonnement de bouillon de volaille, de mouton ou de poisson, et de poivre de Guinée ; l’autre sorte se compose de la partie la plus fine et la plus blanche de la farine, on l’accommode avec du lait et on la mange avec du caillé ; ce plat sert au repas du matin, le couscous est réservé pour les repas du soir.
Autant que j’ai pu le remarquer, dans notre passage assez rapide sur cette partie du territoire béninien, les habitants sont de mœurs assez douces, quand ils ne sont pas exaltés par la guerre ou les fêtes publiques, pendant lesquelles ils se grisent de vin de palme et se portent alors, comme toutes les races encore en enfance, aux cruautés et aux excès les plus odieux.
Dans ces circonstances, la via de leurs prisonniers et de leurs esclaves ne compte plus pour eux, et c’est par centaines, par milliers même, si c’est à la cour de l’oba, qu’ils égorgent ces malheureux.
Il faut que nos négrophiles le sachent bien : la situation des esclaves et des prisonniers de guerre en Afrique est beaucoup plus désastreuse depuis l’abolition de la traite. À Dieu ne plaise que je soutienne l’horrible institution de l’esclavage ! mais il est un fait que je constate car il est d’une vérité absolue, c’est que l’esclave n’étant plus une valeur d’échange pour se procurer les marchandises européennes, les rois et les chefs les égorgent par milliers pour donner de l’éclat à leurs fêtes sauvages, qui ne sont souvent qu’un prétexte à se débarrasser de bouches inutiles. J’ai souvent entendu dire en Europe qu’en abolissant la traite on ôtait aux rois africains la tentation de faire la guerre pour se procurer des esclaves à vendre. Ceux qui tiennent semblable langage n’ont jamais mis les pieds à la côte d’Afrique et ignorent d’abord que les rois africains se font la guerre pour de tout autres motifs, et continueront à se la faire malgré l’abolition de la traite, et ensuite que l’état social de ces contrées étant basé sur l’esclavage, les chefs n’ont pas besoin de la guerre pour se procurer des esclaves.
Je reviendrai dans quelques instants sur cette grande question de l’esclavage, pour expliquer ce qui a été fait et ce que l’on aurait dû faire si la traite eût été véritablement abolie dans un but philanthropique et non dans un but politique ; j’arracherai une fois de plus le masque humanitaire dont l’Angleterre voile ses odieuses spéculations.
La question vaut la peine d’être soulevée et traitée, preuves en main, autrement que par quelques phrases accidentelles. J’arrête donc ma plume prête à s’égarer devant l’indignation que suscite toujours chez moi certains souvenirs… et je reviens aux indigènes d’Akou. Avant de quitter le Bénin pour nous enfoncer dans les régions inexplorées du Yébou et du Yarribah, je viderai à fond cette querelle, qui est celle de la générosité et de l’honneur contre la duplicité et le mercantilisme.
Les Béniniens sont en général bien faits, d’un tempérament robuste, d’une taille moyenne et bien prise ; ils ont les cheveux noirs, crépus, laineux, mais très fins, les yeux noirs et bien fendus, les traits agréables et la barbe assez rare.
Les femmes sont mieux faites encore que les hommes, leur peau est d’une douceur et d’une délicatesse extrêmes, et quelques-unes sont vraiment belles, mais comme presque toutes les femmes de ces côtes, depuis le Sénégal jusqu’à Saint-Paul-de-Loanda, au Congo, elles ont l’habitude de s’oindre les cheveux avec du beurre ou de la graisse qui, au bout de quoique temps, deviennent rances, et unis aux émanations de la peau finissent par prendre une odeur peu agréable. Elles agissent ainsi afin de pouvoir peigner et tresser plus facilement leur chevelure.
Les enfants vont nus jusqu’à l’âge de quatorze ou quinze ans pour les garçons, et jusqu’à l’âge de la puberté pour les filles. Pendant l’hivernage, on les couvre d’une pièce de cotonnade bleue. Les hommes, comme les femmes, pour tout vêtement, ne portent qu’un pagne en étoffe appelée guinéo et qui est tissée dans le pays. Les femmes riches portent le pagne beaucoup plus long que les autres et en ramènent un pan sur leur tête ; mais toutes vont la poitrine nue.
Ce sont les jeunes filles et les femmes qui extraient du fruit de l’elœïs l’huile qui y est contenue, et qui, sous le nom d’huile de palme, fait l’objet d’un des commerces les plus importants de l’Afrique.
Elles pilent ces fruits dans des mortiers de bois, détachent ainsi la pulpe oléagineuse qui adhère fortement au noyau et font bouillir l’espèce de pâte qu’elles obtiennent après l’avoir délayée dans une certaine quantité d’eau.
La partie oléagineuse forme à la surface de l’eau une pellicule plus ou moins épaisse qui, en se refroidissant, se fige et prend la consistance du beurre.
Ce produit a une couleur jaune opaque, et une saveur douce, assez semblable à celle de l’huile de coco fraîche ; mais, de même que cette dernière, il rancit rapidement. Quand il vient d’être fabriqué, l’indigène s’en sort pour faire frire des poissons, des légumes et une espèce de galette de viande qu’ils font avec du mouton haché et des aubergines.
À une certaine distance, le village d’Akou me parut beaucoup plus considérable qu’il n’était, et tous les centres habités au Bénin offrent la même illusion au voyageur.
Cela tient à ce que chaque case possède, de l’autre côté de la cour qui sert à la cuisine, souvent même sur le même alignement, son grenier où on enferme les réserves de millet et autres grains servant à l’alimentation. Ces greniers sont couverts d’une sorte de toit en paille bien travaillée, semblable pour la forme à celui des maisons ordinaires, ce qui les fait confondre aisément avec les habitations, et souvent est cause que l’on donne à un village une importance double de celle qu’il a réellement.
Quand je rejoignis mes compagnons, tout était déjà préparé pour le départ. La principale, ou pour mieux dire, l’unique rue d’Akou, était littéralement encombrée par notre caravane et le spectacle des guerriers béniniens sous les armes, ainsi que des esclaves qui attendaient le signal assis sur leurs fardeaux, était des plus pittoresques.