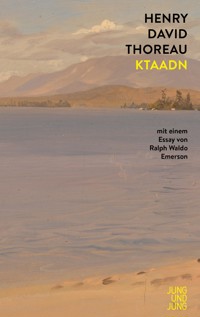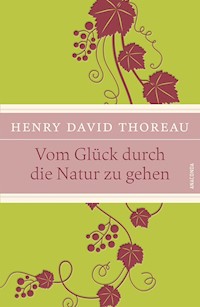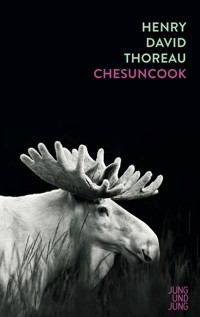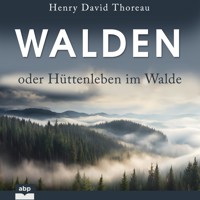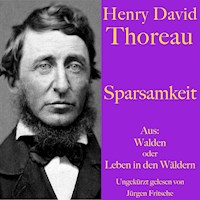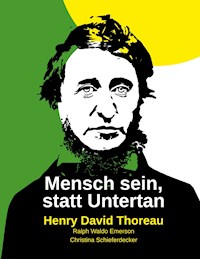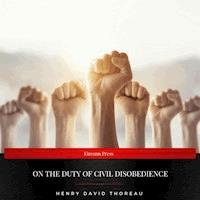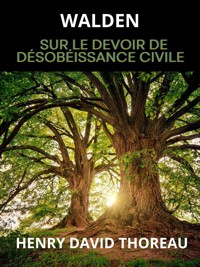
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"Plutôt que l'amour, l'argent ou la gloire, donnez-moi la vérité.
- Henry David Thoreau, Walden
Walden, du célèbre transcendantaliste
Henry David Thoreau, est une réflexion sur la vie simple dans un environnement naturel. L'œuvre est à la fois une déclaration personnelle d'indépendance, une expérience sociale, un voyage de découverte spirituelle, une satire et un manuel d'autosuffisance.
Publié pour la première fois en 1854, il décrit les expériences vécues par Thoreau pendant deux ans, deux mois et deux jours dans une cabane qu'il a construite près de l'étang de Walden, au milieu d'une forêt appartenant à son ami et mentor Ralph Waldo Emerson, près de Concord, dans le Massachusetts. Le livre comprime le temps en une seule année civile et utilise les passages des quatre saisons pour symboliser le développement humain.
En s'immergeant dans la nature, Thoreau espérait acquérir une compréhension plus objective de la société grâce à une introspection personnelle. La vie simple et l'autosuffisance étaient les autres objectifs de Thoreau, et l'ensemble du projet s'inspirait de la philosophie transcendantaliste, un thème central de la période romantique américaine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
WALDEN
Henry David Thoreau
SUR LE DEVOIR DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE
Traduction et édition 2024 par David De Angelis
Tous les droits sont réservés
Contenu
WALDEN
L'économie
Où j'ai vécu et pour quoi j'ai vécu
Lecture
Sons
Solitude
Visiteurs
Le champ de haricots
Le village
Les étangs
Ferme Baker
Droit supérieur
Voisins Brute
Pendaison de crémaillère
Anciens habitants et visiteurs d'hiver
Animaux d'hiver
L'étang en hiver
Printemps
Conclusion
SUR LE DEVOIR DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE
L'économie
Lorsque j'ai écrit les pages suivantes, ou plutôt la majeure partie d'entre elles, je vivais seul, dans les bois, à un kilomètre de tout voisin, dans une maison que j'avais construite moi-même, sur la rive de l'étang de Walden, à Concord, Massachusetts, et je gagnais ma vie par le seul travail de mes mains. J'y ai vécu deux ans et deux mois. Aujourd'hui, je suis de nouveau un voyageur dans la vie civilisée.
Je ne m'imposerais pas autant à mes lecteurs si des questions très particulières n'avaient pas été posées par mes concitoyens sur mon mode de vie, que certains qualifieraient d'impertinentes, bien qu'elles ne me paraissent pas du tout impertinentes, mais, compte tenu des circonstances, tout à fait naturelles et pertinentes. Certains m'ont demandé ce que je mangeais, si je ne me sentais pas seul, si je n'avais pas peur, etc. D'autres ont été curieux d'apprendre quelle part de mes revenus je consacrais à des œuvres de charité ; et certains, qui ont de grandes familles, combien d'enfants pauvres j'entretenais. Je demanderai donc à ceux de mes lecteurs qui ne ressentent pas d'intérêt particulier pour moi de me pardonner si j'entreprends de répondre à certaines de ces questions dans ce livre. Dans la plupart des livres, le je, ou la première personne, est omis ; dans celui-ci, il sera conservé ; c'est là, en ce qui concerne l'égoïsme, la principale différence. Nous oublions souvent qu'après tout, c'est toujours la première personne qui parle. Je ne parlerais pas tant de moi s'il y avait quelqu'un d'autre que je connaissais aussi bien. Malheureusement, je suis confiné à ce thème par l'étroitesse de mon expérience. De plus, j'exige de chaque auteur, qu'il soit le premier ou le dernier, un récit simple et sincère de sa propre vie, et pas seulement ce qu'il a entendu dire de la vie d'autres hommes ; un récit tel qu'il l'enverrait à ses proches depuis un pays lointain ; car s'il a vécu sincèrement, cela doit avoir été dans un pays lointain pour moi. Ces pages s'adressent peut-être plus particulièrement aux étudiants pauvres. Quant aux autres lecteurs, ils accepteront les passages qui les concernent. J'espère qu'aucun d'entre eux n'étirera les coutures en enfilant le manteau, car il peut rendre de bons services à celui à qui il convient.
J'aimerais dire quelque chose, non pas tant sur les Chinois et les habitants des îles Sandwich que sur vous qui lisez ces pages, qui êtes censés vivre en Nouvelle-Angleterre ; quelque chose sur votre condition, en particulier votre condition extérieure ou votre situation dans ce monde, dans cette ville, ce qu'elle est, s'il est nécessaire qu'elle soit aussi mauvaise qu'elle l'est, si elle ne peut pas être améliorée aussi bien qu'elle ne l'est pas. J'ai beaucoup voyagé à Concord ; et partout, dans les boutiques, les bureaux et les champs, les habitants m'ont semblé faire pénitence de mille manières remarquables. J'ai entendu parler de brahmanes exposés à quatre feux et regardant le soleil en face ; de brahmanes suspendus, la tête en bas, au-dessus des flammes ; de brahmanes regardant le ciel par-dessus leurs épaules "jusqu'à ce qu'il leur soit impossible de reprendre leur position naturelle, alors que, par la torsion du cou, rien d'autre que des liquides ne peut passer dans l'estomac ;"ou demeurer, enchaînés pour la vie, au pied d'un arbre ; ou mesurer avec leur corps, comme des chenilles, l'étendue de vastes empires ; ou se tenir sur une jambe au sommet des piliers, - même ces formes de pénitence consciente ne sont guère plus incroyables et plus étonnantes que les scènes dont je suis journellement le témoin. Les douze travaux d'Hercule étaient peu de chose en comparaison de ceux que mes voisins ont entrepris ; car ils n'étaient que douze et avaient une fin ; mais je n'ai jamais pu voir que ces hommes aient tué ou capturé quelque monstre ou terminé quelque travail. Ils n'ont pas d'ami Iolas pour brûler au fer rouge la racine de la tête de l'hydre, mais dès qu'une tête est écrasée, deux surgissent.
Je vois des jeunes gens, mes concitoyens, qui ont le malheur d'avoir hérité de fermes, de maisons, d'étables, de bétail et d'outils agricoles, car il est plus facile de les acquérir que de s'en débarrasser. Il vaudrait mieux qu'ils soient nés en plein pâturage et qu'ils aient été allaités par une louve, afin qu'ils puissent voir d'un œil plus clair le champ dans lequel ils sont appelés à travailler. Qui a fait d'eux des serfs du sol ? Pourquoi mangeraient-ils leurs soixante hectares, alors que l'homme est condamné à ne manger que son morceau de terre ? Pourquoi devraient-ils commencer à creuser leur tombe dès leur naissance ? Ils doivent vivre une vie d'homme, faire face à toutes ces choses et s'en sortir le mieux possible. Combien de pauvres âmes immortelles ai-je rencontrées, presque écrasées et étouffées sous leur fardeau, rampant sur le chemin de la vie, poussant devant elles une grange de soixante-quinze pieds sur quarante, ses écuries d'Auge jamais nettoyées, et cent acres de terre, de labourage, de fauchage, de pâturage et de lot de bois ! Les sans-parts, qui n'ont pas à lutter contre de telles charges héréditaires inutiles, trouvent qu'il est assez laborieux de soumettre et de cultiver quelques pieds cubes de chair.
Mais les hommes travaillent dans l'erreur. La meilleure partie de l'homme est bientôt enfouie dans le sol pour servir de compost. Par une apparente fatalité, communément appelée nécessité, ils sont employés, comme le dit un vieux livre, à se constituer des trésors que la mite et la rouille corrompent et que les voleurs percent et dérobent. C'est une vie de fou, comme ils s'en apercevront à la fin, si ce n'est avant. On dit que Deucalion et Pyrrha ont créé les hommes en leur jetant des pierres sur la tête, derrière eux:-
Inde genus durum sumus, experiensque laborum, Et documenta damus quâ simus origine nati.
Ou, comme le rime Raleigh à sa manière sonore, -
"C'est de là que vient la dureté de notre cœur, qui endure la douleur et les soins, et qui approuve le fait que nos corps soient de nature pierreuse.
C'en est fini de l'obéissance aveugle à un oracle maladroit, jetant les pierres par-dessus leurs têtes, derrière eux, sans voir où elles tombaient.
La plupart des hommes, même dans ce pays relativement libre, par simple ignorance et par erreur, sont tellement occupés par les soucis factices et les travaux superflument grossiers de la vie qu'ils ne peuvent en cueillir les fruits les plus fins. Leurs doigts, à force de travail, sont trop maladroits et tremblent trop pour cela. En fait, l'homme qui travaille n'a pas le loisir d'être vraiment intègre jour après jour ; il ne peut pas se permettre d'entretenir les relations les plus viriles avec les hommes ; son travail serait déprécié sur le marché. Il n'a pas le temps d'être autre chose qu'une machine. Comment peut-il bien se souvenir de son ignorance - ce que sa croissance exige - lui qui doit si souvent utiliser ses connaissances ? Nous devrions parfois le nourrir et l'habiller gratuitement, et le recruter avec nos produits cordiaux, avant de le juger. Les plus belles qualités de notre nature, comme la fleur des fruits, ne peuvent être préservées que par la manipulation la plus délicate. Pourtant, nous ne nous traitons pas nous-mêmes et nous ne nous traitons pas les uns les autres avec autant de tendresse.
Certains d'entre vous, nous le savons tous, sont pauvres, ont du mal à vivre, sont parfois, pour ainsi dire, à bout de souffle. Je ne doute pas que certains d'entre vous, qui lisez ce livre, ne soient pas en mesure de payer tous les dîners que vous avez mangés, ni les manteaux et les chaussures qui s'usent rapidement ou qui sont déjà usés, et qu'ils soient venus sur cette page pour passer du temps emprunté ou volé, en dérobant une heure à leurs créanciers. Il est évident que beaucoup d'entre vous mènent des vies mesquines et sournoises, car ma vue a été aiguisée par l'expérience ; toujours à la limite, essayant d'entrer dans les affaires et essayant de sortir de l'endettement, un bourbier très ancien, appelé par les Latins æs alienum, l'airain d'autrui, car certaines de leurs pièces de monnaie étaient en laiton ; vivre, mourir et être enterré par l'airain d'autrui ; promettre toujours de payer, promettre de payer, demain, et mourir aujourd'hui, insolvable ; chercher à s'attirer les faveurs, à se faire une clientèle, par combien de moyens, seulement pas des délits de prison d'Etat ; mentir, flatter, voter, se contracter dans une coquille de noix de civilité ou se dilater dans une atmosphère de générosité mince et vaporeuse, afin de persuader votre voisin de vous laisser faire ses chaussures, ou son chapeau, ou son manteau, ou sa voiture, ou d'importer ses courses pour lui ; vous rendre malade, afin de mettre de côté quelque chose en prévision d'un jour de maladie, quelque chose à ranger dans un vieux coffre, ou dans un bas derrière le plâtre, ou, plus sûrement, dans la banque de briques ; peu importe où, peu importe combien ou combien peu.
Je m'étonne parfois que nous puissions être si frivoles, je dirais presque, que nous nous intéressions à cette forme de servitude grossière mais quelque peu étrangère qu'est l'esclavage des nègres, car il y a tant de maîtres subtils qui réduisent en esclavage le nord et le sud. Il est difficile d'avoir un surveillant du Sud ; il est pire d'avoir un surveillant du Nord ; mais le pire, c'est quand on est soi-même l'esclavagiste. On parle d'une divinité dans l'homme ! Regardez le conducteur d'attelage sur la route, qui se rend au marché de jour comme de nuit ; y a-t-il une divinité en lui ? Son plus grand devoir est de nourrir et d'abreuver ses chevaux ! Qu'est-ce que son destin par rapport aux intérêts maritimes ? Ne conduit-il pas pour l'écuyer Make-a-stir ? Comme il est divin, comme il est immortel ! Voyez comme il se cache et se faufile, comme il craint vaguement toute la journée, n'étant ni immortel ni divin, mais l'esclave et le prisonnier de l'opinion qu'il a de lui-même, d'une renommée acquise par ses propres actes. L'opinion publique est un tyran bien faible comparé à notre propre opinion privée. C'est ce qu'un homme pense de lui-même qui détermine, ou plutôt indique, son destin. L'auto-émancipation, même dans les provinces antillaises de la fantaisie et de l'imagination, quel Wilberforce est là pour l'obtenir ? Pensez aussi aux dames du pays qui tissent des coussins de toilette contre le dernier jour, pour ne pas trahir un intérêt trop vert pour leur sort ! Comme si l'on pouvait tuer le temps sans blesser l'éternité.
La masse des hommes mène une vie de désespoir tranquille. Ce que l'on appelle résignation n'est qu'un désespoir confirmé. De la ville désespérée, on passe à la campagne désespérée, et l'on doit se consoler avec la bravoure des visons et des rats musqués. Un désespoir stéréotypé mais inconscient se cache même sous ce que l'on appelle les jeux et les amusements de l'humanité. Il n'y a pas de jeu en eux, car ils viennent après le travail. Mais c'est une caractéristique de la sagesse que de ne pas faire des choses désespérées.
Si l'on considère la fin principale de l'homme, pour reprendre les termes du catéchisme, et les vrais besoins et moyens de la vie, on a l'impression que les hommes ont délibérément choisi le mode de vie commun parce qu'ils le préfèrent à tout autre. Pourtant, ils pensent sincèrement qu'il n'y a plus de choix possible. Mais les natures alertes et saines se souviennent que le soleil s'est levé. Il n'est jamais trop tard pour abandonner nos préjugés. Aucune façon de penser ou de faire, aussi ancienne soit-elle, n'est digne de confiance sans preuve. Ce que tout le monde répète ou passe en silence pour vrai aujourd'hui peut s'avérer faux demain, simple fumée d'opinion, que certains avaient pris pour un nuage qui arroserait leurs champs d'une pluie fertilisante. Ce que les vieux disent qu'on ne peut pas faire, on l'essaie et on s'aperçoit qu'on peut le faire. Les vieilles actions pour les vieilles personnes, et les nouvelles actions pour les nouvelles. Les anciens n'en savaient peut-être pas assez autrefois pour aller chercher du combustible frais afin d'entretenir le feu ; les nouveaux mettent un peu de bois sec sous une marmite et sont emportés autour du globe à la vitesse d'un oiseau, de manière à tuer les anciens, comme on dit. L'âge n'est pas mieux qualifié que la jeunesse pour donner des leçons, car il n'a pas profité autant qu'il a perdu. On peut presque douter que l'homme le plus sage ait appris quelque chose de valeur absolue en vivant. En pratique, les vieux n'ont pas de conseils très importants à donner aux jeunes, leur propre expérience a été si partielle et leur vie a été un tel échec, pour des raisons personnelles, qu'ils doivent le croire ; et il se peut qu'il leur reste une certaine foi qui démente cette expérience, et qu'ils soient seulement moins jeunes qu'ils ne l'étaient. J'ai vécu une trentaine d'années sur cette planète et je n'ai pas encore entendu la moindre syllabe de conseil valable ou même sérieux de la part de mes aînés. Ils ne m'ont rien dit, et ne pourront probablement rien me dire qui soit utile. Voici la vie, une expérience que je n'ai en grande partie pas tentée ; mais cela ne me sert à rien qu'ils l'aient tentée. Si j'ai une expérience qui me semble précieuse, je suis sûr de me dire que mes mentors n'en ont pas parlé.
Un fermier me dit : "On ne peut pas vivre uniquement d'aliments végétaux, car ils ne fournissent rien pour faire des os" ; il consacre donc religieusement une partie de sa journée à fournir à son système la matière première des os ; tout en marchant, il parle derrière ses bœufs qui, avec des os faits de végétaux, le poussent, lui et sa lourde charrue, en dépit de tous les obstacles. Dans certains milieux, les plus démunis et les plus malades, certaines choses sont vraiment nécessaires à la vie, alors que dans d'autres, elles ne sont que des luxes, et dans d'autres encore, elles sont totalement inconnues.
Pour certains, tout le terrain de la vie humaine semble avoir été passé en revue par leurs prédécesseurs, tant les hauteurs que les vallées, et toutes les choses semblent avoir été prises en compte. Selon Evelyn, "le sage Salomon a prescrit des ordonnances pour la distance même des arbres ; et les prêtres romains ont décidé combien de fois vous pouvez aller sur la terre de votre voisin pour ramasser les glands qui y tombent sans intrusion, et quelle part revient à ce voisin". Hippocrate a même laissé des indications sur la manière dont nous devrions couper nos ongles, c'est-à-dire même avec l'extrémité des doigts, ni plus courts ni plus longs. Sans doute l'ennui et la lassitude qui prétendent avoir épuisé la variété et les joies de la vie sont-ils aussi vieux qu'Adam. Mais les capacités de l'homme n'ont jamais été mesurées ; nous ne pouvons pas non plus juger de ce qu'il peut faire sur la base de précédents, tant les essais ont été rares. Quels qu'aient été tes échecs jusqu'à présent, "ne t'afflige pas, mon enfant, car qui t'attribuera ce que tu n'as pas fait ?"
Nous pourrions mettre notre vie à l'épreuve d'un millier de tests simples, comme par exemple le fait que le même soleil qui fait mûrir mes haricots illumine en même temps un système de terres comme le nôtre. Si je m'en étais souvenu, j'aurais évité quelques erreurs. Ce n'est pas sous cette lumière que j'ai récolté les haricots. Les étoiles sont les sommets de quels merveilleux triangles ! Quels êtres lointains et différents dans les diverses demeures de l'univers contemplent le même au même moment ! La nature et la vie humaine sont aussi diverses que nos différentes constitutions. Qui dira quelle perspective la vie offre à l'autre ? Pourrait-il y avoir un plus grand miracle que de se regarder un instant à travers les yeux les uns des autres ? En une heure, nous vivrions dans tous les âges du monde ; oui, dans tous les mondes des âges. Histoire, poésie, mythologie, je ne connais pas de lecture de l'expérience d'autrui qui soit aussi surprenante et instructive que celle-ci.
La plus grande partie de ce que mes voisins appellent le bien, je le crois dans mon âme mauvais, et si je me repens de quelque chose, il est très probable que ce soit de mon bon comportement. Quel démon m'a possédé pour que je me conduise si bien ? Vous pouvez dire la chose la plus sage que vous puissiez faire, mon vieux, vous qui avez vécu soixante-dix ans, non sans honneur en quelque sorte, j'entends une voix irrésistible qui m'invite à m'éloigner de tout cela. Une génération abandonne les entreprises d'une autre comme des navires échoués.
Je pense que nous pouvons, en toute sécurité, faire confiance à beaucoup plus que nous ne le faisons. Nous pouvons renoncer à prendre soin de nous-mêmes autant que nous le faisons honnêtement ailleurs. La nature est aussi bien adaptée à nos faiblesses qu'à nos forces. L'anxiété et la tension incessantes de certains sont une forme de maladie presque incurable. On nous fait exagérer l'importance du travail que nous accomplissons ; et pourtant, combien de choses ne sont pas faites par nous ! Ou encore, que se passerait-il si nous étions tombés malades ? Comme nous sommes vigilants ! déterminés à ne pas vivre par la foi si nous pouvons l'éviter ; toute la journée sur le qui-vive, la nuit nous disons malgré nous nos prières et nous nous engageons dans l'incertitude. C'est ainsi que nous sommes obligés de vivre, de révérer notre vie et de nier la possibilité d'un changement. C'est la seule voie, disons-nous, mais il y a autant de voies qu'il peut y avoir de rayons tirés à partir d'un centre. Tout changement est un miracle à contempler, mais c'est un miracle qui se produit à chaque instant. Confucius a dit : "Savoir que nous savons ce que nous savons, et que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, voilà la vraie connaissance". Lorsqu'un homme aura réduit un fait de l'imagination à un fait de sa compréhension, je prévois que tous les hommes finiront par fonder leur vie sur cette base.
Examinons un instant en quoi consistent la plupart des ennuis et des inquiétudes dont j'ai parlé, et combien il est nécessaire que nous soyons inquiets ou, du moins, prudents. Il y aurait quelque avantage à mener une vie primitive et frontalière, bien qu'au milieu d'une civilisation apparente, ne serait-ce que pour apprendre quels sont les besoins essentiels de la vie et quelles sont les méthodes employées pour les obtenir ; ou même pour jeter un coup d'oeil sur les anciens livres de comptes des marchands, pour voir ce que les hommes achetaient le plus souvent dans les magasins, ce qu'ils stockaient, c'est-à-dire quelles sont les denrées les plus grossières. Car les perfectionnements des âges n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme ; comme nos squelettes, probablement, ne se distinguent pas de ceux de nos ancêtres.
Par les mots "nécessaire à la vie", j'entends tout ce qui, de tout ce que l'homme obtient par ses propres efforts, a été dès le début, ou est devenu par un long usage, si important pour la vie humaine que peu de gens, si ce n'est aucun, que ce soit par sauvagerie, pauvreté ou philosophie, tentent jamais de s'en passer. Pour de nombreuses créatures, il n'y a, en ce sens, qu'un seul élément nécessaire à la vie : la nourriture. Pour le bison de la prairie, c'est quelques centimètres d'herbe appétissante et de l'eau à boire, à moins qu'il ne cherche l'abri de la forêt ou l'ombre de la montagne. Aucune des créatures brutes n'a besoin de plus que de nourriture et d'abri. Les nécessités de la vie pour l'homme dans ce climat peuvent, avec assez de précision, être réparties sous les différentes rubriques suivantes : nourriture, abri, vêtements et combustible ; car ce n'est qu'après avoir obtenu ces éléments que nous sommes prêts à aborder les véritables problèmes de la vie avec liberté et perspective de succès. L'homme a inventé non seulement des maisons, mais des vêtements et des aliments cuits ; et c'est peut-être de la découverte accidentelle de la chaleur du feu et de l'usage qui en a été fait, d'abord comme un luxe, qu'est née la nécessité actuelle de s'asseoir près de lui. Nous observons que les chats et les chiens acquièrent la même seconde nature. En nous abritant et en nous habillant convenablement, nous conservons légitimement notre propre chaleur interne ; mais avec un excès de ces éléments ou de carburant, c'est-à-dire avec une chaleur externe supérieure à notre propre chaleur interne, ne peut-on pas dire que la cuisine a commencé ? Darwin, le naturaliste, dit des habitants de la Terre de Feu que, tandis que son propre groupe, bien vêtu et assis près d'un feu, était loin d'avoir trop chaud, ces sauvages nus, qui se trouvaient plus loin, furent observés, à sa grande surprise, "comme ruisselant de transpiration pour avoir subi un tel rôtissage". Ainsi, nous dit-on, le Néo-Hollandais se met impunément à nu, tandis que l'Européen grelotte dans ses vêtements. Est-il impossible de combiner la rusticité de ces sauvages avec l'intellectualité de l'homme civilisé ? Selon Liebig, le corps de l'homme est un fourneau, et la nourriture le combustible qui entretient la combustion interne dans les poumons. Par temps froid, nous mangeons plus, par temps chaud, moins. La chaleur animale est le résultat d'une combustion lente, et la maladie et la mort surviennent lorsque cette combustion est trop rapide ; ou par manque de combustible, ou à cause d'un défaut dans le courant d'air, le feu s'éteint. Bien entendu, la chaleur vitale ne doit pas être confondue avec le feu, mais l'analogie n'a pas lieu d'être. Il ressort donc de l'énumération qui précède que l'expression vie animale est presque synonyme de l'expression chaleur animale ; car si la nourriture peut être considérée comme le combustible qui entretient le feu en nous, - et le combustible ne sert qu'à préparer cette nourriture ou à augmenter la chaleur de notre corps par un apport extérieur, - l'abri et le vêtement ne servent aussi qu'à conserver la chaleur ainsi produite et absorbée.
La grande nécessité pour notre corps est donc de se réchauffer, de conserver la chaleur vitale en nous. Que de peines nous prenons donc, non seulement pour notre nourriture, nos vêtements et notre abri, mais aussi pour nos lits, qui sont nos vêtements de nuit, volant les nids et les poitrines des oiseaux pour préparer cet abri dans l'abri, comme la taupe a son lit d'herbe et de feuilles au fond de son terrier ! Le pauvre homme a coutume de se plaindre que le monde est froid ; et c'est au froid, non moins physique que social, que nous attribuons directement une grande partie de nos maux. L'été, sous certains climats, permet à l'homme une sorte de vie élyséenne. Le combustible, sauf pour cuire ses aliments, est alors inutile ; le soleil est son feu, et beaucoup de fruits sont suffisamment cuits par ses rayons ; tandis que les aliments sont généralement plus variés et plus faciles à obtenir, et que le vêtement et l'abri sont entièrement ou à moitié inutiles. À l'heure actuelle, et dans ce pays, comme je le constate par ma propre expérience, quelques outils, un couteau, une hache, une bêche, une brouette, etc. et, pour les studieux, la lumière d'une lampe, du papier à lettres et l'accès à quelques livres, sont considérés comme des produits de première nécessité et peuvent tous être obtenus à un prix dérisoire. Pourtant, certains, peu avisés, partent à l'autre bout du monde, dans des régions barbares et insalubres, et se consacrent au commerce pendant dix ou vingt ans, afin de vivre, c'est-à-dire de se tenir confortablement au chaud, et de mourir enfin en Nouvelle-Angleterre. Les riches luxueux ne sont pas simplement maintenus confortablement au chaud, mais à une température anormale ; comme je l'ai laissé entendre plus haut, ils sont cuisinés, bien sûr, à la mode.
La plupart des luxes et des soi-disant conforts de la vie, non seulement ne sont pas indispensables, mais constituent des obstacles à l'élévation de l'humanité. En ce qui concerne le luxe et le confort, les plus sages ont toujours mené une vie plus simple et plus maigre que les pauvres. Les anciens philosophes, chinois, hindous, persans et grecs, formaient une classe dont aucun n'a été plus pauvre en richesses extérieures, ni plus riche en richesses intérieures. Nous ne savons pas grand-chose d'eux. Il est remarquable que nous en sachions autant sur eux. Il en va de même pour les réformateurs et les bienfaiteurs les plus modernes de leur race. Nul ne peut être un observateur impartial ou avisé de la vie humaine si ce n'est à partir du point de vue de ce que nous devrions appeler la pauvreté volontaire. Le fruit d'une vie de luxe est le luxe, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce, de littérature ou d'art. Il y a aujourd'hui des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes. Or, il est admirable de professer parce qu'il était autrefois admirable de vivre. Être philosophe, ce n'est pas seulement avoir des pensées subtiles, ni même fonder une école, mais c'est aimer la sagesse au point de vivre selon ses exigences, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité, de confiance. C'est résoudre certains problèmes de la vie, non seulement théoriquement, mais pratiquement. Le succès des grands savants et penseurs est souvent un succès de courtisan, ni royal, ni viril. Ils se contentent de vivre par conformisme, comme le faisaient leurs pères, et ne sont en aucun cas les géniteurs d'une race d'hommes plus nobles. Mais pourquoi les hommes dégénèrent-ils toujours ? Pourquoi les familles s'épuisent-elles ? Quelle est la nature de ce luxe qui enivre et détruit les nations ? Sommes-nous sûrs qu'il n'y en a pas dans notre propre vie ? Le philosophe est en avance sur son âge, même dans la forme extérieure de sa vie. Il n'est pas nourri, abrité, vêtu, chauffé, comme ses contemporains. Comment un homme peut-il être philosophe et ne pas entretenir sa chaleur vitale par de meilleures méthodes que les autres hommes ?
Lorsqu'un homme est réchauffé par les différents modes que j'ai décrits, que désire-t-il ensuite ? Sûrement pas plus de chaleur du même genre, comme une nourriture plus abondante et plus riche, des maisons plus grandes et plus splendides, des vêtements plus fins et plus abondants, des feux plus nombreux, plus incessants et plus chauds, et ainsi de suite. Lorsqu'il a obtenu les choses nécessaires à la vie, il ne lui reste plus qu'à se procurer le superflu, c'est-à-dire à s'aventurer dans la vie dès maintenant, alors qu'il a commencé ses vacances après un labeur plus humble. Le sol, semble-t-il, convient à la graine, car elle a envoyé sa radicule vers le bas, et elle peut maintenant envoyer sa pousse vers le haut avec confiance. Pourquoi l'homme s'est-il enraciné si solidement dans la terre, si ce n'est pour s'élever dans la même proportion jusqu'aux cieux ? car les plantes les plus nobles sont appréciées pour le fruit qu'elles portent enfin dans l'air et la lumière, loin du sol, et ne sont pas traitées comme les humbles esculentes, qui, bien que bisannuelles, ne sont cultivées que jusqu'à ce qu'elles aient perfectionné leur racine, et souvent coupées au sommet dans ce but, de sorte que la plupart des gens ne les reconnaîtraient pas à la saison de leur floraison.
Je ne veux pas prescrire des règles aux natures fortes et vaillantes, qui s'occuperont de leurs propres affaires, que ce soit au ciel ou en enfer, et qui peut-être construiront plus magnifiquement et dépenseront plus abondamment que les plus riches, sans jamais s'appauvrir, ne sachant pas comment ils vivent, - si, en effet, il y en a, comme on l'a rêvé ; ni à ceux qui trouvent leur encouragement et leur inspiration précisément dans l'état actuel des choses, et qui le chérissent avec la tendresse et l'enthousiasme des amoureux,-et, jusqu'à un certain point, je me compte dans ce nombre ; je ne parle pas à ceux qui sont bien employés, quelles que soient les circonstances, et qui savent s'ils sont bien employés ou non;-mais principalement à la masse des hommes qui sont mécontents, et qui se plaignent paresseusement de la dureté de leur sort ou des temps où ils pourraient l'améliorer. Il y en a qui se plaignent le plus énergiquement et le plus inconsolablement de tout, parce qu'ils font, comme ils disent, leur devoir. Je pense aussi à cette classe apparemment riche, mais la plus terriblement appauvrie de toutes, qui a accumulé des scories, mais qui ne sait pas comment les utiliser ou s'en débarrasser, et qui s'est ainsi forgé ses propres entraves d'or ou d'argent.
Si je devais tenter de raconter comment j'ai voulu passer ma vie dans les années passées, cela surprendrait probablement ceux de mes lecteurs qui sont quelque peu au courant de son histoire actuelle ; cela étonnerait certainement ceux qui n'en savent rien. Je me contenterai d'évoquer quelques-unes des entreprises qui m'ont tenu à cœur.
Par n'importe quel temps, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je me suis efforcé d'améliorer le temps et de l'accrocher à mon bâton ; de me tenir à la rencontre de deux éternités, le passé et l'avenir, qui est précisément le moment présent ; de respecter cette ligne de démarcation. Vous me pardonnerez quelques obscurités, car il y a plus de secrets dans mon métier que dans celui de la plupart des hommes, et pourtant ils ne sont pas gardés volontairement, mais sont inséparables de sa nature même. Je raconterais volontiers tout ce que je sais à ce sujet, et je ne peindrais jamais sur mon portail la mention "Entrée interdite".
Il y a longtemps, j'ai perdu un chien de chasse, un cheval bai et une tourterelle, et je suis toujours sur leurs traces. Nombreux sont les voyageurs à qui j'ai parlé d'eux, décrivant leurs traces et les appels auxquels ils répondaient. J'en ai rencontré un ou deux qui avaient entendu le chien, le cheval et même vu la tourterelle disparaître derrière un nuage, et ils semblaient aussi impatients de les retrouver que s'ils les avaient perdus eux-mêmes.
Anticiper, non seulement le lever du soleil et l'aube, mais, si possible, la nature elle-même ! Combien de matins, été comme hiver, avant même qu'un voisin ne s'agite pour vaquer à ses occupations, ai-je été à la mienne ! Il ne fait aucun doute que nombre de mes concitoyens m'ont rencontré au retour de cette entreprise, des fermiers partant pour Boston au crépuscule, ou des bûcherons se rendant à leur travail. Il est vrai que je n'ai jamais aidé matériellement le soleil à se lever, mais, n'en doutez pas, il était de la dernière importance d'y assister.
Que de jours d'automne, de mai et d'hiver passés en dehors de la ville, à essayer d'entendre le vent, de l'entendre et de l'exprimer ! J'ai failli y engloutir tout mon capital et perdre mon propre souffle à force de courir à sa rencontre. Si cela avait concerné l'un ou l'autre des partis politiques, croyez-moi, cela aurait été publié dans la Gazette dès les premières informations. D'autres fois, je guettais depuis l'observatoire d'une falaise ou d'un arbre les nouvelles arrivées, ou j'attendais le soir au sommet des collines que le ciel tombe, afin d'attraper quelque chose, mais je n'attrapais jamais grand-chose, et cette manne se dissolvait à nouveau dans le soleil.
Pendant longtemps, j'ai été rapporteur d'une revue à faible diffusion, dont le rédacteur en chef n'a jamais jugé bon d'imprimer l'essentiel de mes contributions et, comme c'est trop souvent le cas pour les écrivains, je n'ai reçu que mon travail en échange de mes efforts. Cependant, dans ce cas, mes efforts ont été récompensés.
Pendant de nombreuses années, je me suis autoproclamé inspecteur des tempêtes de neige et de pluie, et j'ai fait mon devoir fidèlement ; géomètre, sinon des autoroutes, du moins des sentiers forestiers et de toutes les routes traversant les parcelles, je les ai maintenus ouverts, et les ravins ont été pontés et praticables en toute saison, là où le talon public avait témoigné de leur utilité.
Je me suis occupée des animaux sauvages de la ville, qui donnent beaucoup de fil à retordre à un gardien fidèle en sautant les clôtures, et j'ai eu l'œil sur les coins et recoins peu fréquentés de la ferme, même si je ne savais pas toujours si Jonas ou Solomon travaillait dans tel ou tel champ aujourd'hui, ce qui ne me regardait pas. J'ai arrosé les myrtilles rouges, les cerises de sable et les orties, les pins rouges et les frênes noirs, les raisins blancs et les violettes jaunes, qui auraient pu se dessécher ailleurs pendant les saisons sèches.
Bref, j'ai continué longtemps, je peux le dire sans me vanter, à m'occuper fidèlement de mes affaires, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus évident que mes concitoyens ne m'admettraient pas dans la liste des fonctionnaires de la ville, ni ne feraient de ma place une sinécure avec une indemnité modérée. Mes comptes, que je peux jurer avoir tenus fidèlement, n'ont en effet jamais été vérifiés, encore moins acceptés, encore moins payés et réglés. Mais je n'y tiens pas.
Il n'y a pas longtemps, un Indien ambulant est allé vendre des paniers chez un avocat bien connu de mon quartier. "Il lui demanda : "Voulez-vous acheter des paniers ? "Non, nous n'en voulons pas", répondit l'Indien. "Quoi ? s'exclama l'Indien en sortant, vous voulez nous affamer ? Ayant vu ses laborieux voisins blancs si bien lotis, que l'avocat n'avait qu'à tresser des arguments, et que, par une sorte de magie, la richesse et la réputation s'ensuivaient, il s'était dit : Je vais me lancer dans les affaires ; je vais tresser des paniers ; c'est une chose que je peux faire. Il pensait que lorsqu'il aurait fabriqué les paniers, il aurait fait sa part, et qu'il appartiendrait alors à l'homme blanc de les acheter. Il n'avait pas découvert qu'il lui fallait faire en sorte que l'autre ait intérêt à les acheter, ou au moins lui faire croire que c'était le cas, ou fabriquer quelque chose d'autre qui aurait intérêt à ce qu'il l'achète. Moi aussi, j'avais tressé une sorte de panier d'une texture délicate, mais je n'avais pas fait en sorte que cela vaille la peine à quelqu'un de l'acheter. Je n'en estimais pas moins qu'il valait la peine de les tresser, et au lieu d'étudier comment faire en sorte que les hommes aient envie d'acheter mes paniers, j'étudiais plutôt comment éviter d'avoir à les vendre. La vie dont les hommes font l'éloge et qu'ils considèrent comme réussie n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pourquoi devrions-nous en exagérer une au détriment des autres ?
Constatant que mes concitoyens n'étaient pas susceptibles de m'offrir une chambre au palais de justice, une cure ou un logement ailleurs, mais que je devais me débrouiller seul, je me suis tourné plus exclusivement que jamais vers les bois, où j'étais mieux connu. Je décidai de me lancer immédiatement dans les affaires, sans attendre d'acquérir le capital habituel, en utilisant les maigres moyens dont je disposais déjà. Mon but en allant à Walden Pond n'était pas de vivre à bon marché ni de vivre cher, mais de traiter quelques affaires privées avec le moins d'obstacles possible ; être empêché d'accomplir ce qui, faute d'un peu de bon sens, d'un peu d'esprit d'entreprise et de talent commercial, ne me paraissait pas si triste que cela, mais insensé.
Je me suis toujours efforcé d'acquérir des habitudes commerciales strictes ; elles sont indispensables à tout homme. Si vous faites du commerce avec l'Empire céleste, une petite maison de comptage sur la côte, dans un port de Salem, sera suffisante. Vous exporterez les articles que le pays offre, des produits purement indigènes, beaucoup de glace et de bois de pin et un peu de granit, toujours dans des fonds indigènes. Ce seront de bonnes entreprises. Veiller personnellement à tous les détails, être à la fois pilote et capitaine, propriétaire et souscripteur, acheter, vendre et tenir les comptes, lire toutes les lettres reçues et écrire ou lire toutes les lettres envoyées, superviser le déchargement des importations nuit et jour, être sur plusieurs parties de la côte presque en même temps... Souvent, le fret le plus riche sera celui qui est le plus important ;-être son propre télégraphe, balayant inlassablement l'horizon, pour signaler tous les navires de passage qui se dirigent vers la côte ; assurer une expédition régulière de marchandises, pour approvisionner un marché aussi lointain et aussi exorbitant ; se tenir au courant de l'état des marchés, des perspectives de guerre et de paix partout, et anticiper les tendances du commerce et de la civilisation, en profitant des résultats de toutes les expéditions d'exploration, en utilisant les nouveaux passages et toutes les améliorations de la navigation ;-Il faut étudier les cartes, déterminer la position des récifs, des nouveaux feux et des bouées, et toujours, toujours, corriger les tables logarithmiques, car, par l'erreur de quelque calculateur, le navire se brise souvent sur un rocher qui aurait dû atteindre une jetée amie, et c'est là le sort incalculable de La Pérouse ;-Il faut suivre la science universelle en étudiant la vie de tous les grands découvreurs et navigateurs, de tous les grands aventuriers et marchands, depuis Hanno et les Phœniciens jusqu'à nos jours ; enfin, il faut faire de temps en temps le compte des actions pour savoir où l'on en est. C'est un travail qui mobilise les facultés d'un homme, tant les problèmes de profit et de perte, d'intérêt, de tare et de tret, et de jaugeage de toutes sortes, exigent une connaissance universelle.
J'ai pensé que Walden Pond serait un bon endroit pour les affaires, pas seulement à cause du chemin de fer et du commerce de la glace ; il offre des avantages qu'il n'est peut-être pas de bonne politique de divulguer ; c'est un bon port et une bonne fondation. Il n'y a pas de marais de la Neva à remplir, mais il faut partout construire sur des pilotis que l'on a soi-même construits. On dit qu'une marée d'inondation, avec un vent d'ouest et de la glace dans la Neva, balaierait Saint-Pétersbourg de la surface de la terre.
Comme cette entreprise devait être entreprise sans le capital habituel, il n'est peut-être pas facile de conjecturer où les moyens, qui seront toujours indispensables à toute entreprise de ce genre, ont été obtenus. Quant à l'habillement, pour en venir tout de suite à la partie pratique de la question, c'est peut-être plus l'amour de la nouveauté et le souci de l'opinion des hommes qui nous poussent à nous en procurer que l'utilité véritable. Que celui qui a du travail à faire se rappelle que l'objet des vêtements est, premièrement, de conserver la chaleur vitale et, deuxièmement, dans l'état actuel de la société, de couvrir la nudité, et il pourra juger de la quantité de travail nécessaire ou important qu'il peut accomplir sans ajouter à sa garde-robe. Les rois et les reines qui ne portent qu'une seule fois un costume, même s'il a été confectionné par un tailleur ou un couturier pour leurs majestés, ne peuvent pas connaître le confort d'un costume qui leur va bien. Ils ne valent pas mieux que des chevaux de bois sur lesquels on accroche les vêtements propres. Chaque jour, nos vêtements s'assimilent davantage à nous-mêmes, recevant l'empreinte du caractère de celui qui les porte, jusqu'à ce que nous hésitions à les mettre de côté, sans délai, sans appareil médical et avec une solennité comparable à celle de notre corps. Aucun homme ne s'est jamais abaissé dans mon estime parce qu'il avait des vêtements rapiécés ; pourtant, je suis sûr que l'on tient plus à avoir des vêtements à la mode, ou du moins propres et non rapiécés, qu'à avoir une bonne conscience. Mais même si le loyer n'est pas réparé, le pire vice trahi est peut-être l'imprévoyance. Je mets parfois mes connaissances à l'épreuve par des tests de ce genre : qui pourrait porter une pièce rapportée, ou deux coutures supplémentaires seulement, au-dessus du genou ? La plupart se comportent comme s'ils croyaient que leurs perspectives de vie seraient ruinées s'ils le faisaient. Il leur serait plus facile de se rendre en ville en clopinant avec une jambe cassée qu'avec un pantalon brisé. Souvent, si un accident arrive aux jambes d'un gentleman, on peut les réparer ; mais si un accident semblable arrive aux jambes de ses pantalons, il n'y a rien à faire ; car il ne considère pas ce qui est vraiment respectable, mais ce qui est respecté. Nous connaissons peu d'hommes, beaucoup de manteaux et de culottes. Si l'on habille un épouvantail dans son dernier costume, et que l'on reste là sans rien faire, qui ne saluerait pas l'épouvantail le plus tôt ? L'autre jour, en passant dans un champ de maïs, j'ai reconnu le propriétaire de la ferme à proximité d'un chapeau et d'un manteau accrochés à un piquet. Il était à peine plus abîmé par les intempéries que la dernière fois que je l'ai vu. J'ai entendu parler d'un chien qui aboyait contre tout étranger qui s'approchait de la propriété de son maître avec des vêtements, mais qui se calmait facilement devant un voleur nu. Il est intéressant de se demander dans quelle mesure les hommes conserveraient leur rang relatif s'ils étaient dépouillés de leurs vêtements. Pourriez-vous, dans un tel cas, citer une compagnie d'hommes civilisés qui appartiendrait à la classe la plus respectée ? Lorsque Madame Pfeiffer, dans ses voyages aventureux autour du monde, d'est en ouest, fut arrivée aussi près de chez elle que la Russie asiatique, elle dit qu'elle sentit la nécessité de porter autre chose qu'un vêtement de voyage, lorsqu'elle se présenta devant les autorités, car elle "se trouvait maintenant dans un pays civilisé, où les gens sont jugés d'après leurs vêtements". Même dans nos villes démocratiques de la Nouvelle-Angleterre, la possession accidentelle de richesses, et leur manifestation uniquement dans les vêtements et l'équipement, obtiennent pour leur possesseur un respect presque universel. Mais ceux qui inspirent un tel respect, aussi nombreux soient-ils, sont jusqu'à présent des païens et ont besoin qu'on leur envoie un missionnaire. En outre, les vêtements introduisent la couture, travail que l'on peut qualifier d'interminable ; la robe d'une femme, du moins, n'est jamais terminée.
Un homme qui a enfin trouvé quelque chose à faire n'aura pas besoin d'un nouveau costume pour le faire ; pour lui, le vieux fera l'affaire, celui qui est resté poussiéreux dans le grenier pendant une période indéterminée. Les vieilles chaussures serviront au héros plus longtemps qu'elles n'ont servi à son valet de chambre, si tant est qu'un héros ait jamais un valet de chambre ; les pieds nus sont plus vieux que les chaussures, et il peut les faire marcher. Seuls ceux qui vont dans les soirées et les salles législatives doivent avoir des manteaux neufs, des manteaux à changer aussi souvent que l'homme change dans ces manteaux. Mais si ma veste et mon pantalon, mon chapeau et mes chaussures sont propres à l'adoration de Dieu, ils feront l'affaire, n'est-ce pas ? Qui a jamais vu ses vieux vêtements, son vieux manteau, réellement usé, réduit à ses éléments primitifs, de sorte que ce n'était pas un acte de charité que de le donner à un pauvre garçon, pour qu'il le donne à un autre encore plus pauvre, ou disons plus riche, qui pourrait se contenter de moins ? Méfions-nous de toutes les entreprises qui exigent des vêtements neufs, et non pas plutôt un nouveau porteur de vêtements. S'il n'y a pas d'homme nouveau, comment les nouveaux vêtements peuvent-ils être adaptés ? Si vous avez une entreprise devant vous, essayez-la avec vos vieux vêtements. Tous les hommes veulent, non pas quelque chose à faire, mais quelque chose à faire, ou plutôt quelque chose à être. Peut-être ne devrions-nous jamais nous procurer un nouveau costume, même si l'ancien est délabré ou sale, jusqu'à ce que nous nous soyons tellement conduits, que nous ayons entrepris ou navigué d'une certaine manière, que nous nous sentions comme des hommes nouveaux dans l'ancien, et que le conserver reviendrait à garder du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Notre période de mue, comme celle des oiseaux, doit être une crise dans notre vie. Le plongeon se retire dans des étangs solitaires pour la passer. C'est ainsi que le serpent se débarrasse de son bourbier et la chenille de son manteau vermoulu, par une industrie et une expansion internes ; car les vêtements ne sont que notre cuticule et notre enveloppe mortelle. Sinon, nous naviguerons sous de fausses couleurs, et nous serons inévitablement mis à l'écart par notre propre opinion, ainsi que par celle de l'humanité.
Nous portons vêtement après vêtement, comme si nous nous développions comme des plantes exogènes par addition. Nos vêtements extérieurs, souvent minces et fantaisistes, sont notre épiderme, ou fausse peau, qui ne participe pas à notre vie et qui peut être enlevée ici et là sans blessure mortelle ; nos vêtements plus épais, constamment portés, sont notre tégument cellulaire, ou cortex ; mais nos chemises sont notre liber, ou véritable écorce, qui ne peut être enlevée sans ceinturer et donc détruire l'homme. Je crois que toutes les races portent en certaines saisons quelque chose d'équivalent à la chemise. Il est souhaitable qu'un homme soit vêtu si simplement qu'il puisse mettre la main sur lui-même dans l'obscurité, et qu'il vive à tous égards de façon si compacte et si préparée que, si un ennemi prend la ville, il puisse, comme le vieux philosophe, sortir de la porte les mains vides sans inquiétude. Alors qu'un vêtement épais est, dans la plupart des cas, aussi bon que trois vêtements minces, et que l'on peut se procurer des vêtements bon marché à des prix qui conviennent vraiment aux clients, un manteau épais peut être acheté pour la moitié de sa valeur ; Alors qu'on peut acheter pour cinq dollars un manteau épais qui durera autant d'années, pour deux dollars un pantalon épais, pour un dollar et demi une paire de bottes en peau de vache, pour un quart de dollar un chapeau d'été et pour soixante-deux cents et demi un bonnet d'hiver, ou mieux encore le fabriquer à la maison pour un prix symbolique, où est-il si pauvre que, vêtu d'un tel costume, qu'il a lui-même gagné, il ne se trouve pas de sages pour lui témoigner de la considération ?
Lorsque je demande un vêtement d'une forme particulière, ma couturière me dit gravement : "Ils ne les font plus ainsi maintenant", sans mettre l'accent sur le "Ils", comme si elle citait une autorité aussi impersonnelle que les Parques, et j'ai du mal à obtenir ce que je veux, simplement parce qu'elle ne peut pas croire que je pense ce que je dis, que je suis si imprudente. Lorsque j'entends cette phrase oraculaire, je suis un instant absorbé dans mes pensées, soulignant chaque mot séparément afin d'en saisir le sens, de découvrir par quel degré de consanguinité ils me sont apparentés et quelle autorité ils peuvent avoir dans une affaire qui me touche de si près ; et, finalement, je suis enclin à lui répondre avec le même mystère, et sans plus insister sur le "ils" : "Il est vrai qu'ils ne les ont pas faits ainsi récemment, mais ils les font maintenant." A quoi bon me mesurer si elle ne mesure pas mon caractère, mais seulement la largeur de mes épaules, comme s'il s'agissait d'une cheville pour accrocher le manteau ? Nous ne vénérons ni les Grâces, ni les Parcæ, mais la Mode. Elle file, tisse et coupe en toute autorité. Le chef des singes de Paris met une casquette de voyageur, et tous les singes d'Amérique font de même. Je désespère parfois de voir des choses simples et honnêtes se faire dans ce monde avec l'aide des hommes. Il faudrait d'abord les faire passer par une presse puissante pour leur extirper leurs vieilles notions, afin qu'ils ne se remettent pas vite sur leurs jambes, et puis il y aurait quelqu'un dans la compagnie avec un asticot dans la tête, éclos d'un œuf déposé là on ne sait quand, car même le feu ne tue pas ces choses-là, et vous auriez perdu votre travail. Néanmoins, nous n'oublierons pas que du blé égyptien nous a été transmis par une momie.
Dans l'ensemble, je pense qu'on ne peut pas dire que l'habillement ait atteint, dans ce pays ou dans un autre, la dignité d'un art. À l'heure actuelle, les hommes s'arrangent pour porter ce qu'ils peuvent obtenir. Comme des marins naufragés, ils s'habillent avec ce qu'ils trouvent sur la plage et, à une certaine distance, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, ils se moquent de la mascarade des uns et des autres. Chaque génération se moque des anciennes modes, mais suit religieusement les nouvelles. Le costume d'Henri VIII ou de la reine Élisabeth nous amuse autant que celui du roi et de la reine des îles Cannibales. Tout costume d'homme est pitoyable ou grotesque. Ce n'est que l'œil sérieux qui le regarde et la vie sincère qui s'y déroule qui retiennent le rire et consacrent le costume d'un peuple. Qu'Arlequin soit pris d'une crise de colique, et son costume devra aussi servir cette humeur. Lorsque le soldat est touché par un boulet de canon, les haillons sont aussi beaux que la pourpre.
Le goût enfantin et sauvage des hommes et des femmes pour les nouveaux modèles en fait trembler plus d'un et les fait loucher sur des kaléidoscopes pour découvrir la silhouette particulière dont cette génération a besoin aujourd'hui. Les fabricants ont appris que ce goût n'est que fantaisie. De deux modèles qui ne diffèrent que par quelques fils de plus ou de moins d'une couleur particulière, l'un se vendra facilement, l'autre restera sur l'étagère, bien qu'il arrive fréquemment qu'au bout d'une saison ce dernier devienne le plus à la mode. Comparativement, le tatouage n'est pas la coutume hideuse qu'on lui attribue. Il n'est pas barbare simplement parce que l'impression est à fleur de peau et inaltérable.
Je ne puis croire que notre système de fabrique soit le meilleur moyen pour les hommes de se vêtir. La condition des ouvriers se rapproche chaque jour davantage de celle des Anglais, et il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque, d'après ce que j'ai entendu dire ou observé, le but principal n'est pas que l'humanité soit bien et honnêtement vêtue, mais, incontestablement, que les sociétés s'enrichissent. À long terme, les hommes n'atteignent que ce qu'ils visent. Par conséquent, même s'ils échouent immédiatement, ils feraient mieux de viser haut.
Quant à l'abri, je ne nie pas qu'il soit aujourd'hui nécessaire à la vie, bien qu'il y ait des exemples d'hommes qui s'en sont passés pendant de longues périodes dans des pays plus froids que le nôtre. Samuel Laing dit que "le Lapon, vêtu d'une robe de peau et d'un sac de peau qu'il se met sur la tête et les épaules, dort nuit après nuit sur la neige, à un degré de froid qui éteindrait la vie de celui qui y serait exposé dans n'importe quel vêtement de laine". Il les a vus dormir ainsi. Mais il ajoute : "Ils ne sont pas plus robustes que les autres". Mais, probablement, l'homme n'a pas vécu longtemps sur la terre sans découvrir la commodité qu'il y a dans une maison, le confort domestique, expression qui a peut-être signifié à l'origine les satisfactions de la maison plus que celles de la famille ; bien que ces satisfactions doivent être extrêmement partielles et occasionnelles dans ces climats où la maison est associée dans nos pensées à l'hiver ou à la saison des pluies principalement, et où les deux tiers de l'année, à l'exception d'un parasol, ne sont pas nécessaires. Sous notre climat, en été, il s'agissait autrefois presque uniquement d'une couverture pour la nuit. Dans les gazettes indiennes, un wigwam était le symbole d'une journée de marche, et une rangée de wigwams découpés ou peints sur l'écorce d'un arbre signifiait qu'ils avaient campé autant de fois. L'homme n'a pas été fait si grand et si robuste qu'il doive chercher à restreindre son monde et à s'enfermer dans un espace qui lui convienne. Il fut d'abord nu et en plein air ; mais, bien que cela fût assez agréable par un temps serein et chaud, à la lumière du jour, la saison des pluies et l'hiver, sans parler du soleil torride, auraient peut-être tué sa race dans l'oeuf s'il ne s'était hâté de se vêtir de l'abri d'une maison. Adam et Eve, selon la fable, ont porté la tonnelle avant tout autre vêtement. L'homme avait besoin d'un foyer, d'un lieu de chaleur ou de confort, d'abord de chaleur physique, puis de chaleur affective.
Nous pouvons imaginer une époque où, dans l'enfance de la race humaine, un mortel entreprenant s'est glissé dans le creux d'un rocher pour s'y abriter. Chaque enfant recommence le monde, dans une certaine mesure, et aime rester à l'extérieur, même dans l'humidité et le froid. Il joue à la maison, comme au cheval, car il en a l'instinct. Qui ne se souvient pas de l'intérêt avec lequel, lorsqu'il était jeune, il regardait les rochers en saillie ou toute approche d'une grotte ? C'était le désir naturel de la partie de notre ancêtre le plus primitif qui a survécu en nous. De la grotte, nous sommes passés aux toits de feuilles de palmier, d'écorce et de branchages, de lin tissé et tendu, d'herbe et de paille, de planches et de bardeaux, de pierres et de tuiles. Enfin, nous ne savons pas ce que c'est que de vivre en plein air, et notre vie est domestique dans plus de sens que nous ne le pensons. De l'âtre au champ, il y a une grande distance. Il serait peut-être bon que nous passions plus de jours et de nuits sans obstacle entre nous et les corps célestes, que le poète ne parle pas tant sous un toit, et que le saint n'y demeure pas si longtemps. Les oiseaux ne chantent pas dans les grottes, et les colombes ne chérissent pas leur innocence dans les colombiers.
Toutefois, si l'on envisage de construire une maison d'habitation, il convient de faire preuve d'un peu de sagacité yankee, sous peine de se retrouver dans un asile, un labyrinthe sans queue ni tête, un musée, un hospice, une prison ou un splendide mausolée. Considérez d'abord à quel point un abri léger est absolument nécessaire. J'ai vu des Indiens Penobscot, dans cette ville, vivre dans des tentes de toile de coton mince, alors que la neige avait près d'un pied d'épaisseur autour d'eux, et j'ai pensé qu'ils seraient heureux de l'avoir plus profonde pour se protéger du vent. Autrefois, lorsque la question de savoir comment gagner ma vie honnêtement, tout en restant libre pour mes propres activités, me préoccupait encore plus qu'aujourd'hui, car malheureusement je suis devenu quelque peu insensible, j'avais l'habitude de voir une grande boîte près du chemin de fer, de six pieds de long sur trois de large, dans laquelle les ouvriers enfermaient leurs outils pendant la nuit, et je me suis dit que tout homme qui avait du mal à s'en procurer une pour un dollar, et qu'après y avoir percé quelques trous pour laisser passer l'air au moins, il pourrait y entrer quand il pleuvait et pendant la nuit, et accrocher le couvercle, et ainsi avoir la liberté dans son amour, et dans son âme, être libre. Cela ne semblait pas être la pire des solutions, ni même une solution méprisable. Vous pouviez veiller aussi tard que vous le souhaitiez et, dès que vous vous leviez, partir à l'étranger sans qu'aucun propriétaire ou logeur ne vous réclame un loyer. Beaucoup d'hommes sont harcelés à mort pour payer le loyer d'une boîte plus grande et plus luxueuse, alors qu'ils ne seraient pas morts de froid dans une boîte comme celle-ci. Je suis loin de plaisanter. L'économie est un sujet qui peut être traité avec légèreté, mais on ne peut pas en disposer ainsi. Une maison confortable pour une race rude et rustique, qui vivait principalement à l'extérieur, a été autrefois construite ici presque entièrement avec les matériaux que la nature mettait à leur disposition. Gookin, surintendant des Indiens soumis à la colonie du Massachusetts, écrit en 1674 : "Les meilleures de leurs maisons sont couvertes très proprement, serrées et chaudes, d'écorces d'arbres, détachées de leur corps à la saison où la sève est montée, et transformées en grands flocons, sous la pression de bois lourds, lorsqu'elles sont vertes..... Les plus modestes sont recouverts de nattes qu'ils fabriquent avec une sorte de jonc, et sont aussi indifféremment serrés et chauds, mais pas aussi bien que les premiers..... J'en ai vu qui mesuraient soixante ou cent pieds de long et trente pieds de large.... J'ai souvent logé dans leurs wigwams et je les ai trouvés aussi chauds que les meilleures maisons anglaises". Il ajoute qu'ils étaient généralement recouverts de tapis et garnis à l'intérieur de nattes brodées bien ouvragées, et qu'ils étaient équipés de divers ustensiles. Les Indiens étaient allés jusqu'à régler l'effet du vent au moyen d'une natte suspendue au-dessus du trou dans le toit et mue par une corde. Une telle hutte était d'abord construite en un jour ou deux tout au plus, puis démontée et remontée en quelques heures ; chaque famille en possédait une, ou son appartement.
Dans l'état sauvage, chaque famille possède un abri aussi bon que le meilleur, et suffisant pour ses besoins les plus grossiers et les plus simples ; mais je pense que je parle dans les limites du raisonnable quand je dis que, bien que les oiseaux du ciel aient leurs nids, les renards leurs trous, et les sauvages leurs wigwams, dans la société civilisée moderne, pas plus de la moitié des familles ne possèdent un abri. Dans les grandes villes, où la civilisation prévaut surtout, le nombre de ceux qui possèdent un abri est une très petite fraction de l'ensemble. Les autres paient une taxe annuelle pour ce vêtement extérieur de tous, devenu indispensable été comme hiver, qui permettrait d'acheter un village de wigwams indiens, mais qui contribue maintenant à les maintenir dans la pauvreté aussi longtemps qu'ils vivent. Je ne veux pas insister ici sur l'inconvénient de la location par rapport à la propriété, mais il est évident que le sauvage possède son abri parce qu'il lui coûte peu, tandis que l'homme civilisé loue son habitation parce qu'il n'a pas les moyens de la posséder, et qu'il ne peut pas non plus, à la longue, se permettre de la louer. Mais, répond l'un d'eux, en payant simplement cette taxe, le pauvre homme civilisé s'assure une demeure qui est un palais en comparaison de celle du sauvage. Un loyer annuel de vingt-cinq à cent dollars - ce sont les tarifs pratiqués à la campagne - lui permet de bénéficier des améliorations apportées au cours des siècles, d'appartements spacieux, d'une peinture et d'un papier propres, d'une cheminée Rumford, d'un crépi arrière, de stores vénitiens, d'une pompe en cuivre, d'une serrure à ressort, d'une cave spacieuse, et de bien d'autres choses encore. Mais comment se fait-il que celui dont on dit qu'il jouit de ces choses soit si souvent un pauvre homme civilisé, alors que le sauvage, qui ne les possède pas, est riche comme un sauvage ? Si l'on affirme que la civilisation est un progrès réel dans la condition de l'homme, - et je pense qu'elle l'est, quoique les sages seuls améliorent leurs avantages, - il faut prouver qu'elle a produit de meilleures habitations sans les rendre plus coûteuses ; et le coût d'une chose est la quantité de ce que j'appellerai la vie qui doit être échangée contre elle, immédiatement ou à la longue. Une maison moyenne dans ce quartier coûte peut-être huit cents dollars, et pour amasser cette somme, il faudra de dix à quinze ans de la vie de l'ouvrier, même s'il n'est pas chargé d'une famille ; - en estimant la valeur pécuniaire du travail de chaque homme à un dollar par jour, car si certains reçoivent plus, d'autres reçoivent moins ; - de sorte qu'il devra avoir passé plus de la moitié de sa vie communément avant que son wigwam soit gagné. Si nous supposons qu'il paie un loyer à la place, ce n'est qu'un choix douteux de maux. Le sauvage aurait-il été sage d'échanger son wigwam contre un palais à ces conditions ?
On peut deviner que je réduis presque tout l'avantage de détenir ces biens superflus comme un fonds en réserve pour l'avenir, en ce qui concerne l'individu, principalement à la prise en charge des frais d'obsèques. Mais peut-être qu'un homme n'est pas tenu de s'enterrer lui-même. Quoi qu'il en soit, il y a là une distinction importante entre l'homme civilisé et le sauvage ; et, sans aucun doute, ils ont des desseins sur nous pour notre bien, en faisant de la vie d'un peuple civilisé une institution