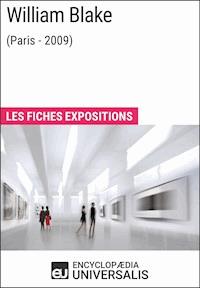
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
On a pu dire que le XVIIIe siècle avait autant été le siècle des Lumières que de l'illuminisme. Nul doute que William Blake (1757-1827) se situa du côté des illuminés, comme on le voit tout au long de l'exposition présentée au Petit Palais, en partenariat avec le musée de la Vie romantique...
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 33
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341010009
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Les grandes expositions sont l’occasion de faire le point sur l’œuvre d’un artiste, sur une démarche esthétique ou sur un moment-clé de l’histoire des cultures. Elles attirent un large public et marquent de leur empreinte l’histoire de la réception des œuvres d’art.
Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches exposition d’Encyclopaedia Universalis associent un compte rendu de l’événement avec un article de fond sur le thème central de chaque exposition retenue : - pour connaître et comprendre les œuvres et leur contexte, les apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause ; - pour se faire son propre jugement sous la conduite de guides à la compétence incontestée.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
William Blake (Paris - 2009)
On a pu dire que le XVIIIe siècle avait autant été le siècle des Lumières que de l’illuminisme. Nul doute que William Blake (1757-1827) se situa du côté des illuminés, comme on le voit tout au long de l’exposition présentée au Petit Palais, en partenariat avec le musée de la Vie romantique, du 2 avril au 28 juin 2009. Car s’il est quelqu’un pour qui l’art a coïncidé avec toutes les vérités de la religion, de la philosophie et de la tradition hermétique, ce fut bien lui. À la religion pharisienne de l’art moderne il fut étranger, tout comme il n’eut pas à résister à la tentation mercantile, son absence de sens pratique lui en ayant fait oublier jusqu’à l’existence, à la tentation satanique, dont il reconnaît les deux faces dans le puritanisme de Milton (Paradis perdu) et la cruauté de Dante (Divine comédie), ni enfin à la tentation narcissique (« Satan l’égoïsme personnifié »). Décidément, Blake n’est pas un moderne, sans négliger les leçons de l’antique, il ne les reproduit pas, pour la bonne raison qu’il rejette toute médiation, entrant en contact avec la chose en soi grâce à la reine des facultés : l’imagination, antagoniste de l’intellect (Urizen, le démiurge ainsi nommé par Blake) qui se prétend abusivement l’auteur de ce monde.
C’est donc un contresens que de voir en Blake un précurseur des modernes et du romantisme. Presque tout en lui contredit cette proposition. Il est « naïf », car s’exprime par lui une science infuse, il n’a rien de « sentimental », il ignore tout, en effet, de la réflexion et de la dialectique. Pour lui, le divorce entre le Beau et le Bon n’a jamais eu lieu, il ignore ce qu’est l’« ironie romantique » et, contrairement à son compatriote Hogarth, il estime que « les caricatures pervertissent l’œil ». Même s’il s’est enthousiasmé par la Révolution française, on ne saurait le faire passer pour un artiste politique, bien qu’il marquât une préférence pour les gouvernements ecclésiastiques. Quant à la reconnaissance qui taraude et ravage en général les artistes, il n’en connut rien, sans en souffrir, se contentant de l’assentiment qu’il se donnait à lui-même. Cette docilité du travailleur qui accepte une vie laborieuse de prolétaire était pour lui une soumission à Dieu. William Blake se voyait davantage en prophète et, contre toute vraisemblance, en maître entouré de disciples (les jeunes peintres Samuel Palmer, George Richmond et Edward Calvert), un souhait qui devait néanmoins être exaucé. Sans qu’on puisse véritablement le dire panthéiste, il faut remarquer que l’association quasi constante chez lui de la belle nature et du texte poétique, comme dans L’Amérique, prophétie





























